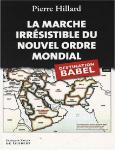/
Автор: Valle D.A. Soppelsa J.
Теги: religion sociologie economie politique soins de santé
ISBN: 978-2-81001-023-3
Год: 2021
Текст
Ouvrages des mêmes auteurs
Alexandre Del Valle
– Le Projet (L’Artilleur, 2019)
– La Stratégie de l’intimidation (L’Artilleur, 2018)
– Les vrais ennemis de l’Occident (L’Artilleur, 2016)
– Comprendre le chaos syrien (avec Randa Kassis, L’Artilleur, 2016)
– Le Complexe occidental (L’Artilleur, 2014)
– Pourquoi on tue des Chrétiens aujourd’hui dans le monde (Maxima, 2011)
– La Turquie dans l’Europe (Syrtes, 2004)
– Islamisme et Etats-Unis, une alliance contre l’Europe (L’Age d’homme, 2000)
Jacques Soppelsa
– Les sept défis capitaux du nouvel ordre mondial (A2C, 2009)
– Géopolitique du monde contemporain (en collaboration, Nathan, 2008)
– Les Etats-Unis. Une histoire revisitée (La Martinière – Seuil, 2004)
– Les dates clefs du dialogue régionale en Amérique latine (Ellipses, 2002)
– Géopolitique de l’Asie-Pacifique (Ellipses, 2001)
– Dix mythes pour l’Amérique (Ellipses, 1997)
– Léxique de géopolitique (Dalloz, 1997)
ISBN
: 978-2-81001-023-3
© 2021, Éditions de l’Artilleur / Toucan – éditeur indépendant
16 rue Vézelay – 75008 Paris
www.lartilleur.fr
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou
de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. »
Antonio Gramsci
« Nous sommes entrés dans un monde en transformation rapide qui présente de formidables opportunités, notamment technologiques. Mais ce monde est
aussi celui de l’incertitude et de l’instabilité, où le rapport de force redevient le mode de règlement des différends entre Nations. Le combat de haute
intensité devient une option très probable. »
Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée de terre française
SOMMAIRE
Titre
Ouvrages des mêmes auteurs
Copyright
Exergue
Prélude
Chapitre I - Déclin de l’Occident ?
Mondialisation américaine McWorld ?
La mondialisation, apogée ou crépuscule ?
Ventres mous civilisationnels versus ventres durs identitaires
Déclassement de l’Occident et mondialisation du virus
Les leçons de la gestion chinoise et asiatique de la crise sanitaire
L’Europe dupe de son interprétation utopique de la mondialisation
Désoccidentalisation, antiaméricanisme et rejet des institutions multilatérales héritées de 1945
Défis géopolitiques : constantes et variables
Les tendances lourdes
Variables contemporaines
Partie I - Les tendances lourdes
Chapitre II - La période contemporaine : ordre ou désordre ?
Djihad versus McWorld ?
Chapitre III - De la multiplication des conflits
Multiplication des conflits infra-étatiques internationalisés
Échec du multilatéralisme ?
Le conflit du Haut-Karabagh
Deux principes de légitimité s’opposent
Du rôle de la communauté internationale
Le retour de la guerre dans le Caucase
La Turquie est entrée en scène…
Les leçons de la guerre du Haut-Karabagh
Le spectre d’une guerre interétatique entre l’Ukraine et la Russie
Stratégies et buts de guerres de part et d’autre
Taiwan : vers un affrontement direct Chine-États-Unis ?
La « surreprésentation » des conflits intraétatiques
Trente-sept conflits ouverts en cours aujourd’hui
La zone Sahel devenue une des plus létales au monde…
L’incessant conflit du Cachemire entre Inde et Pakistan
La multiplication des tensions et conflits locaux en Asie
La Chine à l’assaut de la mer de Chine méridionale
L’aberration géopolitique de la question nord-coréenne
La superpuissance montante et revancharde chinoise
Un monde d’incertitudes, de risques asymétriques et de retour des conflits de haute intensité
Chapitre IV - De l’ancienne à la nouvelle guerre froide ?
L’Europe, théâtre de guerre nucléaire entre États-Unis et Russie ?
L’occasion manquée de l’alliance russo-occidentale (1999-2003)
La rupture stratégique des années 2003-2005
La Russie, une menace plus grande que le terrorisme islamiste pour les atlantistes…
L’OCS, ou l’alliance « antihégémonique » russo-chinoise redoutée par Brzezinski
Chapitre V - … ou désordre mondial multipolaire ?
Fractures internes et externes
Le monde n’appartiendra plus à personne…
La stratégie du collier de perles
Outsiders, émergents, Brics, acteurs de la désoccidentalisation du monde
Inexorable montée en puissance de l’hégémon chinois
Patriots vs McWorldists ?
L’Europe : « impuissance volontaire » et dindon de la farce de la mondialisation ?
Un objet « géopolitique non identifié » et postcivilisationnel
Rejet de l’occidentalisation et de la domination américaine
Monde multipolaire ou polycentrique
Désoccidentalisation de la mondialisation marchande et technologique
La région Asie, nouveau phare du monde
Chapitre VI - Géopolitique linguistique : le français vecteur multipolaire ?
L’emprise de l’anglo-américain
Le paradoxe québécois
Francophonie avec un grand F : l’Organisation internationale de la francophonie
Partie II - Variables contemporaines
Chapitre VII - Islamisme et terrorisme mondialisés
De quoi parle-t-on au juste ?
Les pôles majeurs du totalitarisme vert : de l’islamisme institutionnel au djihadisme
L’erreur occidentale et atlantiste des alliances contracivilisationnelles
État des lieux et stratégies du djihadisme
Une menace asymétrique à la fois exogène et endogène
Djihadisme low cost ubérisé
Situation actuelle/future de Daesh/al-Qaida
Daesh n’est pas mort
Daesh conserve un trésor de guerre et de dizaines de milliers de combattants djihadistes
Al-Qaida redevenue la plus puissante organisation terroriste
L’Asie du Sud, nouvel horizon des centrales djihadistes
Le djihadisme en pleine ascension au Sahel
Les islamistes ont une vraie stratégie, contrairement à leurs ennemis et à l’Occident…
Nomades musulmans peuls fuyant la désertification en razziant les sédentaires du Sud : un double mouvement de fond climatique et
civilisationnel
Extension du domaine du djihadisme : de la Somalie à l’Afrique australe
Le terrorisme islamiste : guerre psychologique et propagande par l’action
Les cerveaux djihadistes recrutent des délinquants pour leur aptitude à la violence
L’efficacité de la stratégie de l’intimidation
Le continuum djihadisme-islamisme et le chantage à l’islamophobie
La vulnérabilité des sociétés démocratiques et multiculturelles
Chapitre VIII - Prolifération nucléaire et aléas du désarmement
Des origines du nucléaire militaire à l’échec des traités de désarmement et de non-prolifération
Les conséquences géopolitiques de l’atome
Bouleversement des hiérarchies militaires étatiques classiques
Le « club nucléaire »
La prolifération nucléaire
Le cauchemar du « terrorisme nucléaire »
Quid de l’Iran ?
Le commerce des armes à l’heure du système postbipolaire
Contrôle des armements ? Désarmement ?
Le maigre bilan de décennies de désarmement
Les accords bilatéraux de Salt I et Salt II
La période 1985-2020 : du contrôle des armements au concept de désarmement, Start I, Start II, Start III et New Start
Les traités multilatéraux
Relance de la course aux armements sur fond de néoguerre froide…
Chapitre IX - Le crime organisé : grand gagnant de la mondialisation !
Blanchiment : la mondialisation financière et le capitalisme dérégulé, des opportunités pour le crime organisé
Le trafic de drogue, entreprise presque aussi lucrative que le pétrole !
Le trou noir narco-islamiste afghan
Géographie du crime organisé
Mafias italiennes
Mafias albanaises
Les cartels d’Amérique centrale
Mafias russophones
Mafia nigériane
La France, les quartiers de non-droit ou la loi des caïds
Drogue et terrorisme : la face cachée mafieuse de Daesh et al-Qaida
Trafic d’êtres humains et prostitutions : esclavage des temps modernes
L’incroyable business de l’immigration clandestine
Les passeurs de clandestins, à la pointe du marketing digital et de la mondialisation…
Trafic d’organes
Trafic d’espèces sauvages et braconnage
Contrefaçon et mondialisation marchande
Trafics d’armes
L’arrivée sur le marché des armes 3D… La 5G sera un casse-tête sécuritaire
Cybercriminalité et Darknet
Les criminels profitent de la crise sanitaire !
Chapitre X - Géopolitique écoénergétique, guerres du gaz et guerres de l’eau…
La menace du réchauffement climatique et de ses conséquences
Les climatosceptiques en question
Les éléments de préoccupation s’accumulent
L’accord de Paris, enjeux de rivalités de leadership entre nations
Transition énergétique et croissance économique : l’ultrapolarisation du débat aux États-Unis
Vers une « civilisation écologique », le nouveau leitmotiv de Xi Jinping
Le projet chinois de « croissance verte », aux antipodes de la décroissance des écolos européens : un autre grand déclassement en cours…
Vers un nouveau paradigme écoénergétique
Depuis la COP 21, les tentatives de résurgence de l’Ancien Monde paraissent peu à peu s’éloigner…
Pétrole et gaz de schiste et filières nucléaires, les énergies renouvelables n’ont pas encore gagné la partie…
Les gazoducs russo-européens, des épines dans le pied pour l’hégémon américain…
Le nucléaire : énergie de tous les dangers pour certains, solution de décarbonation pour d’autres…
La Chine une fois de plus leader dans le domaine
L’enjeu géoéconomique majeur des terres rares, la Chine toujours no 1
Les terres rares, clé des énergies renouvelables, mais désastre pour l’environnement…
Stress hydrique et barrages : les guerres de l’eau en question
Quelques chiffres
Le contrôle des rivières, mers et océans, source de conflits
Guerres de l’eau entre la Turquie et ses voisins
La Turquie à l’assaut des réserves de gaz et de pétrole de Méditerranée orientale
Conflit avec Chypre et la Grèce
Conflit avec l’Égypte autour de la Méditerranée et de la Libye
De l’Asie centrale au Golfe arabo-persique
La Chine à la conquête de la puissance maritime et des ressources subaquatiques
Partie III - Nouveaux défis
Chapitre XI - Les défis démographiques
1/ L’explosion démographique. De quelques chiffres édifiants
Explosion de la population mondiale
Le déséquilibre démographique international
L’hiver démographique des Occidentaux et d’une partie de l’Asie ?
Russie, trop grande trop vide…
La démographie, un facteur critique pour l’alimentation
Relativisons les chiffres catastrophiques
Démographie et Inégalités
2/ Les migrations internationales
« Préparez Venus viendra Mars… »
Les conséquences sociopolitiques et géocivilisationnelles de l’immigration
Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Le droit d’asile, principal prétexte à la migration clandestine
Le tabou du coût de l’immigration
Pause migratoire ?
Chapitre XII - Puissances multinationales et digitales face aux États souverains
La puissance des firmes multinationales
Délocalisation, fiscalité avantageuse et comportements parfois criminels
Les Gafam en question… ou l’économie virtuelle à l’assaut du monde ancien
La puissance financière, politique et technologique démesurée des Gafam
Multinationales prédatrices et capitalisme ubérisé : l’émergence d’un nouveau sous-prolétariat
Le bras de fer entre les cryptomonnaies et les États
Liberté individuelle, espionnage
Les Gafam, danger pour les États… sauf pour les deux hyperpuissances qui les ont créés…
Réseaux sociaux, entre trop grande liberté et néocensure très orientée…
Oligopole des Gafam face au Big Brother chinois des « BATX »
La guerre froide sino-américaine et l’enjeu géoécomique majeur de la 5G
« Le Yalta des mondes digitaux »
La nationalisation des moyens d’information
Chapitre XIII - Crise sanitaire et biotech, l’Europe déclassée ?
État des lieux et chiffres
La crise économique est une crise sanitaire
Géopolitique de la Covid-19
L’endettement colossal et le spectre d’une banqueroute de l’économie mondialisée
La France et l’Europe au bord de la faillite ?
Explosion de la dette et risque d’implosion de l’euro
Perdants et gagnants de la crise sanitaire
Biotech, ordinateurs quantiques, thérapies génétiques : la Chine et l’Asie en voie de déclasser l’Occident ?
Nanotechnologies
Physique et Internet quantique
Médecine régénérative et édition génomique
Chapitre XIV - Démondialisation ou désoccidentalisation de la mondialisation ?
Postmondialisation ?
Ralentissement de la mondialisation chinoise et postmondialisation régionalisée
De la troisième vague de mondialisation à la démondialisation
Doublement du commerce extérieur en valeur, mais augmentation très modérée du taux d’importation
Des échanges de services demeurés localisés
Le retour du bilatéralisme, reflux des investisseurs internationaux et reréglementation financière
Reréglementation financière, effets du Brexit et renationalisations tous azimuts
Monétisation et nationalisation de la dette publique
Flottement des changes et retour au contrôle des changes
L’arrêt durable des voyages d’affaires et du tourisme de masse
Conclusion - Gouverner c’est prévoir, le désordre actuel était prévisible…
Cartes géopolitiques
Bibliographie des ouvrages cités
Index des noms propres
Remerciements
Prélude
Cet ouvrage a été écrit à quatre mains, par deux géopoliticiens appartenant à deux générations successives, mais
complémentaires. La mienne a été en quelque sorte pionnière, lorsque, avant même d’être nommé président de
l’Université de Paris Panthéon Sorbonne (1982-1989), à une époque où la géopolitique n’était pas à la mode, je fus
titulaire, en 1978, de la première chaire de Géopolitique, recréée en Sorbonne, après des décennies de mise à l’écart
d’une discipline bafouée par les errements de Karl Haushoffer et de ses disciples... Vingt-deux ouvrages et des
années plus tard, je me félicite du fait que notre discipline soit désormais en odeur de sainteté et « démocratisée »,
même si l’on peut déplorer des usages parfois intempestifs du terme par des journalistes. Parallèlement aux travaux
d’Yves Lacoste, puis, un peu plus tard, à ceux de Michel Korinmann, de François Thual ou de Pascal Lorot, et dans
le sillage du général Pierre Marie Gallois, nous fûmes en quelques sorte des pionniers de l’école française de
géopolitique, aujourd’hui écoutée ailleurs dans le monde, notamment en Italie ou aux Etats-Unis.
La génération d’Alexandre del Valle, auteur prolixe, que j’ai suivi depuis ses premières publications, assure la
relève. Et c’est dans cet esprit intergénérationnel et de complémentarité, que j’ai eu l’idée d’écrire avec lui, en
novembre dernier, le présent ouvrage. J’avais d’ailleurs envisagé au départ de l’intituler Le nouveau désordre
mondial, mais le texte a évolué aux cours des mois et de nos échanges, à l’image de la démarche géopolitique faite
de constantes et de variables, au point d’aborder des domaines et pistes d’étude au départ non envisagés. Del Valle
figure depuis de nombreuses années aux tous premiers rangs de cette nouvelle génération de géopoliticiens qui n’a
guère à rougir de la comparaison avec son homologue anglo-saxonne. Souhaitons ainsi que notre collaboration
contribue, aux yeux de ses lecteurs, à l’intérêt de cet ouvrage.
Au-delà de la géopolitique, c’est aussi un même lien d’amitié avec le personnage hors pair qu’était Pierre-Marie
Gallois, l’un des grands de cette discipline, qui a achevé de nous convaincre de commettre ensemble ce manuel de
géopolitique engagé. Nous dédions La Mondialisation dangereuse à ce stratège de renommée mondiale admiré par
des personnalités aussi illustres et différentes que Jean-Pierre Chevènement ou Henri Kissinger, lequel venait le
consulter à Paris. Gallois nous a beaucoup transmis. Il venait d’ailleurs de la génération d’avant la mienne : il avait
connu les deux guerres mondiales. Sa carrière de militaire, fut hors-norme (officier-pilote, résistant engagé dans la
Royal Air Force contre l’Allemagne nazie, stratège et conseiller de Charles De Gaulle, père de la force de frappe
nucléaire française, impliqué dans le programme nucléaire israélien) et son parcours intellectuel, tout d’abord au
sein de la revue créée à Londres par Raymond Aron sur demande de De Gaulle, La France Libre, puis comme
enseignant de géopolitique et de stratégie à l’OTAN et à l’Ecole de Guerre, puis, bien sûr comme essayiste, fut
1
exceptionnel. Ses ouvrages remarqués sur les folles aventures militaires des Etats-Unis en ex-Yougoslavie et en
Irak nous inspirent encore. Dans les années 1990, alors qu’il écrivait son oeuvre, il échangeait régulièrement avec
nous, à son domicile de la rue Rembrandt, à Paris, comme à l’Institut international de géopolitique de Marie France
Garraud. Jusqu’au soir de sa vie, il garda son extraordinaire perspicacité quant à l’évolution du monde. Lucide
jusqu’au pessimisme, mais jamais passéiste ou dépassé, ce polyglotte au savoir encyclopédique portait un regard
sans concession sur l’évolution de la France, de l’Europe, de l’Occident et du monde. Il entrevoyait le désordre
mondial en devenir ; le processus inexorable de la multipolarisation de l’échiquier mondial post-Guerre froide et de
sa désoccidentalisation ; la montée de la Chine et des puissances émergentes et ou revanchardes d’Asie et du Sud ; le
péril de l’islamisme radical, longtemps encouragé par les Occidentaux, surtout américains ; les effets paradoxaux et
dangereux d’une nucléarisation militaire mondiale désormais hors de contrôle, de surcroît accélérée par la nouvelle
guerre froide Occident-Russie qu’il déplorait. Il redoutait aussi les revers de la mondialisation marchande anglosaxonne, objet central de ce livre, tout aussi incontrôlable et de plus en plus subvertie par la Chine au détriment des
dindons de la farce ouest-européens, et il déplorait le processus de dévalorisation de l’intérêt général et du sens
national, phénomène de société purement occidental qui promettait, selon lui, nos vieilles sociétés ouest-
européennes au déclin, qu’il nommait la « sortie de l’Histoire ». Gageons qu’il ait péché par excès de pessimisme...
Jacques Soppelsa
1. Géopolitique : Les Voies de la Puissance, Paris, Plon, 1990 ; La France sort-elle de l’histoire ? Paris, L’Age d’Homme, 1999 ; Le Sang du
pétrole, les guerres d’Irak, 1990-2003, Paris, L’Age d’Homme, 2002 ; L’heure fatale de l’Occident, Paris, L’Âge de l’Homme, 2004.
CHAPITRE I
Déclin de l’Occident ?
« Chaque culture traverse les phases évolutives l’homme en particulier. Chacune a son enfance, sa jeunesse, sa
maturité et sa vieillesse. »
Oswald Spengler,
Le Déclin de l’Occident (1918)
1
Spengler avait-il raison ? Dans son essai Le Déclin de l’Occident , le philosophe allemand, adepte d’une vision
des civilisations marquées par des phases d’expansion, d’apogée et de chute, annonçait le déclin de l’Occident au
moment même de son zénith. Les Européens étaient les maîtres incontestés du monde, de la science, de la
technologie, des échanges et de l’industrialisation. Le paradoxe n’est qu’apparent, car l’expansion et le progrès ne
sont jamais des acquis définitifs et ils peuvent précéder des processus d’involution et de régression. En dépit de son
déterminisme historique, Spengler avait pressenti il y a un siècle que l’Occident – alors encore colonial – allait être
détrôné, rongé qu’il était déjà de l’intérieur par des doutes existentiels qui allaient en faire une civilisation
complexée. Beaucoup se réfèrent encore à lui parmi les déclinistes pour annoncer le déclassement de la vieille
Europe, freinée par sa réticence à employer le hard power, sa culpabilisation civilisationnelle, son formalisme
juridico-constitutionnel, ses scrupules moraux qui l’empêchent d’engager une politique de puissance, comme on le
constate depuis les années 2010 vis-à-vis de la Turquie conquérante d’Erdoğan. Les Européens brillent d’ailleurs de
plus en plus par leur absence un peu partout dans le monde, si l’on met de côté les cas de la France et de la GrandeBretagne.
Si l’on s’interroge sur l’état actuel de l’Occident, on constate un lien évident entre ce qu’a annoncé Spengler et
les conséquences de la mondialisation qui, dans sa lecture sans frontiériste, implique un effacement des identités et
du principe même de souveraineté. Presque cent ans plus tard, à l’analyse de Spengler fait étonnamment écho le
positionnement décomplexé des puissances du nouveau monde multipolaire comme la Russie de Vladimir Poutine,
la Turquie de Recep. Tayyip Erdoğan, l’Inde de Narendra Modi, et, bien sûr, la Chine de Xi Jinping, qui semble
incarner le contre-modèle – autoritaire, certes – le plus efficace face au système libéral-démocratique occidental. Ces
puissances, qui voient, à tort ou à raison, l’Occident impérial comme une civilisation déclinante et décadente, sont
toutes souverainistes donc aux antipodes de l’universalisme occidental. De ce point de vue, la mondialisation,
comprise par les élites américaines et ouest-européennes comme le triomphe de leur idéologie planéto-libertaire
devant nécessairement déboucher sur la fin des identités, peut être analysée comme une dernière phase d’un
processus « morphologique » de disparition civilisationnelle pour paraphraser Spengler. Ceci conduit surtout la
vieille Europe à délégitimer la puissance souveraine et sa propre identité au nom d’une vision internationaliste qui
est non seulement vouée à l’échec, mais qui ne peut qu’accentuer la propension des autres civilisations à haïr
l’Occident, dont l’Union européenne apparaît comme le ventre mou voué à servir les intérêts de l’Empire angloaméricain.
De fait, le déclin de l’Occident complexé semble plus concerner, aujourd’hui, le Vieux Continent que les ÉtatsUnis, lesquels n’ont pas renoncé à la recherche de la puissance et de l’hégémonie, et investissent bien plus que les
Européens dans l’innovation, la R&D, les applications, le soft power et la puissance militaire. Toutefois, la fracture
croissante au sein de la société américaine qui oppose – jusqu’au risque de nouvelle guerre civile – l’Amérique
WASP judéo-chrétienne européenne conservatrice, d’une part, à l’Amérique-monde démocrate, multiculturaliste, de
l’autre, montre que la puissance étatsunienne elle-même peut être prise au piège de sa propre doxa planétariste.
Notre diagnostic est que si cette idéologie de la mondialisation (McWorld) a été mise en œuvre au départ par
l’hyperpuissance américaine pour asseoir sa domination planétaire en détruisant la souveraineté et les traditions
culturelles des autres nations – mais pas la sienne ! –, ses effets en termes de déstructuration et d’hétérogénéisation
identitaire s’avèrent à terme subversifs, y compris pour ses créateurs américains, désormais incapables de contrôler
leur Golem. C’est là tout le problème « géocivilisationnel » de l’Occident.
Mondialisation américaine McWorld ?
Si la mondialisation marchande à l’anglo-saxonne s’est faite au détriment d’autres types de capitalismes
(modèles scandinave, germano-français ou méditerranéen), c’est parce qu’elle a été lancée dans sa forme nouvelle,
depuis les années 1990, par l’Empire américain et favorisée par son immense puissance de frappe financière, puis sa
domination politico-stratégique, culturelle et économique sur la vieille Europe, d’ailleurs reconstruite à cette
condition après la Seconde Guerre mondiale. La mondialisation marchande et consumériste, telle que nous la
connaissons depuis la fin de la guerre froide, fort opposée aux précédentes mondialisations préindustrielles
(mongolo-chinoise, vénitienne, génoise, portugaise ou hollandaise), est en fait une projection vers l’extérieur d’un
modèle anglo-saxon capitaliste largement inspiré par les dérégulations néolibérales thatchérienne et reaganienne des
années 1980 (chapitre IV). Elle a longtemps profité essentiellement aux intérêts planétaires de l’empire
multiculturaliste américain piloté par le camp démocrate – aujourd’hui en guerre contre les souverainistes
trumpistes – et aux multinationales qui portent ce modèle. La culture que ces puissances multinationales et digitales
anglo-saxonnes venues des États-Unis diffusent (voir chapitre XII) est fondée sur le fast-food, le fast fashion, le
mimétisme des stars de la pop ou d’Hollywood, l’ubérisation et la déhiérarchisation du travail, puis le fast thinking
du politically correct, de la cancel culture, des revendications des minorités (positive discrimination, woke, BLM)
portées à leur paroxysme dans les milieux universitaires et médiatiques, les séries de Netflix ou les réseaux sociaux
des Gafam. Cependant, si l’on met à part le cas des sociétés musulmanes en voie de réislamisation radicale
(chapitre VII), deux États-nations du monde multipolaire offrent une résistance farouche à ce modèle de
mondialisation à l’anglo-saxonne baptisée McWorld par le politologue américain Benjamin Barber, et appellent les
autres nations émergentes ou multipolaristes à réhabiliter des modèles géocivilisationnels enracinés qui remettent
totalement en question l’internationalisme américano-occidental : la Russie et la Chine. Si Pékin s’oppose à
McWorld en désoccidentalisant la mondialisation et en la retournant contre les États-Unis pour asseoir la domination
mondiale du modèle autoritaire chinois antioccidental, Moscou accuse la mondialisation anglo-saxonne et les ÉtatsUnis de détruire les identités nationales et de menacer la souveraineté russe et sa civilisation slavo-orthodoxe. La
Russie postsoviétique et poutinienne se présente même comme le dernier rempart face au déracinement opéré par
McWorld et le seul pôle – multipolaire – de défense de l’Europe et des traditions judéo-chrétiennes face à une
mondialisation atlantiste et marchande aux mains de l’Empire américain (chapitre V). Dans le même temps, le
monde musulman remet frontalement en cause le libertarisme occidental jugé pervers et déstructurant pendant que
les nations émergentes du Sud, notamment l’Inde, aux mains des adeptes du radicalisme hindoutva du parti BJP au
pouvoir, le Brésil de Jair Bolsonaro ou les nations d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, allient toutes leur
développement à une fierté civilisationnelle et nationaliste.
La mondialisation, apogée ou crépuscule ?
Pour les adeptes d’une vision idéaliste de la politique mondiale, la globalisation libérale conduirait
inéluctablement à la fin des égoïsmes nationaux, à l’avènement de la paix universelle, et ne pourrait que renforcer de
façon linéaire le processus de démocratisation et d’unification de la planète au profit d’un multilatéralisme pacifiant,
voire d’une gouvernance mondiale. Cette idéologie de la « mondialisation heureuse », notamment portée par des
2
penseurs libéraux comme Alain Minc , Thomas Friedman (La Terre est plate), ou néo-hégéliens comme Francis
Fukuyama, est aujourd’hui largement remise en question par le fait que conflits et guerres n’ont pas disparu, que la
pauvreté et les inégalités progressent et que des pans entiers de la planète demeurent exclus de la digitalisation.
D’après le géographe John Agnew, la mondialisation pousserait inéluctablement à l’effacement des identités et
des nations. Selon lui, cinq tendances à l’œuvre depuis la fin de la guerre froide, pas forcément toujours vertueuses,
seraient inévitables : l’effacement des identités nationales et ethniques à la suite de l’intensification des flux
migratoires ; les inégalités croissantes conduisant à l’élargissement du fossé Nord-Sud ; la « métropolisation »
comme moteur de la croissance économique mondiale ; la montée du supranationalisme au détriment des
souverainetés des États-nations et la globalisation de la production et des mouvements financiers qui modifieraient
3
et affaibliraient les marges de manœuvre économiques des États . D’autres, notamment le politologue Bertrand
Badie en France, ont développé cette thèse dans le sens d’une « désouverainisation » et donc d’une réduction de la
puissance de l’État déclassé dans son ancien statut d’acteur majeur des relations internationales au profit
d’organisations internationales, des multinationales et des firmes digitales qui annoncent l’avènement du capitalisme
ubérisé et du multilatéralisme.
Le présent essai prend le contre-pied de cette lecture idéologique de la mondialisation, car en tant que théâtre
d’échanges, de rivalités et de conflits entre puissances, la mondialisation, processus en réalité neutre, peut favoriser
l’expansion de puissances hégémoniques, souverainistes ou même néo-impériales qui savent la canaliser, comme les
deux supergrands chinois et étatsunien, notamment. Notre analyse prend acte de l’essoufflement d’une idéologie qui
se heurte de plein fouet au réel et dont les promoteurs et protagonistes (institutions internationales, multinationales,
Gafam, dirigeants des pays occidentaux) sont de plus en plus remis en cause par les États-nations et les peuples,
demandeurs de « resouverainisation » et donc de démondialisation. Notre thèse soutient que le processus de
mondialisation n’a pas abouti à la disparition des identités et des États, car il intensifie avant tout une concurrence
entre États, seuls ceux qui ne savent pas en tirer profit ou ne sont pas assez performants ou volontaires perdent de
leur puissance souveraine. La mondialisation désigne en fait simplement le processus d’interconnexion à l’échelle
planétaire des affaires et des communications qui s’est accéléré avec la fin de la guerre froide et l’ouverture des
anciens pays communistes à la liberté de circulation des biens, des informations et des personnes. Il s’agit là d’une
prolifération mondiale de technologies de pointe qu’il convient de ne pas confondre avec les utopies cosmopolites
liées aux projets de conquête mondiale qui ont toujours existé dans l’histoire (Alexandre le Grand, Empire mongol,
communisme soviétique, etc.) avec souvent peu de durabilité en raison de leur caractère coercitif, générateur de
réactions antihégémoniques (Brzezinski). Dans la mesure où cette vision a été essentiellement conçue et portée au
départ par des pays occidentaux, la mondialisation est par ailleurs souvent perçue par d’autres civilisations, qui
forment les quatre cinquièmes du globe, comme un avatar de l’impérialisme occidental.
Dans son ouvrage La Revanche de la géographie, le politiste américain Robert D. Kaplan explique que cette
mondialisation, loin de supprimer les identités lorsqu’elle affaiblit l’État, peut au contraire les réveiller, et même les
radicaliser en réaction : « Le pouvoir né de la communication de masse […], les technologies de communication, ont
permis la montée en puissance des mouvements panislamiques, de l’Afrique noire à l’Asie, et elles ont facilité les
4
soulèvements populaires dans de nombreux États musulmans . » Cette idée est présente également dans les analyses
de Samuel Huntington, pour qui la mondialisation et Internet n’ont pas fait disparaître les identités des peuples, mais
ont permis a contrario à ces derniers d’accéder à une « conscience civilisationnelle » déterritorialisée et plus large,
de sorte qu’un exilé serait aujourd’hui bien plus lié à son pays d’origine et s’assimilerait bien moins facilement à la
société d’accueil qu’avant l’ère des télécommunications où les émigrés étaient coupés de leur milieu d’origine par
les lois de la géographie. De ce point de vue, la mondialisation – au sens neutre et technologique et non politique du
terme – n’empêche pas les appartenances de compter dans les dispositifs politiques et géopolitiques. Elle favoriserait
même la constitution de pôles géoéconomiques et civilisationnels : accords de libre-échange du nord de l’Amérique
o
5
(Alena, voir cartes n 3 et 4 ), Union européenne et AELE, Communauté des États indépendants et Union
6
économique eurasiatique (ex-URSS), OCS (Organisation de la conférence de Shanghai qui réunit Russie, Chine et
o
o
quatre pays d’Asie centrale opposés à l’Otan, voir carte n 3), pays de l’Est asiatique (Asean, Apec, voir cartes n 3
et 4), Conseil turcique, qui réunit cinq États turcophones : Turquie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan et
o
Kirghizstan (voir carte n 11), monde islamique (cinquante-sept pays musulmans de l’OCI, Ligue islamique
7
o
mondiale), zones de libre-échange latino-américaines et interafricaines . Les blocs géoéconomiques (voir carte n 2),
ethnoreligieux, les particularismes, les séparatismes et les conflits identitaires sont en fait encouragés par la
globalisation, de ce fait régionalisée, tandis que le côté « unificateur » universaliste de cette dernière ne touche que
les intelligentsias occidentales mondialisées. On ne rappellera d’ailleurs jamais assez que l’ensemble des puissances
émergentes/réémergentes du monde non occidental (Russie, Chine, Inde, Brésil, pays émergents, non alignés), donc
multipolaire, n’a pas du tout renoncé aux souverainetés et identités nationales, ni aux politiques de puissance qui
sont présentées comme un mal absolu par l’Union européenne. Bien au contraire. Totalement opposés à la
gouvernance occidentale, les adeptes du multipolarisme revendiquent un ordre mondial décentralisé fondé sur
l’autonomie, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun et le rejet de l’universalisme occidental
considéré comme un masque d’une nouvelle forme d’impérialisme arrogant et hypocritement moralisateur (droits de
l’homme, politiquement correct, pandémocratisme, etc.). La mondialisation n’affaiblit donc que les États déjà
amoindris et/ou démissionnaires de leur souveraineté. Elle renforce au contraire les États stratèges adeptes de la
Realpolitik et de la guerre économique qui cherchent à instrumentaliser la mondialisation vue comme un levier de
concurrence et d’expansion de leurs puissances. La Chine est à cet égard l’exemple parfait de cette vision
antimondialiste et souverainiste de la globalisation.
Ventres mous civilisationnels versus ventres durs identitaires
Le lien entre géopolitique et identité constitue l’un des fils rouges du présent ouvrage. Nous postulons que les
nations ou les civilisations qui diluent leurs identités au nom de la mondialisation et du multilatéralisme renoncent
de ce fait, tôt ou tard, à leur puissance et à leur souveraineté et mettent ainsi en péril leur avenir d’un point de vue
géocivilisationnel. Schématiquement, on peut diviser l’échiquier géopolitique mondial en deux catégories d’acteurs.
La première est composée de puissances souverainistes qui s’appuient sur leur identité civilisationnelle et défendent
leurs intérêts nationaux et qui voient la mondialisation comme un champ d’expansion de puissances rivales ou
antagonistes. Cette catégorie comprend notamment des nations émergentes et identitaires caractérisées par une
croissance économique soutenue et un activisme sur la scène internationale. On trouve parmi celles-ci entre autres la
Chine, la Russie, l’Inde, la Turquie, les émergents du Sud et les États-Unis (qui sont, certes, en perte de vitesse et
plus isolationnistes qu’interventionnistes depuis une vingtaine d’années). Ces puissances participent toutes à une
reconfiguration des relations internationales causée par la fin du monde bipolaire et l’émergence de la multipolarité
marquée par un déplacement de l’épicentre géopolitique du monde de l’ouest vers l’est de l’Eurasie. La deuxième
catégorie est composée d’acteurs géopolitiques de second ordre ou d’anciennes nations hégémoniques ou coloniales
d’Europe de l’Ouest ayant volontairement renoncé à toute politique de puissance et de civilisation. Certains d’entre
eux, dépourvus de ressources, stagnent sur le plan économique et, pour des raisons évidentes, sont plus sujets
qu’acteurs des relations internationales. D’autres se retrouvent dans une impasse historique par manque de volonté
et surtout par un refus idéologique de mettre au premier plan la défense des intérêts nationaux et des citoyens
autochtones au nom d’un multiculturalisme naïf et d’un multilatéralisme incarnés par l’ONU et l’Union européenne.
Ces deux organisations, impuissantes sur le plan international, plaident pour l’émergence d’intérêts supranationaux –
qui par définition n’existent pas – et ne peuvent justifier leur existence qu’en promouvant l’effacement des
frontières des pays qui acceptent d’abdiquer leur souveraineté, sans pour autant parvenir à créer une nouvelle
souveraineté supranationale. Ce dernier groupe en voie de désouverainisation, donc en train de « sortir de
l’Histoire », comme l’avait annoncé le général Gallois, comprend les États de l’Europe continentale dont le
processus de déclassement en cours découle de l’illusion que leur richesse économique passée et leur idéologie
pacifiste et multiculturaliste les protégeront indéfiniment du monde extérieur. Pris au piège de l’illusion dangereuse
selon laquelle ils vivront indéfiniment protégés des menaces externes par leur pacifisme et leur renoncement à
l’identité, ces non-puissances ouest-européennes ne semblent plus capables de défendre sur leur sol leurs propres
valeurs et civilisation, menacées non pas par une immigration extra-européenne qui serait positive si elle était
assimilée, mais par les appétits de conquête de prédateurs externes : la Chine impériale renaissante, l’empire
acculturant McWorld, et les puissances revanchardes panislamistes, comme la Turquie néo-ottomane d’Erdoğan, qui
instrumentalisent l’ouverture européenne et y embrigadent les communautés immigrées musulmanes pour servir leur
expansionnisme, remplissant ainsi le vide laissé par les États désouverainisés et désindustrialisés d’Europe
occidentale.
Déclassement de l’Occident et mondialisation du virus
La perte d’attractivité et de magistère moral des Occidentaux au profit des modèles multipolaristes, qui s’est
accrue depuis la fin du siècle dernier, a été considérablement amplifiée par les crises sanitaires (chapitre X et XII) et
économico-financières de 2008-2020, accélérant ainsi le double processus de « démondialisation » (chapitre XIV) et
de désoccidentalisation du monde en voie de multipolarisation. La crise de la Covid-19 a retiré les dernières
illusions de ceux qui croyaient encore à la supériorité des acquis, valeurs et avancées de la civilisation occidentale
par rapport au reste du monde. Avec un recul de près de deux ans déjà, la Chine autoritaire, considérée jadis comme
condamnée à l’imitation et donc à être toujours à la traîne de l’Occident triomphant et vertueux, a démontré qu’elle
était capable de gérer de manière bien plus efficiente que l’Europe la présente crise, à la fois sur les plans sanitaire,
technologique, économique, diplomatique et financier, et qu’elle n’est plus suiviste mais avant-gardiste. Elle compte
même pleinement profiter de l’effondrement économique et social de la civilisation européenne pour pouvoir
s’imposer d’ici quelques années comme la première puissance économique et géopolitique mondiale (chapitre XIII).
La Chine et son aire géocivilisationnelle sont les zones où la croissance positive oscille à nouveau depuis fin 2020
entre 6 et 10 % par an, pendant que l’hémisphère nord-occidental en voie de paupérisation continue son lent déclin
géopolitique et technologique, Europe de l’Ouest en tête. Les États-Unis restent, certes, combatifs et résilients,
tandis que l’Europe peine à devenir un acteur géopolitique identifiable. La recherche, par le pouvoir de Pékin, de la
suprématie mondiale passera par la maîtrise du numérique, des nanotechnologies, des neurosciences, de la 5G
(chapitre IX), de la génétique, de l’espace, et même de la transition écoénergétique (chapitre XII), qui ont été lancés
par les Occidentaux mais que la Chine leur ravit en profitant de leur incapacité à mettre en œuvre des plans de
développement et d’investissement ambitieux et de long terme (R&D). En cause aussi, l’avidité de leurs
multinationales qui ont accepté de facto d’être pillées technologiquement par Pékin en échange de facilités de
délocalisations et de contrats commerciaux léonins…
Dans ce contexte, la question qui vient naturellement à l’esprit est celle de la pertinence du modèle chinois, et,
plus largement, la plus grande efficience des modèles autoritaires asiatiques ou illibéraux et de la prévalence de la
stabilité à l’asiatique, qui concilie les opposés (yin et yang) puis privilégie le groupe à l’individu et l’ordre social à la
liberté hédoniste à l’occidentale, de plus en plus associée à l’ingouvernabilité et au chaos.
Les leçons de la gestion chinoise et asiatique de la crise sanitaire
Avec le recul nécessaire, un an et demi après les premiers confinements qui ont paralysé et continuent de
paralyser les pays occidentaux (surtout l’Union européenne) – faute de lits suffisants dans les hôpitaux, de discipline
et de fermeture des frontières –, les modèles alternatifs confucéens de Taiwan, Singapour, Corée du Sud et a fortiori
de la Chine ont incontestablement fait preuve d’une plus grande efficacité, au prix d’une fermeture précoce des
frontières, d’un traçage massif liberticide, de quarantaines drastiques, mais relativement courtes, et d’une emprise
technologico-politique sur les citoyens. La Chine, d’où est parti le virus, a jugulé la pandémie puis est parvenue à
transformer rapidement cette catastrophe économico-sanitaire en une occasion d’accélérer le déclassement d’un
Occident qui n’a pas semblé tirer les leçons de son hyperdépendance vis-à-vis de l’usine du monde chinoise
désormais autonomisée. Soudainement, le modèle nationaliste-maoïste-confucéen, fondé sur l’ordre autoritaire et la
soumission des individus à l’État-nation, s’est posé en alternative au rêve libertaire sans frontiériste occidental
dépeint par Thomas Friedman dans son ouvrage La Terre est plate, qui annonçait un monde unifié sur les ruines des
identités et des frontières au nom d’un consumérisme anglophone planétaire. Les questions qui viennent alors à
l’esprit, d’un point de vue géopolitique, sont les suivantes : ce monde « plat » promis par les adeptes de la
« mondialisation heureuse » est-il seulement un modèle viable ou au contraire dangereux pour ceux qui en sont
dupes ? Le projet de suprasociété mondiale mis en œuvre par les élites de McWorld (Benjamin Barber, voir infra) ne
s’apparente-t-il pas à une périlleuse utopie déconstructrice ? Celle-ci n’a-t-elle pas déjà fait disparaître des milliers
de langues minoritaires, donc des cultures, au nom même d’une fausse « diversité » uniformisatrice ? Cette
mondialisation n’est-elle pas menaçante lorsqu’elle délégitime l’État-nation – pourtant le plus à même de protéger
les citoyens et de faire respecter un « vouloir-vivre ensemble », lorsqu’elle déconstruit ou diabolise les traditions, les
normes sociales, les valeurs et les principes d’autorité au nom d’un libertarisme consumériste, alors que les normes
et l’autorité sont vitales pour échapper à la barbarie ? La diabolisation de l’identité portée par ce projet de Village
8
mondial (« Global village ») au nom d’une pensée « cosmopolitiquement correcte » n’est-elle pas une trahison de
la diversité qui, par essence, est composée d’identités ?
Face à ce risque d’anomie bien analysée par les sociologues, la Chine autoritaire, qui n’est pas dupe de la
confusion fâcheuse entre mondialisme et mondialisation, et qui utilise au contraire cette dernière pour servir ses
intérêts nationaux (« post-mondialisation »), apparaît de plus en plus comme un modèle alternatif efficient. Elle nous
rappelle que le monde multipolaire qui se dessine n’est pas seulement fait de pôles émergents et de puissances
jalouses de leurs prés carrés géopolitiques, mais aussi de polycentrisme des valeurs, celles de l’Occident libertairemondialisé étant perçues par les autres civilisations comme une menace idéologique anarchisante, acculturante et
civilisationnellement mortelle.
La crise de la Covid-19 a brutalement rappelé les effets parfois tragiques de la mondialisation marchande. Ses
effets néfastes ont déjà fait leurs preuves avec la prolifération ininterrompue – depuis les années 1990 – du crime
organisé transnational (chapitre VIII), de l’islamisme radical (chapitre VII), de la pollution environnementale et des
délocalisations/désindustrialisation, génératrices d’hyperdépendance ; de l’appauvrissement culturel et de la
destruction des liens réels liés aux réseaux sociaux mondialisés et aux industries du divertissement et médias ; sans
oublier les migrations incontrôlées et l’affaiblissement des souverainetés et identités nationales qui préparent, en
réaction, un violent retour du refoulé identitaire. C’est d’ailleurs probablement pour avoir osé annoncer – dans son
ouvrage prémonitoire, Le Choc des civilisations – que la mondialisation marchande et l’empire consumériste
McWorld n’allaient pas créer une fraternité universelle mais au contraire accentuer les chocs de civilisations et
conflits identitaires que Samuel Huntington a été conspué par l’intelligentsia occidentale.
L’Europe dupe de son interprétation utopique de la mondialisation
La thèse majeure du présent essai est que la mondialisation a révélé les vulnérabilités majeures de l’Europe,
ventre mou de l’Occident, qui se retrouve, de par son ouverture sans limites, exposée à toute une série de nouveaux
défis qu’elle peine encore plus que les autres grandes puissances à relever : pandémie, chômage endémique, crises
économiques et financières récurrentes, dépopulation des campagnes, vieillissement, fuite des cerveaux (notamment
vers les États-Unis), bureaucratisation, anémie entrepreneuriale, délocalisations industrielles, dumping social
asiatique, concurrence déloyale chinoise, islamisme conquérant, immigration incontrôlée, terrorisme, trafics de
drogue et crime organisé, rivalités énergétiques et menaces hydriques. Un des effets secondaires et curieux de ce
processus est que les Européens sont les seuls dans le monde à rejeter et diaboliser leur identités et frontières alors
que les autres nations non occidentales, à commencer par la Chine, l’Inde, la Turquie, l’Asie du Sud-Est (etc.), se
développent en réaction à l’universalisme occidental et utilisent au contraire la mondialisation comme un levier de
leur puissance nationale et civilisationnelle. Derrière l’utopie consumériste, hédoniste et politiquement correcte de
McWorld, les autres nations du monde multipolaire en gestation et a fortiori la Chine et ses alliés décèlent une
nouvelle forme d’impérialisme cognitif déterritorialisé essentiellement incarné par les puissances anglo-saxonnes
(« lutte pour les cœurs et les esprits », selon la doctrine du général américain David Petraeus). Cet impérialisme
anglo-saxon, incarné par le soft power étatsunien d’Hollywood, des Gafam (chapitre XII), des applications, et son
protectorat ouest-européen (Otan), cherche en fin de compte, sous couvert d’universalisme, à effacer les identités,
traditions et souverainetés des autres acteurs, donc la diversité elle-même. Et en même temps que McWorld tente
avec de moins en moins de succès d’uniformiser les mœurs à la façon libertaire, l’Occident piégé par sa lecture
mondialiste de la globalisation scie la branche sur laquelle il est assis en participant à l’effacement de sa propre
civilisation et de ses normes et valeurs morales fondatrices. À cet impérialisme cognitif de l’Occident mondialisé, le
reste du monde en voie de multipolarisation résiste. Principalement la Chine (Gafam chinois), la Russie avec
Yandex, et même l’Inde, ces pays cherchant par ailleurs à se débarrasser de l’hégémonie du dollar et à fonder des
institutions internationales multipolaires alternatives à celles créées par les Occidentaux depuis 1945. Nous verrons
dans les chapitres suivants que le nouveau Grand Jeu stratégique 2.0 ne fait que commencer. Cette période de
mutation ne se fera pas, certes, sans que l’hégémon planétaire américain ne dise son dernier mot, donc pas sans
réactions et conséquences lourdes en termes de déstabilisation, de remises en question du statu quo mondial actuel
occidentalo-centré, et d’inéluctable rééquilibrage par de nouveaux rapports de force et de nouveaux pivots
géostratégiques mondiaux.
À l’ancienne dichotomie The West and The Rest se substitue désormais une nouvelle division des zones de
puissance réparties entre l’Asie et le Reste du monde, l’Occident devant s’adapter à la perte progressive de son
hégémonie planétaire comme de son magistère moral, idéologique et sociétal, largement démonétisé et contesté.
Comme nous l’avons vu à l’aune de la gestion par les différents pays de la pandémie mondiale de la Covid-19, le
statut des puissances sur le nouvel échiquier multipolaire sera redéfini en partie en fonction des capacités de chacune
à gérer les crises sanitaire, économique et financière en cours. Les conséquences de ces crises, aux fortes
implications sociopolitiques, technologiques, industrielles et géopolitiques, auront des effets multiples et profonds
durant toute la décennie en cours.
Désoccidentalisation, antiaméricanisme et rejet des institutions
multilatérales héritées de 1945
Le centre de gravité du capitalisme, des échanges internationaux, et donc de la mondialisation marchande, est
en train de basculer des États-Unis et de l’Occident vers l’Asie. Parallèlement, les institutions internationales créées
sous l’impulsion américaine sont remises en question par les nouveaux acteurs géopolitiques du monde postguerre
froide en voie de multipolarisation. Depuis le 11 septembre 2001 et leurs coûteuses interventions en Afghanistan, en
Irak ou ailleurs, qui ont contribué à augmenter le chaos mondial, les États-Unis ont perdu une grande partie de leur
capacité de séduction planétaire, même si leur industrie du divertissement, et donc leur instrument de soft power,
continue d’inonder l’humanité et d’imprimer les consciences. Le politologue et stratège américain Zbigniew
Brzezinski, dans son ouvrage Le Grand Échiquier, faisait cette remarque, certes cynique, quant au soft power
américain : « la nature cosmopolite de la société américaine, écrit-il, a permis aux États-Unis d’asseoir plus
facilement leur hégémonie dans le monde sans laisser transparaître son caractère strictement national […]. La
domination culturelle des États-Unis a jusqu’à présent été un aspect sous-estimé de sa puissance globale. Quoi que
l’on pense de ses qualités esthétiques, la culture de masse américaine exerce sur la jeunesse en particulier une
séduction irrésistible. Les programmes américains alimentent les trois quarts du marché mondial de la télévision et
9
du cinéma. De ces avantages, […] l’Amérique tire un prestige politique et une marge de manœuvre inégalés ».
Toujours est-il que l’Occident, associé à cette culture mondiale consumériste, déconstructrice de valeurs et
d’identités, est de plus en plus rejeté par les protagonistes du monde multipolaire. Du fait de la neutralité des
technologies dont les Occidentaux n’ont plus le monopole, ces puissances non occidentales sont déjà en train de
démondialiser et de désoccidentaliser la globalisation, dans le cadre d’une « seconde décolonisation » (chapitre IV),
parfois revancharde. Les valeurs des démocraties occidentales ne sont plus la norme. Leur universalisme discrédité
par leurs entreprises guerrières, leur soutien aux révolutions de couleur qui ont déstabilisé maints régimes en exUnion soviétique, dans les Balkans et dans le monde arabe, et leur impérialisme culturel – dont se félicitait
Brzezinski – sont perçus par d’autres nations et civilisations comme un poison acculturant et le cache-sexe d’une
hégémonie, sous couvert de défense des droits de l’homme et de démocratie libérale. Signe de cette perception très
négative de l’universalisme libéral occidental, le document 9 du Parti communiste chinois de 2013 citait parmi les
« sept périls principaux » pour l’État chinois : le « nihilisme, la démocratie constitutionnelle occidentale et les
10
valeurs universelles occidentales » !
Défis géopolitiques : constantes et variables
Les différents et complexes enjeux de la mondialisation sont analysés ici dans le cadre de la démarche
géopolitique. Rappelons tout d’abord ce que recouvre ce concept, longtemps ignoré (notamment des institutions
universitaires) et qui a aujourd’hui littéralement inondé les médias. La géopolitique, terme popularisé il y a plus d’un
11
siècle par le Suédois Rudolf Kjellén , à la différence de la géographie politique, qui décrit l’organisation du monde
divisé en États à un moment donné, analyse, d’après le général Pierre Marie Gallois, « l’influence du milieu sur
l’Homme », ou encore, « l’étude des relations qui existent entre la conduite d’une politique de puissance et le cadre
12
géographique dans lequel elle s’exerce
». Pour Yves Lacoste, la démarche géopolitique « analyse les rivalités de
13
pouvoir sur des territoires, en confrontant les points de vue des différents protagonistes ». Cette dernière définition
rend compte des représentations antagonistes développées par chaque camp dans le cadre de la revendication du
14
pouvoir sur le territoire convoité, élément que nous avons défini comme la « guerre des représentations ». Au-delà
de ces différentes acceptions, soulignons d’emblée que certains facteurs sont relativement stables et d’autres
beaucoup plus conjoncturels. Bref, il est incontournable de distinguer entre des « tendances lourdes » d’une part, et
les « variables contemporaines », de l’autre, telles que définies par Fernand Braudel dans La Grammaire des
civilisations.
Les tendances lourdes
Les tendances lourdes correspondent à des évolutions observées sur une longue période et reposent
fondamentalement sur deux types de dimensions : celles qui sont liées à la géographie (l’Espace), et celles qui
émargent à l’histoire (le Temps). Ce croisement entre temps et espace invite bien sûr les géopolitologues à accorder
une place importante au facteur identitaire et donc aux appartenances civilisationnelles, forces motrices des « temps
longs de l’Histoire », pour paraphraser Braudel.
Pour ce qui est de la géographie, la taille et la position d’un État, par exemple, notions certes banales, sont
déterminantes. L’existence d’une façade maritime ou son absence et donc la recherche d’un accès à la mer, figure
depuis des siècles aux tout premiers rangs des préoccupations majeures des grandes nations (voir chapitre X), cet
ouvrage évoquant notamment le cas de l’Arménie enclavée et prise en tenailles par ses ennemis turco-azéris, ou
15
celui de la Russie-URSS qui a toujours recherché un accès aux « Mers chaudes », d’où les tensions russoatlantistes actuelles en mer Baltique, en mer Noire (Ukraine/Crimée), ou même passées lors de l’alliance entre les
États-Unis et les moudjahidines après l’invasion soviétique de l’Afghanistan, sur la route directe de l’océan Indien.
Comment ne pas souligner également le rôle ancestral (conforté par la mondialisation et l’essor soutenu du
commerce international) joué à l’échelle de la planète par les isthmes et les détroits, de la Sonde à Gibraltar, du
Bosphore au Sud scandinave, de l’isthme de Panamá à celui de Suez.
Les données climatiques et biogéographiques ont aussi joué un rôle difficilement négligeable. Les armées
napoléoniennes furent en effet vaincues non par Koutouzov ou Bagration, mais plus efficacement par le « général
Hiver », le plus fidèle allié des Russes durant plusieurs siècles. De même, durant la guerre des Malouines, nombre
des neuf cent vingt victimes argentines, mal préparées et sous-équipées, provenant des provinces intertropicales du
nord du pays, sont morts de froid et pas seulement des offensives de l’armée britannique. Quant au rôle de l’eau, il
constitue depuis des siècles un élément majeur des typologies régionales et zonales esquissées ici et là, avec, pour
simplifier, au plan des précipitations proprement dites, trois types de situations : les nations à climat tempéré, bénies
des dieux ; celles qui souffrent de la surabondance pluviométrique, du Bangladesh aux Maldives ; et les zones
désertiques ou semi-désertiques, de la Mongolie au Sahel ou à l’Arabie saoudite… Enfin, la place des grands fleuves
dans l’émergence et l’épanouissement de certaines civilisations ne prête guère à contestation : imagine-t-on l’Égypte
sans le Nil ou la Mésopotamie sans le Tigre et sans l’Euphrate ? (chapitre XII sur les guerres de l’eau).
Les données de l’Histoire sont tout aussi fondamentales. Songeons par exemple (nous y reviendrons dans les
deux chapitres qui suivent) à la multiplication des conflits intraétatiques générés en Afrique subsaharienne par les
vagues de décolonisation et le caractère artificiel des frontières imposées par les anciennes métropoles ; au rôle
majeur des schismes tout au long de l’histoire de l’Islam, et tout particulièrement aux tensions ancestrales entre
sunnites et chiites ; aux données démographiques (chapitre X) liées au contexte religieux ; à la donne linguistique (à
l’image de la place de la Francophonie – voir chapitre V – au cœur du Pacifique Sud), ou encore aux liens culturels
et socioculturels… On pourrait également rappeler l’alliance des « Five Eyes » (abrégé FVEY), qui unit de façon
très stratégique, et au détriment de leurs autres partenaires de l’Otan et de l’UE, allègrement espionnés, les services
de renseignement de cinq pays frères anglo-saxons partageant une même langue (voir chapitres VIII et XIV), une
même civilisation, et une partie d’histoire commune : Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-
Unis. La Grande-Bretagne partage d’ailleurs sa souveraineté nucléaire avec les États-Unis et a longtemps espionné
pour le compte de la National Security Agency (NSA) ses propres partenaires de l’Union européenne avant de finir
par quitter cette dernière… De Gaulle n’avait ainsi pas entièrement tort de dire qu’elle était un « cheval de Troie des
États-Unis en Europe ». C’est ainsi qu’en toute logique géopolitique, Winston Churchill déclarait à la veille du
débarquement de Normandie : « Chaque fois qu’il nous faudra choisir entre l’Europe et le grand large, nous serons
toujours pour le grand large. » Et le célèbre dirigeant anglais précisa, lorsqu’il proposa la création des « États-Unis
d’Europe », que son pays fût « with it, not in it »… Témoin aussi le poids de certaines Constitutions : un exemple
édifiant est illustré par le triple refus (à portée internationale), sous les présidences démocrates de Woodrow Wilson,
de Jimmy Carter et de Bill Clinton, décidé par un Congrès à majorité républicaine, de ratifier un traité international
signé par le Président : non-ratification du traité Salt II en 1977 (voir chapitre VII), sous Carter ; non-ratification du
16
traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBT , voir chapitre III) en 1999, sous Clinton et, plus
spectaculaire encore, non-reconnaissance, par le Congrès, de la Charte en quatorze points créant notamment, le
19 mars 1920, la Société des nations, une charte conçue et proposée par Woodrow Wilson en personne. À preuve
encore du poids de l’Histoire, l’interventionnisme des superpuissances durant la période bipolaire, dans le cadre de
la logique des Blocs, ou, depuis 1990, celui des États-Unis, volontiers gendarmes du monde, systématiquement lié à
un credo inébranlable : les États-Unis sont bénis de Dieu (God bless America) et bénéficient des effets de la
« Destinée manifeste » et du « efficiency first for us ». Il est donc de leur devoir de contribuer à implanter les vertus
de la démocratie américaine partout dans le monde, même si les nations et les peuples concernés ne sont pas
demandeurs.
Variables contemporaines
Toutefois, les tendances lourdes peuvent être, ici ou là, perturbées par l’impact de variables contemporaines :
coups d’État, restauration de la démocratie, changements d’alliances, dévaluation monétaire, crises économiques ou
sanitaires (Covid-19, voir chapitres X et XIII), découvertes plus ou moins inopinées de ressources minérales ou
énergétiques… Ce constat rend compte également qu’au-delà de la définition même de la géopolitique, l’approche
de cette dernière est, depuis des générations, partagée entre deux sensibilités : considérer effectivement que le poids
des tendances lourdes est primordial, s’inscrivant ici dans l’héritage d’illustres ancêtres (Jules César qui, à la veille
de la conquête de la Gaule, fait étudier minutieusement par ses conseillers les spécificités géographiques du territoire
à conquérir et les mœurs et coutumes de ses futurs adversaires ; Richelieu, père des « frontières naturelles »,
Frédéric II ou Bismarck…), ou au contraire privilégier les variables contemporaines, à l’image de Tamerlan, de
Napoléon Bonaparte, du Vietnamien Giap ou des théoriciens comme John Frederick Charles Fuller et Pierre Marie
Gallois, lointains disciples du plus génial des géostratèges : Alexandre le Grand.
Notre analyse géopolitique associe donc ces deux approches, dans le cadre d’une vision holistique et
pragmatique des relations internationales et de l’étude des rivalités de pouvoirs sur des territoires disputés. Ces
disciplines, qui se doivent d’être menées de façon dépassionnée et désidéologisée, sont de ce fait aux antipodes du
manichéisme idéologique et donc de tout politiquement correct : géopolitologues et stratèges postulent en effet que
les États-nations – acteurs géopolitiques majeurs – ont et continueront toujours d’avoir des intérêts froids et des
alliés comme des ennemis ; que seuls ceux qui renoncent à leurs prérogatives régaliennes seront désouverainisés par
la mondialisation ou le supranationalisme ; et enfin qu’ils sont condamnés à conduire des politiques de civilisation et
à se préparer à des menaces – internes ou externes –, à la guerre économique ou à la guerre tout court, s’ils ne
veulent pas disparaître. Car l’humanité est hélas encore très loin d’avoir atteint le stade de la sagesse, de la paix
universelle ou de la « conscience cosmique »…
1. Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident, Paris, Gallimard, 1948.
2. Voir Alain Minc, La Mondialisation heureuse, Paris, Pocket, 2019 ; et Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le dernier homme, Paris,
Flammarion, 2009.
3. John Agnew, Geopolitics, Re-Visioning World Politics, Londres/New York, Routledge, 2003, p. 127.
4. Robert Kaplan, La revanche de la géographie, L’Artilleur, 2014.
5. L’accord nord-américain renégocié par Donald Trump en 2019 qui remplace depuis juillet 2020 l’Alena est l’Accord Canada-États-Unis-
Mexique (ACEUM).
6. Cette organisation réunit l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan.
o
7. Alexandre Del Valle, « La mondialisation en question et le destin de l’Occident », Géoéconomie, n 72, septembre 2014, p. 29-48.
8. Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto, University of Toronto Press, 1962.
9. Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Paris, Bayard, 1997.
10. Michel Geoffroy, La Nouvelle Guerre des mondes, Via Romana, Paris, 2020.
11. Friedrich Ratzel, Anthropogeographie. Die geographische Verbreitung des Menschen, Stuttgart, J. Engelhorn, 1882-1891. Pour Jacques
Soppelsa, la géopolitique « analyse les principaux facteurs dynamiques rendant compte de ladite organisation, pour aboutir à la synthèse d’une
situation politique existante et de ses potentialités ».
12. Pierre Marie Gallois, Géopolitique. Les voies de la puissance, Paris, Plon, 1990.
13. Yves Lacoste, Géopolitique. La longue histoire d’aujourd’hui, Paris, Larousse, 2006.
14. Alexandre Del Valle, Le Complexe occidental, Paris, Toucan, 2014.
15. Comme l’avait démontré l’illustre amiral russo-soviétique Gorchkov, devenu le nom du porte-avions éponyme.
16. Le Traité international « Comprehensive Test Ban Treaty » (CTBT, « Traité d’interdiction complète des essais nucléaires », TICEN) engage
chaque État à ne pas réaliser d’explosions expérimentales d’armes nucléaires. Ouvert à la signature le 24 septembre 1996, il n’est jamais entré en
vigueur. En 2020, 36 États sur 44 ont ratifié le texte.
PARTIE I
LES TENDANCES LOURDES
CHAPITRE II
La période contemporaine : ordre ou désordre ?
« Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l’avenir et qui, par la suite, est également capable
d’expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l’avait prédit. »
Winston Churchill
Avant d’analyser en détail les différents aspects de la mondialisation dangereuse, il est important de revenir en
préalable sur les différentes interprétations de ce qu’allait devenir, selon les plus grands auteurs anglo-saxons, le
nouvel ordre international postguerre froide. Ceux-ci ont émis des hypothèses a priori contradictoires quant à la
configuration du « nouvel ordre mondial », annoncé par George H. Bush en 1990. La relecture de ces grandes écoles
de pensée s’interrogeant sur l’avenir du monde postbipolaire peut nous inciter, rétrospectivement, à critiquer ou
valider leurs analyses à vocation plus ou moins prédictive, d’autant qu’elles ont toutes abordé d’une façon ou d’une
autre la question de la mondialisation et du devenir de l’Empire américano-occidental, aujourd’hui contesté dans ses
fondements mêmes par les outsiders. Cinq courants peuvent être distingués en la matière :
l’école « unipolariste décliniste », autour des travaux de Paul Kennedy ;
le courant « unipolariste optimiste » de Francis Fukuyama ou Joseph Nye ;
l’école de l’empire face à ses ennemis, de Zbigniew Brzezinski et Graham Allison ;
le paradigme civilisationnel de Samuel Huntington ;
la critique de la mondialisation anglo-saxonne productrice de réactions identitaires (Djihad versus
McWorld) par Benjamin Barber.
1) Le « déclinisme » de Paul Kennedy. La vision de cet auteur britannique, auteur d’un essai majeur sur le
1
déclin de l’Empire américain , est relativement simple : l’univers bipolaire a disparu, relayé par un monde
unipolaire dominé provisoirement par les États-Unis condamnés, à plus ou moins brève échéance, à un inexorable
déclin. Son argument central est que : « Tout Empire périra », selon la célèbre expression de Jean Baptiste Duroselle
(1981). Trente ans plus tard, force est de constater que son verdict pessimiste a été singulièrement contredit par les
faits : les États-Unis, au cours de cette période, n’ont nullement renoncé à leur statut d’hyperpuissance. Il n’est
certes pas question de minimiser aujourd’hui la sévère crise financière et boursière qui a secoué l’économie
américaine en 2007 ; ni de nier les conséquences dramatiques des initiatives de l’administration Bush Junior en Irak.
Il est aujourd’hui encore trop tôt pour pouvoir émettre un jugement objectif sur les prises de position d’un Donald
Trump entre 2016 et 2020, d’autant que, en comparaison avec ses prédécesseurs, Trump aura été plutôt un noninterventionniste et n’a pas commis les graves erreurs de politique étrangère de Bill Clinton, George Bush père et
fils et même Barack Obama (guerres d’ex-Yougoslavie, Irak 1 et 2, Libye, Afghanistan).
Beaucoup d’experts brodent sans état d’âme sur le déclin de l’Empire américain, que la nouvelle
superpuissance chinoise cherche à déclasser. Ils ont oublié la rigoureuse mise en application du programme de
« Missile Defense » (bouclier antimissile susceptible d’assurer la protection du territoire américain et des alliés), sur
laquelle nous reviendrons, et proclament un peu trop hâtivement la fin de l’hyperpuissance américaine avant même
qu’elle n’ait été vaincue… En réalité, le déclin semble bien plus frapper l’Europe que les États-Unis.
Les États-Unis restent en effet la première et la seule puissance capable d’intervenir dans tous les recoins de la
planète, grâce à ses 745 bases militaires dans 149 pays, ses 7 flottes, son budget de défense annuel de 720 milliards
de dollars, autant que le budget total de tous les autres pays réunis (et 4,2 fois plus que celui de la Chine –
178 milliards USD). Sa domination satellitaire et technologique, son soft power culturel et sociétal universel,
l’impérialisme de sa monnaie, l’Alliance atlantique, plus puissant système de défense mondial, sa maîtrise des
institutions internationales (certes en décroissance, mais encore importante), et sa pratique des juridictions
coercitives extraterritoriales, demeurent des instruments hégémoniques redoutables. Quant aux capacités de
l’économie américaine à rebondir après les crises, toute l’histoire des États-Unis fourmille d’exemples révélateurs.
Bref, en dépit d’inévitables difficultés conjoncturelles, les États-Unis revendiquent plus que jamais le statut inédit
d’hyperpuissance, via la concrétisation progressive d’une véritable géopolitique orbitale. Est-ce à dire qu’ils ont
toujours vocation à être les gendarmes du monde et qu’ils réussiront à stopper l’avancée fulgurante de l’outsider
chinois ? Seul l’avenir le dira.
2) L’unipolarisme « euphorique » de Fukuyama, et des néoconservateurs. Cette option a été, elle aussi,
2
balayée par les faits. Pour Francis Fukuyama , le monde postguerre froide devenu unipolaire, dominé par une
Amérique exemplaire et caractérisé par le triomphe du libéralisme capitaliste et de la démocratie, serait la « fin de
l’histoire politique mondiale », le modèle indépassable pour les Nations. Rappelant que les États-Unis demeurent les
plus puissants dans tous les domaines, tangibles (ressources de base, secteur militaire, énergie, sciences et
technologie) comme intangibles (du patriotisme à la « culture universelle »), Fukuyama estime que « l’Occident a
gagné la guerre froide et, à l’échelle du monde, les conflits entre les nations sont terminés (sic) ; l’idéologie
3
communiste a échoué et le libéralisme deviendra l’idéologie universelle ». Bénie de Dieu, la nation américaine a le
devoir d’implanter ses vertus démocratiques partout dans le monde. Comme le rappelait Warren Christopher, ancien
Secrétaire d’État de Bill Clinton, « la fin de la guerre froide nous a donné une possibilité sans précédent de façonner
4
un monde plus sûr, dans lequel les intérêts et les idéaux américains peuvent s’épanouir ». Mais l’option de
Fukuyama, singulièrement optimiste, s’est heurtée à la réalité. Les faits sont têtus, disait Lénine. C’est aussi vrai en
géopolitique. Elle a été contredite en effet par une série d’événements convergents, durant la dernière décennie.
D’abord, Washington a manifestement sous-estimé l’évolution de la sécurité collective. Le maintien de la posture
américaine triomphaliste post-guerre froide a entraîné de graves dysfonctionnements dans plusieurs points chauds du
globe, comme la Corne de l’Afrique ou, a fortiori, le Moyen-Orient et l’Asie méridionale. Les États-Unis ont aussi
pris conscience tardivement que la revendication de leur leadership devait s’accompagner d’une diplomatie
cohérente, étayée par la concrétisation de promesses ou de gestes significatifs : Barack Obama ne promettait-il pas
dès le début de son premier mandat la fermeture définitive de la prison de Guantanamo ? Dans un autre registre,
Daesh n’aurait pas pu terrifier le monde arabe, s’emparer d’une partie de l’Irak et de la Syrie en 2014 si, en 2009,
Barack Obama n’avait pas décidé de retirer d’un coup les troupes américaines sans « service après-vente ». On est
ainsi passé de l’excès de l’intervention militaire américaine en Irak stupidement menée par les « néocons » de
l’administration Bush Jr, en 2003, qui ont instauré un chaos en détruisant totalement l’État baathiste irakien, à un
désengagement brutal qui a créé un vide et poussé les tribus sunnites massacrées par les chiites revanchards dans les
bras des djihadistes à peine relâchés des prisons américaines d’Irak et des geôles syriennes à la faveur des
révolutions arabes… Dans un tout autre domaine, prétendre au premier rang en matière de culture et d’éducation…
tout en quittant, en réintégrant, puis en quittant de nouveau l’Unesco, était pour le moins contre-intuitif.
Enfin, et surtout, les États-Unis n’ont pu, jusqu’à une date récente, contribuer efficacement à l’éradication du
terrorisme islamiste international. Au contraire, ils ont même longtemps directement contribué à son expansion, via
leur stratégie pro-islamiste en Afghanistan sous la guerre froide contre l’armée soviétique puis dans les Balkans en
1992-1999, et indirectement, par leurs folles aventures militaires en Irak, en Afghanistan ou en Libye. La mort de
centaines de milliers d’innocents (« dommages collatéraux » des bombardements aériens massifs) a été de ce point
de vue véritable semence de djihadistes selon la formule du célèbre général américain David Petraeus : « deux
terroristes tués avec des dommages collatéraux humains en font naître quatre »…
On peut également mentionner que Washington a négligé le nouveau rôle croissant et de plus en plus
incontrôlable des organisations supraétatiques, des puissances multinationales et digitales, comme des nouveaux
acteurs régionaux du monde multipolaire qui poursuivent leurs propres intérêts. Plus étonnant encore, l’échec de
5
l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena ), pourtant contrôlé par les États-Unis… Quant à la gestion du
contrôle des armements (voir chapitre VIII), le moins que l’on puisse écrire, c’est que depuis le 12 octobre 1999 et
le refus du Congrès de ratifier le CTBT (traité d’interdiction complète des essais nucléaires), puis de poursuivre
Start III, le « gendarme du monde » a peu contribué à son évolution et a plutôt œuvré objectivement à une néoguerre
froide dangereuse avec la Russie jetée de ce fait dans les bras du rival chinois… Enfin, il convient de rendre justice
au fait que Fukuyama est revenu en partie, par la suite, sur son idéalisme triomphal propre à l’école
6
néoconservatrice, notamment dans son ouvrage Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity , reconnaissant
alors que la culture, donc l’identité et l’élément géocivilisationnel, ne peut pas être clairement séparée de la
géoéconomie, et que cela implique de relativiser le caractère universel des valeurs portées par l’Occident.
3) « L’Empire américain face à ses ennemis », de Zbigniew Brzezinski et Graham Allison. En 1997, dans
Le Grand Échiquier, le célèbre politologue et stratège américain Zbigniew Brzezinski expliquait que l’Eurasie, vaste
ensemble allant de l’Europe de l’Ouest à la Chine via l’Asie centrale, constituait la scène centrale de la politique
mondiale et qu’elle était l’enjeu principal pour l’Amérique. Selon lui, la Russie, puissance majeure du heartland
o
(voir carte n 1), devait être endiguée sur son périmètre et ses flancs afin qu’elle ne redevienne jamais une grande
puissance eurasienne. Quant à l’hyperpuissance américaine, devenue le cœur de l’empire occidental après la victoire
contre l’URSS, elle devait impérativement prévenir l’émergence d’une puissance eurasienne antagoniste (la Russie,
puis plus tard la Chine), donc conjurer toute alliance « antihégémonique » russo-européenne. Brzezinski suggère
ainsi d’« utiliser tout moyen pour prévenir l’émergence d’une coalition hostile [en Eurasie] qui pourrait défier la
primauté de l’Amérique » ou la « possibilité d’un pays de se substituer aux États-Unis en tant qu’arbitre en
Eurasie ». Il affirme qu’il faut soutenir les forces et États jadis occupés par l’Union soviétique ou ses alliés en visant
particulièrement la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, et surtout l’Ukraine. Dans sa vision, cette dernière est un
7
verrou destiné à « prévenir l’expansion russe dans son étranger proche », dernier rempart face à l’avancée de la
Russie vers le sud, d’où sa volonté de financer les forces antirusses de l’ouest de l’Ukraine afin de faire perdre à
Moscou le contrôle de ce pays charnière entre la Russie, l’Europe et la Méditerranée (via la Crimée et la mer Noire
o
et les détroits turcs) (voir chapitres III et IV et carte n 14). L’encouragement occidental à la révolution orange de
2004 et à l’Euromaïdan de 2013-2014 était annoncé noir sur blanc dans Le Grand Échiquier, avec comme
conséquences prévisibles la réaction convulsive de Moscou et le chaos régional (guerre civile en Ukraine, voir carte
o
n 14). Sa préconisation du « double élargissement » (avancée le plus possible vers l’est de l’Otan et de l’UE) a en
fait débouché sur une nouvelle guerre froide entre l’Occident atlantiste et la Russie postsoviétique.
En fait, la « doctrine Brzezinski » poursuivait celle de John Foster Dulles, concepteur de la doctrine du roll
back (refoulement) contre la Russie/URSS sous la guerre froide, lequel continua lui-même la vision du stratège
anglais Halford John Mackinder, qui appelait à endiguer le heartland russe et à encercler l’Eurasie avant même
8
o
l’existence de la menace soviéto-communiste (1904, voir carte n 1).
Ceci dit, Brzezinski a été moins primairement impérialiste qu’on le croit : dans les années 2000, à la fin de sa
vie, il a critiqué l’interventionnisme des néoconservateurs et leurs guerres mal menées en Irak et Afghanistan qui ont
contribué à faire perdre aux États-Unis leur pouvoir de séduction. Plus surprenant, celui qui apparut longtemps
comme un russophobe acharné a fini par regretter lucidement à la fin de sa vie, comme Georges Kennan peu avant
lui, le fait que l’échec de l’intégration de la Russie dans l’orbite occidentale a jeté la Russie de Vladimir Poutine
dans les bras du vrai nouvel ennemi de l’Empire américain : la Chine…
Passons au second théoricien de l’Empire américano-occidental face à ses ennemis : Graham Allison,
professeur à Harvard, comme Huntington et Fukuyama, a théorisé l’affrontement apparemment inéluctable entre
9
l’Amérique et l’ennemi chinois depuis la chute de l’URSS. Dans son ouvrage Destined for War , l’auteur s’appuie
10
sur la théorie du piège de Thucydide selon laquelle une puissance dominante, comme les États-Unis, mais en
déclin, tendrait à faire la guerre pour empêcher qu’une puissance rivale, comme la Chine, encore inférieure mais en
pleine expansion, ne finisse par la remplacer. Le piège résiderait dans le fait que c’est la puissance dominante qui
déclenche la guerre qui est vaincue par l’outsider…
Pour Allison, la poursuite et l’intensification constatées des rivalités entre les deux superpuissances sur presque
tous les fronts (stratégique, politique, technologique, idéologique, énergétique et économique) rendent le choc
militaire inévitable… Sauf si l’Oncle Sam et l’oncle Xi s’entendent dans une sorte de duopole/condominium.
L’auteur rappelle que, de l’Antiquité à nos jours, le « piège de Thucydide » s’est vérifié à seize reprises et a
débouché douze fois sur une guerre que l’empire sortant a perdue face à l’outsider… Finalement, quelle que soit
l’issue de la guerre qui vient entre les deux empires, Graham Allison dépeint un monde divisé, comme sous la guerre
froide, mais cette fois-ci dans le cadre d’une lutte entre deux capitalismes concurrents, le capitalisme d’État maoïstoconfucéen, d’une part, et le capitalisme occidentalo-libéral, de l’autre. Certes, on peut espérer que la dissuasion, pas
seulement nucléaire, mais économique et financière (interdépendance), donc la raison et les intérêts mutuels,
empêchera ce scénario pessimiste du conflit militaire direct et le limitera à un conflit/bras de fer économique,
comme c’est le cas actuellement. Le pire n’est jamais certain, et lorsqu’il advient, ce n’est pas toujours là où on
l’avait envisagé…
4) Le paradigme civilisationnel de Samuel Huntington. En 1993, ce professeur de Harvard publie un article,
puis, à partir de ce dernier, un ouvrage, le Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (traduit en
français en 1997) qui va devenir très vite une référence incontournable… et la cible d’une multitude de critiques.
Après avoir à son tour rappelé la disparition du monde bipolaire issu des accords de Yalta, Huntington développe
une idée majeure : la transition des relations entre États-nations à celles impliquant des « aires culturelles ».
Il constate que les affrontements idéologiques de la guerre froide (communisme soviétique versus monde
capitaliste) ont laissé la place au paradigme civilisationnel : « les différences entre les civilisations ne sont pas
seulement réelles ; elles sont fondamentales, écrit-il. Les peuples des différentes civilisations ont des conceptions
différentes des relations entre Dieu et les hommes, les individus et le groupe, le citoyen et l’État […]. Ces
antagonismes, séculaires, ne disparaîtront pas de sitôt. Ils sont bien plus fondamentaux que les différences relatives à
l’idéologie politique ou aux régimes politiques. […]. À travers les siècles, les différences entre les civilisations ont
11
engendré les conflits les plus longs et les plus violents ». Huntington conçoit le paradigme du choc des
civilisations comme une nouvelle rivalité globale entre, d’une part, les démocraties occidentales et le reste du
monde, en particulier le monde sino-confucéen et le monde musulman, les deux aires culturelles qui contestent le
plus l’universalisme occidental, et, de l’autre, entre les aires culturelles qui s’affrontent le long des « lignes de
fractures civilisationnelles » : Chine confucéenne vs Inde ; Inde majoritairement hindoue vs Pakistan musulman ;
catholiques occidentaux vs slavo-russes-orthodoxes « postbyzantins » ; musulmans bosniaques vs Croates
o
catholiques et Serbes orthodoxes dans les Balkans (voir carte n 5). Contrairement à ce qu’ont dit ses détracteurs qui
ne l’ont pas lu, il ne nie pas, bien au contraire, la complexité et donc les fractures à l’intérieur de mêmes zones
culturelles : Alaouites laïques et autres minorités vs sunnites islamistes en Syrie, chiites vs chrétiens et sunnites au
Liban, chiites vs sunnites au Yémen ou en Irak, « tiraillements » internes en Turquie. Prémonitoire, mais souvent
caricaturé, Huntington annonce l’affrontement entre kémalistes et islamistes en Turquie, l’éclatement de l’Ukraine
entre prorusses et antirusses, il prédit la montée des identités séparatistes en Catalogne, Écosse, Kurdistan, etc., ainsi
que la montée des populismes anti-immigration en Europe en réaction à l’immigration de masse. Loin d’être un
impérialiste unipolariste, il constate la remise en question de la suprématie occidentale, qu’il qualifie d’arrogante, en
préconisant, pour faire baisser cette inimitié, l’acceptation d’un monde multipolaire dans lequel l’hyperpuissance
américaine s’accommoderait de l’apparition des pôles de valeurs, d’identité et de puissances autonomes qui ne
partagent pas l’universalisme occidental (voir chapitre V). On est très loin de l’occidentalo-centrisme qu’on lui a
prêté.
Certes, Samuel Huntington n’étant pas un stratège, sa théorie générale est critiquable : il semble considérer les
concepts de superpuissance et d’hyperpuissance comme des synonymes, au risque de tomber dans une
simplification. Rappelons quand même que, pour qu’un leadership planétaire perdure, il doit s’appuyer sur la
maîtrise des quatre éléments de la puissance :
la terre, la domination territoriale d’un espace, gage de la puissance moyenne ;
l’eau (la domination des mers), passeport pour revendiquer le statut de grande puissance ;
le feu (le feu nucléaire en l’occurrence) gage de la superpuissance ;
l’air (l’espace) qui, au moins partiellement maîtrisé, permet d’acquérir le statut d’hyperpuissance.
e
Concernant les « aires de civilisation », son postulat selon lequel le XXI siècle sera « spirituel ou ne sera pas »,
comme l’avait évoqué naguère André Malraux, et se caractérisera par une compétition globale entre civilisations,
avec à leur tête leurs leaders respectifs, est à nuancer, car les États souverains ont leur logique propre, parfois contra12
civilisationnelle. Sa distinction de sept aires culturelles est également discutable . Huntington est toutefois assez
lucide lorsqu’il redoute l’expansionnisme antioccidental de deux aires culturelles montantes, la Chine et le monde
musulman : « Ces deux civilisations pourraient en outre former un axe islamo-confucianiste susceptible de
constituer une véritable menace pour le monde occidental. » Cette énumération a suscité de vives critiques, en partie
13
justifiées , mais que l’alliance renforcée de la Chine et du Pakistan, à la fois contre l’ennemi commun indienhindouiste et contre l’Occident, a tout de même confirmée. Ses classifications sont parfois discutables : une
civilisation japonaise dérivée de la chinoise ? Un monde latino-américain judéo-chrétien mais distinct de l’aire
occidentale ? Mais sa description d’une Afrique tiraillée entre une civilisation propre, « l’Afrique noire » non
musulmane, et l’ère islamique, ou son affirmation que l’Amérique latine, l’Afrique noire et le monde musulman sont
privés de leaders ou « États phares », à la différence des civilisations occidentales (États-Unis), orthodoxes-slavobyzantine (Russie), japonaise (Japon), sino-confucéenne (Chine) ou hindouiste-indienne (Inde), ne sont pas
inintéressantes. Contrairement à ce qu’ont dit ses détracteurs, Huntington n’a pas nié les fractures internes entre les
civilisations, ni présenté l’islam comme une civilisation homogène, puisqu’il souligne son extrême division due aux
rivalités internes pour son leadership. Et son affirmation que le monde musulman et l’islam mondial officiel
connaîtraient depuis les années 1980 un mouvement de radicalisation intégriste tourné contre l’Occident et les autres
civilisations rivales (Inde-hindouiste, Afrique noire animiste-chrétienne, Asie du Sud-Est bouddhiste) est loin, hélas,
d’avoir été démentie par les faits.
Djihad versus McWorld ?
5) La critique de la mondialisation anglosaxonne McWorld de Benjamin Barber. Une autre clé de lecture,
fort originale, est celle du politologue-sociologue Benjamin Barber, qui complète les autres et mérite un
développement à part. Dans son ouvrage, Djihad versus McWorld, publié en 1996, l’auteur dépeint de façon
prémonitoire la lutte très actuelle entre, d’une part, l’Empire anglophone de troisième type, qu’il appelle McWorld,
excroissance hybride des États-Unis échappant à son créateur dans le cadre d’une mondialisation consumériste et
informationnelle, et, de l’autre, « djihad ». Terme qu’il a regretté par la suite car il voulait décrire par là l’ensemble
des forces identitaires radicales et « paroissiales » (pas seulement l’islamisme) qui défendent les valeurs
traditionnelles, le nationalisme, la religion, et autres appartenances tribales, face à l’empire déstructurant et
acculturant de McWorld associé à l’Occident libertaire. Pour Barber, la mondialisation non réglementée et ses
multinationales américaines couplées à la technologie de l’information formeraient une sorte d’empire antinational
planétaire alimenté par une déconstruction permanente des valeurs, des identités et des souverainetés. McWorld
conduirait à l’anomie et à l’anarchie générale qui ne peuvent qu’appeler des réactions identitaires violentes. Celles-ci
pourraient même survenir à l’intérieur de l’Occident, de ce fait divisé entre « mondialistes » et « souverainistes », en
l’absence de réponse à la demande d’identité et de souveraineté nationale des peuples. « La vérité paradoxale est que
les tendances tant de Djihad que de McWorld se développent en même temps et que l’on peut les voir toutes deux à
14
l’œuvre au même endroit et au même moment […]. Chacun des deux produit son contraire et a besoin de lui . »
Visionnaire, Barber annonçait ainsi la polarisation actuelle américaine entre le camp pro-Trump, antiinterventionniste, nationaliste, isolationniste, conservateur et antimondialiste, et le camp démocrate Biden-Obama,
multilatéraliste, universaliste, mondialiste, assimilé à McWorld, aux délocalisations massives et aux Gafam.
Du point de vue géopolitique, cet antagonisme majeur, qui fracture les sociétés occidentales, se retrouve aussi
dans l’opposition entre, d’une part, les puissances émergentes non occidentales, identitaires et partisanes d’un ordre
international multipolaire hostiles au multilatéralisme, aux interventions et à l’hégémonie américano-occidentales et
donc au démocratisme droits-de-l’hommiste qui les justifient hypocritement, et, de l’autre, l’Occident mondialisé
des démocrates/néocons américains, l’Otan, des sociaux-démocrates ouest-européens, qui voudraient étendre à
l’humanité tout entière leurs valeurs woke consuméristes. Barber fut également précurseur, car à l’époque de la
rédaction de son ouvrage, Internet n’en était qu’à ses débuts et les réseaux sociaux n’existaient pas, mais il
pressentait la puissance de plus en plus défiante, pour les identités stato-nationales et les traditions enracinées, que
sont les puissances digitales et autres multinationales déterritorialisées.
La thèse de Barber met en lumière les revers de la mondialisation « pas toujours heureuse ». Il s’est
probablement trompé, dans sa conclusion, en postulant que l’empire marchand anglo-saxon pourrait l’emporter.
Aujourd’hui, le McWorld occidental est largement concurrencé par son rival le Big Brother chinois articulé autour
de gigantesques multinationales et des « BATX » (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, voir chapitre XII). Ces
nouveaux conquérants véhiculent des valeurs opposées à celles, libérales-libertaires, du McWorld anglo-saxon, et
surtout sont contrôlés par l’État. En octobre 2020, on a vu le patron d’Alibaba, Jack Ma, disparaître avant de se faire
15
recadrer par la Cour pénale chinoise … Toutefois, la proposition barberienne de conjurer le scénario chaotique d’un
« Mad Max universel » par la réhabilitation de l’État souverain confirme la nécessité que ce dernier demeure l’acteur
majeur de la politique mondiale et le fait qu’il soit le cadre le plus approprié pour assurer les droits des citoyens –
donc la démocratie elle-même – comme seule alternative viable face aux forces impériales et néobarbares de djihad,
de Mad Max et de McWorld qui annoncent la guerre de tous contre tous.
Kennedy, Fukuyama, Brzezinski, Huntington, Allison, Barber… Des visions prophétiques du monde
postbipolaire, parfois – mais pas toujours – contrariées par les faits, que l’on peut appliquer selon ses préférences
analytiques à une planète qui, depuis un quart de siècle, tend davantage à flirter avec le concept de désordre qu’avec
celui de nouvel ordre. Un univers caractérisé par la multiplication des défis, des contentieux, des menaces et des
crises.
1. Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, 1987.
2. Ex-néoconservateur issu de l’administration Reagan source d’inspiration pour les interventionnistes démocrates.
3. Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le dernier homme, op. cit.
4. Christian Harbulot et Jean Pichot-Duclos, La France doit dire non, Paris, Plon, 1999.
er
5. L’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), en anglais NAFTA (North American Free Trade Agreement), en vigueur le 1 janvier 1994,
crée une zone de libre-échange entre EU, Canada et Mexique et couvrant 480 millions d’habitants, a été complété en 2019 par l’accord CanadaÉtats-Unis-Mexique.
6. Francis Fukuyama, La Confiance et la puissance. Vertus sociales et prospérité économique, Paris, Plon, 1997.
7. Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier, op. cit.
o
8. Halford John Mackinder, « Le pivot géographique de l’Histoire », The Geographical Journal, vol. 23, n 4, avril 1904, p. 421-437. Voir aussi le
précurseur de l’endiguement, Nicholas Spykman, qui préconisait de ceinturer la Russie/Heartland par une chaîne d’alliances ouest/centre
européenne, turcophone, arabo-islamique et asiatique (Rimland) destinée à isoler l’Empire russe et l’empêcher d’accéder aux Mers chaudes et au
Sud, objectif de l’Otan, pendant et après la guerre froide.
9. Graham Allison, Vers la guerre. L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ?, Paris, Odile Jacob, 416 p.
10. En référence à l’opposition (–431-404) entre Athènes – puissante ascendante – et Sparte – puissance ancienne – relatée par Thucydide dans La
Guerre du Péloponnèse.
o
11. Samuel Huntington, Le Choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 1997, 402 p., p. 73. Voir carte n 5.
12. Ces sept aires sont : – la civilisation occidentale, fondée sur l’héritage judéo chrétien ; – latino-américaine, dérivée de celle-ci (sic) ; –
confucianiste chinoise ; – la shintoïste-japonaise, dérivée de cette dernière (sic) ; – hindouiste ; – musulmane ; – et une civilisation africaine tiraillée
entre islam et non islam.
13. Alexandre Del Valle, adepte de la « géopolitique géocivilisationnelle », est ici plus hungtintonien que Jacques Soppelsa.
14. Benjamin R. Barber, Djihad versus McWorld, Paris, Desclée de Brouwer, 1996, p. 24-25
e
15. Voir chapitre VIII. Le patron d’Alibaba, Jack Ma, 25 fortune mondiale, a disparu en octobre 2020 après un discours sévère à l’égard de Pékin,
qui a suspendu l’entrée en Bourse de la fintech Ant Group, la banque en ligne d’Alibaba. Alibaba a été accusée de « pratique anticoncurrentielle »
par la Cour populaire suprême chinoise.
CHAPITRE III
De la multiplication des conflits
« Soyons pessimistes par réalisme et optimistes par nécessité. »
Benjamin Disraeli
La période 1945-1990, au-delà de quelques nuances conjoncturelles, était considérée comme une ère de
certitudes avec des menaces et des ennemis potentiels clairement identifiés. Hormis l’affaire de Suez – qui s’illustra
par l’alliance de facto entre les États-Unis et l’URSS d’une part, la France et le Royaume-Uni, d’autre part –, la
plupart des crises et des contentieux virent s’affronter indirectement les deux superpuissances dans le cadre d’un
monde bipolaire. La chute du mur de Berlin, l’effondrement des démocraties populaires, la disparition de l’Union
1
soviétique, ont fait en revanche entrer la planète dans une ère d’incertitudes , caractérisée par une gamme de plus en
plus nourrie de menaces, de crises, de défis multiformes. Depuis lors, le monde, encore plus durablement déstabilisé
par la pandémie, navigue dans une grande tempête, sans gouvernance capable d’envisager un ordre mondial plus
multilatéraliste.
Dans ce contexte, et contrairement à une idée reçue très ancrée dans les consciences occidentales selon laquelle
les guerres ne seraient plus possibles sur le sol des démocraties libérales, les conflits armés directs, dits « de haute
intensité », redeviennent tout à fait possibles. C’est ainsi que le général Thierry Burkhard, aujourd’hui chef d’Étatmajor de l’armée de terre française (Cemat), confirmait officiellement, le 31 juillet 2019, le double constat de
l’incertitude croissante et d’un possible retour de la guerre en Occident et plus seulement entre pays non
démocratiques dits « du Sud » : « dans un monde de l’incertitude et de l’instabilité, en transformation rapide […], il
faut être prêt à s’engager pour un conflit de survie […]. Le rapport de force redevient le mode de règlement des
différends entre nations. Le combat de haute intensité devient une option très probable ». Cette idée émise par un
responsable militaire dont la mission est d’anticiper les menaces mais qui est tout sauf un va-t-en-guerre dément de
plein fouet le postulat philosophique majeur de l’Union européenne, qui a confié sa défense aux États-Unis, via
l’Otan et a renoncé de ce fait à se doter d’une armée et d’une stratégie propres. Elle dément la croyance qui consiste
à penser que l’on peut conjurer guerres et chocs de civilisation en prônant la paix, la tolérance, en renonçant à son
identité, à tout nationalisme, et en affichant un universalisme droits-de-l’hommiste béat. La radicalisation de la
Turquie d’Erdoğan contre les Européens depuis que ce pays a été déclaré candidat à l’intégration dans l’UE – sans
d’ailleurs en remplir les critères – est l’une des manifestations les plus flagrantes de ce phénomène faussement
paradoxal. On peut bien sûr également évoquer la guerre économique permanente que nous livrent tant nos « amis »
protecteurs nord-américains que la Chine, les desseins de conquête prosélyte de puissances islamiques qui voient
dans le vieux continent européen postchrétien un ventre mou à conquérir par la démographie et en y remplissant le
vide religieux, ou encore les multiples tensions entre puissances nationalistes et autres conflits identitaires partout
dans le monde.
Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R), évoque ainsi des « risques
d’affrontement avec des États non nucléaires disposant de moyens militaires modernes. C’est en particulier le cas de
la Turquie, à laquelle nous pourrions être confrontés en Libye, en Grèce ou en Méditerranée […] beaucoup de pays
du monde ont modernisé leur arsenal militaire alors que les Européens ont tous cherché à profiter des “dividendes de
la paix” et ont baissé la garde. […] Des armements modernes (drones, missiles, aéronefs, moyens de guerre
2
électronique, etc.) sont présents partout, pas seulement chez les grandes puissances militaires ! » Aux risques plus
que jamais d’actualité, mais désormais « classiques », que sont la prolifération nucléaire, la dissémination des
armements (voir chapitre VIII), l’immigration de masse incontrôlée, l’islamisation radicale, le terrorisme et les
mafias transnationales ou narcopuissances, il convient aussi d’ajouter ceux de la nouvelle donne énergétique, des
aléas du contexte écologique, les enjeux de la crise sanitaire et la digitalisation de l’humanité et des cybermenaces
auxquelles les États et les services de sécurité se sont souvent adaptés avec un coup de retard.
Autre manifestation de la mondialisation dangereuse, c’est bien grâce à la globalisation des échanges et des
technologies que les pires ennemis des démocraties, à commencer par la Chine maoïste-capitaliste, mais aussi
d’autres puissances multipolaristes (Turquie, Iran, Pakistan, Corée du Nord) ont réussi à acquérir des technologies et
arsenaux militaires créés par les Occidentaux mais dont ces derniers, avides de délocalisation et de libreéchangisme, n’ont plus le monopole. C’est dans ce contexte de mondialisation que les puissances occidentales et
leurs entreprises stratégiques ont transmis aux outsiders multipolaires des armes et des technologies qui se
retournent aujourd’hui contre elles. Dupés par leurs propres modèles libre-échangistes sans limites, les Occidentaux,
surtout les Européens, sont déjà massivement dépendants de pays jadis perçus comme des zones durablement faibles
où il serait toujours profitable de délocaliser, source majeure de la désindustrialisation de l’Europe – excepté
l’Allemagne – et des États-Unis.
Multiplication des conflits infra-étatiques internationalisés
Avant la montée en puissance du néosultan turc Recep Tayyip Erdoğan et l’intensification du terrorisme
islamiste depuis les années 1995-2001, les pays occidentaux pensaient que la Turquie, pays membre de l’Otan, ainsi
que les puissances islamiques sunnites du Golfe, et le Pakistan, alliées sous la guerre froide, face à l’URSS, étaient
des « amis durables ». Il n’en est rien. Ces pays ont connu paradoxalement un processus de réislamisation radicale et
de montée de l’antioccidentalisme au moment même où, au sortir de la guerre froide, et bien qu’étant nos alliés
stratégiques de longue date ou nos fournisseurs d’énergie, ils entraient de plein fouet dans la modernité
technologique et la mondialisation. En réalité, les élites occidentales et leurs multinationales n’avaient pas prévu les
dommages collatéraux civilisationnels de la mondialisation façon McWorld, laquelle, de par son action
d’acculturation et d’occidentalisation, a suscité de violentes réactions identitaires de la part des nations désireuses de
ne pas subir une « seconde colonisation », à commencer par les partisans des valeurs islamiques. Ces derniers ont
perçu dans la lecture individualiste, libertaire et mondialiste de la globalisation à l’occidentale, une menace
existentielle majeure. Outre le monde musulman, la quasi-totalité des États-nations souverainistes non occidentaux
(Russie, Chine, Turquie, Iran, pays d’Asie du Sud, Inde) ont riposté aux effets déracinant et déconstructivistes de la
globalisation anglosaxonne en la désoccidentalisant, en la désidéologisant et en l’utilisant au contraire comme un
levier d’expansion et de projection de puissance. Décidés à ne pas céder sans identité et souveraineté, ces acteurs ont
canalisé la modernité en fonction de leurs intérêts géocivilisationnels. Bref, l’interconnexion entre aires
géocivilisationnelles et l’internationalisation des échanges ont paradoxalement internationalisé et donc étendu les
sources de conflit et de casus belli…
D’une manière générale, on note que depuis la fin de la guerre froide, les guerres infra-étatiques
internationalisées sont les plus fréquentes et les plus meurtrières, car elles permettent aux grandes puissances de
s’affronter par procuration (dissuasion nucléaire et interdépendance économique entre le tandem Chine-Russie,
3
d’une part, et l’Occident, de l’autre), à travers la participation à des conflits identitaires et des guerres civiles . Par
ailleurs, depuis les années 1990-2000, la politique occidentale de soutien militaire à des forces d’opposition
(révolutions de velours et printemps arabes) ou séparatistes (Kosovo) pour déstabiliser des régimes considérés
antidémocratiques, au nom de valeurs occidentales universelles hégémoniques ou de mobiles issus de la guerre
froide, a contribué à augmenter considérablement le nombre de conflits meurtriers dans le monde, notamment dans
les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique. Le plus souvent, les politiques de « pandémocratisme » et de regime
change voulues par l’Occident (surtout anglo-américain), loin d’avoir remplacé des régimes autoritaires par des
démocraties libérales, ont plutôt abouti à créer des zones de non-droit, des États criminels (Kosovo) ou faillis (Irak,
Libye) et des zones de guerre civile endémique comme l’Afghanistan, le Yémen, la Syrie.
Poussée par une mondialisation acharnée, ladite multiplication des conflits ouverts a pris une telle ampleur au
e
4
cours de la seconde moitié du XX siècle qu’elle a abouti, via la polémologie , à de multiples tentatives de
typologies. L’une de ces tentatives intéressantes est, au-delà de quelques simplifications, celle proposée par le
fondateur de la polémologie française, Gaston Bouthoul, et de son disciple René Carrère, auteurs du Défi de la
5
guerre . Les deux auteurs, à travers cet ouvrage, analysaient trois grands types de conflits : les guerres
interétatiques, les guerres coloniales et les guerres intraétatiques postcoloniales.
D’évidence, les conflits coloniaux décrits par Bouthoul sont quasi inexistants aujourd’hui, puisqu’ils ont été fort
logiquement concentrés sur la période 1955-1975, l’époque d’accession à l’indépendance de pays d’Afrique, d’Asie
méridionale ou de la péninsule indochinoise. Ce type de conflits ouverts s’est progressivement effacé au profit des
guerres intraétatiques, que Bouthoul a qualifiées de « conflits de troisième type ». Le plus significatif réside donc
dans le déclin quantitatif des conflits classiques par rapport aux autres, notamment identitaires et ethnoreligieux. Ce
déclin résulte directement des caractères fondamentaux du système bipolaire engendré par l’après-Yalta et a été
fortement conforté par les effets du nucléaire (voir « Le pouvoir égalisateur de l’atome », dixit Pierre Marie Gallois).
À cette époque, les deux superpuissances ont très vite estimé que tout conflit direct, y compris à l’échelle de leur
zone d’influence respective, serait désormais inconcevable, sous peine de rompre le fragile équilibre des forces, audelà de la sévère crise de Cuba, en 1962, qui faillit plonger le monde dans l’Apocalypse. Dans ce contexte, les
guerres interétatiques ont « privilégié », si l’on peut dire, les nations défavorisées du tiers-monde, d’où la croyance
en vogue dans l’Europe pacifiste, déplorée plus haut, que l’homme blanc-occidental riche et ses démocraties
libérales seraient protégés ad vitaem eternam par les parapluies nucléaires et ne connaîtraient plus jamais de guerre
classique sur leur sol. C’était oublier la montée des guerres asymétriques, identitaires, religieuses, civiles, terroristes,
contre lesquelles l’arme nucléaire d’un État ne peut rien puisqu’elles se passent sur son propre sol.
Échec du multilatéralisme ?
En fin de compte, la multiplication des conflits depuis la fin de la guerre froide peut s’expliquer non seulement
par le fait que la sanctuarisation nucléaire ne suffit pas et ne concerne que peu de nations, mais aussi par l’échec
patent du multilatéralisme, qui n’a réglé pratiquement aucun des conflits, excepté les exemples discutables des
Balkans : échecs au Rwanda, à Chypre, en Israël-Palestine, en République démocratique du Congo, en République
centrafricaine, en Syrie, en Libye, en Irak, en Corée du Nord, au Yémen, en Somalie, et aussi sur le dossier nucléaire
iranien, les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés. La création de l’ONU, suivie de la promotion
officielle durant ces dernières décennies, de la paix internationale, n’a en effet pas réduit les violences, bien que les
antagonismes entre grandes puissances aient été souvent évités et qu’ils se déroulent souvent dans le cadre de
guerres civiles ou conflits asymétriques.
La croyance en la fonction durablement pacifique de la sanctuarisation nucléaire a semblé décrire une réalité
depuis le début de l’ère nucléaire militaire, puisque seuls quatre conflits ouverts, relativement limités, ont opposé
directement des États échappant au dramatique contexte du sous-développement : la guerre des Malouines, entre
6
l’Argentine et le Royaume-Uni, le conflit du Cenepa (la « Cordillera del Condor »), entre Pérou et Équateur, le
conflit du Haut-Karabagh, entre Arménie et Azerbaïdjan et le conflit non officiel certes, mais bien direct, qui oppose
la Russie à l’Ukraine. Si les conflits des Malouines et du Cenepa sont largement oubliés du grand public et si celui
d’Ukraine n’a cessé de s’intensifier depuis 2004 (voir infra), celui du Haut-Karabagh s’est réveillé – tel un volcan –
le 27 septembre 2020, après vingt années de statu quo. Il mérite que l’on s’y penche un instant, sachant qu’il se
déroule sur une zone stratégique, le Caucase, disputée par deux empires renaissants, la Turquie nationale-islamiste
d’Erdoğan, qui a considérablement appuyé son allié et « frère » azéri turcophone, et la Russie slavo-orthodoxe, qui
veut toujours contrôler ces deux États de « l’étranger proche », ex-soviétiques. Ce conflit concerne les Européens au
premier plan, car le pays qui a poussé à la guerre, la Turquie, membre de l’Otan et candidat à l’intégration dans
l’UE, est lui-même au bord de la guerre avec deux pays membres de l’Union, Chypre et la Grèce, ainsi qu’avec des
pays arabes qui partagent avec la Grèce, Chypre ou la France, des intérêts géoénergétiques (voir infra). Le conflit du
o
Haut-Karabagh (voir carte n 10) confirme l’échec du multilatéralisme, manifestation parmi tant d’autres, du fait que
la mondialisation, plus dangereuse et complexe que l’on croit, n’a supprimé ni les motifs de conflits, ni les identités
nationales et civilisationnelles.
Le conflit du Haut-Karabagh
La récente confrontation armée entre l’Azerbaïdjan et les Arméniens du Haut Karabagh (27 septembre10 novembre 2020) n’est que l’énième épisode d’un antagonisme géopolitique violent qui date des années 19881991 : l’Arménie chrétienne ex-soviétique est non seulement enclavée mais surtout prise en tenailles entre Turcs
musulmans sunnites à l’Ouest et Azéris musulmans chiites à l’Est (turcophones également), et n’a de bons rapports
qu’avec les Russes et dans une moindre mesure, avec les Perses voisins, eux-mêmes concurrents des Turcs et des
Russes et méfiants vis-à-vis de l’irrédentisme azéri dans le nord de l’Iran… Bienvenue dans le Caucase ! Dès la
disparition de l’Union soviétique, un conflit ouvert éclata entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à propos du Hauto
Karabagh (ou Nagornyi-Karabakh, voir carte n 10) que les Arméniens nomment « Artsakh ». De fait, il n’est que la
dramatique suite des relations singulièrement tendues, depuis des générations, entre ces deux nations qui viennent
e
d’accéder alors à l’indépendance. Ces tensions, qui remontent au début du XVII siècle, sont renforcées à partir de la
guerre russo-persane de 1804-1813 qui voit la Transcaucasie passer sous le giron russe. Elles entraînent de
douloureuses conséquences régionales, comme les déplacements forcés d’Arméniens de Turquie et d’Iran vers les
horizons du Caucase. Ces relations s’illustrent, au crépuscule de l’Union soviétique, par une guerre sourde et
strictement localisée. Cet événement, du côté des Arméniens de la région, appuyés par Erevan, a permis à l’époque
de qualifier le conflit de « lutte de libération nationale » et non de guerre interétatique entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan.
Deux principes de légitimité s’opposent
Rappelons que le Nagornyi-Karabagh, historiquement arménien depuis deux millénaires (et peuplé à 80 %
d’Arméniens à la veille du conflit), avait été octroyé par Staline en 1921 à l’Azerbaïdjan, voisin dans le cadre de la
politique soviétique de divide et impera, mais aussi pour gagner le soutien du pouvoir kémaliste en Turquie alors en
guerre contre les alliés franco-britanniques. Entre 1988 et 1990, en vue de l’affaiblissement de l’URSS, comme tant
d’autres républiques ex-soviétiques, les Arméniens du Haut-Karabagh ont invoqué le droit à l’autodétermination,
comme l’Azerbaïdjan, vis-à-vis de l’URSS. Mais les Azéris, invoquant les accords d’Helsinki et le principe
d’intangibilité des frontières existantes, ont rétorqué que le Haut-Karabagh est partie intégrante de son territoire
depuis 1921 et que l’Azerbaïdjan, devenu indépendant et reconnu par l’ensemble de la communauté internationale
dans ces frontières de 1921, ne pouvait accepter la sécession des Arméniens du Karabagh, et encore moins leur
rattachement à l’Arménie. Du coup, la région autonome s’est autoproclamée indépendante le 2 septembre 1988 non
pas vis-à-vis de l’Azerbaïdjan, mais du pouvoir central soviétique. En 1988 et 1990, des pogroms antiarméniens ont
éclaté dans la ville de Sumgaït, puis à Bakou et Kirovabad, en Azerbaïdjan, faisant des centaines de victimes et
provoquant d’importants mouvements de populations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
En septembre 1991, l’Assemblée nationale du Haut-Karabagh réitéra sa déclaration d’indépendance, ratifiée par
le référendum du 10 décembre, avec une écrasante majorité de « oui », mais elle n’a jamais été reconnue par aucun
État…, pas même par les Nations unies ou d’autres organisations internationales intergouvernementales qui ne
veulent pas compromettre leurs relations avec l’Azerbaïdjan riche en pétrole et bien plus prospère que la petite
Arménie enclavée, et sous embargo turco-azéri… Pour rétablir leur contrôle sur le Haut-Karabagh, les autorités
azerbaïdjanaises envoyèrent des troupes. Entre 1990 et 1992, une véritable catastrophe humanitaire eut lieu dans
cette région à la suite du blocus imposé par l’Azerbaïdjan. Les Arméniens du Haut-Karabagh, appuyés par
l’Arménie voisine, repoussèrent les Azéris venus rétablir leur souveraineté. Les affrontements inhérents à cette
guerre de libération, qualifiée de « séparatiste » par Bakou, feront de nombreuses victimes. La médiation
internationale de plusieurs groupes, comme l’OSCE, ayant échoué à trouver une solution au conflit qui satisfasse les
intérêts des deux côtés. Au début de l’année 1993, les forces arméniennes, qui avaient l’avantage militaire,
pénétrèrent en territoire azéri et occupèrent une zone qualifiée de « périmètre de sécurité » autour du HautKarabagh, soit 8 000 km² de terres azerbaïdjanaises. À l’issue du conflit au terrible bilan (plus de 40 000 morts,
1 million de réfugiés azéris, 400 000 Arméniens fuyant l’Azerbaïdjan occasionnant d’effroyables massacres, comme
7
celui de Khojaly ), 20 % du territoire azéri fut désormais contrôlé par les forces locales arméniennes : le Haut-
Karabagh et 7 districts voisins, ceux de Fuzuli, d’Agdam, de Djebrail, de Goubadly, de Latchin, de Kelbadjar et de
Zangelan.
Comme Israël dans ses différentes guerres avec les pays arabes, entre 1948 et 1973, les Arméniens de la région
autonome profitèrent de leur avantage militaire pour non seulement reprendre leur province arménienne en territoire
du Karabagh officiellement azéri, mais également pour s’emparer des territoires du Haut-Karabagh (bordures sud)
peuplés d’Azéris, dans une logique d’acquisition d’une zone tampon entre eux et leur voisin ennemi. Ce sera là, près
de trente ans plus tard, la source du revanchisme des dirigeants azéris et de leurs alliés turcs, décidés à laver cet
affront : durant toutes les années 1990 et 2000, puis de façon plus nette encore depuis 2010-2018 avec un appui
politique et militaire turc croissant, Bakou s’est préparé à la revanche, en achetant des armes à tous les pays capables
de lui en fournir : Turquie, Israël, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, France… et même la Russie, pourtant
officiellement protectrice des Arméniens. En réalité soucieuse de vendre ses armes à tous et de maintenir un
équilibre dans un Caucase et une zone Caspienne turcophone extrêmement stratégique et riche en hydrocarbures,
Moscou entend rester présente en ménageant toutes les parties.
Du rôle de la communauté internationale
Dès le milieu de l’année 1992, la communauté internationale tente de mettre un terme à la guerre, via la
8
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) . Le 24 mars 1992, la CSCE officialise la création
9
d’un « Groupe de contact pour le Haut-Karabagh », rapidement appelé « Groupe de Minsk », qui recense onze
participants, dont la France et les États-Unis, rejoints en 1994 par la Russie de Boris Eltsine. Cette triple présidence
France-États-Unis-Russie est en fait le seul forum multilatéral où diplomates russes, américains et français ont
travaillé ensemble. Avant l’intégration de la Russie au Groupe, ce dernier suggère dès avril 1992 la mise en place
d’une force de maintien de la paix « Otan/CEI » pour vérifier la pérennisation du cessez-le-feu et pour protéger les
convois humanitaires. Mais Moscou va s’opposer à cette initiative, refusant le déploiement sur le territoire concerné
d’une force comportant des combattants de l’Otan. Et pour cause, nous verrons dans le chapitre suivant que le
principal motif de l’antagonisme persistant entre l’Occident et la Russie postsoviétique est justement la pénétration
des dispositifs atlantistes et occidentaux dans une zone « réservée » que Moscou nomme son « étranger proche »
(Caucase, Ukraine-Crimée, Biélorussie, Géorgie, républiques turcophones – et autres ex-soviétiques d’Asie
centrale/CEI). Au cours de l’année 1993 (année cruciale), l’ONU tente de reprendre les choses en main : à la
demande du Conseil de sécurité, son secrétaire général, Boutros Ghali, valide un rapport sur la situation du HautKarabagh. Il y rappelle « que les combats dans le Haut-Karabagh constituent une menace pour le maintien de la Paix
et de la sécurité internationale dans toute la Transcaucasie ». L’ONU adoptera quatre résolutions (fort inefficaces) au
cours de cette seule année 1993. Cependant, le conflit reste latent, comme le montrent les nombreux incidents de
10
frontières (2006, 2008, 2010, 2012, 2013, avril-été 2016 , été 2020), qui ont fait chaque fois craindre le retour
d’une guerre ouverte que chacun savait inévitable depuis 2016. Le Groupe de Minsk propose un règlement par
étapes de la question du Haut-Karabagh. Quatre suggestions seront émises, convergeant vers l’obtention d’un
compromis qui comprend la restitution de l’ensemble des territoires occupés par les Arméniens et le droit au retour,
en échange d’une véritable autonomie accordée à la communauté arménienne résidant sur ceux-ci.
11
En juin 2016, le Groupe de Minsk présente des propositions concrètes , reposant sur :
le retrait complet des forces arméniennes des sept districts occupés ;
la démilitarisation du Haut-Karabagh et le déploiement d’une force multilatérale de paix et de sécurité ;
la réinstallation des personnes déplacées et le financement de la reconstruction des villes et des villages
détruits par la guerre ;
in fine, le référendum sur le statut du Haut-Karabagh.
Depuis cette date, plusieurs documents, appuyés ultérieurement par l’ONU, sont validés par l’Otan, l’OSCE, le
Conseil de l’Europe et l’Organisation de la coopération islamique (OCI), pour résoudre le problème conformément
au droit international. Certes, on peut nuancer cette impartialité par le fait que deux membres de l’OCI, Turquie et
Pakistan sont des alliés indéfectibles de l’Azerbaïdjan… Toujours est-il que le multilatéralisme a échoué à régler le
conflit qui éclate à nouveau.
Le retour de la guerre dans le Caucase
Le 27 septembre 2020, une nouvelle guerre éclate dans le Haut-Karabagh, lancée cette fois-ci par l’Azerbaïdjan
avec, ce qui est nouveau, un appui et une coopération stratégiques turcs officiels et déterminés, cela après de
multiples incidents survenus depuis 2016. Cette nouvelle guerre, intense mais localisée dans le Haut-Karabagh, va
durer bien moins longtemps que les précédentes, deux mois seulement, mais elle sera particulièrement meurtrière :
au moins 7 000 à 8 000 morts du côté arménien, et 4 000 à 5 000 côté azéri, d’après les services de renseignements
russes et britanniques. Mais cette fois-ci, les forces azéries ont l’avantage pour trois raisons :
1/ Elles sont bien mieux armées et équipées que dans les années 1990, car elles se sont préparées en utilisant
l’argent de la manne pétrolière qui a permis d’acheter des armes et les drones de haute technologie aux Turcs, aux
12
Israéliens, aux Italiens et à d’autres pays de l’Otan dont la France .
2/ Vladimir Poutine a laissé faire, au départ, la reprise de territoires anciennement azéris du Karabagh acquis
par les Arméniens dans les années 1990, tout en stoppant l’avancée azérie in extremis, ceci dans une logique
d’équilibre mais aussi pour « punir » les Arméniens d’avoir mis au pouvoir, en Arménie, en mai 2018, un Premier
ministre antirusse, Nikol Pachinian…
3/ La Turquie d’Erdoğan envoie des armes, des drones, appuie diplomatiquement l’offensive azérie, puis envoie
des mercenaires djihadistes arabes et turkmènes de Syrie exfiltrés et entraînés par la société de mercenaires Sadat du
général Adnan Tanriverdi. Ce proche d’Erdoğan a recruté depuis des mois des milliers de combattants islamistes et
djihadistes cantonnés, depuis l’échec de Daesh et de la rébellion sunnite anti-Assad, dans le nord-ouest de la Syrie,
en zone sous contrôle turc (zone officialisée en vertu des accords turco-russo-iraniens de désescalade en Syrie signés
lors des rencontres d’Astana et de Sotchi entre 2016 et 2018).
Les Arméniens perdent la guerre. Ils doivent capituler et restituer nombre de territoires azéris du HautKarabagh et même un peu plus, avec le corridor reliant l’Azerbaïdjan à la Turquie via le Nakhitchevan (république
autonome de quatre cent mille habitants peuplée d’Azéris mais jadis d’Arméniens qui en ont été expulsés), tout cela
dans le cadre de négociations entre la Russie et la Turquie, pour la première fois présente dans l’étranger proche
russe (la Russie dispose de son unique base militaire dans la région en Arménie, à Gumri).
On remarquera en passant que, dans le cadre de ce monde multipolaire en voie de constitution, ce n’est pas le
Groupe de Minsk, cité précédemment, qui a fait avaliser le cessez-le-feu du 10 novembre 2020, mais une entente
tripartite fort cynique entre l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Russie, excluant soigneusement des termes de l’accord les
parrains occidentaux du Groupe de Minsk (France, États-Unis) : Erevan s’engage à rétrocéder à Bakou les districts
d’Aghdam et de Kelbadjar ; un corridor est aménagé à Latchin ; le retour des personnes déplacées sera effectué sous
le contrôle de l’ONU ; et, plus concrètement encore, dès le lendemain de la signature de l’accord, deux mille soldats
o
russes sont déployés le long de l’ancienne ligne de front (voir carte n 10).
En fait, l’un des objectifs de guerre de long terme des Azéris, au-delà de la récupération des territoires azéris
pris par les Arméniens en 1993, visait l’obtention, extrêmement importante sur le plan stratégique et idéologique, du
fameux « passage de Meghri », une bande large de dix kilomètres permettant de relier le territoire azéri à l’enclave
azérie du Nakhitchevan, située à l’intérieur du territoire de l’Arménie. L’accord de cessez-le-feu prévoit donc la
création d’un corridor, en terre arménienne, qui reliera l’enclave azérie du Nakhitchevan à l’Azerbaïdjan. C’est une
victoire pour les Azéris, car, géographiquement, cette région n’avait de frontière qu’avec la Turquie, l’Arménie et
l’Iran, mais aucune continuité territoriale avec le reste de l’Azerbaïdjan. De facto, avec ce droit de passage, le rêve
des panturquistes, qui, depuis le génocide arménien de 1915, ont toujours voulu faire la « jonction » entre
turcophones de Turquie et du Caucase, est sur le point d’être réalisé, la continuité territoriale étant désormais
o
possible et extensible (voir carte n 11). D’évidence, la question du Haut-Karabagh n’a pas fini d’envenimer
l’ensemble du Caucase, sur fond de nationalismes irrédentistes et de géoénergie…
La Turquie est entrée en scène…
La paix sera durable tant que les Russes assureront la protection du Haut-Karabagh, certes toujours existant,
mais très peu peuplé, non reconnu par la communauté internationale et réduit à sa partie nord. De plus, on notera que
le couloir de Latchin, seul point de jonction entre l’Arménie et le Haut-Karabagh, est une route étroite qui peut être
coupée à n’importe quel moment par la partie azérie. En Azerbaïdjan, l’objectif stratégique maximal viserait la
reprise de l’ensemble du territoire autonome et donc de la partie encore peuplée par les Arméniens, ainsi que d’une
partie de l’Arménie nécessaire pour assurer une jonction viable plus large entre Turquie, Nakhitchevan et
Azerbaïdjan. Pour ce faire, il faudrait une nouvelle guerre, que les Azéris gagneraient probablement si les forces
d’interposition russes ne restaient pas ou si Vladimir Poutine obtenait des contreparties de la part des parties azérie
et turque… Certes, on n’en est pas là, mais il ne faut jamais oublier, contrairement aux fantasmes de certains
russophiles extrêmes, que Moscou n’est pas une puissance idéaliste chrétienne nécessairement proarménienne, mais
qu’elle cherche à rester présente sur l’ensemble du Caucase riche en hydrocarbures (Azerbaïdjan), traversé par les
routes de transit énergétique, et que dans ce contexte, elle n’a jamais considéré le Haut-Karabagh comme autre
chose qu’une partie intégrante du territoire de l’Azerbaïdjan souverain… Tout dépendra donc des relations futures
entre la Turquie et la Russie, respectivement protectrices de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie.
Bien qu’étant une nation indépendante distincte de la Turquie, de confession majoritairement chiite, encore en
partie russophone, comme les autres pays du Caucase ex-soviétiques, l’Azerbaïdjan, de langue et d’ethnie turques,
est perçue par Ankara comme une nation sœur. Mais cette dernière est coupée des frères azéris par l’obstacle
géographique et humain naturel qu’est l’Arménie : les nationalistes panturquistes ont toujours rêvé de fusionner la
Turquie avec les pays turcophones du Caucase (Azerbaïdjan et autres minorités « tatares ») ou d’Asie centrale
o
(Turkmenistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan voir carte n 11). Avec l’impératif de vider les arrières d’un
des fronts de la Première Guerre mondiale. Ce fut d’ailleurs la motivation première des officiers jeunes-turcs
(« triumvirat »), adeptes du panturquisme raciste (équivalent du pangermanisme hitlérien), qui planifièrent le
génocide des Arméniens d’Anatolie de 1915. Le Président turc a ainsi fait d’une pierre deux coups en appuyant
ostensiblement, politiquement et militairement (coordination entre les armées turque et azérie), cette guerre pour les
« frères turcs azéris » : il fait oublier des problèmes économiques et politiques intérieurs ; il consolide l’alliance
électorale de son parti l’AKP, avec les nationalistes panturcs du MHP ; et il renforce la présence turque dans la
région stratégique et riche en hydrocarbures du Caucase turcophone (mer Caspienne), alors que la Turquie manque
d’énergies fossiles et ne veut pas trop dépendre du gaz russe. Erdoğan a eu l’habileté de négocier cette incursion
dans « l’étranger proche » russe en laissant en échange Vladimir Poutine contrecarrer les projets turcs irrédentistes
13
en Syrie , puis au nom de pactes de non-nuisance réciproques en Libye au-delà de certaines lignes… Certains
disent que la Russie a abandonné les Arméniens et a cédé aux revendications d’Erdoğan. Une lecture moins idéaliste
des événements doit nous rappeler que Moscou ne défend officiellement que l’Arménie reconnue internationalement
et que la Russie n’a jamais reconnu le Haut-Karabagh arménien. En suscitant un accord de cessez-le-feu qui sauve
les Arméniens de la catastrophe totale tout en donnant des satisfactions aux Azéris, la Russie de Poutine accroît en
fait son influence dans le Caucase en tant que puissance d’équilibre dans ce nouveau Grand Jeu russo-turc…
Les leçons de la guerre du Haut-Karabagh
On ne répétera jamais assez la phrase célèbre de Gaston Bouthoul, « préparez Venus viendra Mars »… Les
Arméniens connaissent un déclin démographique catastrophique depuis trente ans ; le Haut-Karabagh s’est vidé,
comme l’Arménie, d’une partie de sa population, les habitants des villages sont en moyenne très âgés et l’Arménie
n’a pas réussi à y fixer les populations faute de dynamisme économique. Il y a depuis longtemps bien plus
d’Arméniens en Russie qu’en Arménie, et nombre d’Arméniens quittent continuellement leur terre pauvre et
enclavée pour aller en Russie ou vers l’Occident. Et si l’Arménie a connu une forte instabilité politique ces dernières
décennies, en face, la riche et plus jeune république d’Azerbaïdjan, certes non démocratique, est remarquablement
stable, avec la dynastie des Aliev, père et fils, au pouvoir depuis 1993.
La première conclusion est qu’avec la Chine et d’autres puissances autoritaires, l’Azerbaïdjan et son système
illibéral semblent démontrer la plus grande efficacité politique des « démocratures », parfois capable de plus de
stabilité par rapport aux démocraties rendues instables par les élections. Et dans le cas arménien, certains ont
observé cyniquement que le pays a été gravement divisé, et de ce fait affaibli, face à son ennemi héréditaire azéri, à
14
la suite d’une alternance problématique largement appuyée par l’Occident …
Une autre leçon de ce conflit turco-azéro-arménien a été la démonstration de l’efficacité des armes
automatisées, robotisées, comme les drones, qui ont fait la différence dans le Haut-Karabagh, dans le cadre d’une
révolution dans les affaires militaires qui s’observe aussi sur des théâtres comme Gaza, ou la Libye, où les différents
acteurs utilisent de façon privilégiée les drones, parallèlement au recrutement de mercenaires, autre phénomène
croissant dans les nouvelles affaires militaires et conflits régionaux. Ce conflit s’inscrit également dans la grille de
lecture de Samuel Huntington qui prédit la multiplication de conflits identitaires dans les zones de fracture et de
contact civilisationnelles.
Le spectre d’une guerre interétatique entre l’Ukraine et la Russie
Toujours dans l’espace postsoviétique, une situation conflictuelle oppose cette fois-ci les deux États les plus
importants ex-membres de l’URSS, à savoir la fédération de Russie et l’Ukraine qui, à elles deux, représentaient
plus des trois quarts du potentiel économique et les deux tiers de la population soviétiques. Les relations entre ces
deux pays sont marquées par un antagonisme croissant caractérisé par un décrochage géopolitique des élites
ukrainiennes qui a commencé avec la révolution orange de 2004 et a évolué en une rupture totale avec
o
l’Euromaïdan, l’annexion de la Crimée et le conflit armé du Donbass (2014, voir carte n 14).
o
Le conflit armé à l’est de l’Ukraine (voir carte n 14), qui a éclaté en 2014 et a fait plus de treize mille morts et
près d’un million et demi de déplacés, n’est pas une simple guerre civile ukrainienne mais oppose dangereusement
les troupes russes à celles de l’Otan en plus de risquer à tout moment d’évoluer en une guerre interétatique entre la
Russie et l’Ukraine, cette dernière compensant sa faiblesse par l’appui occidentalo-américain. Il résulte d’un
antagonisme plus large, opposant, d’une part, les puissances externes atlantistes, indirectement impliquées (Otan) et,
de l’autre, la Russie, directement engagée. Les Ukrainiens y voient un conflit interétatique l’opposant à la Russie,
accusée d’intervenir dans le Donbass en soutenant des rebelles prorusses. En revanche, Moscou affirme qu’il s’agit
d’une guerre civile entre les séparatistes russophones de l’est de l’Ukraine et le pouvoir nationaliste de Kiev.
Rappelons le contexte général : depuis la fin des années 1990, la Russie a connu une certaine reprise
économique soutenue par la hausse des prix des hydrocarbures. Elle essaie donc de transformer cette amélioration
conjoncturelle en influence politique avec comme objectif final la reconstitution d’un espace fondé sur un projet
d’intégration coïncidant largement avec l’Union soviétique et naturellement dominé et guidé par Moscou. Toute la
politique étrangère de Vladimir Poutine s’inscrit dans cette tendance lourde de la géopolitique russe
traditionnellement tournée vers la conquête territoriale des zones qui entourent son noyau central européen
historique. Dans ce dispositif, l’Ukraine représente évidemment la pièce maîtresse qui permet à la Russie de
redevenir une puissance eurasienne car, à partir de ce pays, la Russie peut se projeter à la fois sur la mer Noire, la
Méditerranée orientale et l’Europe centrale et balkanique. D’où la stratégie américaine visant à soutenir en Ukraine,
comme en Géorgie et ailleurs, les forces politiques hostiles à Moscou. Cette manœuvre fait d’ailleurs d’une pierre
deux coups en fragilisant la sécurisation des gazoducs acheminant le gaz russe vers l’Europe de l’Ouest, qui n’est
pas du goût des États-Unis qui y voient un risque de dépendance de l’UE envers la Russie. D’où également
l’hostilité américaine envers le gazoduc Nord Stream qui contourne l’Ukraine, par le nord, appuyé par l’UE, surtout
o
par l’Allemagne (Voir carte n 13).
Les événements du printemps 2021, qui ont failli déboucher sur une guerre directe entre l’Ukraine et la Russie
avec une implication indirecte de l’Otan, illustrent les aléas de ce conflit au départ apparemment intraétatique,
susceptible de conduire dans un second temps à une véritable guerre interétatique. Ceci est inédit pour cette région
du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale si l’on ne tient pas compte des guerres chaotiques survenues
dans les années 1990 en ex-Yougoslavie.
Stratégies et buts de guerres de part et d’autre
Le bras de fer entre la Russie et l’Ukraine le long de la frontière commence fin mars 2021 lorsque la Fédération
de Russie masse des dizaines de milliers de soldats dans les régions russes adjacentes et en Crimée (annexée par
Moscou en 2014). Plusieurs experts russes informés de la situation, comme le spécialiste des questions de défense et
journaliste d’opposition Pavel Felgenhauer, ont dévoilé les supposés plans de guerre russes, révélant que Moscou se
préparait à une grande guerre d’envergure qui devait être lancée par deux grandes percées à partir de Belgorod, vers
le sud, et de la Crimée, vers le nord, afin de prendre en tenailles l’essentiel de l’armée ukrainienne qui se trouvait
dans la partie orientale du pays. L’objectif aurait été de la détruire et d’imposer une solution favorable aux intérêts
russes. Côté ukrainien, certaines sources indiquent qu’il y aurait également une volonté de reproduire le scénario
azéri, pour récupérer militairement les territoires russophones rebelles de l’Est, l’Ukraine escomptant que la Russie
n’ose pas intervenir massivement et directement dans le Donbass pour plusieurs raisons : primo, Moscou n’a pas le
o
droit légal d’intervenir sur le sol ukrainien dont le Donbass (voir carte n 14) fait partie, sachant que l’indépendance
de ces républiques autoproclamées n’a jamais été reconnue par les autorités russes elles-mêmes (comme celle du
Haut-Karabagh). Ainsi, Kiev croyait que Moscou se serait comporté dans le Donbass de la même façon qu’elle l’a
fait au Nagornyi-Karabakh, c’est-à-dire en suivant scrupuleusement le droit international et les frontières légales
reconnues. Secundo, l’Ukraine espérait que la menace des sanctions très lourdes infligées par l’Occident à la Russie,
si elle optait pour un scénario de guerre directe, dissuaderait Moscou d’agir de la sorte. Tercio, le soutien indirect de
l’Alliance atlantique, qui s’est montrée solidaire de l’Ukraine en mobilisant des troupes et en se disant prête à
dépêcher des bâtiments de guerre en mer Noire, a constitué une autre forme de dissuasion car cela aurait pu
déboucher sur une guerre conventionnelle à grande échelle que la Russie ne pourrait pas gagner ou se permettre de
livrer. Il convient aussi de souligner que cette crise a récemment pris une forme différente car le président américain
Joe Biden est intervenu directement en soutien de Kiev, à la différence des réactions prudentes de Barack Obama en
2014, secondé d’ailleurs par Biden lui-même, alors adepte de l’apaisement.
Il est vrai que depuis lors, l’armée ukrainienne s’est considérablement rénovée : en 2014, elle ne pouvait aligner
que 6 000 soldats prêts au combat, alors qu’aujourd’hui elle compte des dizaines de milliers de soldats bien entraînés
par des instructeurs américains et canadiens présents en Ukraine dans le cadre d’accords de coopération militaire. Le
budget de l’armée ukrainienne a été augmenté et les forces nationales restructurées. Le géopolitologue Viatcheslav
Avioutskii rappelle ainsi qu’en 2020, le Pentagone a accordé 250 millions de dollars au titre de l’aide militaire aux
forces armées ukrainiennes. Les Ukrainiens ont cependant toujours réfuté les rumeurs d’intention guerrière en
insistant sur le fait qu’ils cherchent une solution diplomatique, le président Volodymyr Zelensky ayant même
proposé une nouvelle rencontre personnelle dans le Donbass ukrainien à Vladimir Poutine. Mentionnons également
le soutien de la Turquie d’Erdoğan au camp nationaliste ukrainien : le néosultan essaie d’utiliser l’Ukraine dans ce
jeu d’échecs régional – au même titre qu’il le fait en Syrie et en Libye. À l’apogée de la crise du printemps 2021, il
est d’ailleurs intéressant de rappeler la visite du président ukrainien Zelensky à Ankara pour afficher le soutien
d’Erdoğan à sa cause, cela avant même de se rendre à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron… Ce dernier a
d’ailleurs évité de s’impliquer dans cette affaire trop délicate et problématique pour lui, d’autant qu’il est à couteaux
tirés avec le néosultan turc et demeure objectivement du côté russe sans l’avouer.
Ce conflit existentiel russo-ukrainien, alimenté par la nouvelle guerre froide russo-occidentale, peut-il vraiment
être résolu autrement que par la guerre ? Le scénario le plus probable est que l’Ukraine obtiendra à terme son
intégration au sein de l’Otan, de plus en plus empathique envers sa cause, et qui profitera de ce prétexte pour
s’étendre toujours plus à l’est au détriment de « l’étranger proche russe ». Ceci pourrait donner la possibilité à
l’Ukraine de récupérer militairement un jour ses territoires contestés, ou au moins forcer la main à la Russie dans le
cadre de négociations. Cependant, Moscou n’acceptera pas facilement ce type de scénario d’empiétement majeur sur
son pré carré. Vladimir Poutine pourrait alors avoir recours à de nouvelles escalades du type de celle du
printemps 2021. La guerre avec l’Occident (Otan), directe ou indirecte, n’est quant à elle pas totalement à exclure,
certes dans le scénario le plus pessimiste. Cela signifierait que la Russie, si elle est encore contrôlée par les forces
hostiles à l’Alliance atlantique, accentuerait son rôle d’État multipolariste soutenant des États hostiles à l’Occident,
dont la Chine, la Corée du Nord, l’Iran, et toutes les autres forces alternatives. Cet énorme gâchis géopolitique, qui
empêche toute réconciliation occidentalo-russe panoccidentale, serait désastreux pour l’autonomie stratégique de
l’Europe et la sécurité collective des Occidentaux, et ne bénéficierait qu’aux deux grands prédateurs civilisationnels
et stratégiques revanchards que sont l’islamisme radical étatique ou transnational et la Chine néomaoïste.
Taiwan : vers un affrontement direct Chine-États-Unis ?
La situation actuelle à Taiwan est également fortement sismique. Depuis avril 2021, les potentialités belligènes
du contentieux qui oppose depuis des années, sur le terrain diplomatique et politique, la Chine communistecontinentale à l’île de Taiwan, se sont nettement intensifiées. Le 12 avril 2021, la pénétration de vingt-cinq avions
15
de combat chinois dans la zone de défense aérienne de Taiwan a constitué la plus grande incursion de l’armée
chinoise dans la zone que Pékin a cherché longtemps à isoler diplomatiquement avec succès au nom du slogan « une
seule Chine », mais que le président chinois Xi Jinping a promis d’annexer de son vivant de gré ou de force.
L’urgence de la situation a été pointée du doigt devant le comité des forces armées du Sénat américain le 9 mars
16
2021 par Philip Davidson, le chef du commandement du Pacifique des États-Unis , pour qui une guerre serait
même possible entre les États-Unis et la Chine si cette dernière maintenait son engagement d’envahir Taiwan avant
la fin de la décennie. Davidson a notamment averti que les États-Unis ont toutefois fort peu de chances d’empêcher
cette invasion, car la Chine possède l’avantage, que ce soit du point de vue du nombre que du point de vue
logistique, les bases chinoises n’étant qu’à deux cents kilomètres de Taiwan. En réponse aux avertissements et aux
velléités interventionnistes de l’administration Joe Biden tant dans les prés carrés russes (Ukraine) que chinois (mer
de Taiwan), la Russie et la Chine ont d’ailleurs uni leurs forces pour menacer les États-Unis simultanément dans
deux points chauds. Ainsi, le 13 avril 2021, au moment où les forces russes se sont massées à la frontière
ukrainienne alors que les navires de guerre américains se préparaient à entrer dans la mer Noire, le vice-ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a mis en garde l’équipe Biden contre toute implication en Ukraine,
et le même jour, quand les navires de guerre américains ont tenté de dissuader en vain l’aviation chinoise de pénétrer
en masse dans l’espace aérien de Taiwan, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian,
mettait en garde l’administration Biden lors d’une conférence de presse contre toute implication à Taiwan. Pour la
première fois, les deux régimes ont symboliquement synchronisé leurs avertissements, mettant en garde les ÉtatsUnis de ne pas franchir la ligne rouge pouvant mener à un conflit ouvert. Nul doute que c’est en partie dans le but de
tenter de conjurer cette « alliance antihégémonique » tant redoutée par Brzezinski et dans le cadre de la prise de
conscience de la menace chinoise croissante que le président Biden a tenté d’initier un apaisement avec la Russie
lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, à Genève, le 16 juin 2021. Mais l’on est d’autant plus loin d’un reset
avec Moscou que, quelques jours plus tôt, lors du sommet de l’Otan, le 14 juin, à Bruxelles, les États-Unis ont ciblé
une fois de plus l’ennemi russe et le tandem russo-chinois, accusé de « rejeter l’ordre international fondé sur des
règles », comme si les États-Unis et l’OTAN les avaient eux-mêmes respectées (Balkans, Irak, Lybie, etc)…
La « surreprésentation » des conflits intraétatiques
Aujourd’hui, les conflits intraétatiques sont ultramajoritaires. Durant la période 1975-2000, sur vingt-huit
conflits de premier ordre, huit sont interétatiques, six postcoloniaux et quatorze intraétatiques. Entre 1990 et 2018,
sur quatre-vingt-seize conflits de premier ordre, les soixante premiers conflits sont ou ont été clairement
intraétatiques. On peut citer, par exemple, la guerre civile syrienne, sur laquelle nous reviendrons, celle du Yémen,
toujours en cours, qui oppose rebelles chiites-houthistes soutenus par l’Iran, d’une part, aux sunnites
progouvernementaux liés aux Frères musulmans et aux monarchies du Golfe, de l’autre, soutenus par les États-Unis
et l’Occident ; le conflit intercommunautaire opposant les Philippines à la Malaisie dans l’État malaisien de Sabah
17
(2013) ; les conflits africains, surreprésentés : Congo/Kinshasa ; Ethiopie, où les rebelles de la région dissidente du
Tigré (Nord), en guerre contre le pouvoir central et son ethnie majoritaire (Oromo), ont pris les principales villes de
la zone, Adigrat, Shiré et depuis le 29 juin 2021, la capitale régionale Mekele ; Côte d’Ivoire (opposition entre
18
ethnies rivales, Nord rebelle et capitale, puis entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara) ; Kivu ; République centrafricaine
(luttes interethniques et conflits sédentaires chrétiens/musulmans venus du Nord), génocides du Soudan (19902000 : chrétiens du Sud-Soudan et musulmans noirs du Darfour exterminés par la junte nationale-islamiste arabe du
Nord) ou du Rwanda (1994, Hutus contre Tutsis). Ce dernier conflit a été cruellement révélateur de l’impuissance
des Nations unies et donc du dit « multilatéralisme » vanté par les adeptes de la mondialisation heureuse et de la
« gouvernance mondiale »… On peut citer aussi bien évidemment l’éternel conflit israélo-palestinien, qui a semblé
revenir sur le devant de la scène avec la brève guerre Tsahal-Hamas à Gaza, en mai 2021. Toutefois, avant même
cette crise, qui a révélé l’extrême isolement du Hamas, non soutenu par l’Autorité palestinienne et par la plupart des
pays arabes, on a pu constater depuis lesdites « révolutions arabes » que le conflit israélo-palestinien a été relégué au
second plan, un phénomène renforcé avec les accords d’Abraham de septembre 2020 qui ont scellé la réconciliation
entre l’État juif et cinq pays arabes sous l’impulsion des États-Unis et des Émirats arabes unis (alliance contre
l’ennemi commun iranien). Durant l’été 2006, une guerre voisine avait déjà opposé Israël à l’homologue chiitelibanais du Hamas, le Hezbollah, lui aussi appuyé par l’Iran (« guerre des 33 jours »), mais il ne s’agissait pas
officiellement d’une guerre interétatique Liban-Israël. On pense bien sûr aussi aux conflits du Caucase : celui de
Géorgie, en 2008, qui opposa les séparatistes prorusses ossètes du Nord et abkhazes à la Géorgie pro-occidentale de
l’ex-président Mikheil Saakachvili, sur fond de tensions occidentalo-russes ; celui qui opposa trois fois forces
arméniennes et Azerbaïdjan, analysé plus haut, ou encore celui de Tchétchénie, où se sont opposés, dans les
années 1990-2000, une première fois les rebelles indépendantistes puis les djihadistes à Moscou et, une seconde fois,
les séparatistes islamistes et djihadistes internationaux wahhabites aux partisans prorusses du clan tchétchène de
Hamkhat et Ramzan Kadyrov…
Trente-sept conflits ouverts en cours aujourd’hui
Concernant les trente-sept conflits ouverts toujours en cours, exception faite du Donbass et du Haut-Karabagh,
la présence des États de l’hémisphère Sud demeure écrasante :
Irak : conflits internationalisés entre chiites et sunnites ; Kurdes et Arabes ; djihadistes et nationalistes ;
Libye : conflits internationalisés entre, d’abord, les pro- et les anti-Kadhafi durant le printemps arabe puis,
ensuite, entre les forces islamistes proturques de Tripoli liées à la Turquie et au Qatar et l’armée du
maréchal Haftar soutenue par les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Russie et la France ;
Syrie : cinq cent mille morts des « guerres dans les guerres » entre, d’une part, le régime de Bachar alAssad, appuyé par l’Iran et la Russie, et, de l’autre, la rébellion sunnite appuyée par l’Occident, la Turquie
et les monarchies du Golfe et les légions djihadistes d’al-Qaida et Daesh, elles-mêmes en guerre contre les
séparatistes kurdes pro-occidentaux du Nord ;
Somalie : implosion du pays en trois entités et prise de contrôle par les djihadistes des tribunaux
islamiques et des shebabs pro-al-Qaida liés aux pirates ;
Nigeria : entre chrétiens du Sud et musulmans du Nord et entre États fédérés et fédéraux et djihadistes de
Boko Haram, etc. ;
Cachemire : province indienne majoritairement peuplée de musulmans revendiquée par le Pakistan
islamique, etc. ;
Sahara occidental : conflit qui oppose depuis des décennies des indépendantistes du Sahara occidental au
Maroc qui le revendique et l’occupe en grande partie, un conflit en train de resurgir.
Taiwan : conflit précité entre la Chine d’un côté, et Taiwan et son allié les États-Unis de l’autre ;
Égypte/Éthiopie/Soudan : conflit autour du barrage du Nil de l’Éthiopie (voir chapitre X).
Dans tous ces conflits, l’efficacité des Nations unies et en général du multilatéralisme est nulle, et les rares
avancées constatées dans le conflit israélo-palestinien mentionné plus haut ou dans d’autres antagonismes réglés ou
gelés sont, dans l’écrasante majorité, dues à des négociations de Realpolitik et aux rapports de force…
La zone Sahel devenue une des plus létales au monde…
La situation du Mali/Burkina Faso, et en général dans le Sahel, zone grande à elle seule comme toute l’Union
européenne, est particulièrement préoccupante et confirme le constat exprimé plus haut de l’échec du
multilatéralisme comme des interventions militaires lancées avec l’aval des Nations unies ou d’instances
multilatérales régionales, comme le G5 Sahel, l’Union africaine ou la Cedeao : l’intensification et l’extension des
actions terroristes vers le sud touchent de plus en plus de régions et d’États d’Afrique. Le conflit malien, initié en
2012 par l’alliance explosive de groupes séparatistes et djihadistes au nord, en guerre contre la capitale, s’enlise
depuis déjà dix ans. Il ne cesse de prendre de l’ampleur, avec un nombre d’acteurs croissant, dont une multitude de
groupes locaux, arabo-berbères au départ, et de plus en plus peuls, qui ont prêté allégeance tantôt à Aqmi/al-Qaida
au Maghreb islamique, tantôt à l’État islamique (EI) au Sahel. L’armée malienne est totalement dépassée, comme
l’ensemble des pays du G5 Sahel, et l’armée française n’a pas obtenu de résultats (opérations Serval, Épervier et
Barkhane), faute de forces assez nombreuses et de solutions politiques et économiques viables associées. Son échec
a débouché sur une suppression de ses bases au Nord Mali et sur une réduction des effectifs militaires dans la zone
Sahel de 5 100 à 3 000 soldats. En août 2020, les forces armées maliennes ont perpétré un coup d’État qui a conduit
au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013. De plus, l’escalade des violences
intercommunautaires (entre les ethnies dogons et peuls) ne cesse de s’étendre aux pays voisins, notamment le
19
Burkina Faso , et même jusqu’au Bénin ou à la Côte d’Ivoire, jadis épargnés. Entre 2012 et 2020, on y a recensé
20
plus de 8 000 morts, dont 2 700 civils . Le 20 avril, c’est face à des rebelles terroristes du Nord du Tchad que le
président tchadien, Idriss Déby, meilleur allié de la France contre le jihadisme, a trouvé la mort. Une énième
conséquence de la folle guerre franco-américano-britannique qui a fait de la Libye l’épicentre chaotique qui alimente
en armes et mercenaires tout le jihadisme sahélien…
L’incessant conflit du Cachemire entre Inde et Pakistan
Un autre conflit interétatique qui perdure et qui n’a pas été éteint par le multilatéralisme onusien concerne
l’Inde et le Pakistan, toujours à couteaux tirés : avec la révocation de l’autonomie constitutionnelle du Cachemire
indien, en août 2019, le conflit qui oppose le Pakistan islamique, parrain des talibans et d’al-Qaida, et l’Inde, dirigée
par le parti intégriste hindouiste BJP, s’est intensifié, avec 582 bombardements transfrontaliers en 2019 (contre 349
21
en 2018 ), soit une augmentation de près de 70 %, poussant New Delhi à déployer des dizaines de milliers de
militaires à la frontière. La crainte d’une guerre entre les deux nations possédant le feu nucléaire se fait donc de plus
en plus ressentir, même si elle se traduit par l’emploi d’armes conventionnelles. Mais comment être certain que ces
deux pays ennemis n’utiliseront jamais le feu nucléaire, comme d’autres d’ailleurs, d’autant que le Pakistan est
travaillé de l’intérieur par des groupes islamistes liés à al-Qaida et aux talibans et que l’intégrisme hindutva
antimusulmans a gagné du terrain ces dernières décennies en Inde ? Après ces événements, le Premier ministre
pakistanais, Imran Khan, a d’ailleurs déclaré : « Quand le couvre-feu sera levé, ce sera un bain de sang. Si une
22
guerre commence entre nos deux pays, tout peut arriver », laissant planer la menace d’un conflit nucléaire . L’Inde
elle-même n’est pas épargnée par les tensions interethniques et religieuses internes, notamment entre hindous et
musulmans, en dehors du territoire disputé du Cachemire. Une fois de plus, les avertissements de Samuel
Huntington sur le fait que les chocs entre civilisations ne sont pas empêchés par la globalisation des échanges et les
facteurs de contacts mais parfois même multipliés par eux sont plus actuels que jamais.
La multiplication des tensions et conflits locaux en Asie
Prenons cette fois-ci l’exemple de l’Asie-Pacifique, bien moins sage que le laissent accroire les lieux communs
occidentaux sur l’Asie bouddhiste-hindouiste zen et pacifique. À l’heure actuelle, on peut y recenser une bonne
soixantaine de contentieux susceptibles de déboucher sur un conflit ouvert. Nous pouvons citer notamment :
les tensions permanentes entre la Chine et le Japon, les Philippines et la Malaisie, le Japon et la Corée du
Sud, la Malaisie et l’Indonésie ;
les litiges frontaliers entre la Chine et le Viêtnam, le Myanmar (Birmanie) et la Thaïlande, le Cambodge,
le Viêtnam, Singapour et la Malaisie.
Le Japon, par exemple, reste directement impliqué dans quatre contentieux régionaux majeurs :
la question des rochers Liancourt, occupés depuis 1954, au cœur de la mer du Japon ;
les îles Ryukyu, environnées d’un plateau continental très riche, revendiquées simultanément par le Japon,
la Chine de Pékin, la Chine de Taipei et la Corée du Sud ;
le secteur méridional de l’archipel des Kouriles, qualifié par Tokyo de « territoires du Nord »,
originellement peuplé de Japonais, expulsés ensuite, mais occupé par la Russie depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Cet archipel revêt un fort intérêt économico-stratégique pour la Russie, car il recèle des
23
réserves minières et de terres rares, comme le rhénium , ainsi que des gisements de pétrole et de gaz, il
constitue aussi une porte stratégique sur le Pacifique pour les deux bases navales russes de Vladivostok,
d’où les navires partent via le détroit qui ne gèle pas en hiver entre les îles Kounachir et Itouroup, deux
des quatre îles Kouriles ;
le contentieux autour des îles Senkaku (ou Diaoyu en chinois), revendiquées par ces mêmes puissances où
la situation est devenue très conflictuelle depuis que le gouvernement japonais a décidé, en
24
septembre 2012, de nationaliser trois des cinq îles de l’archipel qui se situent en mer de Chine orientale.
Cette crise met en perspective une dimension géostratégique importante avec pour toile de fond une
concurrence pour le leadership régional et un contrôle des nombreuses richesses de la région, la zone
25
ayant un grand potentiel économique notamment grâce aux importants gisements d’hydrocarbures . Les
tensions en mer de Chine orientale risquent donc de se prolonger, à moins que les deux pays décident de
s’entendre sur une gestion commune des ressources naturelles de la région.
La Chine à l’assaut de la mer de Chine méridionale
o
Un conflit similaire oppose également, autour de l’archipel des Paracels et des Spratleys (voir carte n 6),
plusieurs pays du Sud-Est asiatique : Chine, Viêtnam, Taiwan, Philippines, Malaisie, etc., lesquels se disputent la
souveraineté territoriale de ces îlots qui occupent une place hautement stratégique, puisque environ un tiers du trafic
maritime mondial y passe… Depuis plusieurs décennies, 15 km² de terres émergées comprenant 230 îles dispersées
sur 425 000 km² de mers sont au centre des tensions régionales en mer de Chine méridionale, que les Vietnamiens
appellent « mer de l’Est ». L’enjeu est d’obtenir les zones économiques exclusives (ZEE) les plus élargies possible,
en fonction du droit international, pour les uns (Viêtnam), et contre celui-ci pour les autres (Chine), les buts
stratégiques étant l’exploitation des ressources naturelles, puis le contrôle des grands détroits régionaux. Le
Viêtnam, puissance émergente du monde multipolaire, qui tente de réaffirmer sa maritimisation régionale, ne
os
pouvant pas lutter à armes égales contre la Chine, mise sur le dispositif de l’Asean (voir cartes n 3 et 4), qui inclut
des pays partageant les mêmes préoccupations (Malaisie, Philippines, Brunei), et se rapproche des États-Unis,
l’ancien ennemi juré, ainsi que de l’Inde, et de l’Australie dans une logique d’endiguement de la Chine. Le conflit
des Spratleys et Paracels illustre à merveille le processus en cours de reconfiguration multipolaire du monde et les
sérieuses limites de l’arbitrage international et du multilatéralisme au profit des purs rapports de force… Ainsi,
lorsque la Cour d’arbitrage permanente de La Haye s’était prononcée en 2016 en faveur de Manille à propos du
contentieux des Paracels (voir chapitre IX), Pékin avait répondu de façon décomplexée qu’elle n’accordait aucune
légitimité à cette décision…
L’aberration géopolitique de la question nord-coréenne
Comme l’actualité l’a souvent évoqué en raison des personnalités particulières de Donald Trump et du tyran
nord-coréen Kim Jong-un, la région Asie-Pacifique est aussi marquée par les conséquences d’une véritable
aberration géopolitique : le contentieux coréen se traduit par un armistice vieux de deux tiers de siècle, sans
signature de traité de paix et par les spécificités inquiétantes du régime communiste nucléaro-centré nord-coréen qui
entretient des relations conflictuelles avec le reste du globe en général, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis en
particulier.
Le régime de Pyongyang est la plus terrible dictature de la planète. L’armée contrôle la police politique qui
espionne tout le monde et encourage la délation. Dans une douzaine de camps de concentration, cent cinquante mille
prisonniers, opposants politiques et droit-commun confondus, croupissent au nom de l’idéologie officielle maoïstestalinienne-nationaliste du juche, qui divinise quasiment le leader suprême et sa dynastie. Toutes les ressources du
pays sont détournées au profit de la dynastie Kim alors que la majorité des habitants dispose à peine de quoi se
nourrir. Ce pays, qui avait été rangé dans la catégorie d’« État voyou », menace régulièrement de frappe nucléaire
l’archipel japonais et les îles Hawaï, et négocie ainsi, par la terreur, des aides humanitaires et financières récurrentes.
Séoul est directement la cible d’assassinats politiques, détournements d’avion, attaques terroristes, chantages de la
part de Pyongyang. Tout cela a motivé les administrations américaines néoconservatrices de G. Bush Jr à ranger la
Corée du Nord dans l’axe du mal. Ceci dit, il convient de comprendre la rationalité du régime nord-coréen et la
raison de sa longévité, ceci malgré l’horrible famine qui a décimé 6 % de sa population. De ce point de vue, le
jugement de valeur moral stigmatisant Pyongyang « ne permet pas, non plus, d’expliquer pourquoi le Nord remporte
26
chacune des parties de bras de fer qui l’opposent à la communauté internationale , observe justement Pascal DayezBurgeon. […] Grâce au chantage humanitaire, il a obtenu des programmes de l’ONU, de la Chine, des États-Unis et
de nombreuses ONG sud-coréennes, l’aide indispensable pour survivre. Grâce au chantage nucléaire, il s’est
également ménagé l’appui de Washington », qui a soutenu un temps ses ambitions nucléaires civiles…
Quant à la Chine, elle doit manœuvrer habilement. Et si elle a parrainé les rencontres de dialogue en vue de la
paix entre Kim Jong-un et Donald Trump depuis 2017, c’est aussi parce que le régime de Pékin n’a pas intérêt à ce
que la menaçante dictature stalino-maoïste autarcique continue à être « l’ennemi utile » qui justifie le renforcement
du dispositif balistique, radar et antimissile de l’armée américaine dans la région. Cette présence étatsunienne
stratégique (sous-marins lanceurs d’engins, flotte américaine en mer de Chine, coopération de défense avec la Corée
du Sud et le Japon, etc.) est fort problématique pour la capacité de dissuasion chinoise et son objectif de contrôler
son flanc maritime sud. La Corée du Nord, enfin, joue très bien le rôle du « fou » qui s’oppose au fort, dans une
sorte de travestissement de la doctrine du général Gallois dite « du faible au fort », devenue « du fou au fort ».
D’autres, à commencer par le dictateur Kim Jong-un lui-même, ont parlé « d’assurance-vie » : l’Irak et la Libye ont
renoncé à leurs programmes nucléaires et n’ont pas échappé aux interventions militaires occidentales de regime
change, se plaît souvent à répéter Kim Jong-un, à juste titre d’ailleurs. Il est vrai que quelques ogives nucléaires
associées à des missiles balistiques de longue portée suffisent à calmer les plus grandes puissances, dont plus aucune
des capitales ne demeure à l’abri. Contrairement à Saddam Hussein ou à Kadhafi, la Corée du Nord a eu
l’intelligence de ne pas attendre longtemps avant de lancer un programme de développement du nucléaire qu’aucune
puissance ne peut plus se permettre aujourd’hui de bombarder. La morale de cette histoire est que les Occidentaux,
en renversant deux régimes qui ne les avaient pas ou plus agressés (Irak, Libye), une fois que ceux-ci avaient
renoncé au nucléaire militaire, ont donné des raisons à tous les autres régimes voyous ou antioccidentaux du monde
qui en auraient les moyens de ne jamais renoncer au nucléaire, ou d’y songer fortement en tant qu’assurance-vie…
La superpuissance montante et revancharde chinoise
La Chine a connu de profonds bouleversements depuis un demi-siècle sur le plan des relations internationales.
Pourtant, une constante l’anime : essayer de conjurer par tous les moyens le spectre des concessions, notamment visà-vis de l’Occident, qui obligèrent la Chine à céder des pans de son territoire et plusieurs de ses ports, dont Hong
Kong, aux puissances européennes, dans la foulée des deux guerres de l’opium (1839-1842, 1856-1860). Ces
affronts n’ont jamais été oubliés ni pardonnés par Pékin. Et les stratèges, dirigeants et chroniqueurs chinois évoquent
régulièrement l’humiliation passée des occupations de Pékin et Shanghai, etc. Outre ces contentieux historiques,
dont Hong Kong est un des symboles, deux faits majeurs ont rappelé que la Chine est de plus en plus sûre d’ellemême : parallèlement aux incidents de frontières avec la Russie le long du fleuve Amour – rivalité qui persiste
malgré leur alliance stratégique au sein de l’OCS (voir chapitre V) –, son contentieux avec l’Union indienne, d’une
part, et son souci de s’affirmer comme une véritable puissance maritime, d’autre part, sont des tendances lourdes.
Deux contentieux frontaliers ont ainsi resurgi récemment entre la nouvelle superpuissance chinoise et l’Union
indienne, puissance nucléaire depuis 1974 : après une période de relative accalmie, les pays rivaux sont en situation
de conflit latent à l’est du Cachemire (également source de conflits pérennes avec le Pakistan, autre puissance
nucléaire), et l’on se souvient de la guerre sino-indienne de 1962, brève mais très violente, pour le contrôle des
territoires himalayens. La Chine occupe trois territoires revendiqués par l’Inde, dont le Ladakh, d’un haut intérêt
stratégique, où les armées chinoises et indiennes ont été au bord du conflit en 2019-2020 et où la Chine a multiplié
les bases militaires. Pékin a également remis en question l’accord dit « de la ligne MacMahon » et s’est installé dans
l’Himachal Pradesh. Plus important peut-être à l’échelle de l’Asie-Pacifique : l’affirmation de la puissance maritime
chinoise se traduit en particulier par la multiplication de ses installations militaires au large de son littoral et de
manière spectaculaire en mer de Chine méridionale, de Food Island à Mischief Reef, en passant par Fiery Cross…
Au-delà de cet exemple édifiant, un constat général s’impose : les contentieux de premier ordre, susceptibles de
dégénérer en conflits ouverts, sont plus que jamais d’actualité et se sont nettement multipliés. Ceci étant, cette
observation s’explique aussi par la découverte et l’exploitation d’appréciables ressources naturelles. Le politiste
américain Michael L. Ross, de l’Ucla (l’Université de Californie à Los Angeles), avait pu écrire naguère « que les
économies d’extraction constituent une véritable malédiction dans la mesure où les probabilités de conflits ouverts
dans les pays possédant du pétrole, du gaz, des diamants, des minerais rares ont fortement augmenté au cours du
27
dernier tiers de siècle, au même titre que le nombre de groupes rebelles multipliant ici ou là les exactions ». Nous
verrons au cours des passages de cet essai consacrés aux énergies, aux guerres de l’eau et des terres rares que les
exemples ne manquent pas (voir chapitre X).
Un monde d’incertitudes, de risques asymétriques et de retour des
conflits de haute intensité
Pour récapituler, dans le monde instable et multipolaire qui vient, les conflits majeurs et potentiels – qui ne
comprennent pas les risques climatiques ou sanitaires, plus indépendants des agendas politiques et géopolitiques et
étudiés plus loin – peuvent être fondés sur :
des antagonismes géoénergétiques ou autour de l’eau et des terres rares ;
la persistance des rivalités et conflits infra-étatiques internationalisés ou régionalisés ;
la guerre géoéconomique et financière autour des rivalités entre l’Occident et ses outsiders et entre les
acteurs principaux du monde polycentrique ;
des conflits identitaires que Samuel Huntington a rangés dans la catégorie des « chocs de civilisations » ;
des phénomènes migratoires de masse incontrôlés ;
le terrorisme international, très majoritairement islamiste ;
les chocs des empires naissants ou résurgents (néo-ottomanisme turc versus nationalismes arabes et
Europe ; États-Unis versus Chine et Russie).
1. Jacques Soppelsa, Les Sept Défis capitaux du nouvel ordre mondial, Paris, A2C Médias, 2009.
2. Entretien avec Éric Denécé, « Nouvelles menaces, nouveaux risques, nouveaux défis, la France est-elle préparée ? », Atlantico, 28 janvier 2020.
3. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, ex-Yougoslavie, Ukraine, Géorgie, Yémen, Soudan, Mali, Somalie, RCA, Côte d’Ivoire, RDC.
4. Étude scientifique de la guerre considérée comme « phénomène psychologique et social ».
5. Gaston Bouthoul et René Carrère, Le Défi de la guerre. 1740-1974 : deux siècles de guerre et de révolution, Paris, PUF, 1976, p. 34.
6. Conflits frontaliers entre le Pérou et l’Équateur en janvier-février 1995.
7. À Khojaly, les forces arméniennes vont massacrer 613 civils, dont 63 enfants et 70 vieillards et déplacer 1 275 otages. Les circonstances, que la
propagande azérie qualifie de « génocide », demeurent non élucidées.
8. Devenue à partir de 1995 l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
9. En mai 1994, suite à la guerre du Karabakh, le Groupe de Minsk est médiateur pour signer le traité de Minsk qui organise un cessez-le-feu au
Haut-Karabagh. Il est alors coprésidé par les États-Unis, la France et la Russie et inclut l’Allemagne, la Biélorussie, la Finlande, l’Italie, les PaysBas, le Portugal, la Suède, la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
10. Durant la guerre d’avril 2016 (« guerre de 4 jours »), l’armée azérie a tenté de reprendre le Karabakh par la force, un cessez-le-feu avait été
obtenu grâce à la médiation russe. Ankara n’a alors pas bougé. La nouveauté de 2020 a été la supériorité technologique des Azéris et la participation
active de l’armée turque.
11. « Principes de Madrid », www.chroniques-diplomatiques.eu/2010/03/les-principes-de-base-de-madrid-et-le.html.
12. Via la vente de satellite d’observation soi-disant civil…
13. Alexandre Del Valle, « Haut-Karabakh. Du Caucase à l’Afrique, de Libye en Azerbaïdjan : les nouveaux fronts stratégiques d’Erdoğan »,
Atlantico, 12 octobre 2020.
o
14. Voir Tigrane Yégavian, « Les Diasporas turque et azerbaïdjanaise de France : instrument au service du panturquisme », rapport n 27 du CF2R,
téléchargeable sur https://cf2r.org/.../les-diasporas-turques-et.../.
15. « Tensions. Taïwan dénonce une incursion record de 25 avions militaires chinois près de ses côtes », Courrier international, 13 avril 2021.
16. Thomas Romanacce, « L’US Army devrait utiliser la quasi-totalité de ses ressources pour repousser une invasion chinoise à Taiwan », Capital,
27 avril 2021.
17. Première guerre du Congo (1996-1997), entre le président zaïrois Mobutu Sese Seko, l’Angola et l’Ouganda, qui verra la victoire de LaurentDésiré Kabila, créateur de la République démocratique du Congo ; et deuxième guerre du Congo (1998-2003) qui impliqua neuf pays africains et
trente groupes armés…, ce qui en fait la plus grande guerre entre États en Afrique (« Grande Guerre africaine »), entre 200 000 environ et 4 millions
de morts.
18. Guerre ethnique débutée en 1993, entre Hutus et Tutsis, qui, depuis le Rwanda, déborde au Kivu et oppose milices armées, soutenues par
Mobutu, ex-Président du Zaïre (future RDC), et Tutsis rwandais et Ougandais soutenant Laurent-Désiré Kabila. Au Kivu s’affrontent sur divers
fronts Hutus, Tutsis, forces pro-ougandaises et armée de Kinshasa. En 2001, L. – D. Kabila, assassiné, et remplacé par son fils, Joseph. La guerre
prend fin en 2003.
19. Delphine Papin, Flavie Holzinger, Riccardo Pravettoni, « Du Mali au Burkina Faso, une spirale de violence », Le Monde, 23 juin 2019.
20. Données : Armed Conflict Location and Event Data project (ACLED).
21. Benjamin Roman, « Panorama des conflits dans le monde : quels risques géopolitiques futurs ? », Portail de l’IE, 18 juin 2020.
22. Sophie Landrin, Carrie Nooten, « Cachemire : Imran Khan brandit le risque d’une guerre nucléaire », Le Monde, 28 septembre 2019.
23. Métal rare utilisé notamment dans le secteur aéronautique.
24. Uotsurijima/Diaoyu Dao, Kita-Kojima/Bei Xiaodao, Minami-Kojima/Nan Xiaodao.
25. Selon l’Agence internationale de l’énergie, il y aurait entre 60 et 100 millions de barils de pétrole et entre 1 000 et 2 000 milliards de mètres
cubes de gaz naturel aux alentours. Voir site de l’organisme ; www.aie.gov.
o
26. Pascal Dayez-Burgeon, « Dédiaboliser la Corée du Nord ? », Politique internationale, n 140 – Été 2013.
27. Michael L. Ross, The Oil Curse. How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, Paperback, 2012.
CHAPITRE IV
De l’ancienne à la nouvelle guerre froide ?
« Nous avons des types d’armes prometteurs, absolument exclusifs […], des systèmes de missiles qui ne volent
pas sur une trajectoire balistique mais rasante, avec une vitesse hypersonique. Pour l’instant, personne n’a
d’armes hypersoniques… »
Vladimir Poutine
Depuis la chute pacifique et l’éclatement de l’URSS, la Russie, pays où il existe un taux d’imposition forfaitaire
de 13 % (flat tax), digne d’Andorre ou de Monaco, n’a plus rien à voir avec l’Union soviétique. Les menaces
géopolitiques majeures pour le modèle capitaliste occidental et les démocraties se trouvent plutôt du côté de
l’islamisme radical, de la Turquie postkémaliste néo-ottomane, des nouvelles mafias transnationales, des
phénomènes de fractures ethnoreligieuses intranationales, et bien sûr du modèle antidémocratique chinois
néomaoïste. Mais les pays de l’Alliance atlantique, États-Unis en tête, ne semblent pas avoir changé de logiciel
géostratégique. Les États-Unis, l’UE et l’Otan ont donc continué à penser la Russie comme le clone monstrueux de
l’Union soviétique, un ennemi majeur. Les États-Unis, l’Alliance atlantique et l’Union européenne – vassalisée
depuis 1950 – ont étendu leur puissance vers l’Europe centrale et orientale, jusqu’aux pays baltes et aux Balkans, ce
qui a été ressenti par la Russie comme une humiliation, car il s’agit de son ancienne zone d’influence du temps de la
guerre froide. Or, en 1994, puis en 1997, le prédécesseur et parrain politique de Vladimir Poutine, Boris Eltsine,
avait ratifié le Partenariat pour la paix de l’Otan, puis le partenariat Otan-Russie qui devaient permettre une
coopération et tourner définitivement la page de la guerre froide.
Il n’en était rien : les ingérences occidentales qui ont pris la forme d’interventions militaires directes en exYougoslavie, en Irak ou en Libye, ou celles indirectes contre la Russie en Géorgie, en Tchétchénie, ou en Ukraine,
sans oublier l’obsession américaine de renverser la dictature prosoviétique de Bachar al-Assad, ont dangereusement
interrompu ce processus en poussant la Russie eltsinienne et poutinienne, à devenir un ennemi. Après l’Irak, la
goutte d’eau qui fera déborder le vase sera le soutien américano-européen aux forces ukrainiennes antirusses entre
2004 (révolution orange) et 2013-2014 (seconde révolution ukrainienne ou Euromaïdan) puis aux forces
révolutionnaires arabes islamistes tournées contre l’allié majeur de la Russie en Méditerranée arabe, la Syrie. Ici,
comme en Crimée ukrainienne, la stratégie américaine de changements de régime visait ni plus ni moins à faire
perdre à Moscou le contrôle de ses bases militaires stratégiques installées depuis des décennies à l’ouest de la Syrie
(Tartous) et à Sébastopol, en Crimée, sans lesquelles la Russie perd son accès vital à la Méditerranée orientale et son
statut de puissance maritime mondiale. La suite, ou plutôt la réaction, est connue : double intervention militaire russe
spectaculaire en Syrie, pour sauver Bachar al-Assad de l’offensive des rebelles islamistes et djihadistes, puis en
Crimée, avec l’annexion de celle-ci par la Russie, et ainsi qu’indirectement en Ukraine orientale (Donbass). Dans les
deux cas, les Russes ont conservé leurs acquis stratégiques sur leurs flancs sud.
Prétextant de la menace croissante russe dans le contexte de la guerre civile ukrainienne et de l’annexion de la
Crimée, les États-Unis, en guerre géoénergétique avec la Russie pour l’approvisionnement en gaz de l’Europe (gaz
russe versus gaz de schiste américain), firent adopter par l’ensemble des pays occidentaux des sanctions américaines
et internationales contre la Russie, de ce fait poussée dans ses retranchements. À cet égard, les premières
déclarations et décisions du président Joe Biden, pourtant supposé être plus mesuré que son prédécesseur Donald
Trump, n’ont pas été dans le sens de l’amélioration des relations russo-américaines : après avoir qualifié (17 mars
2021) Vladimir Poutine de « meurtrier », Joe Biden a accusé la Russie d’essayer de continuer à influencer la
politique intérieure américaine et il a non seulement renforcé les sanctions contre Moscou en mettant sur une liste
noire trente-cinq personnes morales et physiques russes, mais aussi interdit aux entreprises et citoyens américains
d’acquérir et acheter des bons du Trésor russe destinés à financer la dette de la Russie.
Théoriquement, l’analyse officielle de l’Otan est qu’un pays peut intégrer l’Alliance s’il est stable et s’il peut
apporter des ressources, synergies et forces supplémentaires, ce qui signifie que des pays ayant de graves
contentieux territoriaux et conflits ouverts avec leurs voisins ne sont pas éligibles. Ceci explique pourquoi l’Ukraine
et la Géorgie ont raté leurs premières tentatives d’intégration lors des sommets 2008, jusqu’avant la crise russogéorgienne. En revanche, l’escalade russo-ukrainienne du printemps 2021 analysée plus haut montre l’évolution
significative de l’Alliance sur ce sujet, puisque son secrétaire général, Jens Stoltenberg, tout en ne répondant pas
positivement à l’intégration immédiate de l’Ukraine, n’a pas fermé la porte et a même plus précisément conditionné
son intégration à la mise en place de réformes institutionnelles que les partenaires occidentaux de l’Ukraine exigent
depuis bien longtemps. Le même raisonnement a été avancé par Emmanuel Macron au Président ukrainien
Volodymyr Zelensky, lorsque ce dernier est venu demander à son homologue français son soutien à l’entrée dans
l’Otan lors de la rencontre du 16 avril 2021. Le fait que l’Occident semble de plus en plus ouvert à une intégration
de l’Ukraine à l’Alliance atlantique ne peut qu’envenimer ses relations déjà exécrables avec la Russie, et de ce fait
mettre en danger la stabilité de cette zone postsoviétique et de l’ensemble de l’Europe.
L’Europe, théâtre de guerre nucléaire entre États-Unis et Russie ?
Certes, le scénario d’un conflit nucléaire Occident-Russie autour du dossier ukrainien ou d’autres est quasi
impossible, compte tenu du principe de dissuasion d’une telle arme. Sur le plan stratégique, la situation est tout de
même préoccupante : le 2 août 2019, après plus de vingt ans de discorde et de poussée américano-occidentale vers le
pré carré russe, les États-Unis sont sortis du traité de désarmement relatif aux forces nucléaires de portée
intermédiaire (INF), décision lourde de conséquences qui a incité la Russie à faire de même en réaction. Et en
novembre 2019, le Pentagone a réaffirmé que le nucléaire pouvait être utilisé comme toute autre arme contre les
objectifs militaires de l’ennemi. Des exercices annuels et des manœuvres navales de l’Alliance atlantique ont lieu
depuis 2016 de façon de plus en plus intense, de la Baltique à la mer Noire. Des blindés américains paradent près de
la Finlande, en Estonie, en Roumanie, en Bulgarie, et surtout en Pologne. Des exercices mobilisent six mille soldats
de dix pays de l’Otan, des bombardiers, chasseurs et hélicoptères en zone balte. Entre 2000 et 2019, l’Alliance a
inauguré en Roumanie et en Pologne des sites stratégiques de missiles antimissiles, des installations de radars en
Turquie, puis des navires de guerre américains en Méditerranée.
Depuis janvier 2021, les États-Unis et l’Alliance atlantique ont placé leurs troupes en état d’alerte renforcée
après la reprise des combats en Ukraine et dénoncent une stratégie d’intimidation de la Russie. Le secrétaire général
de l’Otan a réitéré son soutien total au camp ukrainien et au président Volodymyr Zelensky qui, selon les rumeurs,
aurait préparé une offensive en vue de récupérer les territoires du Donbass occupés par des forces prorusses. Depuis
le début de 2021, la Russie accuse l’armée ukrainienne d’avoir massivement bombardé des villages prorusses de
l’Est ukrainien et Washington d’avoir envoyé des navires de guerre en mer Noire et des troupes à la frontière russe
1
et dans la mer Baltique : 40 000 militaires et 15 000 pièces d’armement et véhicules, dont des avions stratégiques .
Cinq cents soldats américains supplémentaires ont également été positionnés en Allemagne en cas d’escalade.
L’Ukraine et les États-Unis accusent en retour la Russie d’avoir déployé plus de 80 000 soldats en Crimée depuis
2014 et de préparer une offensive en cas de reprise des territoires prorusses par Kiev. En réponse à ce qu’elle
analyse comme une menace majeure de la part de l’Otan, la Russie a effectué, le 14 avril 2021, des entraînements en
tir d’artillerie en mer Noire puis a envoyé une partie de sa flotte ainsi que des hélicoptères de l’aviation navale.
Pour les États-Unis et l’Otan, l’ennemi est plus que jamais la Russie. L’« Acte fondateur Otan-Russie », signé
en 1997, qui engageait l’Alliance à ne pas déployer de forces supplémentaires dans les nouveaux pays membres de
l’Alliance atlantique, est mort, du moins dans les faits. Avec l’élargissement de l’Otan aux frontières de la Russie,
source d’une néoguerre froide, cette rupture de l’équilibre stratégique a achevé de pousser la Russie plus encore
dans les bras de la Chine. Pour Moscou, l’installation d’un bouclier antimissile en Pologne et en République tchèque
remet en cause sa dissuasion nucléaire à sa porte… Ce dispositif, certes annulé en 2009 par Barack Obama, sera
remplacé par un autre système (Défense antimissiles balistiques de théâtre – TBMD) encore plus problématique
pour la Russie. Face à cette remise en cause de sa capacité de frappe « en second » (principe de base de sa
dissuasion nucléaire stratégique), la Russie a suspendu toute coopération au sein du Conseil Otan-Russie.
L’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a servi de prétexte a posteriori à l’Otan pour justifier la protection
stratégique de l’Europe face à ladite « menace russe ». En réaction, Moscou va déployer à son tour ses lanceurs
mobiles du système sol-sol Iskander dans l’enclave de Kaliningrad. Vladimir Poutine a ainsi annoncé la mise au
point par la Russie d’une panoplie de nouvelles armes stratégiques, toutes réputées quasiment impossibles à
intercepter et capables de frapper en n’importe quel point du globe. L’Amérique a réussi à faire de l’Europe à
nouveau le théâtre d’opération d’une « bataille nucléaire de l’avant » sur les frontières avec la Russie. Ce
processus – entamé depuis les années 1992-1998-2003 – d’exclusion occidentale de la Russie, désignée comme
l’ennemi suprême, permet en réalité de pérenniser la domination atlanto-américaine du continent européen et
donc sa division.
Nous sommes ainsi revenus à l’équivalent de la guerre froide, sans mur, cette fois-ci, mais bien pire sur le plan
stratégique. Contrairement aux années 2003-2009, ce n’est plus le prétexte hypocrite de la menace iranienne qui
justifie ce déploiement américain aux portes de la Russie, déjà poussée à bout par l’élargissement qui a précédé,
mais une hypothétique menace russe qui nécessiterait de faire du territoire de l’UE lui-même le champ de bataille
Russie-États-Unis… On est très loin du reset d’Obama annoncé initialement, comme Trump après lui, pour pacifier
les relations russo-américaines.
L’occasion manquée de l’alliance russo-occidentale (1999-2003)
Pourtant, en 1990, la stratégie des pays de l’Alliance atlantique avait semblé aller dans le sens d’un
rapprochement panoccidental ou russo-atlantique. Rappelons qu’après l’implosion de l’Union soviétique, la Russie
ne cessa de se rapprocher de l’Otan, qui semblait tirer les leçons de la chute de l’ex-ennemi soviétique. Ainsi, en
1994, Moscou ratifia le programme du Partenariat pour la paix de l’Otan, une première. Puis en mai 1997, un accord
de coopération mutuelle stipulant en préambule que les deux pays n’étaient plus des ennemis. Vinrent ensuite les
intégrations d’ex-pays membres du pacte de Varsovie dans l’Otan puis dans l’UE, devenus indépendants après 1989,
qui conforta même sa coopération avec les Occidentaux (exercices militaires communs, fréquentes consultations ;
ouverture d’un point de transit de l’Alliance à Oulianovsk, en Russie, afin de favoriser l’acheminement de matériel
vers le front afghan, etc.). Certes, la Russie n’était pas enchantée de l’extension sans fin vers l’est, mais les lignes
rouges du Kosovo, de la Géorgie et de l’Ukraine n’avaient pas encore été franchies et les révolutions de velours puis
la seconde guerre en Irak n’avaient pas encore produit leurs effets délétères. Andrei Kozyrev, l’ancien ministre des
Affaires étrangères de Boris Eltsine, connu pour son occidentalisme passionnel, définissait ainsi sa doctrine et celle
de Boris Eltsine à ce moment : « Prendre modèle sur les pays démocratiques avancés, être admis dans leur club sur
un pied d’égalité, tout en restant digne et en gardant sa personnalité ; telle est notre conception. » Il envisageait de
fusionner les structures militaires de la CEI et de l’Otan et espérait que la Russie intégrerait le Conseil de l’Europe et
l’Union européenne. Au départ, la politique pro-occidentale d’Eltsine et de Kozyrev fut clairement appuyée par le
peuple russe qui avait une excellente image de l’Occident, alors perçu comme une force amicale, alors
2
qu’aujourd’hui, la tendance s’est nettement inversée .
Après la période Eltsine, l’ascension progressive de Vladimir Poutine fut au départ marquée par un fort prisme
pro-européen et pro-occidental, puisque ce dernier commença sa carrière politique avec le clan des libéraux (prooccidentaux) du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchak. La chose est souvent oubliée : dès son arrivée au
pouvoir (hiver 1999-2000), Vladimir Poutine ne cessa de multiplier les signes d’ouverture envers les États-Unis,
essayant d’établir une alliance russo-occidentale, à l’opposé de l’image d’antioccidental primaire et de nostalgique
de l’URSS que l’Occident a forgée de lui. Poutine voyait dans une libéralisation maximale de l’économie et dans sa
débureaucratisation les clés de la renaissance et celui que la presse occidentale définit souvent comme un
nostalgique de Staline a toujours été très critique à l’égard de l’héritage soviétique, dont il estime que « nous
récoltons aujourd’hui les fruits amers ». C’est d’ailleurs ce même Poutine qui fit acte de candidature à l’OMC, et qui
fut le premier dirigeant russe postsoviétique ayant affirmé que la Russie appartient à la culture européenne
occidentale. Il n’a d’ailleurs jamais cessé de plaider en faveur d’une coopération plus étroite avec l’Union
européenne. Quant aux relations russo-américaines, il a toujours répété qu’il ne choisira jamais de réactiver les
facteurs de confrontation.
De son côté, George W. Bush, alors moins moraliste et manichéen que les démocrates et les autres néocons, ne
semblait pas avoir d’a priori négatifs envers le dirigeant russe qu’il reçut dans son ranch privé, fait assez rare et
grande marque de proximité de sa part. En juillet 2001, lorsqu’il rencontra le Président russe, il fit savoir qu’il avait
vu en Poutine « un homme qui pense que son avenir est avec l’Occident et non avec l’Orient et qui partage avec les
3
États-Unis les mêmes préoccupations concernant la sécurité, notamment l’islamisme ». Au lendemain des attentats
du 11 septembre 2001, Vladimir Poutine fut le premier chef d’État qui appela le Président américain pour lui
témoigner de sa forte solidarité avec le peuple américain, rappelant que la Russie avait elle aussi été victime depuis
des années des attaques menées par des terroristes islamistes originaires de Tchétchénie. Lorsque George W. Bush
lança sa campagne militaire contre le terrorisme, notamment avec l’intervention en Afghanistan, il chercha l’aide de
la Russie, également préoccupée par l’influence du djihadisme international sur le conflit de Tchétchénie. Cette
convergence conjoncturelle d’intérêts offrait une opportunité rare aux deux anciens adversaires de la guerre froide
pour forger un partenariat stratégique panoccidental.
Le 24 septembre 2001, le Président russe annonça un plan en quatre points pour soutenir la guerre américaine
contre le terrorisme. Premièrement, le gouvernement russe s’engageait à partager les données de renseignements
avec son homologue américain. Deuxièmement, il ouvrait l’espace aérien russe aux vols d’avions américains à
destination de l’Afghanistan. Troisièmement, il promettait d’obtenir l’ouverture de l’espace aérien en Asie centrale
pour les États-Unis. Quatrièmement, il s’agissait d’apporter une aide militaire et humanitaire à l’Alliance du Nord en
Afghanistan qui était en train de combattre les talibans. Le politologue et ex-ambassadeur américain à Moscou
(2012-2014), Michael McFaul, constate que même si la Russie n’était pas d’accord avec la doctrine américaine de
l’axe du mal, elle partageait avec les États-Unis une vue plus traditionnelle d’utilisation de la force militaire.
Rétrospectivement, on constate que la coopération américano-russe proposée initialement par Poutine ne fut pas
égalitaire ni mutuellement bénéfique, car l’administration Bush se focalisa sur les questions purement militaires liées
à l’Afghanistan dans le cadre d’une vision court-termiste de sa relation avec la Russie.
La rupture stratégique des années 2003-2005
Comme l’a noté McFaul, pour évoluer vers une réelle alliance, cette relation stratégique aurait également dû
revêtir un contenu intéressant pour le partenaire russe. À titre d’exemple, les États-Unis auraient pu appuyer
l’adhésion de la Russie à l’OMC, ce qu’ils refusèrent jusqu’en 2012 ; établir une relation d’alliance plus formelle
entre l’Otan et la Russie ; suspendre le boycott d’achat d’armes russes par les membres de l’Otan ; contribuer au
rapprochement entre l’UE et la Russie ; continuer à travailler sur la réduction des missiles balistiques ; acheter des
armes russes pour les envoyer à l’Alliance du Nord en Afghanistan ; préciser l’attitude américaine sur la
4
Tchétchénie ; ou encore soutenir le développement des institutions plus démocratiques en Russie . Cependant, ainsi
5
que le note le journaliste américain Peter Baker dans son livre consacré à la politique étrangère de George W. Bush,
la Maison Blanche manqua largement cette opportunité en raison d’une stratégie incohérente et imprévisible. Au
début de son premier mandat, Bush s’était certes fixé comme objectif de garder la Russie dans le camp occidental
afin d’éviter un rapprochement avec la Chine, mais vers 2003-2004, la doctrine Bush évolua vers l’engagement
(néoconservateur) d’en finir avec la tyrannie et les États voyous (rogue States) partout dans le monde.
Concernant la Russie, cette nouvelle approche était déclinée à travers un objectif à terme de changement de
régime à Moscou. Or, c’est à ce moment-là, au milieu des années 2000 – qui correspondait aussi à l’intervention
anglo-américaine en Irak –, que Vladimir Poutine commença précisément à recentrer son pouvoir, à cesser de se
montrer ouvert à une libéralisation appuyée depuis l’extérieur et à considérer de nouveau les États-Unis comme
menaçants. Une nouvelle approche, plus confrontationnelle, émergea ainsi entre 2004 (révolution orange), et 2008,
lorsque George W. Bush intensifia le soutien américain à l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’Otan. En bref,
par cette provocation, en tout cas ressentie comme telle par Moscou, le Président américain rata complètement une
occasion historique.
Les relations russo-américaines se dégradèrent rapidement à partir de 2003, après trois années de lune de miel
porteuses d’espoir. Apparemment, ces relations demeuraient hantées par l’esprit de la guerre froide, pendant laquelle
l’Union soviétique était perçue comme une menace mortelle pour la civilisation occidentale et pour le monde. En
2000, Condoleezza Rice notait ainsi que « les États-Unis ont eu beaucoup de difficultés à s’adapter au monde
d’après-la-guerre-froide et à concevoir une nouvelle grande stratégie pour remplacer l’endiguement de la menace
6
soviétique ». La guerre d’Irak (mars 2003) provoqua une réelle rupture stratégique entre la Russie et les États-Unis.
Devenu plus européen, en février 2003, Vladimir Poutine se rendit à Berlin et à Paris, capitales qui s’étaient
fortement opposées à l’intervention militaire américaine en Irak. L’opposition des deux poids lourds européens à
l’approche hégémonique américaine poussa le Président russe à épouser des concepts gaullistes : le monde
multipolaire et la lutte contre l’hégémonie, prises de position autant idéologiques que pragmatiques car la guerre
d’Irak permit de s’opposer à l’hyperpuissance occidentale en s’alliant à d’autres États occidentaux. Moscou décidait
ainsi de mettre en péril sa relation avec les États-Unis dans l’espoir de la compenser par le rapprochement avec
l’Union européenne, mais cette dernière ne voulut jamais réellement poursuivre ce rapprochement dès lors qu’il
n’était plus souhaité par Washington et par la direction de l’Otan, véritable pilote des orientations stratégiques de
l’UE.
La guerre d’Irak influença non seulement la relation russo-américaine, mais fit également changer radicalement
la vision que Moscou avait de l’ordre international. L’impunité des États-Unis fit croire aux Russes que les plus forts
pouvaient faire ce qu’ils voulaient sur la scène internationale. Tout ce qui s’est passé depuis lors, y compris le flirt
avec les islamistes pendant le printemps arabe, la politique américaine en Libye et l’action des États-Unis en Syrie,
7
prouve que la dernière superpuissance mène une stratégie excessive . Il est vrai que les chaos irakien, libyen et
syrien, consécutifs aux interventions militaires ou diplomatiques américano-occidentales, en ont fait la
démonstration. En 2004, le soutien américain à la révolution orange élargit encore un peu plus les divergences entre
les deux pays, tandis que le soutien des États-Unis à l’indépendance du Kosovo en 2008 sembla rendre la rupture
russo-américaine irréversible.
Après l’élargissement de l’Otan à de nombreux pays de l’Est devenus aussi membres de l’Union européenne,
l’UE devint de facto une entité atlantiste sous la domination des intérêts américains. On assista à la reconstitution
d’un impressionnant potentiel militaire en Pologne, qui se prépare quasi ouvertement depuis la crise ukrainienne à
une guerre potentielle contre la Russie. D’autres nouveaux membres de l’Alliance (pays baltes, Bulgarie, Roumanie)
se sont placés quant à eux sous le parapluie de l’Alliance qui y a ouvert depuis 2006 des bases aériennes,
notamment ; Bezmer et Graf Ignatievo, puis un polygone militaire (Novo Selo). Les patrouilles d’avions militaires
de l’Otan survolent désormais très régulièrement l’espace aérien des pays baltes en proximité immédiate des
frontières russes, en raison de l’absence d’aviation militaire dans ces pays.
Aujourd’hui, on ne peut que constater l’état déplorable des relations entre les deux pays. Dans ce contexte, les
critiques américaines concernant l’état de la démocratie en Russie se sont multipliées, mais pas envers des régimes
autoritaires islamiques comme le Qatar, l’Arabie saoudite, ou le Pakistan, parrains du djihadisme.
Vladimir Poutine n’a jamais accepté le projet américain de déployer en Europe centrale et orientale un système
de défense antimissile, au même titre que l’ingérence occidentale en Ukraine. Il a toujours répondu fermement en
assurant que si les États-Unis sortent du traité ABM, la Russie sortira du système d’accords de limitation et de
maîtrise des armements stratégiques, classiques, voire tactiques (chapitre VIII), et engagera une politique
indépendante en matière de dissuasion nucléaire. D’après de nombreux stratèges polonais, baltes ou anglo-saxons,
Vladimir Poutine aurait donc comme objectif proche d’envahir, après l’Ukraine, les pays baltes qui abritent
d’importantes communautés russophones dans l’intention de contrer, la Grande-Bretagne, les États-Unis et leurs
alliés baltes et polonais qui ne cessent de diffuser encore plus sérieusement ce type de scénarios apocalyptiques
concernant la menace russe.
La Russie, une menace plus grande que le terrorisme islamiste pour
les atlantistes…
Si l’on en juge par les déclarations officielles de responsables atlantistes, par les mouvements de troupes en
direction du nord de l’Europe et de l’Europe orientale et aux moyens et stratégies déployés contre la Russie au
détriment du Moyen-Orient et donc de la lutte contre la menace islamiste, tout se passe comme si le péril islamiste
préoccupait moins les États-Unis que la Russie, « ennemi principal ». Ainsi, le général Joseph Dunford, chef d’étatmajor des armées américaines, avait déclaré, lors des auditions au Congrès dans le cadre de sa nomination, citant le
8
cas ukrainien, que la Russie présentait « la plus grave menace à court terme pour la stabilité du monde entier ». La
Russie représente la « plus grande menace » pour la sécurité nationale des États-Unis, a confirmé Deborah James, la
secrétaire des forces aériennes américaines, qui en conclut que « l’Amérique doit donc augmenter sa présence
militaire en Europe ». Dans cette perspective de hiérarchisation de l’ennemi, privilégiant la menace russe sur le péril
islamiste, la Pologne est bien évidemment toujours en première ligne. C’est ainsi que Witold Waszczykowski, le
ministre polonais des Affaires étrangères (2015-2018), a fait écho à Deborah James en déclarant, lors de la
conférence annuelle sur la sécurité Globsec, organisée le 15 avril 2016 à Bratislava (Slovaquie) : « De toute
évidence, l’activité de la Russie est une sorte de menace existentielle parce que cette activité peut détruire des pays
[…], nous avons aussi des menaces non existentielles comme le terrorisme, comme les grandes vagues de
9
migrants », mises ainsi au second plan. Dans la même logique d’alliance atlantico-islamique pour endiguer
l’ennemi russe, Waszczykowski confirmait, à Ankara, le 20 avril 2016, que son pays est très favorable à une
intégration rapide de la Turquie dans l’Union européenne et qu’il ne craint pas la suppression des visas pour les
citoyens turcs, car la Turquie est « un des meilleurs atouts pour sécuriser le flanc est de l’OTAN face à la Russie ».
La Pologne, qui joue comme jadis l’Angleterre le rôle de cheval de Troie des États-Unis dans l’Union, a subi des
pressions américaines pour un soutien à la candidature turque (très souhaitée par les milieux anglo-saxons pour
rendre l’UE ingouvernable et encore plus hétérogène) en échange d’installation de nouvelles bases américaines en
Pologne.
Le 2 février 2016, le secrétaire d’État Ashton Carter a clairement confirmé ce retour à la case départ stratégique
de la guerre froide, et c’est dans ce contexte qu’est apparu le nouveau concept stratégique de Third Offset Strategy
qui pose comme priorité de maintenir une supériorité militaire et technologique sur les Russes et les Chinois sur le
long terme, l’idée étant de franchir un nouveau palier stratégique fondé sur le développement de systèmes
d’intelligences artificielles, d’armes-robots, de nouveaux systèmes de brouillages des communications
ennemies, etc. (voir Robert Work). Comme on l’a vu en Syrie ou même avant en Afghanistan, plutôt que de
coopérer face à un ennemi commun islamiste et djihadiste qui menace autant les États-Unis, l’Union européenne que
la Russie en tant que sociétés « mécréantes » à conquérir, les Occidentaux et les Russes ont au contraire renforcé
10
leurs rivalités, s’espionnent et analysent leurs armes respectives dans l’optique d’une confrontation ultérieure .
Certes, il est vrai que, de son côté, le 31 décembre 2015, Vladimir Poutine a lui-même signé un document
officiel sur la « stratégie de sécurité nationale de la Fédération de Russie » dans lequel les États-Unis sont clairement
qualifiés de « menace pour la sécurité nationale ». Nous sommes donc revenus à l’époque de la guerre froide, et la
stratégie des États-Unis et des pays membres de l’Otan et de l’UE y est pour beaucoup… Si les torts et visions
diabolisantes sont partagés, force est de reconnaître que la partie qui a rompu les liens et mis fin au rapprochement
est l’Occident. Sur les dossiers afghan et syrien, personne ne peut nier que si les Russes ont systématiquement
proposé de coordonner et collaborer étroitement contre l’ennemi islamiste principal dans le cadre d’une vaste
coalition panoccidentale ou euro-occidentale, ce sont les États-Unis qui ont toujours refusé pareil dispositif en
accusant à chaque fois les Russes de défier l’Occident, de perpétrer un génocide en Tchétchénie, de frapper les
« modérés » en Syrie ou de défendre la dictature d’Assad et d’aggraver la situation en Ukraine au lieu de
l’améliorer.
L’OCS, ou l’alliance « antihégémonique » russo-chinoise redoutée
par Brzezinski
Face aux puissances occidentales universalistes que sont l’Amérique et l’Europe de l’Ouest, la Russie
postsoviétique et la Chine partagent la même philosophie des relations internationales fondées sur la souveraineté
des États, la préservation de leurs zones d’influence respectives, ainsi que le refus de la théorie occidentale du droit
d’ingérence humanitaire et de la démocratie libérale et moralisatrice à visée mondialiste. Les politiques de sanction
(Irak, Serbie, Russie, Iran, Cuba, Corée du Nord, etc.), aussi contre-productives que souvent injustifiées, n’auront
fait que conforter Moscou dans l’idée que l’Occident ne lui laisse d’autre choix que de se rapprocher de Pékin. On
assiste ainsi, depuis le début des années 2000, à une convergence de plus en plus profonde des visions diplomatiques
des deux grandes puissances créatrices de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), dont sont membres
aussi l’Ouzbékistan, l’Inde, le Pakistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, et probablement bientôt l’Iran (voir carte
o
n 3). Certes, l’OCS est composée, comme les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), d’États parfois
ennemis entre eux (l’Inde et la Chine), mais outre que la Chine et la Russie, son noyau dur, sont des alliées
stratégiques face à l’Otan et aux États-Unis, elle représente tout de même un ensemble multipolaire qui dispose de
38 % des ressources mondiales de gaz, de 20 % de celles en gaz, de 40 % du charbon, de 30 % de l’uranium de la
planète et des deux armées les plus puissantes après les États-Unis, de surcroît nucléaires. De fait, face à
l’unipolarité américaine, la Russie et la Chine défendent l’avènement d’un monde multipolaire, afin de contrer
l’encerclement de leurs terres et mers par l’Otan, l’UE, les forces anglo-américaines et leurs alliés en Asie. Il est vrai
que Moscou avait averti, dans les années 1990-2005, que toute tentative de faire basculer dans le camp de l’Otan
l’Ukraine et la Géorgie (« plan Brzezinski », voir supra) serait un casus belli. On a d’ailleurs vu, entre 2003 et 2013,
les conséquences dramatiques – pourtant prévisibles – de la politique des États-Unis, de l’Otan et de l’Union
11
européenne de soutien aux dirigeants antirusses dans « l’étranger proche » de Moscou .
12
À la fin de sa vie, le concepteur même de la doctrine de l’endiguement de l’URSS, George Kennan , déplorait
l’obsession antirusse de l’Otan et des États-Unis, qui persistaient à traiter la Russie postsoviétique comme l’URSS
en accentuant l’encerclement et les sanctions contre Moscou : « Étendre l’Otan vers l’est serait la pire erreur de la
politique américaine de l’ère post-guerre froide… Les Russes vont réagir progressivement de manière
particulièrement hostile et cela changera leur politique […]. Cette expansion (de l’Otan) ferait se retourner les Pères
fondateurs de notre pays dans leur tombe. » Les stratèges de Washington devront finir par comprendre que leur
attitude vis-à-vis de Moscou et de Pékin a plus de chances d’accélérer, par réaction antihégémonique, la fin de
l’unipolarité étatsunienne que de la prolonger, et que cela ne peut que renforcer l’avènement d’un nouveau désordre
multipolaire tourné contre l’Amérique. Ce mouvement renforcera non seulement les liens entre la Chine, la Russie,
l’Iran et l’Inde, mais il attirera aussi contre lui des pays du monde musulman et des acteurs souverainistes pas
forcément antioccidentaux, pour qui l’hégémonie américaine est rédhibitoire, donnant ainsi corps à l’alliance
antihégémonique que redoutait tant Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier. Quant à la Chine, elle ne peut
plus tolérer de se laisser enfermer par les Américains et leurs alliés dans les eaux du détroit de Formose, alors que le
contrôle de ses places maritimes ou leur accès sont la condition sine qua non de son statut de puissance mondiale.
D’où l’accroissement subit de ses forces navales, certes, très en deçà de celles de Washington, mais en plein
développement.
1. « Ukraine : de nouvelles tensions entre la Russie, l’Otan et les États-Unis », LCI, 13 avril 2021.
o
2. Vyacheslav Nikonov, « La Russie et l’Occident : des illusions au désenchantement », Critique internationale, n 12, p. 175-191.
3. Peggy Noonan, « A Chat in the Oval Office », The Wall Street Journal, 2 juin 2001.
o
4. Angela Stent et Lilia Shevtsova, « America, Russia and Europe: a Realignment? », ResearchGate, vol. 44, n 4, p. 121-134.
5. Peter Baker, Days of Fire. Bush and Cheney in the White House, Washington, Anchor, 2013.
6. Condoleezza Rice, « Campaign 2000: Promoting the National Interest », Foreign Affairs, janvier 2000.
7. Fyodor Lukyanov, « What Russia Learned from the Iraq War », Al-Monitor, 18 mars 2013.
8. Laurent Lagneau, « Pour la Pologne, la Russie est plus menaçante que l’État islamique », Opex360, 16 avril 2016.
9. Voir
http://lesmoutonsenrages.fr/2016/04/16/gros-danger-annonce-par-nos-medias-la-russie-est-une-menace-plus-serieuse-quelei/#vLaxL0ch4ieC1LRV.99.
10. À titre d’exemple, en Syrie, un déserteur de l’armée syrienne et porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), Talal Silo, a révélé
comment les États-Unis ont interdit au groupe FDS et donc aux combattants kurdes toute collaboration ou entraînement avec les Russes en Syrie.
11. Voir Alexandre Del Valle, Les Vrais Ennemis de l’Occident. Du rejet de la Russie à l’islamisation des sociétés ouvertes, Paris, L’Artilleur,
2016.
12. Thomas Friedman, éditorialiste du New York Times, relata son entretien avec George Kennan, en 1999, soit un an avant l’arrivée de Vladimir
Poutine au Kremlin, à propos de l’expansion de l’Otan en Europe.
CHAPITRE V
… ou désordre mondial multipolaire ?
« L’affrontement de tête entre Washington et Pékin, qui structure la nouvelle donne stratégique planétaire, va bon
train sur le front commercial, mais aussi sur tous les autres terrains (militaire, sécuritaire, diplomatique, normatif,
politique, numérique, spatial, etc.). La planète entière est devenue le terrain de jeu de ce pugilat géant […] :
l’Europe bien sûr, l’Eurasie, mais aussi l’Afrique […], l’Amérique latine, la zone indopacifique […] et
naturellement le Moyen-Orient. »
Caroline Galacteros
Depuis les années 2000 et la remise en question sino-russe de l’unipolarisme américano-atlantiste (OCS, voir
os
cartes n 2 et 3) le monde vit une transition historique vers la multipolarité. Celle-ci est caractérisée non seulement
par le retour de la Realpolitik, des souverainismes identitaires, des empires civilisationnels régionaux, mais aussi par
un processus global de désoccidentalisation de la mondialisation, redevenue un phénomène neutre découplé de son
idéologisation mondialiste. Le nouveau monde multipolaire qui vient, apparemment désordonné, sera composé
d’espaces ou « zones géocivilisationnelles » en compétition constante et à géométrie variable. Désordre non pas en
vue du pire, qui n’est jamais certain, mais parce que les règles de fonctionnement de ce nouveau monde en gestation
n’ont pas encore été fixées. Pour l’heure, ce qui est certain, c’est que la mondialisation n’est plus maîtrisée par
l’Occident et devient surtout un champ de rivalités géostratégiques et d’hypercompétition économique de plus en
plus agressives accentuées par la crise économique mondiale et la crise sanitaire.
En 1987, Paul Kennedy avait expliqué, comme Duroselle, que « toute superpuissance à la recherche d’une
domination globale finira par la perdre ». Un constat également émis, on l’a vu, par Graham Allison avec son
« piège de Thucydide ». La raison majeure est l’attribution ruineuse de ressources économiques et financières à un
pouvoir militaire contre-productif. Il est vrai que les interventions américaines de l’après-guerre froide ont coûté des
milliers de milliards de dollars. Depuis 2001, la « guerre contre le terrorisme » (war on terror) en Afghanistan aurait
coûté à elle seule 850 milliards de dollars de 2001 à 2017 (sans résultats), et celle en Irak (1990-2003) près de
2 000 milliards. Dans le même temps, maintes infrastructures sont restées en retard aux États-Unis (trains et lignes
électriques ou téléphoniques non enterrées) et les jeunes endettés pour leurs études ainsi que les pauvres incapables
de payer des soins corrects se révoltent car tout cet argent aurait pu contribuer à rendre leur vie moins rude.
Si l’Amérique veut continuer à jouer un rôle majeur en faveur de la stabilité et retrouver son pouvoir de
séduction, largement perdu à cause de son arrogance, pour paraphraser Huntington, elle devra accepter la
constitution de sphères d’influence régionales souveraines autour de la Chine, de la Russie, de l’Inde, de la Turquie,
du Brésil, de l’Égypte, de l’Afrique du Sud, notamment, ce qui ne l’empêchera pas de protéger ses propres zones
d’influence en Amérique du Nord et du Sud, et de maintenir des liens étroits avec l’Europe. Sa politique étrangère
devra renoncer à l’impérialisme de ses juridictions extraterritoriales et devra se recentrer sur la promotion d’un
équilibre global du pouvoir, ce qui signifie l’abandon des politiques contre-productives de regime change. Mais rien
n’indique que cette tendance, paradoxalement bien plus incarnée par les électeurs de Donald Trump que par ceux
des démocrates, prisonniers de leur moralisme interventionniste, l’emportera.
Fractures internes et externes
D’une manière générale, on constate à l’échelle des États-Unis, qui ont été au bord de la guerre civile autour de
la présidence Trump et du mouvement des Black Lives Matter, ainsi qu’à l’échelle mondiale, une détérioration
globale du statu quo, un déclin progressif des structures établies depuis 1945 : intensification des rivalités entre
grandes puissances ; montée du nationalisme, des intégrismes et des populismes face au néo-impérialisme moraliste
des élites occidentales mondialisées ; migrations incontrôlées ; tentations de « démondialisation » ; explosion des
inégalités ; questions sanitaires et environnementales. Dans le même temps, les Nations unies ne parviennent pas à
se renouveler : le Conseil de sécurité permanent est toujours composé des mêmes cinq grands vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale et refuse de partager ce club de happy few avec de nouveaux grands acteurs, comme
l’Inde ou le Brésil. On peut donc s’attendre dans les années à venir à un discrédit croissant du multilatéralisme cher
aux adeptes de l’école idéaliste des relations internationales, et à un retour en grâce de la Realpolitik, et du
souverainisme, déjà en action dans la quasi-totalité du monde non occidental, c’est-à-dire hors l’aire euro-américaine
industrialisée-atlantiste.
La période de transition géostratégique qui, après la fin du monde bipolaire (1990), a vu le triomphe éphémère
de l’unipolarité américaine et qui évolue progressivement vers un multipolarisme pourrait être appelée « nouveau
1
désordre mondial » ou « marche vers un multilatéralisme asymétrique ».
Le monde n’appartiendra plus à personne…
2
Comme l’écrit Charles Kupchan, dans La Fin de l’ère américaine , le monde qui vient n’appartiendra à
personne, car il sera à la fois multipolaire, politiquement pluriel et fera cohabiter une hyperpuissance américaine
lassée de son fardeau de l’hégémonie mondiale et les acteurs émergents et réémergents d’un monde polycentrique.
Certes, la montée de la Chine pourrait déboucher sur un duopole sino-américain ou une néoguerre froide entre les
deux rivaux dans une sorte de bipolarité, mais le monde ne redeviendra pas bipolaire pour autant car la Chine
s’accommode du polycentrisme et n’a de prétention hégémonique (mais non prosélyte comme l’Occident) que dans
sa zone d’influence asiatique. Contrairement à l’URSS, elle ne cherche nullement à répandre son modèle politique
communiste ou civilisationnel sino-confucéen aux autres pôles. Pour Kupchan, l’internationalisme libéral qui a porté
la politique américaine tout au long de la guerre froide s’essouffle. Les États-Unis, après plusieurs stratégies
successives (containment, roll back, détente, puis unilatéralisme) pendant la guerre froide et durant la décennie et
demie qui a suivi, n’ont plus de Grand Strategy (Luttwak) aujourd’hui, après avoir triomphé du communisme. Le
« moment unipolaire » des États-Unis est donc terminé et la transition, inexorable. Depuis quelques années, aux
États-Unis, un courant de pensée a d’ailleurs émergé parmi les universitaires américains selon lequel l’Amérique
devrait accepter les sphères d’influence respectives des nouveaux acteurs, c’est-à-dire un partage de la puissance
mondiale avec d’autres grandes puissances, avec une référence particulière à la Chine, à l’Inde et à la Russie.
Le nombre de grandes puissances va être plus élevé qu’il ne l’a jamais été par le passé : on trouve tout d’abord
le « club des sept empires » (Giannulli), à savoir les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, le Brésil, la Russie,
l’Inde et la Chine, qui représentent à eux seuls plus de 50 % de la population mondiale et 75 % du produit intérieur
brut (PIB) mondial, puis viennent dans un second cercle de puissances de moindre poids l’Afrique du Sud, la
Colombie, l’Indonésie, l’Égypte, l’Iran, la Turquie, chacune de ces puissances évoluant dans leur « étranger
proche » sur la base de leurs propres valeurs et intérêts, portant ainsi une vision spécifique.
La Chine, deuxième puissance du monde, va continuer de tout faire, dans tous les domaines, pour dépasser les
États-Unis, même si cela va s’avérer long et plus difficile dans le domaine militaire et celui du soft power culturel
mondial. La politique étrangère et de défense des États-Unis va se concentrer de ce fait sur l’impératif de contrer non
seulement la Chine, mais aussi les « alliances antihégémoniques » (Brzezinski) susceptibles de gêner sa domination
stratégique mondiale, comme l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Washington craint également le
rapprochement Iran-Chine qui s’est traduit par la signature, en mars 2021, d’un accord commercial de 400 milliards
de dollars pour une période de vingt-cinq ans entre les deux pays. Cet accord stratégique surnommé Lion-Dragon
Deal s’est également matérialisé par des ventes d’armes et des manœuvres navales communes aux côtés de la
Russie. Cette nouvelle proximité sino-iranienne rebat les cartes au Moyen-Orient, en passe de devenir un nouveau
terrain de confrontation entre la Chine et les Occidentaux. Le duel sino-américain va donc de plus en plus prendre la
forme d’une confrontation ouverte, mais les interdépendances économiques entre eux vont probablement empêcher
que se reproduise un scénario identique à celui de la guerre froide. L’objectif immédiat des États-Unis sera de freiner
au maximum les efforts de la Chine pour prendre l’avantage dans plusieurs domaines, ceci au moyen d’une guerre
commerciale, monétaire, technologique (guerre de la 5G, voir infra) et stratégique (forces militaires, Quad
o
[Quadrilateral Security Dialogue] voir carte n 3), mais aussi en contrant le projet chinois d’établir une position
hégémonique en Asie. Cette bataille se déroule d’ailleurs déjà en mer de Chine, autour de Taiwan et de la Corée du
Sud, des Paracels/Spratleys et autres îles (Senkaku, etc., voir chapitre XII). Les Chinois, eux, vont donc tout faire
pour éloigner les États-Unis de la zone (d’où la reprise en main de Hong Kong, les menaces sur Taiwan et la
stratégie du « collier de perles »).
La stratégie du collier de perles
Cette expression désigne l’installation, par la marine de guerre chinoise, de points d’appui (les « perles ») tout
le long de sa voie d’approvisionnement maritime vers le Moyen-Orient. Cela inclut la construction, l’achat ou la
location, sur le long terme, d’installations portuaires et aériennes (échelonnées jusqu’en Afrique), destinées à
protéger ses intérêts commerciaux d’est en ouest : de la mer de Chine méridionale au golfe de Bengale, à la mer
d’Arabie et la mer Rouge. Sans surprise, l’Inde rivale y voit un encerclement, notamment à partir des ports au
Pakistan, grand allié de la Chine, au Sri Lanka, au Bangladesh, ou encore au Myanmar et aux Seychelles, pays
« retournés » ou acquis ces dernières années à Pékin. Il s’agit en fait d’une chaîne de bases militaires chinoises et de
ports étrangers dans lesquels la marine militaire chinoise a acquis des installations portuaires dans le cadre de projets
3
d’infrastructures financées par Pékin . L’idée est d’étendre son contrôle sur toute la mer de Chine méridionale et
orientale, 80 % des importations énergétiques chinoises y transitant. Pékin rachète dans ce même contexte des ports,
en Corée du Nord, au Cambodge (voir infra) et convoite même un port en Islande pour réduire les trajets de
Shanghai à Hambourg de six mille quatre cents kilomètres durant l’été ; sans oublier le golfe d’Aden-Djibouti, et
alentour, pour escorter ses navires à travers cette zone infestée de pirates.
Outsiders, émergents, Brics, acteurs de la désoccidentalisation du
monde
os
Depuis le retour politique des non-alignés, l’émergence de l’OCS et des Brics (voir cartes n 2 et 3), la montée
en puissance de l’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Malaisie, de la Turquie et d’autres pays émergents,
l’économie mondiale multipolaire a évolué si rapidement que certains pays en développement se sont mués en
puissances géoéconomiques. La catégorie générique de tiers-monde apparaît désormais désuète, du moins sur le plan
économique. Si l’Europe et les États-Unis semblent menacés par la désagrégation économique et l’apparition de
nouvelles frontières intérieures, d’autres zones sont en passe d’apparaître sous l’impulsion d’échanges
commerciaux, financiers et humains intensifiés entre les États qui les constituent.
D’après le Fonds monétaire international (FMI), les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud,
acronyme créé par Goldman Sachs en 2001) comptent 40 % de la population mondiale et assureraient 50 % de la
croissance mondiale. Leur place dans l’économie mondiale croît fortement : 16 % du PIB mondial en 2001, 27 % en
2015 et, d’après des estimations, 40 % en 2025. Ils affichent un PIB nominal équivalent à celui des 27 de l’UE
réunis. Forts de ce constat, certains prospectivistes de Goldman Sach évoquent l’apparition possible d’un « E7 »,
sigle d’un « G7 à l’envers », qui regrouperait 7 puissances mondiales émergentes (Chine, Inde, Brésil, Russie,
Mexique, Indonésie, Turquie). La crise économique et financière a par ailleurs accentué le phénomène de
rééquilibrage économique et géopolitique mondial en faveur d’une participation plus importante des pays non
occidentaux aux affaires du monde : la part de l’Asie dans l’économie mondiale est passée de 7 % en 1980 à 30 %
en 2020, tandis que les marchés d’Asie représentent aujourd’hui 34 % de la capitalisation boursière mondiale
(devant les États-Unis, 29 %, et l’Europe 24 %). La part du monde en développement dans le PIB mondial en termes
de parité de pouvoir d’achat est passée de 33,7 % en 1980 à 45 % en 2019. Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud forment au total un ensemble humain de plus de 3 milliards d’habitants, soit 40 % de l’humanité, et
ils ont une surface de presque 40 millions de km². Ils pourraient être bientôt rejoints par la Turquie, l’Indonésie, la
Colombie, le Chili ou le Mexique (BRIICCTMS). Lors du sommet de Brasilia du 15 avril 2010, les 4 principaux
pays-continents des Bric (alors dénommés ainsi) ont pour la première fois remis en cause l’ordre économique et
financier mondial hérité des accords de Breton Woods, appelant à la réforme de la Banque mondiale et du FMI. Le
15 juillet 2014, à l’occasion de leur sixième sommet annuel à Fortaleza, au Brésil, les Brics (alors déjà augmentés du
s de South Africa) ont signé un accord créant une banque de développement (NBD) et une réserve de change
4
commune dont les fonds de dotations ont « financé trente-cinq projets d’investissements d’une valeur supérieure à
5
9 milliards de dollars ». Plus gênant pour l’imperium américain : ces puissances remettent en cause la suprématie
planétaire du dollar, appelant à constituer un système financier international alternatif au nom de leur droit d’utiliser
comme bon leur semble leurs monnaies nationales pour l’énergie et d’autres transactions. Cette idée séduit bien sûr
au premier chef Russes et Chinois, qui échangent déjà leurs hydrocarbures en yuans, mais aussi l’Inde et nombre de
pays africains. Quant à la Turquie, elle a signé un accord avec la Russie pour échanger également hors du dollar, ce
que la Chine fait déjà avec les pays africains qui ont abandonné eux-mêmes le franc CFA. La désoccidentalisation
est en marche… En juin 2019, dans le cadre d’un sommet des Brics, en marge du G20, au Japon, à Osaka, Vladimir
Poutine a appelé les émergents à stabiliser les cours de leurs devises nationales en échangeant le plus possible avec
elles au lieu du dollar. Et la Banque centrale russe a suggéré, en décembre 2017, de créer une monnaie virtuelle
6
commune à la fois aux Brics et aux États de l’Union économique eurasienne . En 2018, lorsque la direction de
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), sous pression américaine, a déconnecté de
son système la Banque centrale d’Iran et d’autres organismes financiers iraniens visés par les sanctions américaines
liées aux lois extraterritoriales, l’Inde, la Russie et la Chine ont décidé de se débarrasser à terme de la dépendance
envers Swift en reliant le système de messagerie financière (PSSA) au système chinois de paiements internationaux
7
(CIPS) et au projet d’une structure indienne indépendante .
D’autres puissances régionales majeures, comme l’Iran, ont également un très fort potentiel et même des
velléités néo-impériales. L’Iran a considérablement augmenté sa profondeur stratégique au Moyen et Proche-Orient
depuis les années 1980, mais également dans d’autres zones du monde, comme l’Amérique latine, l’Asie centrale et
la Turquie. Il est un membre observateur de l’OCS, il renforce sa coopération avec l’axe Chine-Russie et les Brics,
et seules la politique de sanctions drastiques lancées par les États-Unis et la nature cleptocratique et totalitaire
islamiste du régime ont empêché ce grand pays de poursuivre sa croissance économique, géopolitique et
technologique déjà visible à l’époque du shah, mais que les rivaux de Téhéran, Arabie saoudite en tête, craignent
par-dessus tout.
Puissance nucléaire potentielle, la Turquie postkémaliste et national-islamiste est quant à elle déjà la première
puissance du Moyen-Orient, devant l’Iran et l’Arabie saoudite, et même la treizième puissance mondiale depuis
2018. Non seulement elle revendique son entrée dans le club nucléaire et abrite des ogives nucléaires américaines
sur son sol, mais elle se dote, grâce à son partenariat avec Moscou, de centrales nucléaires et diversifie ses capacités
militaires, comme on le voit dans le rapprochement avec l’OCS et l’achat du système de missiles S400 russes qui
permet à Ankara de devenir stratégiquement plus autonome vis-à-vis de l’Alliance atlantique.
Enfin, pour reprendre la dichotomie « ventres durs/ventres mous » du monde, chère à Pierre Marie Gallois, le
pôle africain, avec ses 150 millions d’habitants en 1930 devenus 2 milliards dans trente ans, ne participe qu’à
hauteur de 3 % aux échanges mondiaux et reste englué dans les cercles vicieux de la surnatalité, du clanisme, de la
corruption endémique, de la mauvaise gouvernance, de l’analphabétisme et des guerres et tensions ethnoreligieuses
et tribales dans des États postcoloniaux dont les frontières ont été fort mal découpées. Le rêve de Chinafrique ou
même Chindiafrique demeure hélas un doux mythe : le décrochage des pays du Sahel est stupéfiant, cumulant
problématiques de sous-développement, de réchauffement climatique, de séparatisme et de terrorisme islamiste, et il
s’agit là de la seule région au monde où la pauvreté a continué de progresser… L’Afrique demeure globalement une
source de convoitises pour les matières premières et les terres agraires au profit des multinationales, pas seulement
occidentales, d’ailleurs, et des acteurs du monde polycentrique, Chine, Inde, États-Unis, France, Turquie, et même
Russie.
Inexorable montée en puissance de l’hégémon chinois
En 1980, le produit intérieur brut (PIB) chinois équivalait à 7 % du PIB américain, contre 61 % en 2015, et sera
bientôt équivalent. Une tendance quasi certaine : le FMI prévoit pour la Chine une croissance d’au moins 8 % en
2022, quand l’Europe peinera à sortir de la crise la plus catastrophique depuis 1929. Rappelons tout de même que la
Chine, devenue l’usine du monde avec la complicité des oligarchies économiques occidentales, a désormais plus de
8
travailleurs dans l’industrie que tous les pays de l’OCDE réunis . Pékin a par ailleurs acheté 1 200 milliards de
dollars de bons du Trésor américain indispensables au budget des États-Unis, et acquiert des actifs financiers et
physiques partout dans le monde. Longtemps considérée comme un simple pays d’accueil, la Chine est désormais
9
exportatrice nette d’IDE : les flux sortants sont ainsi passés de 7 à 200 milliards de dollars entre 2001 et 2018. Dans
une logique de guerre économique et financière, la Chine refuse de remettre en cause le taux de change de sa
monnaie et elle exige d’entrer dans le club des « Économies de marché » pour s’affranchir de toute contrainte à
l’exportation, tout en pillant allègrement les technologies de ses partenaires et en pratiquant en « non-retour » une
forme de protectionnisme et de concurrence déloyale fondée sur le dumping social et le non-respect des critères de
l’OMC et de l’OIT…
Outre l’OCS et les Brics, évoqués plus haut, les instruments de ce processus de montée en puissance chinoise
sont tout d’abord la Belt and Road Initiative (BRI), littéralement « ceinture et route », appelée dans la presse
« nouvelles routes de la soie ». Il s’agit d’un gigantesque plan de construction de réseaux d’infrastructures terrestres,
maritimes, énergétiques et communicationnels, véritable pilier de la mondialisation chinoise déployé sur 6 corridors
d’Eurasie. Qualifiée de plus grand projet d’investissements depuis le plan Marshall, la BRI répond à la quête
10
géopolitique de « Rêve chinois global
» lancé en 2013 par Xi Jinping lorsqu’il est arrivé au pouvoir. Visant à
11
accroître la place de la Chine au niveau international , les « nouvelles routes de la soie » englobent 65 pays
asiatiques et européens, représentant près de 55 % du PIB, 70 % de la population et 75 % des réserves énergétiques
du monde, pour une durée d’investissement de trente-cinq ans… Le coût estimé des premiers projets est de
900 milliards de dollars et les prêts associés, alloués par la Chine pour les infrastructures à venir dans les différents
pays traversés, atteignent 8 trillions de dollars !
Patriots vs McWorldists ?
À la lumière des fractures internes de plus en plus problématiques dans les pays occidentaux, prisonniers de
systèmes court-termistes (en Europe populiste vs sociaux-démocrates et aux États-Unis trumpistes Patriots vs
démocrates « multiculturalistes »), qui ont failli, durant l’été 2020 et en janvier 2021, conduire les États-Unis à la
guerre civile, la Chine et d’autres puissances considèrent que des élections libres et équitables ne peuvent plus
garantir un gouvernement efficace et que l’idéologie libérale-libertaire McWorld est foncièrement subversive et
anarchiste. Pékin considère le « scénario Mad Max » qui prédestine les démocraties libérales occidentales au chaos
comme une opportunité historique pour remplir le vide. Le pouvoir chinois compte ainsi démontrer que, dans le
e
monde complexe du XXI siècle, la paix et la prospérité sont mieux servies lorsque des gouvernements centraux forts
affrontent les défis mondiaux… Comme dans les années 1930, la démocratie occidentale n’est plus le seul modèle,
et sur ce point, Samuel Huntington, dans la conclusion de son Choc des civilisations, ne s’est pas trompé en
annonçant la fin du pouvoir d’attraction de l’Occident. « L’hégémonie mondiale américaine ne fonctionnera plus,
écrit Robert W. Merry, l’exceptionnalisme américain est une vanité nationale ridiculisée par les événements […] nos
idéaux sont bons pour nous et valent la peine de se battre pour eux, mais ils ne sont pas universels et ne devraient
12
pas être imposés à d’autres peuples dans d’autres pays . » Cette remarque peut être désagréable pour les oreilles des
missionnaires pandémocratiques d’Occident, mais cette musique est en vogue dans le nouveau monde multipolaire,
c’est-à-dire dans près de 90 % de l’Humanité, si l’on reprend le chiffre de Samuel Huntington qui évaluait le poids
mondial des « élites blanches mondialisées » (ou « club de Davos ») à 12 % de l’Humanité…
Contrairement aux expectatives occidentalistes de Fukuyama, et à la différence de la Russie postsoviétique de
Boris Eltsine, la Chine ne s’est pas du tout démocratisée et libéralisée sur le plan politique, et ne s’est ouverte qu’à
son avantage, sur le plan économique et commercial. Elle développe ainsi un ordre mondial alternatif régi par la
Realpolitik, fondé sur la dictature absolue du parti léniniste-maoïste combinée à un néoconfucianisme et à un
capitalisme mercantiliste de conquête. Étrange mélange, certes, presque incompréhensible pour un Occidental
cartésien, mais alliage fort opportun et efficace pour un confucéen-taoïste habitué à mélanger les contraires (« yin et
yang »)… Pour le pouvoir de Pékin, la mondialisation constitue de ce fait une formidable opportunité pour
consolider son hégémonie, son nationalisme impérial, et non pour fonder une suprasociété mondiale prosélyte,
comme l’entend l’Occident. Ce projet est perçu comme utopique, contre-productif et menaçant. Dans le court terme,
la Chine, qui a besoin de vendre ses produits au monde entier et donc aux États-Unis, ne veut surtout pas d’une
confrontation directe, et concéderait même à Washington, dans une logique pragmatique, une ouverture politique et
économique en échange de l’endiguement de la marine américaine en mer de Chine. Son but premier est d’acquérir
la puissance mondiale nécessaire pour gagner une guerre sans avoir à la livrer, à la lumière de Sun Tzu ou du jeu de
go. Et cette puissance a déjà été en partie acquise par l’instrumentalisation de la mondialisation…
D’évidence, le nouveau (dés)ordre mondial ne s’annonce pas libéral : la plupart des acteurs de ce monde en
voie de multipolarisation rejettent les valeurs libérales-libertaires et démocratiques promues par les démocrates
américains et les sociaux-démocrates européens. « Au grand dam de l’Occident, écrit Caroline Galacteros, Pékin
propose une synthèse efficace et séduisante pour bien des pays. C’est du dirigisme, c’est une pratique autoritaire du
pouvoir, c’est une restriction manifeste des “droits de l’homme”. Mais au lieu de crier à la dictature, nous ferions
13
mieux d’observer cette synthèse très attentivement et d’analyser sa force d’attraction . » Un appel au réalisme.
L’Europe : « impuissance volontaire » et dindon de la farce de la
mondialisation ?
À l’inverse, la puissance européenne semble être dupe de la mondialisation, idéologiquement assimilée au
« mondialisme », avec la difficulté qui en découle de défendre le principe de souveraineté, qu’il soit national ou
supranational, délégitimé en lui-même par McWorld et Bruxelles. Certes, le PIB global des vingt-sept pays
européens représente 25 % de la richesse mondiale. Globalement, l’UE est un partenaire économique majeur pour
l’ensemble du monde. Son secteur secondaire n’a pas totalement disparu, même si les délocalisations ont porté un
coup fatal à des pans entiers de l’économie. Par la plupart des critères de puissance – taille du marché, monnaie
unique, main-d’œuvre hautement qualifiée, gouvernements démocratiques stables et bloc commercial unifié – de ses
pays membres, l’Union pourrait acquérir un poids sur la scène internationale, mais le vieillissement de sa population
et la diminution de la main-d’œuvre dans la plupart des pays auront un impact négatif durable sur un continent
14
désindustrialisé qui risque de se paupériser progressivement et de « sortir de l’Histoire » . Certes, sa présence
industrielle est encore forte dans des domaines sensibles, comme la chimie, certaines industries lourdes, l’ingénierie
industrielle, les énergies alternatives, en plus de l’automobile et des machines-outils, et elle demeure, au niveau des
échanges intracommunautaires, le leader du commerce international. Mais pas forcément pour longtemps. Car le
déséquilibre avec les pays émergents à bas coût de main-d’œuvre et/ou à monnaie sous-évaluée s’accentuant, l’UE
doit se protéger contre la concurrence déloyale en matière de commerce international et se détacher de l’angélisme
en mettant en place une réciprocité dans le domaine des marchés publics. L’UE serait bien inspirée, pour ne plus être
le dindon de la farce, d’instaurer l’équivalent du Buy American Act américain, qui contraint d’affecter les fonds
publics américains à des entreprises américaines. Un tel Buy European Act aurait par exemple permis d’interdire à la
Pologne d’acheter des avions militaires américains plutôt qu’européens, et éviterait les achats trop fréquents de
matériels américains par les États européens membres de l’Otan.
L’Europe, prisonnière de son propre mythe universaliste, qui s’affiche comme le continent de la non-identité,
des droits de l’homme, de la social-démocratie, a comme pire ennemi sa propre volonté d’impuissance et sa
mauvaise conscience, en plus de sa démographie déclinante. En fait, si tant est qu’elle devienne un jour un acteur
géopolitique, elle est le seul qui a renoncé à afficher une identité, à définir des frontières, et a renoncé à la volonté de
puissance.
Un objet « géopolitique non identifié » et postcivilisationnel
La grande majorité des pays de l’Union européenne dépensant entre 1 et 2 % de leur PIB dans le domaine
militaire, le budget européen de la défense équivaudrait théoriquement à 290 milliards de dollars, ce qui en ferait
potentiellement le deuxième budget mondial derrière les États-Unis (732 milliards de dollars), et devant la Chine
(178 milliards). Mais cela n’est qu’une projection car, en réalité, l’UE n’a ni stratégie, ni défense et armée propres,
ni même une politique étrangère unie, mais 27 intérêts nationaux souvent divergents… Le véritable ordre de
placement situe la Chine juste derrière les États-Unis, bien devant sa concurrente, l’Inde (71 milliards), puis la
Russie (65,1), l’Arabie saoudite (61,9) et la France (51).
Outre les empires étatsunien, turco-islamique et chinois, qui la prennent en tenailles et convoitent ses richesses
et son patrimoine uniques, l’Europe, démographiquement déclinante et psychologiquement complexée, est la seule
civilisation au monde qui a remplacé toute appartenance identitaire par des valeurs humanitaires, démocratiques et
libérales-libertaires. Celles-ci sont d’ailleurs vues comme des antivaleurs postidentitaires par les autres civilisations
et nations, même démocratiques, comme le Japon, l’Inde, etc., qui demeurent patriotes et qui assument fièrement des
15
politiques de puissance
et de civilisation. Le fait que l’UE, protégée par l’Otan, donc vassale des États-Unis,
16
amoindrisse progressivement les souverainetés nationales de ses pays membres depuis les années 1990 la place en
situation d’apesanteur stratégique. Loin de prendre le chemin de devenir un acteur géostratégique, alors qu’elle le
pourrait si une unité de vue et une volonté existaient entre États membres, elle demeure en fait un no man’s land
géopolitique. Pour les acteurs du reste du monde, Chine, États-Unis, Russie, Turquie, elle apparaît selon les uns
comme un objet de dérision – Kissinger demandait d’ailleurs : « Europe, quel numéro de téléphone » ? – et selon les
autres comme une belle proie affaiblie donc à convoiter…
L’Union européenne est aujourd’hui une organisation hybride : un Ogni, un objet géopolitique non identifié :
elle n’est ni un État, ni une fédération, ni même une confédération, mais une organisation internationale très divisée
et hétérogène, unie en apparence seulement par une idéologie sociale-démocrate universaliste et une économie de
marché, qui s’applique à elle-même des règles de limitation des souverainetés, de répression des identités nationales,
d’ingénuité géoéconomique, de strict respect de la concurrence, de protection des travailleurs et de l’environnement
ou de multiculturalisme, que les autres acteurs du monde ne s’appliquent pas à eux-mêmes, mais exigent
opportunément d’elle, dans l’intention de la conquérir. Bref, elle agit de façon objective en dindon de la farce d’une
mondialisation que tous les autres acteurs conçoivent comme un immense champ de concurrence et de ce fait
comme un levier d’extension de leurs propres puissances et non comme un partage de souverainetés ou un projet de
« village global »… Ce constat confirme l’observation que nous faisait partager dans les années 1990-2000 Pierre
Marie Gallois, qui craignait que le continent ouest-européen devienne celui de l’impuissance et de la
désouverainisation car l’Europe ne peut pas, pour des raisons historiques et idéologiques, acquérir au niveau
supranational la souveraineté qu’elle fait perdre aux États membres au niveau national.
Rejet de l’occidentalisation et de la domination américaine
Les nouveaux dispositifs géopolitiques mis en œuvre depuis la fin de la guerre froide par les partisans d’un
nouvel ordre international polycentrique, émancipés de l’hégémonie de l’Occident et des États-Unis, donc en quête
de « désoccidentalisation », appartiennent à deux grands groupes :
premièrement, les groupes d’États qui s’opposent à l’Occident, combattent ses valeurs et sa civilisation ;
deuxièmement, ceux qui ne sont pas forcément antioccidentaux mais qui veulent un monde multipolaire
fondé sur le respect de la souveraineté des États maîtres de leurs zones d’action géopolitique, économique
et stratégique respectives.
Comme l’explique le sociologue suisse Jean Ziegler, « la haine de l’Occident, cette passion irréductible, habite
aujourd’hui la grande majorité des peuples du Sud. Elle agit comme une force mobilisatrice puissante ». D’après
cette représentation, la simple évocation récurrente des droits de l’homme par des pays occidentaux pour justifier
des sanctions internationales contre des dictatures du tiers-monde ou des pays accusés de massacrer des minorités ou
de poursuivre un programme secret d’acquisition de l’arme nucléaire (Iran, Corée du Nord) est perçue comme un
nouvel hégémonisme et motive la montée du ressentiment envers un Occident qui aurait d’autant moins de leçons de
morale à donner qu’il colonisa, exploita et conquit tant de peuples dans le passé. D’après Ziegler, cette haine
antioccidentale paralyse les Nations unies : l’Assemblée générale de l’ONU est d’ores et déjà composée en grande
majorité de pays du Sud et émergents (Afrique, Asie du Sud, Amérique latine, monde islamique-OCI, OCS,
Brics, etc.), qui contestent l’unipolarité du monde, alors que l’organe décisionnel stratégique (les cinq États
membres permanents du Conseil de sécurité) demeure dominé par des États vainqueurs de la Seconde Guerre
mondiale (États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine) qui refusent pour l’heure de revoir cette
composition qui ne reflète pourtant plus du tout l’état du monde dans sa pluralité ni l’émergence de nouveaux
acteurs stratégiques clés du Sud, comme l’Inde, le Brésil ou l’Afrique du Sud. Tant à la conférence antioccidentale
de l’ONU organisée à Durban, en 2000 puis en 2009 (« Durban II »), qu’au Conseil des droits de l’homme des
Nations unies à Genève ou à l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, on constate la radicalisation d’un
front antioccidental, rappelant à la fois l’expérience de la Tricontinentale et des non-alignés, et unissant, contre
Israël, les États-Unis, et les pays industriels démocratiques des États aussi différents que l’Égypte, le Pakistan, Cuba,
la Bolivie, le Venezuela, les États membres des groupes africains, arabes, musulmans (OCI) et latino-américains, la
Corée du Nord, la Chine ou la Russie (Brics, OCS, États non-alignés). C’est notamment par ce type d’accord
informel conclu entre pays opposés à l’Occident que la Chine a pu jusqu’à aujourd’hui échapper à toute
condamnation globale – par l’Assemblée générale des Nations unies – des persécutions dont sont victimes les
indépendantistes tibétains depuis l’annexion de cette région par la Chine ou les Ouïgours musulmans turcophones du
17
Xinjiang . D’une manière générale, Washington et l’UE parviennent de moins en moins à imposer leurs choix aux
Nations unies : les propositions des États-Unis sont rejetées par la majorité de l’Assemblée générale, et la baisse du
nombre d’États suivant l’Amérique s’observe d’année en année.
Monde multipolaire ou polycentrique
En raison de la taille considérable des populations de la Chine et de l’Inde, respectivement 1,4 milliard et
1,3 milliard, leur niveau de vie n’a pas besoin de se rapprocher de ceux des Occidentaux pour que ces pays
deviennent des puissances économiques et géostratégiques majeures. Quant au Brésil, il pourrait bientôt dépasser
presque tous les pays européens, sauf les trois plus grands. L’économie indonésienne, qui connaît un très rapide
développement démographique, économique et technologique, tout comme celle du Viêtnam et de la Malaisie,
pourraient également bientôt se rapprocher des économies des pays européens, ce qui est déjà le cas pour le Chili et
la Colombie.
Le Japon est confronté à une crise de vieillissement sévère qui pourrait nuire à sa reprise économique à plus
long terme, mais il sera également mis au défi d’évaluer son statut et son rôle régional. Tokyo devra peut-être choisir
entre équilibrer ou faire marche commune avec la Chine.
La Russie a le potentiel de renforcer son rôle international en raison de sa position de grand exportateur de
pétrole et de gaz. Elle est toutefois confrontée elle aussi à une grave crise démographique résultant de faibles taux de
natalité, de soins médicaux insuffisants et d’une situation de sida potentiellement explosive, sans oublier le fait,
grave pour une puissance contemporaine, qu’elle ne produit et ne vend rien d’autre, ou presque, que des armes, des
avions de combat et des énergies fossiles. Au sud, elle borde la région instable du Caucase et d’Asie centrale, dont
les troubles – extrémisme musulman, et conflits endémiques – continueront à l’impacter. Alors que ces facteurs
sociaux et politiques limitent la possibilité pour la Russie de continuer à être un acteur mondial majeur, Moscou est
susceptible d’être un partenaire important pour la Chine ou l’Inde.
Enfin, à terme, ces puissances arrivistes – et peut-être d’autres, comme la Turquie, le Mexique, le Nigeria – ont
le potentiel de rendre obsolètes les anciennes catégories de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud, alignées et nonalignées, développées et en développement.
Désoccidentalisation de la mondialisation marchande et
technologique
Les États-Unis verront leur position de puissance relative s’éroder, même s’ils resteront encore longtemps le
pays le plus puissant dans toutes les dimensions du pouvoir. Les plus grands avantages de la mondialisation
profiteront aux pays et aux groupes qui peuvent accéder aux nouvelles technologies et seront généralement définis
en termes d’investissement et à l’échelle mondiale – que ceux-ci soient acquis grâce à la recherche fondamentale
d’un pays ou auprès de leaders technologiques. La Chine et l’Inde sont en pole position pour devenir des chefs de
file technologiques, et même les pays les plus pauvres pourront tirer parti de technologies prolifiques et bon marché
pour alimenter leur propre développement. La prochaine révolution attendue de la haute technologie, impliquant la
convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l’information et des matériaux (voir chapitre XI),
pourrait encore renforcer les perspectives de la Chine et de l’Inde. Les deux pays investissent dans la recherche
fondamentale dans ces domaines et sont bien placés pour être des leaders dans des secteurs clés. L’Europe risque de
glisser alors derrière l’Asie, faute d’investissements et de budgets R&D suffisants.
Dans l’avenir proche, les principales entreprises opérant dans l’arène mondiale seront plus diversifiées, tant en
taille qu’en origine, plus asiatiques et de moins en moins occidentales et a fortiori européennes. Elles seront plus
souvent basées dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil, la Corée du Sud. Alors que l’Amérique du Nord, le
Japon et l’Europe pourraient continuer collectivement à dominer les institutions politiques et financières
internationales, d’ici 2030, la mondialisation sera de plus en plus assimilée, dans l’esprit populaire, à une Asie
émergente qui remplacera l’américanisation et l’occidentalisation façon McWorld.
La région Asie, nouveau phare du monde
Une zone asiatique opposant les ennemis héréditaires chinois, japonais, sud-coréens et vietnamiens semble se
dessiner. Indépendamment de leurs rivalités géopolitiques et identitaires profondes, ces contrées, situées dans la
nouvelle zone « d’économie-monde », ont tous les atouts pour déclasser l’ancien pivot ouest-européen et
occidentalo-américain dans le futur : méthodes de travail similaires, sens du collectif extrêmement poussé, respect
des organisations de type hiérarchique, sens de l’effort, culte du travail, gouvernance efficace, permettent de
surmonter les préjugés nationaux et les cicatrices de l’Histoire. Dans ce contexte de commerce horizontal évoqué
plus haut, mais qui ne concerne pas que les Brics, entre nouveaux acteurs du monde polycentrique, il est clair que,
malgré la Covid-19, bien mieux gérée et surmontée en Asie qu’en Occident, les économies asiatiques vont continuer
à croître, tout comme le commerce intra-asiatique en général. Le degré d’intégration du système asiatique dans
l’économie mondiale continuera d’augmenter, et la guerre des États-Unis contre la 5G chinoise ne dissuadera pas le
reste du monde et des pays européens d’adopter des technologies chinoises qui concurrenceront de plus en plus les
18
Gafam et autres multinationales américaines. La Chine et la zone Asean resteront toujours des acteurs clés du
commerce intra-asiatique, d’autant plus que le rebond de ces marchés s’est amorcé dès 2021, avec la reprise de la
demande chinoise de biens et la meilleure gestion de la crise sanitaire. En outre, l’industrie manufacturière en Chine
et dans l’Asean offre toujours des conditions économiques attractives non seulement pour les entreprises asiatiques,
mais aussi pour celles des États-Unis et d’Europe qui continueront à y investir, malgré les belles déclarations de
relocalisations. En s’adaptant à la numérisation du commerce et de la logistique et en interagissant davantage au
niveau régional, les économies asiatiques peuvent encore faire mieux que celles du monde entier et ceci pour
longtemps.
Enfin, contrairement aux attentes, une « américanisation » massive des productions jadis trop concentrées en
Chine n’est pas attendue dans les années qui viennent, car les grandes firmes transnationales, loin de se conformer
aux demandes politiques de relocalisation, jettent leur dévolu sur d’autres pays asiatiques où les salaires sont
inférieurs à ceux pratiqués en Chine, mais dont les régimes sont favorables à Washington (Bangladesh, Viêtnam,
Inde).
En 2021, l’Asie, dans sa globalité, va générer plus de 50 % de l’ensemble du PIB mondial (20 % en 1980). Le
15 novembre 2020, suite au retrait américain de l’accord de partenariat transpacifique (TPP) voulu par Donald
Trump en 2017, qui a ravi la Chine, cette dernière a signé avec 14 pays d’Asie-Pacifique (les 10 pays de l’Asean, le
os
Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, voir cartes n 3 et 4) le Partenariat régional économique
global (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), nouvelle zone de libre-échange qui rassemble plus
de 30 % de la population mondiale, qui va diminuer les tarifs douaniers de 90 %, et qui prévoit une croissance des
PIB des pays membres de 0,2 %. Cette intégration régionale Asie-Pacifique confirme le découplage entre intérêts
économiques et axes stratégiques : nombre d’États du RCEP, comme le Japon, l’Australie ou le Viêtnam, sont
hostiles à Pékin, mais la force d’attraction de l’économie chinoise est irrésistible. Le RCEP incite les entreprises
étrangères à implanter dans cet espace périphérique de la Chine le maximum d’unités de production pour bénéficier
de tarifs douaniers privilégiés et, ainsi, rester compétitives dans la région. La Chine va ainsi asseoir encore son
influence économique et industrielle sur toute l’Asie, en déployant de nouvelles chaînes de production en Asie du
Sud-Est, sanctuarisant de ce fait sa puissance industrielle et commerciale et contestant le réseau d’alliances militaires
et économiques des États-Unis par une stratégie économico-financière de contre-encerclement asymétrique, qui va
de pair avec la stratégie du collier de perles et l’initiative BRI… L’intégration de pays industrialisés et proches des
États-Unis sur les plans industriel, économique et militaire (Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande) à
l’orbite chinoise contredit considérablement les objectifs américains du paradigme « Indo-pacifique » (Free and
Open Indo-Pacific) et de la coopération entre le Japon, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, face à
l’expansionnisme chinois.
La question qui se pose pour les Occidentaux à long terme est de savoir si cette nouvelle pax asiaticaeconomica ne va pas se retourner contre eux, de la même façon que les traités de Vienne et de Berlin avaient uni
objectivement les Européens, pourtant divisés, contre le reste du monde avec la colonisation et l’impérialisme…
Quelles pourraient être les prochaines cibles de la zone Asie ? La Sibérie russe convoitée, Taiwan appelée, selon
l’Oncle Xi, à rejoindre de gré ou de force la mère patrie, le Japon, tôt ou tard contraint de se « réasiatiser » et se
désaméricaniser, les Philippines ou la Thaïlande, l’Australie-Pacifique, convoitée par Pékin et vue en Asie comme
une anomalie-excroissance européenne allogène ?
Pour contrer l’expansion chinoise dans la zone, les États-Unis et leurs alliés comptent notamment sur le QUAD
o
(Quadrilateral Security Dialogue, voir carte n 3), un forum stratégique informel créé en 2004 composé de l’Inde, du
Japon, de l’Australie et de l’Amérique, et dont le premier exercice militaire coordonné a eu lieu fin 2019. Déjà, en
2005, la secrétaire d’État Condoleezza Rice, dans un discours prononcé à l’université Sophia de Tokyo, avait
soutenu la nécessité d’alliances en Asie (avec une référence spécifique à l’Inde, la Corée du Sud et le Japon) afin
d’empêcher la Chine de grandir « sans laisse » (« sans attaches »).
Dans ce contexte, et face à la menace chinoise commune, l’Inde est sortie de son ancienne position de nonalignement. Comme l’Australie, le Japon ou le Viêtnam, l’Inde craint l’expansion chinoise et se rapproche des ÉtatsUnis, tout en demeurant membre des Brics et proche de la Russie et de l’OCS. Elle développe ses propres liens
économiques, militaires, diplomatiques et zones de libre-échange avec l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Australie.
Outre les accords militaires avec le Népal et économiques avec le Japon, l’Inde compte sur l’organisation des pays
19
d’Asie du Sud et du Sud-Est créée dans le cadre des accords Bimstec – qui réunissent le Bangladesh, l’Inde, le
Myanmar, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Bhoutan et le Népal – et sur l’union économique de l’Asie du Sud. Même si
elle ne ferme pas totalement la porte, à terme, au RCEP, dans une logique de diversification et de développement
économique (fameux découplage évoqué supra).
En conclusion, le scénario le plus réaliste est qu’après la pandémie, l’affrontement politico-économique entre la
Chine et les États-Unis s’intensifiera, avec un probable renforcement de la position chinoise dans la région, sans que
l’on puisse exclure des répercussions militaires, compte tenu de l’existence dans cette zone de frictions multiples
(problème nord-coréen ; question de Taiwan ; « dilemme de Malacca »).
Tout cela contredit-il notre annonce d’un monde en voie de multipolarisation et signifie-t-il un retour à un
bipolarisme, cette fois-ci non plus russo-américain mais sino-américain ? Pas forcément. Le monde deviendra de
toute façon de plus en plus multipolaire, mais dans le même temps, les deux hyperpuissances sino-américaines
s’affronteront directement et indirectement, politiquement, idéologiquement, commercialement, et même
technologiquement, dans un contexte éminemment polycentrique. Pour reprendre une expression chère aux
théoriciens des relations internationales, le décalage des rapports de force résultant de la transition du pouvoir et du
resserrement de la confrontation entre les deux grandes puissances pourrait inciter les alliés de Washington à
remplacer la stratégie du containment par celle du bandwagoning. À l’opposé du balancing, ce concept fait
référence au fait, pour des États faibles, de rejoindre un État plus fort ou une coalition.
1. Partage du pouvoir déséquilibré entre acteurs géostratégiques de premier plan (États-Unis, Chine) et de moindre importance mais régionalement
puissants (Russie, Allemagne, Inde, Japon, Brésil, Indonésie, Afrique du Sud, Turquie).
2. Charles Kupchan, The End of the American Era. US Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-First Century, New York, Knopf, 2002.
3. Base navale de Yulin, sur l’île de Hainan, bases aériennes de Sansha (îles Paracels), de Zhubi, Meiji et Yougshu (Spratleys), à Sihanoukville
(Cambodge), à Kyaukpyu, à Sittwe (Myanmar), au Chittagong (Bangladesh), à Hambantota (Sri Lanka), à Gwadar (Pakistan), à Doraleh et Obock
(Djibouti) et à Port-Soudan.
4. Doté de 100 milliards de dollars, dont 41 versés par la Chine, 18 par l’Inde, le Brésil et la Russie, et 5 par l’Afrique du Sud, ce fonds,
opérationnel depuis 2015, devrait permettre à ses membres de se protéger en cas de tempête sur leurs devises, comme celle déclenchée mi-2013
après le changement de politique monétaire américaine.
5. Michel Geoffroy, La Nouvelle Guerre des mondes, op. cit.
6. UEEA : Arménie, Biélorussie, Russie, Kazakhstan et Kirghizistan.
7. Swift est un système international qui fournit des services de messagerie standardisée et de transfert interbancaire ainsi que des interfaces à plus
de 10 800 institutions dans 200 pays.
8. Michel Geoffroy, La Nouvelle Guerre des mondes, op. cit.
9. Investissements directs à l’étranger.
10. On peut citer aussi la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), avec laquelle Pékin veut concurrencer le FMI et la
Banque mondiale, ou le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP, voir infra).
11. La BRI englobe tous les niveaux de connectivité : commercial (baisse des droits de douane, contrats de gré à gré), financières (prêts), humain
(main-d’œuvre, formation) et construction d’immenses infrastructures (portuaire, routière, énergétique, communication, etc.).
12. Robert W. Merry, Sands of Empire. Missionary Zeal, American Foreign Policy, and the Hazards of Global Ambition, New York, Simon
& Schuster, 302 pp.
13. Alexandre Del Valle, « Entretien avec Caroline Galacteros : Les grands défis et enjeux géostratégiques de 2021… et du monde multipolaire
plein d’incertitudes qui vient », Atlantico, 22 janvier 2021.
14. Voir Pierre Marie Gallois, L’Heure fatale de l’Occident, Lausanne/Paris, L’Âge de l’Homme, 2004 ; et Gallois, La France sort-elle de
l’histoire ? Superpuissances et déclin national, Paris, L’Âge d’Homme, 158p.
15. Le doublement de la population africaine d’ici à 2050 va exacerber le problème des réfugiés économiques.
16. Maastricht, Euro, Schengen ; 60 % des règles nationales issues des décisions de la Commission de Bruxelles, progression du principe de
décisions à la majorité au détriment de l’unanimité, etc.
17. Jean Ziegler, La Haine de l’Occident, Paris, Albin Michel, 2008, p. 14, p. 13-14.
18. L’accord de libre-échange de l’Asean, signé le 28 janvier 1992 à Singapour entre les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du
Sud-Est, est entré en vigueur en 2003.
19. Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation.
CHAPITRE VI
Géopolitique linguistique : le français vecteur multipolaire ?
« L’anglais menace le français et la diversité même des langues […]. Posséder les mots et les diffuser, c’est
1
posséder la pensée . Le français, à la différence de l’anglais, n’a pas de vision dominante mondiale […], la
promotion du français, je le répète, n’a pas pour but une mondialisation à son bénéfice. Il a pour but un autre
choix, qui est celui de la diversité. »
Claude Hagège, linguiste français
Dans les années 1990 et surtout 2000, les échanges d’informations ont connu une amplification sans précédent
grâce à la généralisation de l’anglais comme langue de travail et de socialisation dans les zones touchées par la
métropolisation, dont il est devenu la lingua franca, avec la numérisation de l’information, l’ordinateur individuel,
Internet et le GSM, puis grâce à l’émergence d’une deuxième génération de fournisseurs de services numériques :
les Gafam. Depuis cette dernière phase de la mondialisation digitalisée, fruit de McWorld, l’hégémonie de la langue
anglo-américaine semble s’imposer partout, bien que certains pôles linguistiques et civilisationnels offrent une
résistance, notamment le mandarin, l’espagnol, le portugais, l’arabe et, bien sûr, le français. D’après les spécialistes,
le monde contemporain recenserait plus de 6 000 langues ! Mais leur « poids », a fortiori géopolitique, est
naturellement très variable. Seulement une trentaine de langues dites « majeures » domineraient la planète. Encore
faut-il, d’ores et déjà, lever quelques ambiguïtés quant au dénombrement plus ou moins précis des différents
locuteurs. En 2018, certains instituts, notamment anglo-saxons, établissaient des hiérarchies en prenant en compte la
« langue maternelle » et la « langue seconde ». La synthèse de ces hiérarchies aboutissait au classement (certes
approximatif) suivant, pour les langues maternelles : 1) mandarin : 921 millions de locuteurs ; 2) espagnol :
463 millions ; 3) anglais : 370 millions ; 4) hindi : 342 millions ; 5) arabe : 250 millions ; 6) bengali : 228 millions ;
7) portugais : 227 millions ; 8) indonésien : 200 millions ; 9) russe : 153 millions ; 10) japonais : 80 millions.
Cependant, si l’on ne raisonne pas seulement en nombre de locuteurs de langue maternelle mais de langues les plus
parlées en prenant en compte la « langue maternelle » et la « langue seconde », on arrive à un classement bien
2
différent : 1) anglais : 1 268 millions ; 2) mandarin : 1 120 ; 3) hindi : 637 4) espagnol : 538 ; 5) français : 277 ;
6) arabe (standard) : 274 ; 7) bengali : 265 ; 8) russe : 258 ; 9) portugais : 252 ; 10) indonésien : 199.
Si l’ONU recense officiellement six langues de travail (l’anglais, le français, le russe, le chinois, l’arabe et
l’espagnol), la quasi-totalité des grandes organisations internationales ne sont réellement concernées que par
l’anglais et le français. Ces deux vecteurs sont les seuls à être de facto présents sur les cinq continents. Eux seuls
disposent véritablement du statut international, un statut capital dans la compétition économique, politique et,
a fortiori, culturelle qui agite le globe à l’heure de la mondialisation. À l’image du système bipolaire sécrété au plan
géopolitique par l’après-Yalta et qui vécut jusqu’à l’effondrement de l’URSS, on peut parler aujourd’hui, sur le plan
linguistique, de la pérennisation d’un partage du monde, entre la langue de Shakespeare (ou plutôt celle de l’Oncle
Sam !) d’une part – celle de la mondialisation dangereuse, qui efface les identités au profit d’un village mondial
anglophone – et la langue de Molière, d’autre part, qui aurait dû continuer à être un vecteur de résistance à McWorld
et de promotion d’un modèle multipolaire, le français résistant paradoxalement presque plus au Québec que dans la
mère patrie française où les Français semblent avoir honte de leur héritage et de leurs traditions, lorsqu’ils
plébiscitent McDonald’s, le blue-jeans, et le fast fashion pour se fondre dans ces millions de consommateurs
anonymes que l’Oncle Sam rend dépendants à travers le monde.
L’emprise de l’anglo-américain
Idiome de McWorld, véhicule privilégié des échanges internationaux et socle du soft power américain avec plus
d’un milliard et demi de locuteurs, l’anglais écrase donc la planète linguistique, tant au plan quantitatif que
qualitatif. Il est la langue maternelle au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, et la langue seconde dans des nations au gabarit impressionnant comme
l’Union indienne, le Pakistan ou le Nigeria. En 2017, les chiffres généralement de l’ordre de 380 millions de
locuteurs « langue maternelle », de 620 millions « langue seconde » et plus de 600 millions « langue étrangère »
confirment cette hégémonie linguistique… Héritage de l’Empire britannique (Commonwealth), et plus récemment
de l’impact économique et politique de la superpuissance étatsunienne, mais aussi de son soft power et de son
industrie musicale et télévisuelle, en plus d’être la langue de l’informatique et du business, l’anglais et son avatar
anglo-américain constituent l’outil primordial de la communication internationale, des échanges commerciaux aux
transferts de technologie, en passant par les systèmes audiovisuels, sans oublier les revues scientifiques et
universitaires internationales et les grandes écoles qui imposent les normes américaines. Véhicule politique et
commercial, l’impérialisme anglo-américain se traduit aussi par un processus, maintes fois dénoncé (tout
particulièrement du côté de Paris), d’« invasion culturelle ».
Outre la culture, l’anglais est devenu le vecteur quasi exclusif du monde scientifique. La passivité, voire la
résignation, des scientifiques de langue française à son égard est devenue monnaie courante. Une publication dans
une revue aussi prestigieuse que Nature ne peut se faire que par le canal de l’anglais. Les classements des centres de
recherche universitaires, qui font la part belle, et pour cause, aux institutions anglo-saxonnes, s’appuient d’abord sur
les travaux publiés en anglais. En 1988, l’Académie des sciences française décidait de l’emploi de l’anglais dans ses
comptes-rendus : reconnaissant le rôle essentiel de l’anglais dans les communications scientifiques internationales,
spécialement dans les sciences, l’Académie décidait de donner une place beaucoup plus importante à l’anglais en
favorisant les auteurs acceptant de donner leurs propositions de contributions via une abridged english version. Et
pour la seule année 2017, on a recensé dans l’enceinte de la vénérable Sorbonne huit colloques et conférences
internationaux se déroulant exclusivement en anglais ! Richelieu, rénovateur de l’antique maison, a dû se retourner
dans sa tombe… Dès 1990, l’Aupelf s’inquiétait : sur l’ensemble des publications scientifiques dans le monde, 65 %
étaient rédigées en anglais, 12 % en russe et 10 % en français. En 2012, les pourcentages étaient passés à 70 %,
13 % et 9 %… Pire, peut-être, en changeant d’échelle, au Québec, siège de l’Organisation internationale de la
francophonie (voir infra), 70 % des articles publiés par les scientifiques québécois l’étaient en langue anglaise en
1970… et plus de 85 % en 2012…
L’affrontement entre l’anglophonie et la francophonie est particulièrement visible en Afrique de l’Ouest et
centrale, où certains pays comme le Rwanda sont passés subitement à l’anglais. Les Tutsis, traditionnellement
antifrançais et anglophones, sont devenus la pièce maîtresse de la diplomatie américaine au Rwanda comme dans
d’autres pays de la région où ils sont prépondérants. Ce n’est pas non plus un hasard si Laurent-Désiré Kabila, exprésident de la République démocratique du Congo, qui avait renversé Mobutu avec l’aide américaine, inscrivit en
priorité dans son programme culturel le remplacement du français par l’anglais comme première langue étrangère.
En Afrique noire, la lutte contre la francophonie est également un puissant outil d’islamisation, la francophonie étant
assimilée à l’héritage colonial et chrétien. La politique d’islamisation menée par l’Arabie saoudite, le Qatar et le
Koweït se traduit d’ailleurs systématiquement, en Afrique, sur le plan culturel, par une éviction de l’influence
française, belge ou portugaise au profit de l’anglophonie. Partout, les islamistes, qui veulent rompre tout lien avec
les anciennes puissances coloniales, surtout francophones, préfèrent l’anglais standard McWorld au français associé
à la laïcité et aux Lumières antireligieuses. C’est en partie en jouant sur ce tableau anticolonialiste que Washington
sape partout les positions françaises, comme on a pu le voir dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement au
Zaïre. Dans d’autres cieux, notamment au Canada, les francophones du Québec ont quant à eux le plus grand mal à
résister à la progression de l’anglophonie. Certes, le Québec a adopté des lois contre la progression de termes
« franglais » et défend souvent mieux le français que ses « cousins » de France ou de Belgique. Toutefois, ce
farouche combat en faveur de la francophonie québécoise n’a pas réussi à maintenir la langue française partout,
puisque dans la seconde grande ville du Québec, Montréal, de nombreuses familles anglophones refusent de se plier
à la francophonie et tentent même, portées par la mondialisation anglo-saxonne et la proximité des États-Unis, d’y
faire progresser l’anglophonie tandis que le français n’est plus connu que de rares élites et de quelques vieillards au
Viêtnam, dans l’ex-Indochine française comme en Pologne ou en Roumanie.
Le paradoxe québécois
La géopolitique de la langue française en Amérique du Nord illustre néanmoins la vitalité de la langue de
Molière. Le français est vu généralement non seulement comme une enclave linguistique qui a réussi à se maintenir
et à se développer au milieu d’un océan anglo-saxon, mais aussi comme une résistance à la domination linguistique
de l’anglais que l’on constate aujourd’hui en France, dont la langue s’anglicise rapidement. L’Histoire de la
e
Nouvelle-France canadienne commence très tôt au début du XVII siècle lorsqu’une poignée de colons s’installe dans
ces contrées peu adaptées à la présence humaine. Or, les quelques colons français (quelques milliers seulement)
s’occupent surtout du commerce des fourrures, établissent des relations constructives avec des tribus indiennes
voisines, à la différence des Britanniques des 13 colonies, et très vite, une mini-civilisation française se constitue
autour du golfe du fleuve Saint-Laurent, des villes de Québec, de Trois-Rivières, et de Montréal. En 1763, après une
longue série de guerres, la France cède définitivement sa colonie d’outre-Atlantique à la Grande-Bretagne. Il est
curieux de noter que le roi français, lorsqu’on lui offrait le choix d’abandonner soit les Antilles, soit la NouvelleFrance, décide de garder les deux îles sucrières de Guadeloupe et de Martinique qu’il considère comme plus
importantes sur le plan économique que « quelques arpents de neige » au Canada français. Ces Français oubliés du
Québec comptent alors seulement 60 000 âmes, devenus deux cent cinquante ans plus tard plus de 8 millions.
Aujourd’hui, cette province est le véritable moteur économique du Canada et sa partie la plus développée marquée
par une forte capacité d’innovation, de flexibilité et de productivité. Comment ceci a-t-il été possible ? Il convient ici
de revenir sur un paradoxe : les Québécois ont préservé une forte identité nationale alors même que leurs frères
français ont tout fait pour l’effacer – et en même temps cette société a réussi à s’insérer dans l’écosystème productif
de l’Amérique du Nord. Le Québec constitue un prolongement vers le nord du cluster productif et financier de la
côte est des États-Unis. En même temps, le Québec représente une porte d’entrée pour les capitaux européens en
raison de ses liens avec le Vieux Continent. Les Québécois francophones ont préservé pendant des siècles une très
forte natalité grâce au modèle rural qui prédominait au Canada français, mais ils ont aussi préservé la langue de leurs
ailleux en résistant farouchement à tout emprunt linguistique à leur voisin. Nous pensons que cette lutte identitaire
est à l’origine du phénomène que l’on observe aujourd’hui au Québec et qui consiste en ce que le développement
économique et l’innovation ne peuvent avoir lieu que dans une société fière de ses racines, de son histoire, qui
résiste à la mondialisation anglo-saxonne et qui n’a pas honte de son identité. Grâce à une politique linguistique très
active, les Québécois ont non seulement réussi à maintenir leur présence mais aussi à élargir le champ de la langue
française qui progresse même aujourd’hui au Québec, y compris à Montréal, notamment au moyen d’une
immigration sélective privilégiant les candidats francophones venus de France, de Belgique, de l’Afrique du Nord et
de l’Afrique subsaharienne. Les autorités québécoises pratiquent en effet une immigration volontariste et choisie
puisque les candidats sont soumis à un examen linguistique préalable avant de pouvoir émigrer au Canada
francophone, ce qui rend plus éligible par exemple un Russe francophone qu’un Algérien qui ne le serait plus.
Francophonie avec un grand F : l’Organisation internationale de la
francophonie
La Francophonie avec un F majuscule désigne l’ensemble des États et des instances officielles supraétatiques
« qui ont en commun l’usage du français dans leurs communications et leurs échanges ». La Francophonie est
3
e
aujourd’hui « dirigée » par l’OIF . Le concept, créé à l’origine au XIX siècle par le géographe Onésime Reclus, était
une idée défendue par quelques grandes personnalités du monde francophone, comme le Cambodgien Norodom
Sihanouk, le Tunisien Habib Bourguiba ou, au premier rang d’entre eux, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor,
membre de l’Académie française… Le 20 mars 1970, c’est en présence du ministre de la Culture français, André
Malraux, et de 22 chefs d’État que l’acte de naissance de l’ACCT (Agence de coopération culturelle et technique),
devenue aujourd’hui l’Organisation internationale de la francophonie, est signé à Niamey. La liste des signataires est
édifiante : 5 États de l’hémisphère Nord, la France, Monaco, le Canada, la Belgique et le Luxembourg ; 2 États de
4
l’Asie pacifique, le Cambodge et le Viêtnam, 1 des Caraïbes, Haïti, et 14 États du continent africain . La place des
États pudiquement baptisés « pays en voie de développement » y reste donc très majoritaire, et on imagine sans mal,
dès cette époque, qu’au-delà des objectifs strictement linguistiques et culturels, les préoccupations géoéconomique
sont présentes dans de nombreux cas.
Depuis 1945, l’Afrique subsaharienne partage le triste privilège de vivre en direct la majorité des conflits
ouverts. Et les États francophones sont loin d’être absents du palmarès, de la guerre entre le Mali et le Burkina Faso
aux dramatiques événements du Rwanda, des crises intestines égrenant l’histoire contemporaine de l’ex-Zaïre ou du
Congo-Brazzaville au conflit de Casamance ou à celui du Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie, sans
oublier la montée en puissance de l’islamisme et du djihadisme dans toute la bande sahélo-saharienne et alentour.
Quant à l’océan Indien, exempt de nombreux conflits « frontaliers » par essence, leur intérêt stratégique n’en est pas
moins exceptionnel ! Et ce n’est pas par hasard que, sous couvert de la francophonie, Paris affirme sa présence, via
5
sa souveraineté sur les « Îles Éparses » ou son département de Mayotte, face aux Comores. Cette évocation nous
autorise sans doute à souligner, in fine, le rôle majeur et parfois complémentaire, joué par les disparités de valeurs,
politiques religieuses et « historiques ». Pour ce qui est des valeurs démocratiques, au-delà de l’exemple de la
Guinée équatoriale, la palette des régimes politiques est particulièrement variée au sein des États membres de l’OIF,
des grandes démocraties libérales occidentales aux régimes « autoritaires » en passant par les « semi-présidentiels »,
ou, pour reprendre l’heureuse formule de l’écrivain argentin Ernesto Sábato, les « démocratures ».
Concernant le facteur religieux, rappelons qu’officiellement, seuls quelques États comme la France ont intégré
le concept de laïcité dans leur Constitution. Face au fait religieux, la diversité des membres de l’OIF est patente : si
la quasi-totalité de ses adhérents localisés dans l’hémisphère Nord baignent dans la sphère judéo-chrétienne et ses
héritages plus ou moins laïques et désenchantés, les contrées du Sud en général et du continent africain en particulier
sont marquées par une expansion structurelle et spatiale de l’Islam, voire de l’islamisme antioccidental, antifrançais
et de plus en plus hostile à la francophonie. Son expansion tend à délégitimer et même à combattre les religions jadis
importées par les puissances coloniales européennes chrétiennes. Une référence concrète, en ce domaine, peut être
évoquée : l’appartenance de certains membres de l’OIF à une autre institution internationale, l’Organisation de la
conférence islamique (OCI). Sur les 29 États africains membres de l’OIF, 18 ont aussi adhéré à l’OCI, dont
7 membres fondateurs de la Francophonie. Créée dès 1970, à Djeddah, la Conférence islamique, évoquée au
chapitre VII, est devenue une institution incontournable à l’échelle de l’ensemble du monde musulman. Certains de
ses objectifs clairement affichés ne peuvent que contribuer à renforcer les divergences d’intérêts au sein l’OIF entre
membres et non-membres, par exemple l’article qui invite à « consolider la solidarité islamique ; à conforter la lutte
de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leur dignité, de leur indépendance et de leurs droits
nationaux »… A fortiori quand on lit dans la Charte le souci de rendre compatibles « les lois civiles avec celles
supérieures de la charia », puis de « coordonner les actions destinées à sauvegarder les Lieux saints, soutenir la lutte
du peuple palestinien et aider à récupérer ses territoires », l’objectif est difficilement compatible avec celui de l’OIF
qui s’interdit toute ingérence dans la géopolitique interne des États.
La troisième vague d’adhésions, qui fait passer aujourd’hui l’OIF à 84 membres (54 de plein droit, 4 associés et
26 observateurs), est plus édifiante encore. Elle correspond à la conjonction de 3 facteurs complémentaires : la
disparition du système bipolaire, le processus de mondialisation et les mutations internes des missions assignées à
6
l’OIF . Un flux qui, même si certains de ces nouveaux adhérents n’adoptent que le simple statut d’observateur,
souligne le souci des anciens membres du bloc de l’Est, après la disparition de l’Union soviétique, d’intégrer des
structures supraétatiques susceptibles de leur éviter l’isolement géopolitique synonyme de marginalisation et qui
explique aussi l’arrivée au sein de l’OIF d’États où le français n’est ni langue officielle, ni langue nationale, et même
tout juste « langue d’étude » pour une minorité ! Quant au processus de mondialisation, il achève de faire de l’OIF
une organisation fermement ancrée sur les 5 continents, avec l’adhésion du Cap-Vert (1992), de la Suisse (1996), de
São Tomé e Príncipe (1999), d’Andorre (2004), de l’Autriche (2004), de la Grèce (2004), de Chypre (2006), du
Ghana (2006), du Mozambique (2006), de la Thaïlande (2006), de la République dominicaine (2010), des Émirats
arabes unis (2010), du Monténégro (2010), du Qatar (2012), de l’Uruguay (2012), de la Corée du Sud (2015), du
Mexique (2015) ou de l’Argentine (2016).
Les missions de l’OIF, progressivement modifiées, se sont notamment concrétisées par les déclarations
historiques de Bamako, de Saint-Boniface et de Ouagadougou. Les deux premières soulignent la volonté de l’OIF de
« contribuer à la prévention des conflits et dans l’espace francophone, de favoriser la consolidation de l’État de droit
et de la démocratie et d’agir pour la promotion et l’effectivité des droits de l’homme ». Programme qui épouse
indéniablement les grands principes et les grands axes de la politique étrangère conduite par la France au cours des
dernières décennies. Quant à la déclaration de Ouagadougou, elle met en avant dans le domaine économique et
social les thèmes majeurs de la coopération et du développement durable et solidaire. Notons déjà, une
incompatibilité (au moins apparente) entre ce double affichage et le fait que l’OIF a aussi adopté sans réserve le
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États concernés ! Au-delà de ces considérations générales,
deux processus majeurs et complémentaires demeurent : l’approfondissement des structures, des missions, des
objectifs, d’une part ; l’élargissement géographique, avec la multiplication spectaculaire des adhésions, d’autre part.
Parmi les exemples les plus édifiants, on peut citer celui de la Guinée équatoriale. Au lendemain de son
accession à l’indépendance, ce pays ne reconnaissait qu’une seule langue officielle, l’espagnol (en dépit du fait que
la grande majorité de ses habitants ne parlait que fang). Par sa situation géographique, la partie continentale du pays
étant frontalière de deux États francophones, le Gabon et le Cameroun, le régime de Malabo a décidé d’adopter, en
1998, une loi constitutionnelle établissant que « les langues officielles de la République de Guinée équatoriale sont
l’espagnol et le français ». Dans ce contexte volontariste, le français est devenu la langue obligatoire dans les
établissements du second degré (des établissements, il est vrai, fréquentés par moins de 10 % de la population). En
juillet 2007, le président Obiang Nguema faisait adopter le portugais comme troisième langue officielle du pays, et
adhérait dans la foulée à la Communauté des pays de langue portugaise (la CPLP, « lusophonie ») sans cacher que
l’officialisation des langues française et lusitanienne était destinée à favoriser la candidature de Malabo aux aides
économiques offertes par la France, la CPLP et la Francophonie !
À l’échelle de l’Europe, les nouveaux venus dans le club francophone de l’OIF confortent sans équivoque
l’actualité et la pérennité des contentieux potentiels de la péninsule balkanique. La Croatie catholique (proallemande
et germanophile), la Serbie orthodoxe (traditionnellement francophile), l’Albanie musulmane (très italophile et
italophone), par exemple, sont désormais toutes les trois membres de l’OIF. Cela suffira-t-il à éradiquer
définitivement les problèmes interétatiques, voire intraétatiques qui surgissent régulièrement au sein des territoires
de l’ex-Yougoslavie ? On peut bien sûr en douter.
Au-delà des Balkans, la présence de la Moldavie, de l’Ukraine, de l’Arménie ou de la Géorgie dans cette
instance francophone rappelle aussi directement l’acuité des questions géopolitiques qui ont agité et qui agitent
encore les marches orientales de l’Europe, l’ensemble caucasien et la vitalité de ses « conflits gelés ». Dans l’Asie
du Sud-Est, la présence du Laos, du Viêtnam ou du Cambodge contribue à s’interroger sur la fragilité des équilibres
régionaux et sur le rôle effectif que pourrait jouer l’OIF dans la promotion des valeurs démocratiques. Au plan des
relations bilatérales, les exemples foisonnent aussi en matière d’ambiguïté et vraisemblablement de leurres et de
faux-semblants. Par exemple, la « cohabitation », au sein de l’OIF, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie et
de la Moldavie, masque les contestations récurrentes liées (et pas seulement dans la mémoire collective) aux
modifications historiques des frontières, et particulièrement celles qui sont directement héritées des traités mettant
fin à la Première Guerre mondiale et régulièrement réactualisés par l’épineuse question des minorités. Témoin,
l’œuvre concrète d’un francophone, Emmanuel de Martonne, le « Père » de la Grande Roumanie, dont la personne
est quasiment adulée à Bucarest et franchement détestée du côté de Budapest ou de Sofia, et pour cause : une partie
de l’ancienne Hongrie, toujours peuplée de Magyars, appartient à la Roumanie.
1. Claude Hagège, Contre la pensée unique, Paris, Odile Jacob, 256 p.
2. Tristan Gaudiaut, « Les langues les plus parlées dans le monde », Statista, 29 septembre 2020.
3. Organisation internationale de la francophonie.
4. Bénin, Burundi, Côte d’Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Madagascar, Mali, Maurice, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie. Une seconde
vague d’adhésions deux décennies après, plus hétérogène : Laos (1972), Liban (1973), Comores (1975), Seychelles (1976), Djibouti (1977),
Vanuatu (1979), Dominique (1977), Sainte-Lucie (1979), Mauritanie (1981), Maroc (1981), Égypte (1983), Centrafrique (1973), Cameroun (1975),
Congo RDC (1977), Guinée-Bissau (1979), Congo-Brazzaville (1981), Guinée (1981).
5. Petites îles françaises situées autour de Madagascar.
6. Vont adhérer successivement à l’Organisation des pays comme la Roumanie (1991), la Bulgarie (1991), la Pologne (1996), la République
tchèque (1997), la Moldavie (1998), la Lituanie (1999), l’Albanie (1999), la Slovénie (1999), la Slovaquie (2002), la Macédoine (2002), la Serbie
(2003), la Hongrie (2004), la Croatie (2006), la Géorgie (2006), l’Ukraine (2006), I’Arménie (2008) ou la Lettonie (2008).
PARTIE II
VARIABLES CONTEMPORAINES
CHAPITRE VII
Islamisme et terrorisme mondialisés
« Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir
le courage de le faire. »
Georges Clemenceau
De quoi parle-t-on au juste ?
Loin de supprimer les conflits identitaires, la mondialisation est un formidable moteur des chocs
civilisationnels, dont l’islamisme radical est l’exemple le plus flagrant. Le projet panislamiste étant par définition
hostile aux frontières et aux nations, il constitue de ce point de vue une des faces noires de la mondialisation. En
2014, lorsque des combattants de l’État islamique effaçaient à coups de pelleteuses la frontière syro-irakienne
considérée comme un héritage impie des accords Sykes-Picot, cela participait en fait du même projet antifrontiériste
que celui annoncé par Thomas Friedman, auteur de La Terre est plate. Cet apparent paradoxe a été décrypté par
Benjamin Barber dans son ouvrage précité, Djihad versus McWorld.
Pour mieux comprendre la place de l’islamisme et du terrorisme djihadiste dans le processus de mondialisation
et donc de destruction de la diversité culturelle de la planète, il faut d’abord définir ce phénomène d’un point de vue
1
2
géopolitique. La perspective communautarienne des relations internationales, théorisée par Barry Hughes , qui
reconnaît aux groupes identitaires ethnoreligieux radicaux un rôle d’acteurs de la politique internationale, permet
d’appréhender l’islamisme comme un phénomène géopolitique à part entière, dont le terrorisme n’est qu’une
composante minoritaire.
Du point de vue des études de sécurité et de la polémologie, l’islamisme doit être analysé comme un projet
politico-religieux qui vise à imposer la charia dans sa conception totalitaire à tous les musulmans, puis à rétablir un
o
califat destiné à dominer, de gré ou de force, l’humanité tout entière (voir califat, cartes n 8 et 9). Ce continuum
idéologico-religieux, qui crée des passerelles entre islamisme politique institutionnel et islamisme djihadiste, ne peut
pas être ignoré par ceux qui font face à cette menace à la fois polymorphe et asymétrique, qu’ils soient musulmans,
les premiers concernés et frappés par les islamistes qui poursuivent avant tout les « apostats » (murtaddin), ou qu’ils
soient non musulmans, donc des infidèles (koufars).
D’après l’approche communautarienne de Barry Hughes, les communautés qui se perçoivent comme
supérieures (race, ethnie, religion ou culture/langue) ont tendance à s’isoler par l’établissement de frontières
étanches, formelles ou virtuelles, et peuvent devenir des acteurs influents de la politique internationale dès lors que
leur groupe en rupture avec l’ordre ambiant veut imposer sa domination aux autres entités via un prosélytisme
3
suprémaciste ou irrédentiste . Adepte de cette démarche analytique qui analyse le fait civilisationnel, Mohammad4
Reza Djalili a très bien mis en lumière la conception géopolitique originelle islamique, à laquelle se réfèrent toutes
les mouvances islamistes, en rappelant que l’islam politique (et pas seulement le terrorisme islamiste) divise
principalement l’humanité en deux mondes antinomiques : le dar al-islam, ou « demeure de l’Islam », entité fondée
sur le triple monisme : une communauté, une foi, une loi, et le dar al-harb (monde du non-Islam ou demeure de la
guerre, à combattre ou à soumettre). Les musulmans sont ici censés former une communauté unique, séparée et
5
supérieure . Dans cette vision, la religion est le seul fondement de la citoyenneté et de la communauté, l’oumma,
o
appelées à terme à être réunies dans un califat (carte n 8). Ce projet néocalifal, commun aux mouvances islamistes
institutionnalisées (Frères musulmans, Jamaa al-islam, Millî Görüş, etc.) ou terroristes (salafistes djihadistes),
relancé par les adeptes du salafisme ou salafiyya, est non seulement vu comme une institution supranationale
appelée à dominer toute l’humanité (Tamkine planétaire), mais constitue la seule « nation » ayant réellement le droit
d’exister sur terre. Le droit islamique classique ne reconnaît d’ailleurs d’autre nation que l’islamique. Cette théorie
néo-impériale de l’État universel islamique s’oppose par principe à la coexistence d’une pluralité d’États égaux et
souverains, et c’est pour cette raison notamment que l’islamisme radical n’est pas qu’une menace terroriste (partie
émergée de l’iceberg totalitaire) mais avant tout un défi géopolitique et stratégique pour tous les États-nations
attachés à leur souveraineté et à leur pérennité, qui voient dans l’islamisme un projet subversif à la fois séparatiste
(en interne) et suprémaciste conquérant (au niveau externe). « Tant que l’humanité dans sa totalité n’est pas soumise
à cet État islamique idéal – le “dar al-islam” –, il reste une partie du monde qui échappe à la loi divine, le “dar alharb”, explique Djalili. Pour conquérir ces territoires, le recours à la force (guerre) est en principe licite jusqu’à la
victoire finale de l’Islam sur les non-croyants. »
Fortement influencé par le prédicateur islamiste pakistanais Abou Ala al-Mawdoudi, penseur majeur des Frères
musulmans – après al-Banna et Sayyid Qutb, inspirateur du djihadisme, confirme cette idée « orthodoxe »
théocratique que « l’Islam ne connaît que deux types de sociétés : musulmane ou jahilite. La société musulmane est
6
celle où est appliqué l’Islam, […]. La société jahilite est celle où l’Islam ne s’applique pas ». Par extension, la
jahiliyya désigne tout ce qui, dans le monde moderne, s’éloigne de l’Islam, que ce soient les vestiges de la société
païenne pharaonique ou les sociétés non musulmanes du présent. Dans la rhétorique musulmane traditionnelle,
l’Europe, l’Inde ou les pays musulmans dirigés par des régimes peu ou prou laïcisant (Irak, Syrie, Tunisie, Turquie)
7
sont par conséquent des sociétés jahilites .
Les pôles majeurs du totalitarisme vert : de l’islamisme
institutionnel au djihadisme
Cette pensée totalitaire, commune à l’islamisme indo-pakistanais, au salafisme révolutionnaire et djihadiste et
aux Frères musulmans, dont les États protecteurs actuels sont le Qatar et la Turquie d’Erdoğan, inspire l’ensemble
de l’islamisme radical. La seule différence est que les djihadistes veulent réaliser l’objectif ultime du califat
universel par la guerre hic et nunc, dans le cadre de la « stratégie de la sidération » violente, alors que les adeptes de
l’islamisme institutionnel (Frères musulmans ; islamistes turcs de l’AKP/Milli Görüs) veulent y parvenir par des
moyens démocratiques ou subversifs, en prenant le contrôle d’États musulmans purifiés de leurs forces laïques statonationalistes, perçues comme des cinquièmes colonnes du monde « mécréant ». En dépit des différences et
antagonismes opposant, d’une part, l’islamisme institutionnel, adepte de la stratégie de l’entrisme, et, de l’autre,
l’islamisme djihadiste, adepte de la stratégie de l’intimidation par la violence, les sources théologiques salafofréristes demeurent communes et les deux acteurs islamistes dissemblables concourent tous deux aux mêmes
objectifs de démantèlement du pouvoir infidèle dénoncé par Hassan al-Banna, Sayyid Qutb ou Abou Ala alMawdoudi et d’édification d’un empire califal, décrit par Bruno Étienne comme le marqueur même de la catégorie
d’islamisme radical.
Cette idéologie fondée sur le règne de la charia et du califat planétaire, appelée à soumettre, de gré ou de force,
o
8
l’humanité (voir carte n 8), est portée depuis des décennies par des grands pôles étatiques : le wahhabisme salafiste
officiel d’Arabie saoudite, avec son bras prosélyte mondial, la Ligue islamique mondiale ; le pôle indo-pakistanais,
cofondateur du Jamaat al-islamiyya ; des talibans d’al-Qaida ; le Qatar, parrain du Hamas et des Frères musulmans,
à la tête du média planétaire Al Jazeera ; le pôle néo-ottoman réhabilité par la Turquie postkémaliste de Recep
Tayyip Erdoğan ; la révolution islamique iranienne chiite, influencée dans ses origines par les Frères musulmans
bien qu’étant chiite ; sans oublier les puissantes institutions et organisations internationales panislamiques comme
l’Organisation de la coopération islamique (voir infra), qui réunit cinquante-sept pays musulmans désireux
d’instaurer un ordre international alternatif fondé sur la charia, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation,
les sciences et la culture (Isesco, sorte d’« Unesco » islamique, influencée par les Frères musulmans) ; et enfin, les
grandes centrales terroristes comme al-Qaida ou Daesh, et les groupes franchisés associés comme Aqmi, Boko
Haram, shebab somaliens, etc. (voir infra). Ces pôles sont tous plus ou moins reliés par des passerelles officieuses
ou officielles, ponctuelles ou durables, le Qatar, la Turquie et l’Iran appuyant officiellement le Djihad islamique et le
Hamas palestiniens, et le Pakistan, le Qatar, le Koweït, le Soudan, l’Arabie saoudite et la Turquie soutenant ou ayant
même parfois cocréé des centrales terroristes comme al-Qaida ou Daesh.
De ce fait, la différence entre, d’une part, l’islamisme institutionnel, qui a pignon sur rue en pays musulman et
non musulman, et, de l’autre, l’islamisme djihadiste, est plus une différence de degrés que de nature, et c’est bien là
le vrai fond, idéologico-politique et théologique, du problème. Les organisations terroristes ne constituent que la
face émergée de l’iceberg islamiste totalitaire qui a déclaré la guerre à ses ennemis « mécréants » et « apostats ». En
réalité, la menace islamiste est également incarnée par des pays et mouvances parfois réputés « amis » de l’Occident,
certains étant dotés d’armées régulières, parfois nucléaires (Pakistan, bientôt la Turquie et l’Arabie saoudite), ou
fournies par l’Alliance atlantique (Turquie). Elle est alimentée financièrement, diplomatiquement et
idéologiquement par les monarchies gazo-pétrolières sunnites du Golfe et relayée – sous couvert de droit à la liberté
religieuse – jusqu’au sein de nos sociétés ouvertes ou des Nations unies, par des organisations et associations
appuyées au niveau institutionnel par ces mêmes États et pôles précités (Isesco, OCI, Ligue islamique
mondiale, etc.). Paradoxalement, l’Occident entend donc lutter contre le djihadisme sur son sol sans jamais
neutraliser ces pôles subversifs parfois « alliés », qui poursuivent pourtant les mêmes objectifs d’islamisation
planétaire que ces terroristes, certes de façon plus « pacifique ».
L’erreur occidentale et atlantiste des alliances
contracivilisationnelles
Les alliances paradoxales, que nous avons nommées « contra- ou anticivilisationnelles » scellées par les États
occidentaux membres de l’Otan avec les pôles de l’islamisme, remontent, on le sait, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale (pacte du Quincy scellé entre les États-Unis et l’Arabie saoudite en 1945). Elles ont été à la fois fondées
sur des impératifs énergétiques, financiers, puis politico-stratégiques, notamment sous la guerre froide, lorsque les
États-Unis ont appuyé les moudjahidines en Afghanistan pour endiguer l’Union soviétique (muslim belt). La
généalogie du djihadisme remonte en fait, sur le plan doctrinal, à un courant de l’islam sunnite promu par l’Arabie
saoudite et le Qatar, et inspirateur théologique d’al-Qaida et de Daesh, le hanbalisme, ancêtre du wahhabisme. On
appelle aussi ce courant « salafisme », en référence aux « pieux ancêtres » (as-Salaf), les premiers musulmans
compagnons de Mahomet qu’il conviendrait selon eux d’imiter en tout, y compris dans le culte du djihad
9
conquérant . Au même titre que le djihad guerrier offensif, le dogme salafiste (aqida), qui invite tout musulman à
désavouer les mécréants et à faire corps avec les musulmans (al-wala wa’l-bara ou « l’alliance et le désaveu »), est
directement issu du wahhabisme saoudien. Cette idée foncièrement communautarienne, pour paraphraser Hughes,
ou séparatiste, selon les termes du président Emmanuel Macron, consistant à désavouer les infidèles, a été théorisée
e
au XIX siècle par le petit-fils de Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb ash-Sheikh (1786-1818) et elle est officiellement
enseignée en Arabie saoudite et dans des milliers de mosquées et centres islamiques pilotés par ce grand allié des
États-Unis dans le monde entier. À titre d’exemple, le fameux terroriste français Farid Benyettou, émir du réseau
djihadiste dit « des Buttes-Chaumont », à Paris, qui a formé un nombre incroyable de futurs terroristes, élaborait ses
« cours de religion » à partir des ouvrages de salafistes très respectables comme Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb,
notamment Ousoul ath-Thalata, puis de Saoudiens contemporains en bons termes avec les autorités de Riyad,
comme Muhammad ibn Salih al-‘Uthaymin (mort en 2001), auteur notamment d’un manuel de droit islamique, Al10
Ousoul min ‘ilm al-Oussoul . À ses débuts, le phénomène s’est essentiellement exprimé à l’échelle locale, malgré
sa prétention néocalifale déjà perceptible dans les écrits fondateurs des grands idéologues de l’islamisme radical au
e
siècle. Force est de constater que c’est le processus de mondialisation anglo-saxonne qui a permis à al-Qaida de
devenir la première organisation internationale islamiste et djihadiste dans les années 1980-1990, au sortir de la
XIX
guerre froide. Depuis, le djihadisme, profitant de la mondialisation technologique comme des flux migratoires et du
multiculturalisme, est devenu le quotidien de nombreuses sociétés musulmanes ou non musulmanes partout dans le
monde.
État des lieux et stratégies du djihadisme
D’après une étude de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol) qui a recensé les attentats djihadistes
dans le monde sur les quarante dernières années, le terrorisme islamiste aurait tué 167 000 personnes entre 1979
et 2019 pour 36 000 actes terroristes perpétrés aux quatre coins du globe. À ce chiffre, il convient d’ajouter au moins
3 000 morts en 2020, ce qui nous amène à un total de 170 000 morts début 2021. Si la France est le pays européen le
plus touché, avec 320 morts causés par près de 74 attentats islamistes (soit 100 morts de plus que l’Espagne et trois
fois plus que le Royaume-Uni – 101 morts), l’attentat du World Trade Center du 11 septembre 2001
(2 977 victimes) demeure l’acte le plus meurtrier à ce jour. Toutefois, il faut toujours garder à l’esprit que les pays
qui paient le tribut le plus lourd sont, et de loin, les pays musulmans eux-mêmes, les zones les plus touchées étant
l’Asie centrale (Afghanistan : 36 725 morts), l’Afrique subsaharienne (Nigeria : 19 000 morts), les États de la mer
d’Arabie (Somalie, Soudan, Yémen), le Proche- et le Moyen-Orient (Syrie, Irak).
Depuis 2012, l’Europe, plus particulièrement la France et la Belgique, a été la cible d’attentats ou de projets
d’attaques perpétrés par des commandos revenant de Syrie ou d’Irak, ou bien par des islamistes ne s’étant pas rendus
sur zone mais déterminés à agir localement. Dans la seule période 2017-2019, les pays de l’Union européenne ont
subi 115 incidents à caractère terroriste islamiste, 22 attentats, 13 tentatives d’attentats et 78 projets d’attaques, pour
11
un total de 85 morts et 400 blessés . Près de 5 500 citoyens européens sont partis faire le djihad en Syrie-Irak
12
depuis 2014 et 7 000 d’Afrique du Nord . D’après le coordinateur de l’Union contre le terrorisme, Gilles de
Kerchove, 1 500 djihadistes sont déjà rentrés en Europe depuis 2014, et le nombre d’islamistes radicaux capables de
13
passer à l’acte est évalué à 50 000 au moins pour l’ensemble de l’UE , donc sans compter des foyers suisses,
bosniaques ou kosovars et albanais. Il estime le nombre d’islamistes prodjihadistes ou terroristes à 5 000 en
Espagne, 25 000 au Royaume-Uni, et 17 000 en France. Dans l’Hexagone, 450 détenus islamisés (radicalisés) ont
déjà été libérés entre 2012 et 2020, la majorité ayant été fanatisée en prison, preuve que les stratégies de
déradicalisation et de réinsertion promues par l’Union et ses pays membres sont un fiasco, d’autant que dans
plusieurs cas, des terroristes passés à l’acte étaient eux-mêmes suivis par les services… La France est le pays pour
lequel le défi est et sera le plus important à l’avenir : environ 21 000 personnes ont été identifiées comme étant à des
14
stades divers de radicalisation . Le problème se pose donc, d’une part, avec les terroristes encore présents en Syrie
dans les camps de détention kurdes, qui pourraient s’échapper ou être libérés, à la suite du désengagement américain
et de l’abandon des forces kurdes, puis, d’autre part, en Europe et en France avec « les frustrés du djihad », ceux qui
n’ont pas pu partir, puis tous ceux qui vont être ou ont été libérés de prison après être revenus de la zone Syrie-IrakYémen ou après avoir été arrêtés dans le cadre d’opérations terroristes commises ou planifiées en France. Les
Français partis faire le djihad, le plus gros contingent d’Européens, et qui sont de retour, représentent ainsi un danger
et un défi majeurs pour les autorités, en raison de leur expérience du terrain, de leur formation aux techniques de
guérilla urbaine et de leur capacité à transmettre leur savoir aux radicalisés français, notamment en prison. De plus,
la situation instable dans le nord de la Syrie, avec le retrait des troupes américaines, a inspiré le gouvernement
15
français qui a décidé de rapatrier près de 130 hommes et femmes détenus par les Kurdes et qui ont combattu ou
sont en lien avec l’État islamique, soit une faible proportion sur les 300 personnes entre 2012 et 2017 qui sont
16
revenues de Syrie, dont 240 hommes djihadistes . Preuve de la forte possibilité de récidive de ces détenus libérés et
très difficiles à surveiller indéfiniment, faute de moyens, une étude du Centre d’analyse du terrorisme (CAT) de
juillet 2018 rappelle qu’environ 60 % des Français partis faire le djihad entre 1986 et 2011, en Afghanistan, en
Bosnie ou en Irak, ont récidivé à leur retour : 6 revenants sur 10 ont en effet été condamnés en France ou à l’étranger
postérieurement à leur retour pour des infractions terroristes. Ces chiffres ne comprennent pas les nombreux
Français partis rejoindre Daesh entre 2014 et 2019, faute d’étude globale sur leur cas, fait ainsi valoir le CAT, et de
recul historique, la majorité des 600 personnes jugées depuis 2014 étant encore en détention.
Une menace asymétrique à la fois exogène et endogène
Les principaux facteurs qui ont engendré le terrorisme international dans un contexte de mondialisation toujours
plus intense ne montrent aucun signe de ralentissement pour les quinze prochaines années. Facilitée par les
communications mondiales et les nouvelles technologies de l’information, la renaissance globale de l’identité
islamique et le succès de l’islam politique, mouvement de fond observé dans tous les pays musulmans et même au
sein des minorités musulmanes d’Occident, d’Inde, ou d’Asie du Sud-Est, va continuer d’offrir un cadre propice
pour la diffusion de l’islamisme radical à l’intérieur et à l’extérieur du Moyen-Orient. Ce renouveau panislamiste
s’est manifesté de façon particulièrement conflictuelle dans les contrées aux prises avec des luttes séparatistes
nationales ou régionales (Palestine, Tchétchénie, Irak, Cachemire, Mindanao, sud de la Thaïlande, Xinjiang, Syrie,
Libye, Nigeria, Afghanistan, Sahel, Corne africaine, etc.). Et dans un avenir proche, des grandes centrales
djihadistes comme al-Qaida ou Daesh vont absorber encore plus qu’auparavant des guérillas islamistes et des
mouvements séparatistes locaux. Parallèlement aux réseaux informels et traditionnels de fondations caritatives,
madrassas, hawalas, et autres mécanismes de solidarité panislamique, exploités au maximum par les organisations
islamistes pour contrer les forces antiterroristes et judiciaires des États, les technologies de l’information digitale
permettront à la menace terroriste de devenir de plus en plus décentralisée, évoluant de ce fait vers un éventail
éclectique de groupes, cellules et individus qui n’ont plus besoin d’un quartier général fixe pour planifier et exécuter
des opérations, même si les actes perpétrés individuellement par des terroristes de troisième génération (voir infra)
ou pseudo-loups solitaires sont en fait inspirés par les grandes centrales qui conçoivent kits, modes d’emploi,
programmes ou simples appels destinés à mobiliser plus de personnes encore. Les conseils de ciblage, le savoir-faire
en matière d’armes, la collecte de fonds et les formations deviendront de plus en plus virtuels, surtout avec
l’avènement de la 5G et des imprimantes 3D (voir chapitre IX).
Les attaques terroristes continueront, certes, d’utiliser principalement des armes conventionnelles, voire
rudimentaires (djihad low cost : couteaux, voitures béliers et fusillades), qui s’adaptent constamment à la lutte contre
le terrorisme. Toutefois, l’intérêt des djihadistes pour les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires,
certes compliquées à manier et à acquérir, est croissant. Le risque d’attaques terroristes majeures impliquant des
ADM (armes de destruction massive) augmente donc. Les terroristes pourraient en effet acquérir des agents
biologiques ou, moins vraisemblablement, un engin nucléaire portable (valise nucléaire), qui pourrait causer des
pertes massives. Le bioterrorisme semble particulièrement adapté aux groupes plus petits et mieux informés. Les
terroristes vont également intensifier les cyberattaques pour perturber les réseaux d’information critiques et, plus
probablement encore, causer des dommages physiques aux systèmes d’information, puis pénétrer et frapper les
services régaliens et même de renseignements. L’exemple français le plus évident étant l’agent de renseignement
informaticien Mickaël Harpon, qui attaqua et tua quatre de ses collègues à la direction du renseignement de la
préfecture de police de Paris (DR-PP) le 3 octobre 2019.
Djihadisme low cost ubérisé
Aujourd’hui, grâce aux technologies de la mondialisation marchande et digitale, n’importe qui peut se
radicaliser seul chez lui, mais non sans aide extérieure, ce qui signifie que le « loup solitaire » existe de façon
opérationnelle parfois, mais son inspiration vient de documents, vidéos, messages, fréquentations, lieux de prière,
ouvrages conçus par des professionnels du terrorisme transnational et les cerveaux islamistes apatrides qui les
mobilisent et qui cautionnent religieusement et moralement leurs actes de manière déterritorialisée. Il existe ainsi
mille outils destinés à appuyer la diffusion de l’idéologie djihadiste, de modes d’emploi, de magazines (Dabiq, Dar
al-Islam, etc.), de manuels, d’appels ou de protocoles… On peut citer par exemple le manuel Management de la
sauvagerie d’Abou Bakr Naji, ou les textes d’Abou Moussab al-Souri, Syrien naturalisé espagnol, qui a écrit l’Appel
à la résistance islamique mondiale (2003), deux théoriciens liés à al-Qaida et repris par Daesh qui ont mobilisé des
centaines de djihadistes européens et internationaux soi-disant loups solitaires, mais en réalité recrutés
psychologiquement et idéologiquement par ces inspirateurs suivant le modèle du djihadisme ubérisé. En outre, des
documents techniques circulent dans ces milieux et sur le Darknet (voir chapitre IX), pour transmettre la fabrication
17
de bombes artisanales, les méthodes pour se fondre dans la population, les techniques de ruses de guerre et taqiya ,
bref, un ensemble de modus operandi et stratagèmes prêts à l’emploi à destination des candidats au terrorisme.
Les stratèges du djihadisme s’appuient par ailleurs sur les textes sacrés. De cette manière, ils sont parvenus à
légitimer et à décomplexer ceux qui commettent des crimes au nom d’Allah. Si un homme allait poser une bombe
dans une synagogue après avoir lu Mein Kampf, en se réclamant des idées d’Adolf Hitler, dirait-on de lui qu’il se
serait autoradicalisé et qu’il n’aurait rien à voir avec l’extrême droite ? En fait, les organisations islamistes
internationales qui diffusent l’idéologie totalitaire et violente de la charia ont une influence mondiale et un réel
enracinement théologique. Si l’on veut l’appréhender correctement et lutter efficacement contre les dangers qu’il
pose, on ne peut pas réduire le terrorisme islamiste à ses petits soldats, mais il faut s’attaquer à son continuum
idéologique évoqué plus haut. Et ce point de contact idéologique ou continuum est crucial dans la lutte antiterroriste,
car si les radicalisés pouvant passer à l’acte violent sont estimés en France entre 12 000 et 20 000 (partisans de l’État
islamique ou d’al-Qaida), les islamistes plus habituels, adeptes du suprémacisme de la charia et du califat, mais qui
évoluent dans un cadre plus institutionnel tout en adhérant aux mêmes fondamentaux, sont quant à eux évalués à au
moins 500 000 en France et entre un million et 1,5 million dans l’Union européenne, véritable vivier idéologique
pour les recruteurs djihadistes. À cet effet, l’étude de l’Institut Montaigne, menée par Hakim El Karoui, citée
précédemment, a démontré que 46 % des musulmans français sont de bons républicains, mais que 25 % sont
favorables au voile islamique et à l’essentiel de la charia, et que 28 % d’entre eux ont connu une jeunesse marginale
et sont entrés en sécession islamiste, contre la société française. Nous sommes donc confrontés à un véritable
problème géopolitique de fracture civilisationnelle : une part croissante de la population musulmane européenne est
appelée à s’inscrire en rupture avec la majorité « mécréante » autochtone en l’absence de politiques d’assimilation
volontaristes. Ainsi, nos contrées jadis relativement homogènes et pacifiques seront de plus en plus semblables aux
pays fracturés ethnoreligieusement et au bord de la guerre civile, comme la Thaïlande du Sud, les Philippines (îles
musulmanes du Sud), le Nigeria (Nord musulman contre Sud chrétien), le Liban (chiites versus chrétiens et sunnites,
puis Palestiniens), la Tchétchénie (Russes orthodoxes contre musulmans autochtones), la Macédoine (Albanais
versus slavo-orthodoxes), etc. Comprenons bien en effet que cette idéologie s’implante de façon privilégiée là où
elle trouve un écho, un terreau favorable, donc en pays hétérogène et ouvert aux flux de populations externes, ce qui
explique pourquoi des pays comme la Hongrie ou le Japon ne connaissent aucun problème de non-intégration
islamiste communautariste et de djihadisme.
Situation actuelle/future de Daesh/al-Qaida
La perte de territoire de Daesh et sa capacité de frappe en Occident diminuée ces derniers temps peuvent donner
un sentiment de victoire. Mais loin d’avoir perdu aujourd’hui toute son influence et ses territoires, on oublie trop
souvent que le premier territoire de Daesh, organisation foncièrement antinationaliste, est autant virtuel que celui du
capitalisme ubérisé à la McWorld. Il est donc fondamental pour les États de l’investir dans le cadre d’une contrepropagande. Loin d’être des simples barbares illettrés, nombre de djihadistes sont parfaitement à l’aise avec les
nouvelles technologies : ils savent notamment parfaitement crypter leurs communications. D’après le Centre
d’analyse du terrorisme, en 2016, 80 % de la propagande (islamiste extrémiste) est diffusée sur les réseaux sociaux
comme Facebook et Twitter. Les jeunes européens étant pour la grande majorité ultraconnectés, ils sont le terreau
idéal des djihadistes pour la propagation de leur idéologie et le recrutement. On notera la même chose au sujet du
rôle des femmes. Si elles n’avaient jadis pas le « droit » de s’impliquer, elles sont aujourd’hui autorisées à participer
aux opérations suicide de « martyrs » terroristes. Dans les médias, on insiste trop souvent sur les femmes victimes de
manipulation des islamistes (bien que cela arrive aussi), en oubliant qu’elles y jouent en fait un rôle très important
en participant activement au recrutement et aux actions, la plupart de celles qui ont rejoint l’État islamique en Syrie
l’ayant fait en connaissance de cause.
Autre nouveauté, les groupes djihadistes ont vu dans la crise sanitaire de la Covid-19 une opportunité pour
lancer de nouvelles offensives contre des gouvernements affaiblis d’Afrique (Sahel, Corne est), du Moyen-Orient et
d’Asie du Sud-Est. Jusqu’à présent, ni l’État islamique ni aucune des différentes branches d’al-Qaida n’a affiché une
vision stratégique claire concernant la pandémie (bien que l’EI ait diffusé des conseils sanitaires à ses militants sur la
manière de gérer la maladie en se basant sur les paroles du prophète Mahomet…). Néanmoins, comme l’a déjà fait
valoir Crisis Group, les forces djihadistes ont tendance à « exploiter le chaos » (voir l’ouvrage d’Abou Bakr Naji,
18
Gestion de la barbarie ), en gagnant du terrain et des adeptes là où il existe déjà des conflits, ou lorsque des États
faibles sont confrontés à des troubles sociaux. L’EI, par exemple, a tiré parti du chaos post-2011 en Syrie pour
arriver à un niveau de pouvoir que l’organisation n’aurait jamais atteint autrement. Il est possible que le chaos social
et politique qui va probablement s’exacerber en 2022 (révoltes sociales comme les Gilets jaunes débordés par des
groupes islamistes, émeutes et pillages perpétrés par les bandes ethniques des quartiers, etc.) offre des occasions
similaires pour les djihadistes à mesure que la crise actuelle se poursuit. Inversement, les groupes qui contrôlent des
portions importantes du territoire – comme les shebabs en Somalie – pourraient, tout comme les gouvernements,
19
faire face à une montée de la grogne populaire s’ils ne parviennent pas à enrayer l’épidémie de la Covid-19 .
Daesh n’est pas mort
L’État islamique est aujourd’hui une organisation fort différente de ce qu’elle était lors de son accession au
pouvoir en 2014 dans des territoires d’Irak et de Syrie où elle a proclamé un éphémère califat. Ceci fut tout de même
la première expérience audacieuse visant à créer un « État » néocalifal et qui a fait sortir du mythe ce projet rêvé
depuis des décennies par l’ensemble de la mouvance islamiste totalitaire mondiale. Depuis 2017, ce califat étatique
territorialisé a été détruit par la Coalition internationale portée par les États-Unis et les efforts parallèles de la Russie,
de l’Iran, des forces Kurdes, et des États syrien et irakien. Cependant, l’État islamique, redevenu une organisation
transnationale, demeure encore parmi les deux plus puissantes « centrales » terroristes du monde avec al-Qaida. En
Irak et en Syrie, le groupe tente de se reconstruire et il s’appuie sur des tactiques de guérilla et des attaques contre
les forces de sécurité irakiennes et le régime d’Assad en Syrie. Pendant ce temps, des cellules dormantes attendent
de lancer des attaques, comme celle du 21 janvier à Bagdad qui a fait plus de 30 morts, revendiquée par l’État
islamique. Concernant la Syrie, la situation est loin de s’améliorer et toute l’action des Occidentaux, encore
obnubilés par leur stratégie d’endiguement de la Russie et de ses alliés stratégiques iranien et syrien, semble
concourir à faire le jeu de l’islamisme et du djihadisme : en juin 2019, Washington a fait adopter de nouvelles
sanctions à travers la loi César (Caesar Syria Civilian Protection Act), extraterritoriale, qui prévoit d’interdire
l’entrée aux États-Unis et de barrer l’accès au système financier américain à toute personne, institution ou entreprise
soutenant l’État syrien dans la reconstruction ou les hydrocarbures (y compris la vente). Le but de cette stratégie de
« pressions maximales sur le pays » est clairement d’empêcher la reconstruction matérielle de la Syrie, et donc de
compromettre le volet économique, social et politique du plan de stabilisation du régime d’Assad conçu par Moscou.
La Russie a certes gagné la bataille de l’éradication des rebelles islamistes mais ne pourra pas en empêcher
durablement leur retour tant que le pays n’aura pas retrouvé le chemin de la croissance. On pourrait presque parler
de « terrorisme économique » tant la pression sur la population, qui en est la première victime, est grande. Il est clair
que la pauvreté endémique et croissante dans le pays, comme d’ailleurs au Liban voisin, directement impacté, offre
un terreau favorable au retour de Daesh, d’al-Qaida et des rebelles frères musulmans qui attendent leur heure. En
témoignent d’ailleurs les attentats commis par l’État islamique dans des zones stratégiques de Syrie : le 30 décembre
20
2020, 37 soldats syriens ont été tués dans une embuscade dans leur bus militaire ; le 3 février 2021, 20 combattants
21
prorégime ont trouvé la mort dans une nouvelle attaque de l’EI . Et globalement, depuis mars 2019, 1 200 soldats
22
syriens ou alliés ont été tués par les djihadistes de Daesh qui sont donc loin d’avoir disparu . Daesh a cependant
subi des revers bien réels, mais outre le fait que ses troupes sont encore nombreuses en zone « Syriak », il s’est aussi
étendu dans le monde, adaptant ses stratégies à chaque contrée, jusqu’en Afrique subsaharienne, à l’Ouest, et à
l’Asie, au Sud-Est. L’EI conserve aussi un trésor de guerre imposant estimé à 3 milliards d’euros, et son réseau, de
plus en plus dur à cibler grâce à une digitalisation et à une décentralisation accrue, sera plus difficile à identifier et à
combattre.
L’erreur des pays occidentaux serait de préjuger de la défaite ou de la victoire de la mouvance islamiste
(politique ou djihadiste) sur la base d’une perte de territoires ou de pouvoir (coup d’État du maréchal Abdel Fattah
al-Sissi renversant l’ex-président égyptien frère musulman Mohamed Morsi en novembre 2013). Ce serait oublier
que nous sommes confrontés à un phénomène totalitaire prosélyte dont le premier but est de propulser l’idéologie
islamiste, de gré ou de force, dans une optique de conquête des esprits qui prime sur celle des territoires, en tout cas
dans une phase préparatoire. Il est intéressant de relire les propos prononcés par Abou Mohammed al-Adnani peu
avant sa mort en 2016. Le cerveau des attentats et porte-parole de Daesh, selon lequel le « territoire est secondaire »
et l’idéologie (charia-califat) première, dit ainsi : « Notre but, notre victoire ou notre échec ne se mesurent pas à la
conquête ou à la perte d’une ville. […] Notre système d’action est essentiellement de répandre la Charia et de suivre
le Coran. Tant que notre saint Coran sera lu et se répandra, notre vraie conquête continuera et nous ne serons jamais
23
vaincus . » L’anthropologue franco-américain Scott Atran, spécialiste du djihadisme, en conclut que la victoire de
Daesh, en dépit de ses pertes de territoires, consiste à « avoir persuadé des millions de personnes que la charia est la
seule façon légitime de gouverner ». Il est en effet indéniable que cette idée a progressé dans le monde, y compris
auprès des jeunes musulmans de France. Dans la même veine, on peut aussi relire les propos du précurseur de l’État
islamique, ex-membre d’al-Qaida en Irak, tué en 2006, Abou Moussab al-Zarqaoui : « Nous ne combattons pas ici
(Irak) pour un morceau de terre, ni pour des frontières imaginaires tracées par Sykes-Picot, de même que nous ne
combattons pas pour qu’un taghout (“tyran-apostat”) arabe remplace un taghout occidental. Notre djihad est bien
supérieur à tout cela, nous combattons pour que la parole d’Allah soit la plus haute et que la religion soit tout entière
24
à Allah . »
La mort d’al-Baghdadi, n’a pas fondamentalement changé la donne : l’organisation s’est immédiatement dotée
d’un nouveau chef/calife en la personne du Turkmène irakien, Amir Mohammed Saïd al-Salbi al-Mawla, surnommé
Abou Omar al-Turkmani, issu de la ville de Tal Afar, où nombre d’ateliers d’explosifs ont préparé les attentats
25
planifiés par Daesh durant des années. Abou Omar, alias le Turkmène , a d’ailleurs joué un rôle majeur dans le
génocide de la minorité kurdophone irakienne yézidie et les trafics d’esclaves sexuels. Le fait que la direction de
l’EI ne soit plus arabe mais turkmène, et que le frère même de ce nouveau calife, réfugié en Turquie, soit à la tête de
réseaux de rebelles islamistes turkmènes agissant en Syrie, en Irak et en Libye (le « Front turkmène d’Irak »,
coalition de formations turkmènes fondée en 1995 avec le soutien d’Ankara), montre une évolution non
exclusivement arabophone de la direction de l’organisation qui rompt ainsi avec trente ans de direction arabe des
groupes djihadistes internationaux du Moyen-Orient. Cette évolution est d’autant plus significative que la Turquie
d’Erdoğan, elle-même en voie de radicalisation idéologique panislamiste ou plutôt « néo-ottomane », a soutenu
Daesh en Syrie (2014-2016), face à l’ennemi commun kurde, puis le Hamas palestinien à Gaza et al-Qaida en Syrie.
Ankara a d’ailleurs parfaitement su instrumentaliser ces groupes combattants islamistes (dont nombre d’anciens
d’al-Qaida/al-Nosra) en zone syro-irakienne pour alimenter ses nouveaux fronts ouverts en Libye ou dans le
Caucase. On peut citer notamment les divisions Sultan Mourad, Hamza, Muntazir Billah, Suleyman Shah, qui ont
fourni des mercenaires pour aller combattre aux côtés des milices islamistes dans l’ouest de la Libye face au
nationaliste Khalifa Haftar et avec les forces azéries contre les Arméniens dans le Haut-Karabagh. Parallèlement, le
nouveau calife Abou Omar al-Turkmani s’emploie actuellement à transformer les 4 000 djihadistes actifs en Irak et
les 3 800 encore présents en Syrie en troupes de guérilleros capables de reprendre des territoires dès que des fenêtres
d’opportunités s’ouvriront.
Daesh conserve un trésor de guerre et de dizaines de milliers de
combattants djihadistes
D’après le ministère de la Défense américain, Daesh conserverait entre 15 500 et 25 000 membres, en Irak,
principalement, sans compter les franchisés d’Afrique subsaharienne et d’Asie. En juin 2018, l’organisation
contrôlait toujours environ 2 % du territoire en Irak et en Syrie, et elle essaierait de regrouper ses membres pour y
créer des cellules dormantes en attendant un retour en force. Son noyau territorial est surtout concentré dans l’est de
la Syrie, dans la vallée du Moyen-Euphrate, dans des régions rurales du sud de la province de Hasakah, et dans une
enclave du bassin du Yarmuk, au sud de Damas. L’État islamique maintient des réseaux clandestins et ses
djihadistes combattent principalement en petits groupes de 3 à 5 personnes. L’EI est devenu plus internationaliste
qu’al-Qaida et s’est en quelque sorte spécialisé dans « l’ennemi lointain », d’où la plus grande proportion d’attentats
commis par Daesh en Occident par rapport à al-Qaida, quant à elle focalisée sur « l’ennemi proche »
(gouvernements musulmans « traîtres », apostats, et les forces occidentales « occupant » des pays musulmans). En
outre, depuis la chute de l’État islamique en 2017, nombre d’anciens d’al-Qaida devenus membres de l’EI sont
retournés dans le giron d’al-Qaida, ce qui n’est pas sans créer des tensions entre les deux organisations, même si l’on
observe aussi des cas d’hybridations selon les théâtres, notamment en Afrique sahélienne. L’objectif d’islamisation
de l’humanité demeure toutefois commun aux deux organisations, mais les modèles diffèrent : si l’État islamique
veut absolument recréer le califat transnational et abolir les frontières entre États musulmans, al-Qaida remet à plus
tard le but ultime du califat mondial et privilégie entre-temps une lutte plus directe dans des cadres nationaux.
Al-Qaida redevenue la plus puissante organisation terroriste
Après la chute de l’État islamique, al-Qaida, moins sous les radars que l’EI, en a profité pour se renforcer. Elle
a toujours été présente en Syrie, via le groupe Jabhat al-Nosra, devenu Hayat Tahrir al-Sham, et début 2018, un
nouveau groupe fidèle à al-Qaida a fait son apparition en Syrie sous le nom de Tanzim Hurras ad-Din, lequel
regroupe entre 2 000 et 3 000 combattants. Al-Qaida possède des implantations plus anciennes et plus importantes
que Daesh, au Moyen-Orient, au Khorasan, au Sahel, au Yémen, en Libye ou en Somalie. Lors d’une opération
américaine dans la région Afghanistan/Pakistan, les forces spéciales américaines ont tué Hamza Ben Laden, fils
préféré d’Oussama Ben Laden, le 14 septembre 2019, présenté comme l’héritier de l’organisation. De la même
manière, le supposé numéro deux d’al-Qaida, inculpé aux États-Unis pour des attentats perpétrés contre des
ambassades américaines en Afrique de l’Est en 1998, Abdullah Ahmed Abdullah, a été assassiné lors d’une
opération secrète dans les rues de Téhéran au mois d’août 2020. Abdullah, alias Abou Mohammed al-Masri (« Abou
Mohamed l’Égyptien »), était présenté comme un successeur possible d’Ayman al-Zawahiri, l’actuel chef d’alQaida, et se trouvait en Iran depuis 2003. Et le 4 juin 2020, le leader d’al-Qaida au Maghreb islamique, l’Algérien
Abdelmalek Droukdel, a lui aussi été tué dans le nord du Mali, parallèlement à la capture, mi-mai, d’un cadre
important de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Toutefois, la mort de hauts cadres du noyau central
historique d’al-Qaida n’affecte pas le reste de la nébuleuse, en réalité reliée par une idéologie, un projet et des
intérêts partagés, mais composée de franchisés et franchiseurs.
L’organisation est toujours forte de plus de 50 000 à 70 000 membres dans le monde, dont 11 000 rien qu’en
Syrie et 7 000 dans le seul Sahel. Elle fonctionne comme une centrale qui rédige des notes, des appels, suggère des
alliances, émet des fatwas et consignes, conçoit des kits opérationnels, sans intervenir sur l’aspect tactique des
opérations, se contentant de définir la stratégie globale que les affiliés et groupes « franchisés » appliquent comme
ils l’entendent. al-Qaida au Maghreb islamique reste la filiale la plus active, aux côtés d’al-Qaida dans la péninsule
Arabique (Aqpa, basée au Yémen). Si les États-Unis retirent des milliers de soldats d’Afghanistan, al-Qaida est
également bien placée pour profiter du vide qui en résulte et régénérer son réseau dans toute l’Asie du Sud.
L’organisation, toujours dirigée par l’un de ses fondateurs historiques, Ayman al-Zawahiri, a survécu pendant
plus de trois décennies grâce à la capacité du groupe à innover en affinant constamment des tactiques, des
techniques et modus vivendi caractérisés par une très forte capacité d’adaptation selon les circonstances, les
contextes culturels et les zones géographiques. Ses affiliés à travers le monde continuent de démontrer leur capacité
à lancer des attaques spectaculaires, comme en témoignent les attentats perpétrés le 2 janvier 2021 au Niger
(cinquante-six villageois tués), par une mouvance d’al-Qaida au Sahel, le Groupe de soutien à l’islam et aux
26
musulmans (en abrégé GSIM ), puis au Mali, contre deux militaires français : la sergente Yvonne Huynh et le
e
brigadier Loïc Risser, du 2 régiment de hussards de Haguenau (Bas-Rhin).
L’Asie du Sud, nouvel horizon des centrales djihadistes
En Asie du Sud-Est, principalement aux Philippines et en Indonésie, alimentées par la pauvreté, les tensions
entre les divers groupes ethnoreligieux, les organisations terroristes se développent et recrutent de plus en plus
depuis une dizaine d’années, souvent en se greffant sur des mouvements préexistants séparatistes islamistes qui sont
ainsi franchisés. Aux Philippines, l’organisation terroriste Abu Sayyaf a été très tôt en lien avec al-Qaida et a même
été financée à ses débuts par l’organisation caritative de Mohammad Jamal Khalifa, un beau-frère d’Oussama Ben
Laden. Al-Qaida est l’organisation terroriste la plus active dans cette zone, même si Daesh y progresse depuis 2016.
Parmi les principales attaques survenues au cours des deux dernières décennies, on peut mentionner celles
perpétrées par Abou Sayyaf, le 27 février 2004 contre un ferry, aux Philippines (116 morts), et le 10 juillet 2007 –
en coopération avec le Front Moro islamique de libération (14 marines philippins tués, à Basilan, dont
10 décapités) ; le 27 janvier 2019 dans la cathédrale de Jolo aux Philippines (20 morts et 81 blessés), le double
attentat à la bombe du 24 août 2019, à Jolo (10 morts), ou encore celui du 17 avril 2020, lorsque, en pleine
pandémie, 40 combattants de Daesh et Abu Sayyaf ont attaqué des soldats toujours à Jolo (12 morts). Quant à
Daesh, initialement présente surtout au Moyen-Orient, elle a commencé à migrer vers l’Asie du Sud-Est après sa
défaite en Syrie, montrant ainsi que l’organisation est capable de s’implanter partout dans le monde, en se greffant
sur des groupes islamistes locaux ou en les infiltrant puis en les divisant. De nombreux militants d’Abu Sayyaf ont
ainsi fait allégeance à l’État islamique. De même, 700 ressortissants indonésiens ont rejoint Daesh en Syrie pour y
faire le djihad. La plupart ont répandu leur radicalisme dans leur pays à leur retour.
L’État islamique comprendrait minimum 500 membres actifs aux Philippines, sans compter les autres groupes
djihadistes armés rivaux ou associés, ce qui est conséquent pour la seule partie musulmane du sud des Philippines.
En octobre 2017, un épisode marquant a démontré la montée en force de Daesh dans la région du Mindanao, au sud
du pays, lors de la bataille de Marawi (ville à majorité musulmane) qui a opposé des combattants de l’État islamique
aux forces gouvernementales philippines. Avec des scènes dignes de la guerre en Syrie, l’affrontement a duré cinq
mois et provoqué la mort de 1 132 personnes (920 islamistes, 165 soldats et 47 civils) ainsi que le déplacement de
360 000 autres. Des centaines, voire des milliers de civils sont restés piégés dans la ville assiégée pendant des mois,
27
retenus en otages ou pris entre deux feux . Rappelons qu’en septembre 2017, dans le cadre de l’opération Pacific
Eagle-Philippines (OPE-P), une campagne antiterroriste menée par le commandement Indo-Pacifique des États-Unis
a été lancée pour soutenir le gouvernement philippin et ses forces militaires dans leurs efforts pour contrer l’État
islamique et autres organisations djihadistes philippines.
En avril 2020, sur fond de Covid-19 et de tensions sociales liées, la Defense Intelligence Agency (DIA)
américaine a répertorié des messages islamistes sur les réseaux sociaux appelant à attaquer ceux qui respectent les
mesures sanitaires du gouvernement philippin, et qui menacent les autorités de violence si les mosquées n’étaient
28
pas autorisées à rouvrir . Les terroristes ont ainsi profité de la crise sanitaire pour tenter de gagner du terrain : ainsi,
le 26 juin 2020, lorsque la police a tué quatre militants de l’État islamique à Parañaque, près de la capitale Manille,
une cellule dormante de l’EI a été démantelée, dont un membre impliqué dans l’attaque de la cathédrale de Jolo en
2019. Bien que moins touchée par le terrorisme, la Malaisie est également gagnée par l’islamisme, notamment l’État
du Kelantan, dirigé par un parti islamiste qui a implanté les législations issues de la charia : les cinémas et
discothèques y sont interdits, les couples ne peuvent pas se tenir la main en public et l’administration introduit les
29
coups de canne en public pour sanctionner le non-respect de la loi islamique …
Le djihadisme en pleine ascension au Sahel
Le drame que traverse l’Afrique, frappée de plein fouet par le djihadisme, rappelle aux Occidentaux restés
prisonniers de l’eurocentrisme que le totalitarisme islamiste ne combat pas seulement l’Occident « croisé », mais
d’abord les pays musulmans et du Sud : l’Afrique paie de loin le plus lourd tribut depuis la chute de Daesh en
Irak/Syrie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 4 000 morts rien qu’en 2019 dans la zone sahélienne dite « des trois
frontières » (Niger-Burkina-Mali), 15 000 au Nigeria depuis 2012, 5 000 en Afrique dans la Corne et l’Afrique
australe depuis trois ans…
Bien que le Nigeria soit la plus importante économie de l’Afrique – l’un des plus grands producteurs de pétrole
de l’OPEP, et qui possède une élite politique compétente –, l’armée nationale est dépassée par l’insurrection du
groupe Boko Haram dans le Nord et par ses incessantes attaques. Boko Haram, qui signifie « interdire ce qui est
occidental », ne cesse de gagner du terrain. Rendue célèbre en 2014 lorsqu’elle a kidnappé plus de 200 jeunes filles
en 2014, l’organisation a depuis lors considérablement élargi son assise au Nigeria en s’appuyant sur la pauvreté du
Nord-Est musulman revanchard vis-à-vis du Sud chrétien, riche en pétrole, mais aussi sur la diffusion depuis les
années 1990 du fanatisme salafiste, qui a souvent commencé par l’islamisation « institutionnelle » à l’instigation de
prédicateurs revenus d’Arabie saoudite. Depuis l’ascension médiatique de Boko Haram, en 2014, des centaines
d’églises catholiques ont été incendiées dans ces États du Nord-Est ; 80 000 chrétiens ont pris le chemin de l’exil
pour gagner des États du Nigeria non musulmans. 64 000 ont dû trouver refuge au Cameroun, ce pays subissant
aussi des attaques régulières du groupe…
Depuis les années 2005, les attentats les plus violents commis par al-Qaida ont eu lieu au Sahel, où des dizaines
de milliers de combattants appuyés par des tribus et réseaux salafistes ont plongé dans le chaos les faibles États du
G5 Sahel (Mali, Tchad, Burkina, Mauritanie et Niger). Des milliers de civils ont été tués. Près de 3 millions de
personnes ont dû fuir leurs domiciles au Mali, Niger et Burkina Faso, principaux pays touchés. Les troupes
françaises de l’opération Barkhane, dont les effectifs (5 100 soldats en 2020, devant être réduits à 3 000 en 2022)
sont trop faibles pour pacifier une zone grande comme l’Union européenne, peinent à endiguer la progression
constante du djihadisme, d’une part, et de l’islamisme politique salafiste, de l’autre, faute de solution politique. On
retrouve toujours ici le continuum idéologico-politique évoqué plus haut entre islamistes politiques et djihadistes.
Dans les anciennes colonies françaises, la situation ressemble de plus en plus à celle du Nigeria : depuis la
guerre de 2012, les djihadistes venus du nord du Mali (Kidal) ne cessent de gagner du terrain vers le centre et le sud
du pays et les États voisins : Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mali, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire. Avec leur folle
intervention contre le régime de Kadhafi en 2011 – qui a permis aux mercenaires présents en Libye d’acheminer
armes et combattants dans tout le Sahel –, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont contribué à
l’expansion de ce fléau en Afrique noire. Les attentats et prises d’otages dans la région des « trois frontières », là où
une mine artisanale a tué, le 2 janvier 2021, deux soldats français à Ménaka (Mali), sont quasi quotidiens.
Le processus de « sahélisation » d’Aqmi, à l’origine maghrébine, s’est accentué depuis la fin des années 2010 et
la guerre civile malienne : la quasi-totalité de ses chefs et de sa logistique a été transférée de l’Algérie vers le Sahel.
Le génie de l’homme fort d’Aqmi au Sahel, le Touareg malien Iyad Ag Ghali, ancien du Tabligh et des milices
libyennes, fondateur d’Ansar Dine, a été de regrouper des mouvements djihadistes, touaregs, arabes et peuls noirsafricains nomades de la région au sein d’une structure unitaire nommée GSIM.
Selon le Centre d’études stratégiques de l’Afrique lié au ministère de la Défense américain, et d’après les forces
françaises présentes sur place, le Sahel est aujourd’hui la zone où le terrorisme islamiste connaît la croissance la plus
rapide. Dans ce contexte, déjà très chaotique, le Burkina Faso a subi depuis la seule année 2015 plus de 100 attentats
djihadistes de plus en plus meurtriers, perpétrés notamment par Aqmi, Ansar Dine, le Mouvement pour l’unicité du
djihad en Afrique de l’Ouest (Mujao), Al-Mourabitoune, le GSIM, l’État islamique au Grand Sahara, la Katiba
Macina, ou encore Ansar-ul-Islam, lié à Daesh. On retiendra l’attentat du 2 mars 2018 contre l’état-major général
des armées et l’ambassade de France à Ouagadougou, revendiqué par le GSIM, qui a fait 16 morts. Ou encore celui
du 13 août 2017, lorsque des djihadistes ont ouvert le feu sur un restaurant du centre de Ouagadougou (19 morts).
Dans tout le continent africain, on constate une augmentation de tensions entre les communautés. Le terrorisme
islamiste progresse non seulement en pays musulmans (Mali, Burkina Faso), mais aussi de plus en plus en pays
mixtes chrétiens/musulmans, comme on le voit au Nigeria, bien sûr, et même, ce qui est nouveau, en Côte d’Ivoire,
pays certes tiraillé entre tribus antagonistes et entre musulmans au nord et chrétiens au sud, mais où les attaques
djihadistes et la percée de l’islam politique sont très récentes. On se souvient de l’attentat du 13 mars 2016 qui fit
19 morts (dont 3 soldats ivoiriens) dans un quartier touristique de Grand-Bassam – lieu de tourisme très prisé classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Comme ailleurs, les lieux touristiques sont, avec les militaires des pays du G5
Sahel et les symboles gouvernementaux, des cibles privilégiées des djihadistes. Pour ce qui est du Bénin, de plus en
plus infiltré par le djihadisme venu du Burkina Faso voisin, on rappellera que les otages français libérés le 10 mai
2019 par les forces spéciales du COS s’étaient aventurés dans le cadre d’un safari dans le parc du Pendjari (Bénin),
l’un des plus beaux de l’Afrique de l’Ouest. Comme en Égypte (Nil, Charm el-Cheikh, Alexandrie, etc.), en Tunisie
(attentats du Bardo et sur les plages), ou ailleurs, la stratégie des groupes djihadistes est de paralyser le tourisme en
déstabilisant la zone. C’est ainsi que des pays comme le Bénin, qui tentent de développer leur tourisme, la Côte
d’Ivoire, le Ghana et le Cameroun, sans oublier le Nigeria, voient leurs côtes et leurs zones frontalières de plus en
plus visées.
Le 2 janvier 2021, le pire attentat jamais commis par des djihadistes au Niger contre des civils a fait 100 morts
dans 2 villages de l’Ouest (Tchoma Bangou et Zaroumadereye). Notons que les attentats et prises d’otages dans la
région Sahel en zone francophone ont presque toujours lieu dans le secteur des « trois frontières ». Face à ce fléau
hybride qui unit fanatisme, rivalités ethnotribales, délinquance et séparatismes, la France, venue au secours de l’État
malien en janvier 2013 (opération Serval), puis l’opération Barkhane (revue à la baisse par Emmanuel Macron et qui
a délaissé le Nord du Mali pour la zone des trois-frontières, plus exposée, notamment au Niger) apparaissent de
moins en moins légitimes aux yeux des habitants. Nombre d’entre eux manifestant même à Bamako ou Gao aux
cris : « La Russie plutôt que la France… »
Les islamistes ont une vraie stratégie, contrairement à leurs
ennemis et à l’Occident…
D’après l’expert du djihadisme au Sahel, Drissa Kananbayé, les groupes djihadistes ont une vraie stratégie
régionale d’expansion, et leurs attaques suivent un plan de conquête réfléchi. Il décline cette stratégie en trois actes :
1/ affamer, en volant le bétail et brûlant les vivres des habitants des villages abandonnés par des forces de l’ordre ;
2/ acculturer, en détruisant les traditions africaines préislamiques animistes et le soufisme-maraboutisme,
considérés apostats ;
3/ soumettre les villageois qui, excommuniés et culpabilisés par les uns, attaqués et terrorisés par les autres,
finissent même parfois par rejoindre les djihadistes.
Grâce à cette stratégie qui pousse les villageois à gagner des villes, poursuit l’expert, les djihadistes étendent
leur contrôle et leur économie criminelle. Ils font d’une pierre deux coups, en terrifiant les personnes exilées en ville
où les islamistes politiques les fanatisent idéologiquement. Kananbayé rappelle que leur but n’est pas de sortir de la
pauvreté, mais d’y plonger les habitants dans le cadre d’un chaos d’ailleurs théorisé par l’idéologue du califat, Abou
Baker Naji (voir infra), très prisé dans la djihadosphère. Kananbayé rappelle que les imams wahhabites formés en
Arabie saoudite complètent le travail des djihadistes sur le théâtre urbain : le célèbre imam malien Mahmoud Dicko,
chef salafiste endoctriné à Médine, qui a présidé le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) et formé des milliers
30
d’adeptes, incarne parfaitement cette alliance objective entre « coupeurs de têtes » et « coupeurs de langues ». Le
26 mars en 2018, il remplit un stade de 100 000 personnes et fit annuler un projet de Code de la famille qui aurait
amélioré le statut légal des mères isolées. En juin 2020, il a contribué à faire chuter le président Ibrahim Boubacar
Keïta et créé un mouvement islamiste, la Coordination des mouvements, associations et sympathisants (CMAS) aux
relations très ambiguës avec les djihadistes. Pour l’expert, la mainmise des islamistes se vérifie à travers la
construction sauvage de mosquées à tous les coins de rue sur financement des pays du Golfe pendant que les
populations meurent de soif et de faim.
Nomades musulmans peuls fuyant la désertification en razziant les
sédentaires du Sud : un double mouvement de fond climatique et
civilisationnel
Le problème (djihadiste) de fond en Afrique subsaharienne est également alimenté par le phénomène d’exode
des nomades africains musulmans des ethnies peuls ou foulani, venues du nord et en proie à la sécheresse (la
pluviométrie a en effet chuté de 20 % ces quarante dernières années), qui descendent de plus en plus vers le centre et
le sud en pays mixte musulmans/chrétiens ou majoritairement non musulmans. Parallèlement, l’autre grand fléau
concret de l’Afrique subsaharienne, la surnatalité incontrôlée (le Sahel est la seule région du monde qui n’a pas
entamé sa transition démographique, voir chapitre IX), conduit les agriculteurs à rechercher de nouvelles terres. Un
autre phénomène amplificateur est le délitement de l’État, corrompu et mal géré.
On observe en particulier ce phénomène au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou en République
centrafricaine. Les phénomènes de razzias perpétrées par des musulmans nomades du Nord sur des sédentaires du
Sud-Est, une vraie tendance lourde. Dans leur pérégrination visant à retrouver du pâturage pour leur bétail, ces
prédateurs nomades attaquent les villages des chrétiens, animistes ou musulmans sédentaires non peuls hostiles à
l’islamisme (maraboutiques). Ces razzieurs sont « bénis » par des prêcheurs islamistes qui s’appuient sur la tradition
du djihad et de la razzia contenue dans la charia et héritée des empires islamistes peuls du passé dits « du Macina ».
Fondée en 2015 et sévissant surtout en milieu peul dans la région de Mopti, la « Katiba Macina » est le groupe
terroriste le plus redoutable de la région. Dans l’imaginaire peul, « l’empire du Macina » (également nommé la
e
Diina, ou « religion », en arabe mal prononcé), ancien État islamiste peul qui régna au XIX siècle dans l’ouest du
Mali, une partie du Burkina Faso et de la Mauritanie avec Mopti pour capitale, représente l’âge d’or où les Peuls
31
n’étaient pas des minorités marginalisées par des États-nations postcoloniaux, mais des dominateurs … Du fait de
cet héritage, les Peuls vivent comme les tenants d’un « islam pur », ce qui les rend perméables à la propagande
salafiste, même lorsqu’ils viennent de traditions malikites et soufies africaines. Comme les idéologues de Daesh
voulant rétablir les califats arabes (ommeyyade et abbasside) en Syrie et en Irak, les djihadistes maliens peuls sont
nostalgiques de cet empire peul du Macina qui lançait des djihads pour « purifier » les sociétés musulmanes. Le
leader de l’actuel groupe Macina ou Front de libération du Macina, Hamadoun Koufa, nom de guerre d’Amadou
Diallo, est d’ailleurs lui-même un prêcheur peul d’origine soufie qui a été « salafisé » – radicalisé au contact du
groupe Ansar Dine. La Katiba Macina a pour objectif de faire sécession de l’État malien dans son fief au centre du
Mali, à l’instar des djihadistes berbéro-arabes du nord du pays. Montée en puissance depuis mars 2017, affiliée à
Ansar Dine, puis au GSIM, la Katiba Macina sévit dans diverses communes de la région de Gao depuis 2014-2015.
C’est elle qui perpètre le plus grand nombre d’attaques terroristes au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la
frontière béninoise. Et bientôt en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Togo, en Guinée Conakry et équatoriale, puis partout
où des groupes tribaux peuls sont perméables au djihadisme. Dans cette partie du monde, le djihadisme est un
phénomène « géocivilisationnel » de fond, qui répond à une « tradition djihadiste » ancestrale, d’où le recrutement
très « endogène » en Afrique subsaharienne (presque aucun cas de « volontaires » djihadistes européens). Certes,
tous les Peuls ne sont pas islamistes et encore moins djihadistes. Et l’amalgame entre Peuls et djihadistes – à
l’origine de représailles sommaires contre les minorités peules de la part des pouvoirs et tribus sédentaires – est
instrumentalisé par les groupes djihadistes dans le but de recruter.
Extension du domaine du djihadisme : de la Somalie à l’Afrique
australe
De l’autre côté de l’Afrique, le groupe djihadiste somalien Al-Shabaab (« La jeunesse »), lié à al-Qaida, proche
de la matrice géopolitique salafiste qu’est la péninsule Arabique, lutte depuis des années pour la création d’un État
islamique salafiste en Somalie. Le groupe a régné un temps sur la capitale, Mogadiscio, et d’autres régions, mais la
campagne militaire soutenue par l’Union africaine l’a affaibli territorialement. Sa présence demeure toutefois
redoutable sur une partie importante du territoire, et aux frontières des pays voisins (Éthiopie, Kenya). Autre preuve
du continuum idéologico-théologique du djihadisme, Al-Shabaab a incubé dans le giron d’Al-Ittihad al-Islami, une
mouvance de prédicateurs salafistes formés en Arabie saoudite et au Yémen dans les années 1990 qui a été financée
et poussée à la violence par Oussama Ben Laden, alors établi au Soudan. Le groupe a uni ses forces avec l’Union
des tribunaux islamiques qui s’empara avec lui de la capitale en juin 2006. Ce succès a contribué à répandre le virus
djihadiste dans les régions musulmanes voisines de l’Éthiopie honnie car à majorité chrétienne. Suite à
l’intervention militaire de cette dernière, fin 2006, pour évincer les djihadistes de Mogadiscio à la demande du
gouvernement de transition de la Somalie, les Shabaab ont pris la place des tribunaux islamiques et sont devenus une
sorte de guérilla qui contrôle des bouts de territoire au centre et au sud.
Un des pays les plus récemment ciblés par le djihadisme en Afrique est le Mozambique, État lusophone,
majoritairement catholique, mais qui est un lieu stratégique : le canal du Mozambique étant l’une des principales
routes du trafic maritime international. Frontalier de la Tanzanie et riverain de l’archipel des Comores, le pays
compte 20 % de musulmans, répartis dans le Nord-Est très pauvre. Profitant de la faiblesse de l’État, l’Arabie
saoudite y a exporté dans les années 1980-1990 son salafisme-wahhabite, comme au Mali. En 1998, à la fin de la
32
guerre civile du Mozambique, des jeunes formés dans les universités islamiques saoudiennes ont fait émerger le
mouvement Ansar Al-Sunna du Mozambique, appelé par le peuple « Shabbabs ». Ce dernier a prêté récemment
allégeance à l’État islamique, contrairement à ses homonymes somaliens. Al-Ansar/shebabs est apparu sur le devant
de la scène en 2015, dans la province à 60 % musulmane du Cabo Delgado, au nord du pays, très pauvre et
revancharde vis-à-vis des chrétiens majoritaires. Il commet sa première attaque d’envergure en octobre 2017 : il
assaille le port de Mocimboa da Praia, s’emparant de postes de police, d’armes et de munitions. Ses attentats,
revendiqués par Daesh, sont toujours plus meurtriers : 2 500 victimes en trois ans et plus de 500 000 déplacés depuis
juin 2019. Lors d’une attaque djihadiste, le 7 avril 2020, 50 civils villageois ont été exécutés par balles et décapités
dans un village, et un autre attentat perpétré en novembre 2020 a provoqué la mort de 52 adolescents retrouvés
décapités. Le groupe se finance via les trafics de bois et de rubis, qui généreraient 30 millions de dollars annuels, et
– comme Aqmi à l’ouest avec la cocaïne venue d’Amérique latine via le golfe de Guinée – en prélevant des « taxes »
sur l’acheminement de l’héroïne venue d’Orient vers l’Europe et l’Afrique du Sud, via Cabo Delgado. Le groupe se
finance aussi par donations électroniques… Face à ce péril, Mozambicains et Tanzaniens ont signé, fin 2020, un
accord de coopération militaire pour s’organiser face aux djihadistes qui compteraient dans leurs rangs des
Somaliens, des Congolais, des Rwandais et des Burundais, et même, fait nouveau, une centaine de Sud-Africains,
preuve de l’internationalisation croissante de la menace et de son adaptation à la mondialisation.
Le terrorisme islamiste : guerre psychologique et propagande par
l’action
Attardons-nous maintenant sur les volets idéologico-psychologiques de la stratégie des djihadistes. Selon
l’universitaire américain Walter Laqueur, spécialiste de la violence politique, la stratégie du terrorisme consiste à
faire de la violence et de la médiatisation qu’elle déclenche une forme de publicité gratuite, une façon de répandre
l’idéologie qui anime les terroristes. La finalité de la propagande, qu’elle soit « pacifique » ou « terroriste » (« par
l’action » ou « par les faits »), vise selon lui avant tout à influencer et à endoctriner, de sorte qu’il convient
d’analyser le djihadisme non pas comme une idéologie, mais comme un simple outil (ou une arme) utilisé pour
promouvoir et diffuser une idéologie qui, elle, peut avoir aussi des adeptes non-terroristes et institutionnels. Walter
Laqueur précise que « le succès d’une opération terroriste dépend presque entièrement de l’importance de la
33
publicité qu’elle obtient ». L’objectif est d’amener l’adversaire-mécréant-apostat à penser qu’il est en position de
faiblesse radicale (« à armes égales, celui qui aime la mort l’emporte sur celui qui la craint ») et qu’il a par
conséquent intérêt à se rendre de façon anticipatoire afin d’être épargné dans le futur (en cessant de blasphémer, de
réclamer l’intégration des musulmans, de critiquer l’islam, en acceptant l’application graduelle de la charia, et en
combattant toujours plus « l’islamophobie » à mesure que le djihadisme frappe, etc.). Pour Laqueur, l’assassinat
n’est donc qu’un moyen parmi tant d’autres pour faire de la propagande ou du prosélytisme politico-religieux.
En latin, propaganda vient de propagare, qui signifie littéralement « ce qui doit être propagé » : le terrorisme
de propagande cherche à modifier les perceptions et comportements des personnes ciblées dans une logique de
propagation d’une idée-force, celle de la nécessité de se soumettre à la charia ou de se convertir, à terme, ne serait-ce
que pour conjurer la « promesse du pire ». Les médias sont la « cible indirecte » privilégiée des terroristes. Les
attaques djihadistes sont donc tout sauf le résultat d’une violence aléatoire, « nihiliste ». Elles obéissent au contraire
à une logique et à une planification minutieuses, fruits d’une vision idéologique précise.
Comme on l’a vu pour nombre de groupes djihadistes des zones sahélienne ou sud-est asiatique, il est vrai que
nombre de microcellules terroristes sont des « franchisés » sui generis n’ayant presque pas de lien de subordination
avec al-Qaida ou Daesh, voire des groupes autoradicalisés, des marginaux ou des bandes criminelles que les
cerveaux djihadistes récupèrent par opportunité. Ces derniers ne sont jamais étrangers à la mobilisation de leurs
émules, même les plus indirectes, car ce sont eux qui mettent à disposition sur le Net des « kits » de fabrication
artisanale de bombes ou des appels théologiquement référencés à « tuer les mécréants de n’importe quelle manière,
n’importe où et n’importe quand ». Il ne faut pas non plus sous-estimer ces messages idéologiques et mobilisation
directe, même à distance, car les contenus et messages s’appuyant sur des hadiths et sur un corpus de l’islam sunnite
indiscutés ont une réelle « force légitimante » et mobilisatrice. À la manière des anciens compagnons de route ou
activistes favorables à l’ex-URSS, aux régimes révolutionnaires de Castro, de Mao Zedong, ou fascinés par le
e
romantisme violent du Che, sans oublier les Allemands et Européens subjugués par le III Reich, ceux qui vont
commettre des carnages terroristes répondent aux appels idéologiques lancés par des professionnels de la
propagande, eux-mêmes appuyés par des entités, partis ou États ayant des objectifs géopolitiques.
Dans le cadre de leurs textes de référence qui circulent dans la « djihadosphère », comme le fameux « appel
mondial à la résistance islamique », de l’idéologue Abou Moussab al-Souri, les « fanatiseurs » professionnels
mobilisent à distance des personnes qui ne leur demandent pas leur avis hiérarchique pour passer à l’acte par la
suite, puisqu’ils y sont invités (« djihadisme d’inspiration »). Ce manque de lien pyramidal et hiérarchique ne veut
pas dire que les futurs terroristes recrutés sur le Web ou en prison sont « moins islamistes » que ceux recrutés par
des imams dans des lieux de culte officiels. Réduire le terrorisme djihadiste à la réalité asociale de délinquants ou
déséquilibrés fanatisés via des réseaux sociaux, dans des milieux carcéraux ou des banlieues problématiques (voir
supra) pour en conclure qu’il n’y a « rien d’islamique », ne permet ni de comprendre les objectifs du djihadisme, ni
de prouver que ce terrorisme n’aurait « rien à voir avec l’islam ». Les musulmans libéraux, soufis ou réformistes
issus des élites sécularisées, qui dénoncent au péril de leur vie ou de peines de prison lourdes la pénalisation du
blasphème, un des piliers de la charia et de sa « violence sacrée », dans les pays musulmans ou ailleurs, ne sont pas
plus « islamiquement corrects » que ceux qui veulent imiter les compagnons du Prophète en embrassant le djihad
conquérant.
Les cerveaux djihadistes recrutent des délinquants pour leur
aptitude à la violence
Les entités et gourous salafistes-djihadistes, qui recrutent sur le Web, dans les prisons, les mosquées ou parmi
des fratries de voyous des cités, savent canaliser « l’expérience » des malfrats dont la violence est utile, à l’instar des
34
imams radicaux de l’école coranique de Zarka qui formèrent le voyou Abou Moussa al-Zarqaoui , devenu plus tard
chef d’al-Qaida en Irak et précurseur de l’État islamique. Zarqaoui avait été repris en main, sur demande de sa mère,
par un imam fanatique, al-Maqdissi, lequel condamnera bien sûr Daesh après avoir fanatisé ses monstres,
notamment entre l’Afghanistan et l’Irak… Le continuum est là.
Les spécialistes de la terreur savent bien que, pour créer une « mentalité terroriste », une organisation structurée
au fort rayonnement médiatique et idéologique, il faut faire converger trois éléments complémentaires :
le niveau individuel, exécutif (« main-d’œuvre »), qui contribue à créer la motivation opérationnelle et le
dévouement nécessaire sur un théâtre d’opérations ;
le noyau terroriste (souvent fait de fratries closes ou minisociétés sectaires coupées du monde extérieur et
des familles, que Pierre Conessa appelle « cellules souches »), qui assure la phase d’endoctrinement et la
formation opérationnelle ;
enfin l’organisation mère, qui donne le ton, conçoit la stratégie globale, crée les mécanismes de
légitimation théocratique légalisant la violence barbare, et déculpabilise les tueurs en les
déresponsabilisant. On retrouve ici les conclusions des expériences des sociopsychologues américains
Milgram et Zimbardo qui ont prouvé la puissance de l’autorité hiérarchique et morale dans l’incitation à
35
l’acte sadique violent .
L’acte terroriste ne se réduit pas aux commandos suicide spectaculaires lancés par les organisations terroristes.
Il est en ce sens bien plus qu’une menace sécuritaire, car il est un moteur, un accélérateur de l’histoire politique.
L’effet à la fois « convaincant » et dissuasif de la terreur a des conséquences immédiates sur les consciences
sidérées. Le dernier exemple en date, après l’attentat de Charlie Hebdo, a été la décapitation de l’enseignant Samuel
Paty (attentat de Conflans-Sainte-Honorine, du 16 octobre 2020) par un djihadiste tchétchène suite à une campagne
de diabolisation à la fois digitale, associative et « institutionnelle » (relais dans des mosquées et associations légales
proches des Frères musulmans). La « promesse du pire » des terroristes adressée aux « blasphémateurs » est en soi
un message hautement persuasif. Elle a déjà fait réfléchir nombre de caricaturistes, d’intellectuels et même de
décideurs politiques.
Le terrorisme peut ainsi être analysé, d’un point de vue stratégique, comme la façon la plus fulgurante de
modifier les comportements d’un camp adverse et de diffuser une idée conquérante, en l’occurrence le
suprémacisme panislamiste. En ce sens, la dissuasion extrême provoquée par les massacres perpétrés par les
djihadistes profite plus qu’on ne le pense aux islamistes non terroristes, car ceux-ci savent, en dépit de leur
dénonciation formelle des attentats, que l’on ne prendrait jamais autant au sérieux leurs demandes de lutter « contre
l’islamophobie » si les « infidèles » n’avaient l’épée de Damoclès djihadiste au-dessus de leur tête…
L’efficacité de la stratégie de l’intimidation
Depuis des décennies, dans les pays musulmans, jadis bien plus laïques et où la liberté de croire ou de ne pas
croire était plus présente, la « stratégie de l’intimidation » a associé les pressions des islamistes politiques aux
menaces violentes des islamistes terroristes. Les concessions octroyées par les dirigeants nationalistes en place à
ceux qui voulaient introduire la charia dans l’ordre légal ont toujours été octroyées pour tenter de faire baisser la
violence et « calmer la colère des djihadistes ». En Iran, la révolution islamique de l’ayatollah Khomeiny s’est faite
dans le sang avant de devenir texte de loi. Depuis les années 1950, les Frères musulmans égyptiens ont fait
assassiner des « apostats » et mis au pas des villages entiers par leurs milices avant de conquérir les urnes lors du
printemps arabe en 2012 une fois abouti le processus de réislamisation. Ils n’ont d’ailleurs été stoppés par la suite
que par une violence plus dissuasive que la leur, celle du nationalisme et du coup d’État militaire qui a porté au
pouvoir le réformiste Abdel Fattah al-Sissi en juillet 2013. En Algérie, les assassinats de nombreux intellectuels et
journalistes athées ou laïques et la guerre civile extrêmement meurtrière des années 1990 qui a opposé la junte au
pouvoir au FIS et au GIA ont précédé l’islamisation des lois favorisées dans les années 1990-2000 par le président
Bouteflika, artisan d’une « Concorde civile ». Exemple plus récent, mais plus lointain, au Bangladesh, jadis pays
réputé assez modéré et laïque, le parti islamiste Hefazat-e-Islam, qui a adressé au gouvernement, en 2013, une
demande de réislamisation des lois comportant la pénalisation du blasphème, a obtenu gain de cause en 2016 à la
suite d’une vague d’assassinats commis entre autres afin d’exiger la peine de mort pour les blasphémateurs. C’est
ainsi qu’en trois années, une quarantaine d’intellectuels laïques (blogueurs, journalistes, professeurs…) ont été
36
assassinés après avoir été menacés et ciblés dans le pays. Dans la perspective des élections de 2019, la Ligue
Awami au pouvoir a finalement cédé, au nom d’une pax islamica, aux requêtes du Hefazat-e-Islam. Celles-ci ont été
d’autant plus prises au sérieux qu’elles ont été objectivement « appuyées » par l’effet d’intimidation et de sidération
des actions terroristes. Le Hefazat-e-Islam a même réussi à obtenir la limitation des représentations des êtres
humains puis à faire interdire les exercices physiques dans les écoles pour les jeunes filles.
Le continuum djihadisme-islamisme et le chantage à l’islamophobie
La raison pour laquelle les pôles de l’islam officiel n’ont pas profité de l’occasion funeste des attentats
terroristes pour opérer un aggiornamento, pourtant réclamé depuis des décennies par les intellectuels musulmans
réformistes et modérés, réside dans le fait que ces pôles reconnus comme interlocuteurs légitimes par les États
occidentaux et les Nations unies se distinguent plus des djihadistes par les moyens que par les fins, qui sont en fait
les mêmes : l’application de la charia et la restauration du califat. De fait, la réunification de l’oumma islamique au
nom d’un projet néo-impérial califal demeure l’objectif affiché des Frères musulmans, de l’OCI, dont sont membres
cinquante-sept États musulmans, et d’autres grandes institutions panislamiques mondiales. Ces pôles institutionnels
de l’islamisation qui dénoncent verbalement la violence djihadiste tout en affirmant qu’elle n’a « rien à voir avec
l’Islam » – et donc en niant son existence même – pratiquent de leur côté une ingérence politique dans les affaires de
tous les pays du monde où vivent des musulmans, sous couvert de défense de l’islam et des musulmans
« persécutés », se nourrissant aussi d’une « islamophobie » souvent imaginaire. Bien que divisés, ces grands
37
vecteurs de l’islamisation planétaire ambitionnent, sous prétexte de « défendre la religion », de contrôler l’oumma
islamique dans le monde et en Occident.
L’ouverture de nos sociétés pluralistes, rendues perméables par une vision sans-frontiériste et multiculturaliste
béate de la mondialisation, est perçue par les forces islamistes radicales comme une vulnérabilité et une faille dans
laquelle le prosélytisme politico-religieux islamiste progresse sans rencontrer trop d’obstacles. C’est à l’aune de ce
constat que l’une des références suprêmes des Frères musulmans et de nombreux salafistes « modérés », Youssef alQardaoui, a décrété il y a des années que l’Europe, habituellement assimilée au « territoire de la guerre » (dar alharb), est devenue une terre de « l’annonce » (dar al-dawà) et du « témoignage » (dar as-shahada) car ne faisant
plus d’obstacle au prosélytisme islamique. De ce fait, pour un musulman, y vivre serait « licite » pour Qardaoui, dès
lors que la société d’accueil permet de vivre en conformité avec la charia.
La stratégie du « séparatisme islamiste », déplorée par le président français Emmanuel Macron, et combattue
par sa loi visant à « renforcer les principes républicains », pousse les musulmans à ne pas s’intégrer aux mœurs
locales « impies » et laïques, au nom d’un « droit à la différence » et d’un antiracisme dévoyés. Pour illustrer cette
stratégie de « désassimilation », rappelons les propos prononcés, en 2008, par Recep Tayyip Erdoğan, qui répondit à
la chancelière Angela Merkel lorsque celle-ci réclama l’intégration des Turcs musulmans d’Allemagne, pourtant
présents depuis des générations mais qui forment toujours une communauté à part : « l’intégration est un crime
38
contre l’Humanité ». Ce processus de « ghetto volontaire » se nourrit de la contagion paranoïaque, qui permet aux
islamistes de pousser les musulmans – pris ainsi idéologiquement au piège de la victimisation – à se radicaliser et à
se ranger progressivement, par « réaction », sous la bannière protectrice et l’ordre sans frontière de la charia.
L’objectif panislamiste et sécessionniste poursuivi par les pôles de l’islamisme mondial, djihadistes ou
institutionnels, est combattu, certes, par les États musulmans nationalistes (Émirats arabes unis, Égypte, Jordanie,
Algérie, Syrie des Assad, Kazakhstan), qui craignent ce nouvel impérialisme théocratique tourné contre leur
souveraineté, mais appuyé par le Qatar, la Turquie néo-ottomane d’Erdoğan, le Pakistan, les Frères musulmans, etc.
Toutefois, en dépit des rivalités opposant États et pôles islamistes entre eux dans la lutte pour le leadership islamique
mondial, ces pôles ont réussi à rendre une partie des communautés musulmanes d’Occident hostiles à leurs pays de
naissance ou d’accueil, perçus comme « mécréants », « pervers », et « hostiles aux musulmans ». La force
mobilisatrice des pôles violents et non-violents du totalitarisme islamiste consiste à miser sur la « paranoïsation »
qui permet de motiver le musulman qui se sent « exclu » à ne plus se conformer aux mœurs et ordres infidèles
« ennemis de l’islam ». Ces foyers potentiels de communautarisme « désassimilé » sont autant de viviers dans
lesquels les djihadistes peuvent puiser.
La vulnérabilité des sociétés démocratiques et multiculturelles
Dans nos sociétés occidentales ouvertes, tout comme au Mozambique, au Nigeria, ou en Inde, le but est de
polariser la société en opposant les musulmans aux non-musulmans, d’où le fait que les pays les plus souvent et
massivement frappés par les djihadistes sont, premièrement, les pays d’islam et, deuxièmement, les pays
multiculturels abritant de fortes communautés musulmanes. La stratégie victimaire de « paranoïsation » fonctionne
en plein, tant que des non-musulmans continuent à « dominer » et donc « humilier » les « vrais croyants ». Nos
sociétés culpabilisées tombent ainsi dans le piège lorsque leurs dirigeants, leurs intellectuels et leurs médias
expliquent la violence islamo-terroriste par la dénonciation de « l’oppression » des musulmans, l’exclusion des
immigrés, « l’humiliation des Palestiniens » ou l’islamophobie, qui serait le pire des néoracismes et dont
l’interdiction du voile ou de la burqa serait la manifestation la plus concrète. En conséquence, nombre de musulmans
radicalisés ou djihadistes justifient eux aussi leur franchissement du Rubicon terroriste en affirmant « réagir » à la
« persécution » dont ils feraient l’objet en Occident. Ainsi, Émilie König, la célèbre recruteuse française de Daesh
partie rejoindre le califat en Syrie en 2012 puis capturée par les Forces démocratiques kurdes (FDS) de Syrie, début
janvier 2017, a assuré, quand elle s’est « désavouée » de la France, que c’est la « persécution » des musulmanes
interdites de se couvrir dans l’Hexagone qui la motiva. D’où la dangerosité des théories victimaires véhiculées tant
par des djihadistes que par des pôles institutionnels de l’islamisme. Ainsi, l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-Moon, déclara-t-il en 2009 que « le racisme peut aussi s’exprimer de manière moins formelle comme la haine
contre un peuple ou une catégorie particulière comme l’antisémitisme, par exemple, ou plus récemment
39
l’islamophobie ».
Une illustration plus récente de ce processus de la « stratégie de l’intimidation » par la « paranoïsation » a été
offerte, en octobre 2020, à la suite des deux attentats terroristes survenus en France, à Conflans-Sainte-Honorine
(décapitation de Samuel Paty, 16 octobre) et à Nice (trois fidèles égorgés dans la basilique Notre-Dame, 29 octobre),
lorsque, au lieu de présenter ses condoléances, comme d’autres grands chefs d’État du monde, le président turc
Recep Tayyip Erdoğan a dénoncé « l’islamophobie » de la France républicaine et de son homologue Emmanuel
Macron, accusés de « persécuter les musulmans » dans le double contexte du projet de loi contre le « séparatisme
islamiste » et de la défense de la liberté de caricaturer dans la presse française. Sans surprise, des pays mentionnés
plus haut et réputés amis de l’Occident, comme le Qatar, le Koweït ou le Pakistan, structurellement et
idéologiquement proches des Frères musulmans, mais aussi l’université sunnite d’Al-Azhar (Égypte), pourtant
réputée modérée, ont emboîté le pas au néosultan en dénonçant vigoureusement l’islamophobie française et
occidentale. C’est ainsi que Fahrettin Altun, le directeur de communications à la présidence turque, a affirmé que
l’islamophobie gauloise rappellerait « la diabolisation des juifs européens dans les années 1920 » ! Au Pakistan, le
Premier ministre Imran Khan a reproché au Président français « d’attaquer l’Islam ». Ces accusations miroirs sont
intéressantes à analyser de la part de dirigeants de pays musulmans qui persécutent leurs minorités juives,
chrétiennes, hindouistes et chiites…
Dans la même logique, l’OCI, qui réunit cinquante-sept pays musulmans, a déploré « les propos de certains
responsables français […] susceptibles de nuire aux relations franco-musulmanes ». Cette adresse insinue que la
violence djihadiste qui a décapité Samuel Paty ne serait qu’une réaction à une « provocation » initiale des
« islamophobes ». Ce réflexe d’exonération a posteriori de la violence chariatique est une constante de l’OCI et des
grands pays et institutions islamiques, Arabie saoudite, Qatar, Turquie et Pakistan en tête. D’où la tentative des pays
de l’OCI de faire adopter, depuis 2010, par les Nations unies, des résolutions condamnant la « diffamation des
religions ». Ce concept, qui confirme la théorie « communautarienne » des relations internationales de Hughes, vise
à faire accréditer l’idée que la critique de l’islam ou le blasphème seraient des formes de « racisme » envers les
musulmans. Et dans tous les textes et déclarations de l’OCI et d’autres « institutions » islamiques mondiales (Isesco,
Congrès islamique mondial, Ligue islamique mondiale) relatifs au terrorisme islamiste, le fait même de désigner le
terrorisme islamiste est dépeint comme une « insulte » envers l’islam et les musulmans. D’où la proposition de
bannir tout terme invoquant l’islam et de s’en tenir à l’expression « extrémisme violent », édulcoration adoptée par
les Nations unies, l’Union européenne, l’OSCE et le Conseil de l’Europe.
Le 25 novembre 2020, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a logiquement utilisé la tribune de l’OCI, dans
le cadre d’une réunion virtuelle de l’un des comités permanents, pour fustiger la liberté d’expression et de presse en
matière d’islam dans la France et l’Europe « islamophobes » : « Certains politiciens européens […] poursuivent une
politique discriminante et haineuse envers les musulmans, cibles de la même campagne de haine qui a visé les Juifs
d’Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Nous devons combattre […] le racisme culturel qui a englobé
l’Occident. » En réalité, le Président turc et ses homologues, ou autres instances islamiques mondiales, sont
parfaitement conscients du fait que les musulmans en France et en Occident sont libres, et bien plus que dans la
quasi-totalité des pays islamiques, non démocratiques. La reductio ad hitlerum est utilisée ici de façon rhétorique
par des leaders qui ne culpabilisent pas d’être intolérants et même judéophobes mais qui savent que l’Européen
culpabilise pour ce qu’il ne fait plus depuis longtemps. Erdoğan a habilement profité de la campagne mondiale de
diabolisation de la France et des appels aux boycotts qui en ont découlé pour tancer en fait le seul pays européen qui
a contrecarré l’expansionnisme turc croissant en Méditerranée orientale (en plus de la Grèce et de Chypre, voir
infra). La géopolitique est une démarche holistique, et cet exemple démontre que « tout est lié ».
1. Qui privilégie l’appartenance culturelle et la communauté face à l’individu.
e
2. Voir Barry B. Hughes, Continuity and Change in World Politics. Competing Perspectives, 3 éd., Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 1997.
3. Voir Philippe Braillard, Théories des relations internationales, Paris, Presses universitaires de France, 1977, p. 12.
4. Mohammad-Reza Djalili, Diplomatie islamique, Paris, Presses universitaires de France, 1989.
5. Daniel Colard, Les Relations internationales, p. 52-53. En fait, il existe une troisième catégorie, le dar al-ahd, situation exceptionnelle de trêve
entre monde non musulman et monde musulman, le plus célèbre exemple étant la première communauté des fidèles (oumma) qui vivait en paix au
royaume chrétien d’Abyssinie (Éthiopie) face aux ennemis communs païens.
6. Gilles Kepel, Le Prophète et Pharaon. Aux sources des mouvements islamistes, p. 54-55.
7. Sayyid Qutb, in ibid., p. 54.
8. Pays du Golfe, Pakistan ; République islamique iranienne ; Frères musulmans ; Ligue islamique mondiale ; Organisation de la coopération
islamique ; etc.
9. Ce courant hanbalite salafiste, quatrième école juridique officielle de l’islam (madhab) sunnite, qui ne peut être réduit à une « hérésie », a été
porté par deux penseurs fondamentaux du hanbalisme constamment cités par les djihadistes : Ibn Taymiyya (1263-1328), qui éleva le djihad au rang
de sixième pilier de l’islam face aux mécréants mongols, puis Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb (1703-1792), à l’origine du « wahhabisme », école
sunnite officielle du royaume saoudien, gardien des deux Lieux saints (al-Haramain) de l’islam : La Mecque et Médine.
e
10. Benyettou citait aussi beaucoup un « savant » salaf des XIV-XV siècles, Ibn Hajar al-Asqalani, auteur du traité des hadiths Boulough al-Maram,
qui aborde notamment la question du djihad.
11. Voir rapports du CAT, 2017, 2018 et 2019, http://cat-int.org/.
12. CAT, Compte-rendu de la conférence internationale sur le terrorisme : « Quelles menaces et quels enjeux après la chute du califat ? »,
7 novembre 2019.
13. Voir son interview accordée à El Mundo, 31 août 2017.
14. Compte-rendu de la conférence internationale sur le terrorisme, op. cit.
15. Alexandra Gonzalez et Ambre Lepoivre, « Près de 130 djihadistes français vont être rapatriés de Syrie en France », Le Monde, 29 janvier 2019.
16. Lucie Valais, « Terrorisme : 240 jihadistes de retour en France depuis 2012, la majorité en prison », RTL, 27 octobre 2017.
17. Voir Alexandre Del Valle, La Stratégie de l’intimidation. Du terrorisme jihadiste à l’islamiquement correct, Paris, L’Artilleur, 2018, voir dans
ce livre les annexes consacrées aux textes sacrés islamiques relatifs à la ruse de guerre.
18. Abou Bakr Naji, Idārat at-Tawaḥḥuš. Akhṭar marḥalah satamurru bihā l ‘ummah ; Management of Savagery. The Most Critical Stage Through
Which the Islamic Nation Will Pass, 2007, 250 p.
19. International Crisis Group, « COVID-19 and Conflict: Seven Trends to Watch », 24 mars 2020.
20. « Syrie : 37 militaires du régime tués dans une attaque djihadiste dans l’Est », Le Figaro, 30 décembre 2020.
21. « Dix-neuf combattants prorégime tués dans une attaque de l’EI », L’Orient-Le Jour, 3 février 2021.
22. « Terrorisme. Daech revient sur le devant de la scène en Syrie », Courrier international, 12 janvier 2021.
23. Scott Atran, « Daech n’a pas commandé les attentats de Paris et Bruxelles », Le Soir plus, 20 octobre 2017.
24. Cité in Romain Caillet et Pierre Puchot, Le combat vous a été prescrit, Stock, 2017, p. 233-234.
25. Il est né dans la ville irakienne de Tal Afar (soixante-dix kilomètres à l’ouest de Mossoul), enclave turkmène entre chiites et sunnites, ces
derniers ayant fourni jadis à Saddam Hussein maints cadres. Et lorsque Saddam commença, face aux Américains, à mobiliser des réseaux salafistes,
les sunnites de Tal Afar, surreprésentés, alimenteront l’EI.
26. Le GSIM regroupe Ansar Dine, des branches d’Aqmi, des combattants de l’ex-Mujao et du MNLA berbère du Mali.
27. Amnesty International, « The Battle of Marawi: Death and destruction in the Philippines », rapport, 17 novembre 2017.
er
28. Lead inspector general, « Operation Inherent resolve and Operation Pacific Eagle – Philippines », report to the United States Congress, 1 avril
2020-30 juin 2020.
29. « En Malaisie, l’islam conservateur progresse », Le Monde, 21 juillet 2017.
30. Alexandre Del Valle, La Stratégie de l’intimidation, op. cit.
31. Dès le
Guinéeau
e
XVIII
e
XVIII
siècle, un « protodjihadisme » a sévi en Afrique subsaharienne-sahélienne : l’État théocratique du Fouta-Djalon en Moyenne-
siècle ; l’Empire peul du Macina au Mali entre 1818-1862 ; l’empire théocratique de Sékou Amadou Barryi, puis de Sékou
e
Amadou, sans oublier au Nigeria l’empire de Sokoto au XIX siècle.
32. Et inspirés par un religieux kenyan lié aux attentats antiaméricains de Nairobi et Dar es-Salam en 1998, Aboud Rogo Mohammed, ont ouvert
leurs madrasas en Tanzanie et au Mozambique.
o
33. Walter Laqueur, « The Futility of Terrorism », Harper’s Magazine, vol. 252, n 1510, mai 1976, p. 69-120.
34. Dans les années 1980, la mère d’Abou Moussa al-Zarqaoui, inquiète que son fils soit délinquant drogué et alcoolique, l’envoie dans une école
coranique de Zarka (sa ville natale en Jordanie) pour le « remettre dans le droit chemin ». Il en ressortira très pieux mais ultraradical puis se
retrouvera à la fin des années 1980 dans les mains de l’imam djihadiste d’al-Qaida al-Maqdissi, qui l’emmènera en Afghanistan.
35. Tout comme l’expérience célèbre de Milgram, celle de Zimbardo, psychologue américain, dite « expérience de Stanford », montre les
mécanismes de l’obéissance à une institution et prouve que n’importe qui peut commettre des actes atroces en situation de légitimation par l’autorité
de référence.
36. Un rapport du Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council de 2016 comptabilise 1 471 incidents violents contre des minorités, contre
er
262 en 2015. Les atrocités ont culminé le 1 juillet 2016, lors de l’attaque d’un café-restaurant de Dacca qui a fait 22 victimes, dont 18 étrangers.
37. OCI ; Ligue islamique mondiale ; Frères musulmans ; autres associations pilotées par des États comme la Turquie néo-ottomane d’Erdoğan, le
Pakistan coparrain d’al-Qaida et créateur des talibans afghans, le Qatar, protecteur des Frères musulmans, et l’Arabie saoudite, promotrice du
wahhabisme-salafiste.
38. « L’assimilation est un crime contre l’humanité », déclara Erdoğan, à Cologne, le 10 février 2007, devant 16 000 Turcs.
39. Delphine Roucaute et Madjid Zerrouky, « L’islamophobie est-elle punie par la loi ? », Le Monde, 20 janvier 2015.
CHAPITRE VIII
Prolifération nucléaire et aléas du désarmement
« Les États émergents d’Asie se sont naturellement tournés vers les sciences de l’atome dans le même temps que
s’en détournaient les “anciennement industrialisés” en Occident […]. La Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan, la
Corée du Nord possédant le savoir de l’“atome militarisé”. La Chine doit à Hiroshima une révélation :
séculairement assurée d’une civilisation n’ayant rien à envier à l’extérieur, force lui fut de constater que c’est la
science occidentale et non la sienne qui a maîtrisé la désintégration de la matière. Dans un tel environnement, on
saisit les ressorts de la démarche iranienne… »
Général Pierre Marie Gallois
Des origines du nucléaire militaire à l’échec des traités de
désarmement et de non-prolifération
La prolifération nucléaire récente, qui concerne surtout la Corée du Nord et l’Iran, est devenue possible grâce à
l’effacement des frontières, processus qui a facilité la mondialisation des technologies nucléaires et balistiques qui
devaient être au départ strictement contrôlées par des États membres du club privilégié des détenteurs de ces armes
dévastatrices. Un exemple édifiant de cette mondialisation technologique hors contrôle a été offert ces dernières
années par l’évolution de l’Ukraine. Après la dislocation de l’URSS, ce pays a vendu clandestinement des
technologies balistiques à la Corée du Nord, profitant d’un contexte de chaos et de paupérisation accentué par le
conflit armé dans le Donbass qui a démarré en 2014 et dure encore.
Le 16 juillet 1945, le monde entrait dans l’ère nucléaire avec la première explosion de la bombe atomique
américaine dans le désert du Nouveau-Mexique, à Alamogordo. Non sans cynisme, les Américains n’ont guère tardé
pour passer du stade de l’expérimentation à celui de l’application, puisque vingt jours plus tard, le 6 août 1945, le
bombardier Enola Gay larguait « Little Boy » et ses 15 kt sur Hiroshima ; trois jours encore, et c’était au tour de
Nagasaki. « L’arme de la terreur » n’était plus une fiction. À la fin des années 1930, des savants comme Albert
Einstein avaient émis l’hypothèse que l’Allemagne hitlérienne pourrait produire dans un délai assez bref une bombe
basée sur le principe de l’énergie de fission d’un atome lourd, comme le plutonium ou uranium. C’est dans ce
1
contexte que le gouvernement Franklin Roosevelt lança le spectaculaire programme Manhattan , dans lequel les
meilleurs experts du monde occidental, associés à de grandes entreprises (amorce du désormais célèbre « complexe
militaro-industriel »), et qui devait aboutir à Alamogordo, puis, à Hiroshima… La plupart des observateurs
évoquaient à ce propos la naissance du concept de dissuasion, or il n’en était rien : Little Boy était tout simplement
destiné à faire capituler l’armée nippone et, plus discrètement, à freiner les ambitions de « l’allié » soviétique car
I’armée Rouge progressait rapidement. Quant au bombardement atomique tout aussi massif de la ville de Nagasaki,
trois jours plus tard, qui était en réalité inutile pour atteindre l’objectif de la capitulation, déjà acquise, il s’explique
par le fait que la bombe d’Hiroshima est une bombe à l’uranium tandis que celle de Nagasaki était au plutonium,
cette dernière avait été fabriquée par un lobby industriel concurrent du précédent et désirant faire, à son tour, une
« expérimentation »…
À partir de cette date, le « club nucléaire » va se développer lentement mais régulièrement. Durant quatre ans,
Washington conserve le monopole de la détention de l’arme atomique. Moscou réalisera sa première expérience
dans le désert du Kazakhstan en août 1949. La Grande-Bretagne (sous franchise américaine) la réalise à son tour en
novembre 1952, suivie de la France, en février 1960 (au Sahara, alors encore français), de la Chine de Mao, en
octobre 1964, dans le Xinjiang, de l’Union indienne, le 19 mai 1974, d’Israël en 1981, du Pakistan, le 13 mai 1998,
et de la Corée du Nord, en 2006. Pour résumer, ces 9 pays sont les seuls qui possèdent l’arme nucléaire aujourd’hui.
2
Au total, de 1945 jusqu’à nos jours, il y a eu plus de 2 000 essais nucléaires réalisés .
Quant à la spécificité de l’arme atomique : rappelons simplement que l’explosif présente plusieurs caractères
originaux, dont une puissance de destruction colossale pour un faible volume, comparativement aux armes
conventionnelles. La miniaturisation de l’arme nucléaire n’a guère cessé de croître au cours des années, permettant
aussi de réduire le gabarit des véhicules porteurs et de multiplier, sur un même vecteur, le nombre d’ogives. Les
missiles balistiques présentent des caractéristiques quasi révolutionnaires : la vitesse était grosso modo de l’ordre de
1 000 km/h pour un bombardier « banal ». Elle peut désormais atteindre 25 000 à 30 000 km/h, avec les
conséquences que l’on imagine en matière de temps de réaction. Quant à la portée, les missiles intercontinentaux
peuvent atteindre, depuis un demi-siècle, des cibles situées de 14 000 à 15 000 km, ce qui signifie tout simplement
qu’un des pays possédant cette arme peut menacer n’importe quelle région du globe. De plus, alors qu’à l’aube des
3
années 1970, la marge d’imprécision d’un Minuteman était de 2,4 km, elle n’est aujourd’hui que d’environ
200 m… Ces précisions permettent de mieux comprendre pourquoi la République islamique iranienne souhaite
acquérir le feu atomique et pourquoi la Corée du Nord n’y a pas renoncé : cette dissuasion maximale est une
« assurance-vie » pour tout régime qui se trouve dans le collimateur des États-Unis… La Corée du Nord n’a en effet
jamais subi le sort de l’Irak ou de la Libye, se plaît à dire le dictateur Kim Jong-un…
Les conséquences géopolitiques de l’atome
Au-delà des conséquences strictement stratégiques, l’apparition puis le développement de l’armement nucléaire
ont entraîné un certain nombre de bouleversements, notamment dans la hiérarchie et le poids des facteurs
géostratégiques des six critères majeurs pris en compte depuis des siècles par les États-majors, à savoir :
la localisation : toutes notions de distance perdent leur signification à l’heure des armes de nouvelle
technologie nucléaire et des missiles intercontinentaux ;
les dimensions du champ de bataille, qui changent complètement d’échelle par rapport aux territoires à
conquérir, la puissance de destruction de la charge atomique pouvant raser des villes entières. Une bombe
4
nucléaire Tsar , par exemple, a une zone de déflagration d’environ 117 km², de quoi raser Paris et une
5
partie de sa banlieue d’un coup ! Et l’on ne raisonne plus en délais de quelques jours, mais en une
poignée de minutes… ;
les conditions climatiques : la qualité de ces armes leur permet d’être utilisées dans n’importe quelle
condition, comme se plaisait aussi à le répéter Pierre Marie Gallois, « le missile atomique ignore la pluie,
la neige, la glace, la tempête, le brouillard ».
le poids de la logistique, majeur dans le cadre des guerres conventionnelles, est très allégé dans l’optique
d’un conflit atomique ;
le contexte « industriel » : le nucléaire est friand, par essence, de techniciens hautement qualifiés et de
budgets de R&D élevés, mais peu gourmand en hommes, contrairement aux arsenaux d’armements
classiques ;
le nombre de combattants : l’époque des gros bataillons est révolue à l’ère nucléaire ; une flotte de 4 ou
6
5 SNLE suffirait largement à détruire n’importe quel État du globe.
Cependant, pour chaque gouvernement, la menace que représentent ces armes pour la sécurité collective passe
après la défense de leurs propres intérêts. La Chine, la Russie ou l’Iran y voyant un moyen de contrer les Américains
en renforçant leur influence dans diverses zones du globe, notamment au Moyen-Orient.
Bouleversement des hiérarchies militaires étatiques classiques
La plupart des spécialistes s’accordent depuis des lustres à établir une hiérarchie des États-nations. En 1914, à
la veille de la Grande Guerre, la France et le Royaume-Uni, les deux grands empires coloniaux, précédaient le
Deuxième Reich et la Russie tsariste, suivaient les États-Unis, le Japon ou les empires austro-hongrois et ottomans
o
(voir carte n 9). Ce classement s’est vu modifié maintes fois au gré des différentes guerres. L’Allemagne nazie était
en tête à la veille de la Seconde Guerre mondiale, pour passer ensuite au monde bipolaire avec les États-Unis et
l’URSS et arriver aujourd’hui avec les puissances que l’on connaît : les États-Unis suivis de la Chine et de la Russie,
après lesquels viennent la France, le Royaume-Uni, le Japon et l’Inde.
Les classements traditionnels des puissances se basent sur divers critères quantitatifs comme le nombre de
soldats, la quantité d’armement ou autre, qui, bien que globalement justes, sont assez discutables. En effet,
aujourd’hui on distingue plutôt certaines catégories de hiérarchie de puissances :
les superpuissances qui sont, par définition, susceptibles de préserver leur territoire national par la
« sanctuarisation nucléaire » en dissuadant l’adversaire potentiel d’une agression grâce à un arsenal de
forces conventionnelles telles que leur capacité d’intervention extérieure est très élevée. Cette définition
pouvait s’appliquer avant 1991 aux deux grands de l’époque. Elle ne concerne plus, pour le moment, que
les États-Unis ;
ensuite les autres membres du club nucléaire (les huit « partenaires ») composé de : la Russie, la France, le
Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, Israël, le Pakistan et la Corée du Nord, qui disposent de la maîtrise de
l’armement nucléaire et, intégrant dans leurs stratégies le « pouvoir égalisateur de l’atome » (Gallois),
peuvent se sentir sanctuarisés, ceux-ci n’ont cependant pas ou plus la capacité de jouer aux gendarmes du
monde et ne peuvent évoquer l’utilisation éventuelle de leur arsenal nucléaire que si leurs intérêts vitaux
sont menacés ;
et enfin les « Exclus de l’arme atomique », catégorie désignant tous les autres membres de l’ONU qui,
pour des raisons diverses, ne possèdent pas l’arme nucléaire.
Le « club nucléaire »
En 2020, neuf États-nations (voir supra) possèdent l’arme nucléaire, avec un poids certes variable, même si
l’important ici n’est pas quantitatif, mais tout simplement d’en disposer ou non (« pouvoir égalisateur »). Soulignons
tout d’abord qu’il existe deux catégories de membres du club : ceux qui tendent à réduire leurs armements
nucléaires, à savoir les États-Unis, la Russie, et, sur une plus petite échelle, le Royaume-Uni et la France ; et les
autres, a contrario, qui ont engagé un processus d’augmentation, même modeste, de leurs capacités en la matière : la
Chine, bien sûr, mais aussi l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord.
Revenons sur le statut et l’état des lieux nucléaires de chacun des membres du « club des 9 », par ordre d’entrée
en scène :
1) Leader incontesté en matière de nucléaire militaire, les États-Unis possèdent environ 5 800 ogives nucléaires à
7
ce jour (dont 2 300 « en attente de démantèlement ») après en avoir eu plus de 25 000 pendant la guerre
froide, avec un budget pour la recherche et le maintien de leur arsenal nucléaire de 35,4 milliards de dollars en
2019, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2018. Leur arsenal est actuellement déployé sur 19 bases,
dont 5 dans des pays européens membres de l’Otan (l’Allemagne, la Turquie, l’Italie, la Belgique et les PaysBas) et composé d’une centaine d’appareils aériens, de 450 missiles intercontinentaux et d’une composante
sous-marine (2/5 de la force de frappe américaine) de 14 SNLE et 50 sous-marins lance-missiles de croisière.
8
2) La Russie possède 6 372 ogives pour un peu moins de 400 missiles intercontinentaux avec 78 bombardiers et
13 SNLE patrouillant dans le Pacifique Nord, au large du Japon, dans l’océan Arctique et au sud. Mais l’autre
fer de lance de la puissance de la Russie demeure ses forces nucléaires tactiques pour l’essentiel implantées sur
9
les frontières des ex-démocraties populaires, face à l’Otan, et sur la rive de l’Amour, face à son voisin chinois .
10
3) Le Royaume-Uni dispose aujourd’hui de 195 ogives , dont 4 SNLE armés de Trident. Depuis 1992, tout en
confirmant son engagement à n’utiliser l’arme atomique qu’en riposte à une attaque nucléaire, le Royaume-Uni
a abandonné sa composante aérienne et n’a donc plus que sa force sous-marine. Autre originalité de la GrandeBretagne, eu égard à la genèse de ses forces nucléaires : le principe de « double clé », qui suppose
l’autorisation préalable de Washington quant à l’utilisation en seconde frappe de ses forces. Plus qu’un
symbole, les missiles britanniques sont aujourd’hui stockés dans la base américaine de Kings Bay, en Géorgie.
4) La France, troisième puissance nucléaire du globe, dispose de 290 ogives. Sa capacité de dissuasion repose sur
11
5)
6)
7)
8)
9)
2 composantes, ses forces aériennes (Mirage, Rafale) et ses forces sous-marines, notamment 6 SNA ,
progressivement remplacés via la politique de modernisation des sous-marins d’attaque, et 4 SNLE dotés
chacun de 16 missiles.
La Chine dispose aujourd’hui de 320 ogives nucléaires, 140 missiles balistiques ; et sa composante marine, qui
était il y a peu dérisoire (un seul SNLE équipé de 12 missiles il y a dix ans), est maintenant de 6 SNLE de la
classe 094 (certaines sources donnent 4 SNLE équipés de 12 Ju Lang-2 [Opex] et 2 autres pas encore
opérationnels), armés de 12 missiles JL-2. Deux nouveaux sous-marins SNLE viennent d’être construits et,
d’ici 2030, Pékin va se doter d’un nombre de SNLE permettant une présence simultanée de 2 à 3 sous-marins
en mer, Pékin devant armer un total incompressible de 4 à 6 lots de missiles (pour tenir compte des rotations et
de la maintenance), pour un total de 6 à 8 SNLE, ce qui est logique eu égard à l’importance des façades
littorales du pays et de sa vocation potentielle à s’implanter dans le Pacifique.
L’Inde recenserait 150 ogives, une capacité de frappe potentielle suffisante pour dissuader la Chine et,
a fortiori, le Pakistan. New Delhi dispose aussi d’une petite composante sous-marine, 4 SNA prévus, 3
construits et 1 opérationnel, grâce à son partenariat avec Moscou. L’Inde est le seul État avec la Chine, parmi
les puissances nucléaires historiques, à poursuivre un programme de construction de SNLE.
Le Pakistan possède 160 ogives nucléaires, des missiles à moyenne portée, dans le cadre de sa coopération
militaire avec les États-Unis, dont 1 missile de croisière (le Tigre). Le Pakistan possède ainsi des forces
nucléaires susceptibles de dissuader un adversaire potentiel, et donc incontournables dans les relations qu’il
entretient avec ses voisins indien et chinois.
Israël a longtemps disposé d’un arsenal nucléaire caché, pour des raisons politiques évidentes. L’État hébreu
disposerait d’une centaine de missiles balistiques, rendant parfaitement crédible une riposte, voire une frappe
préventive, en cas d’agression d’un ennemi potentiel comme l’Iran. En outre, Tel-Aviv s’est doté depuis quinze
ans d’une flottille de 6 SNA Dolphin qui font d’Israël une puissance navale non négligeable au cœur de la
Méditerranée.
La Corée du Nord a procédé, le 9 octobre 2006, à son premier tir, à la stupéfaction de maints États de la
planète, y compris de son allié chinois, puis à d’autres en mars 2009, en mai 2013, en janvier 2016, le 23 avril
2016 (tir d’un missile depuis un sous-marin), en septembre 2017, et en août 2019. Tout cela en dépit de la
multiplication des sanctions économiques décidées par la communauté internationale. L’État nord-coréen
disposerait actuellement de 35 ogives. D’autres sources estimaient en 2016 que l’arsenal nord-coréen était entre
12
10 et 16 bombes atomiques, mais ce chiffre doit aujourd’hui s’élever à 20 à 30 unités .
La prolifération nucléaire
La prolifération nucléaire reste aujourd’hui la plus grave menace pour la sécurité collective, car étant donné le
nombre de nations ayant ou pouvant avoir l’arme atomique, aucun État ou institution internationale à l’heure
actuelle n’est en mesure de faire accepter ses décisions ou de faire respecter les traités de non-prolifération (voir
infra).
À l’heure de la disparition de l’Union soviétique, et donc du système bipolaire, la Commission des Nations
unies consacrée à cette question considérait officiellement qu’« une bonne douzaine d’États disposaient de la
capacité de fabriquer la bombe atomique », ils sont aujourd’hui le double ! Figurent dans cette liste des puissances
d’Europe occidentale, comme la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège ou
l’Espagne, qui maîtrisent la technologie mais qui, pour de raisons diverses, refusent de s’y engager. D’autres pays
n’ont pas besoin actuellement de la développer car ils bénéficient de la protection du parapluie américain, à l’image
du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Japon. Mais d’autres, comme l’Iran, les pays moyenorientaux ou certains pays asiatiques, essaient actuellement ou pourraient essayer à l’avenir de l’obtenir. Le Japon et
la Corée du Sud pourraient être tentés d’acquérir à leur tour l’arme nucléaire face à l’hégémonie militaire croissante
de la Chine et face au pouvoir de nuisance de la Corée du Nord.
La course au nucléaire est par conséquent loin d’être terminée : en 2019, les neuf pays disposant du feu
nucléaire ont dépensé 66,5 milliards d’euros pour cette technologie (10 % de plus qu’en 2018). Aujourd’hui encore,
les armes atomiques peuvent constituer une grave menace pour la paix et la sécurité internationales, car ce sont des
armes de destruction massive dont l’utilisation provoquerait non seulement des dégâts (humain et matériel)
13
incommensurables, mais remettrait en cause la survie même de l’humanité. Le traité sur la non-prolifération (TNP)
est plus que jamais menacé (voir infra) et sa crédibilité est réduite depuis l’obtention de l’arme nucléaire par le
Pakistan, l’Inde et surtout la Corée du Nord.
Le cauchemar du « terrorisme nucléaire »
En plus de comporter un fort risque de déstabilisation de l’ordre géopolitique mondial, la prolifération nucléaire
comporte également aujourd’hui le risque que des organisations terroristes obtiennent un jour des armes nucléaires,
certes rudimentaires, mais au potentiel dévastateur sans précédent.
Il y a actuellement deux régions dans lesquelles le risque de prolifération est élevé : le Moyen-Orient et l’Asie
du Nord-Est. Certes, la construction d’une arme nucléaire et son utilisation sont très difficilement accessibles à des
groupes terroristes. Toutefois, ceux-ci pourraient s’en procurer soit en l’achetant à un État – peu probable –, soit en
14
prenant le pouvoir dans un pays qui la possède, soit en fabriquant des bombes sales après avoir acheté de la
matière fissile auprès d’États ex-soviétiques ou trafiquants de ces pays ayant accédé à des stocks. Des armes
atomiques du pauvre seront de plus en plus faciles à fabriquer à l’avenir en raison du nombre très élevé de sources
radioactives et des contrôles beaucoup trop légers (peu de réglementations sur les vieux stocks de déchets
radioactifs). Un rapport d’information du Sénat estime « à plusieurs milliers le nombre de sources radioactives dites
“orphelines”, perdues, abandonnées ou volées, dont certaines peuvent présenter un risque important pour la
15
sécurité ». Un autre point sensible à l’avenir concerne le développement accéléré des nouvelles technologies
(notamment le cyber) qui rend encore plus incertains et fragiles les systèmes de sécurisation de ces armes.
Quid de l’Iran ?
La question du programme nucléaire iranien défraya la chronique internationale en 2002, lorsqu’un dissident du
régime, Alireza Jafarzadeh, annonça, preuves à l’appui, que Téhéran avait secrètement construit un site
d’enrichissement d’uranium à Natanz, au sud de la capitale. Le Président d’alors, Mahmoud Ahmadinejad, confirma
lui-même que « l’Iran allait rapidement rejoindre les puissances nucléaires » et que son pays « éradiquerait l’État
d’Israël ». Certes, la communauté scientifique iranienne ne manqua pas de souligner que cela concernait le strict
domaine du nucléaire civil, via les centrales de Boucheh, sur le golfe Persique, et de Darkhovin, face au Koweït.
Mais la « communauté » dite « internationale » n’a jamais été convaincue, même si le passage du nucléaire civil
(enrichissement de 3 à 5 % du minerai d’uranium) au nucléaire militaire (enrichissement de l’ordre de 90 %) est loin
d’être évident. C’est ainsi que le 14 juillet 2015, à Vienne, à l’initiative du président Hassan Rohani et de son
homologue Barack Obama, un accord spécifique a été signé entre Téhéran, les cinq membres permanents du Conseil
de sécurité des Nations unies et l’Allemagne. L’accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien, appelé Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), comporte trois volets majeurs :
une limitation du programme nucléaire iranien, pendant au moins dix ans, lui interdisant la possibilité de
produire du plutonium enrichi, et non, comme on a pu le lire ici ou là, par un démantèlement du
programme ;
un renforcement des contrôles, via le corps des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) ;
et, en contrepartie, la levée au moins partielle, des sanctions économiques qui avaient été imposées à
l’Iran.
Bien que le rapport de l’AIEA du 30 août 2017 soulignait que « l’Iran tenait ses promesses et respectait ses
engagements en renonçant à poursuivre la construction du réacteur d’Arak et en maintenant son uranium enrichi
sous le seuil exigé des 30 kilogrammes », Donald Trump dénonça l’accord le 8 mai 2018. Deux faits conjoncturels
16
sont à relever depuis cette date : l’assassinat, en Irak, le 12 janvier 2020, du général Qassem Soleimani , le chef des
17
forces Al-Qods et des Gardiens de la révolution (Pasdarans), et celui de Mohsen Fakhrizadeh , le père de la bombe
atomique iranienne, le 13 novembre 2020, à Absard, dans la province de Téhéran. Parallèlement, entre 2010 et 2019,
des infrastructures nucléaires (centrifugeuses) et des réseaux stratégiques iraniens ont été attaqués par le virus
18
informatique Stuxnet ainsi qu’un autre encore plus sophistiqué et violent. Des faits qui montrent la détermination
des États-Unis et d’Israël à ne pas accepter l’avancée de l’Iran vers le feu atomique. Certes, le nouveau président
américain Joe Biden a promis de réintégrer l’accord. Et les négociations de Vienne, initiées le 6 avril 2021, ont
permis de mettre sur la table un projet d’accord, le 20 juin 2021. Toutefois, si un texte est signé par l’administration
américaine et le nouveau président iranien, Ebrahim Raeissi – un proche du Guide Suprême jadis hostile à l’accord
de 2015, dont l’intérêt immédiat est de sortir son pays de la crise économique terrible – il sera toujours considéré
comme un accord de dupes par l’Etat hébreu qui ne croit pas un instant aux engagements et à la parole des dirigeants
iraniens. Joe Biden s’est d’ailleurs gardé de promettre de réintégrer les États-Unis dans l’accord de 2015 sans
obtenir au préalable que le régime iranien donne des gages de bonne foi, notamment la fin de l’enrichissement de
l’uranium à 60 %, seuil pas si éloigné que cela des 90 % qui permettent le passage au nucléaire militaire alors que
l’accord limitait à 3,67 % le degré d’enrichissement de l’uranium produit par l’Iran, bien en deçà du seuil de 20 %
atteint par Téhéran avant de signer le pacte. L’intention du président Joe Biden de lever les sanctions renforcées par
Donald Trump pour que l’Iran soit motivé à renouer avec ses engagements se heurte en effet au caractère presque
irréversible de certaines des mesures prises en 2018, notamment l’embargo pétrolier drastique contre Téhéran et
l’interdiction de toute transaction avec l’Iran. Biden ne pourra en fait lever une partie des sanctions que si le régime
des mollahs renoue avec les engagements de renonciation au nucléaire militaire dont il s’est progressivement
affranchi, officiellement pour répondre à la « pression maximale » exercée par l’administration Trump. Toutefois,
Téhéran exige en préalable l’abandon de « toutes les sanctions anciennes et nouvelles ». S’ajoute à ces
préconditions, en elles-mêmes problématiques, la dénonciation par le régime iranien du sabotage ayant causé la
panne du complexe nucléaire de Natanz (indispensable à l’enrichissement de l’uranium iranien) attribué à Israël. En
représailles à cet acte de « terrorisme antinucléaire sioniste », les dirigeants iraniens ont décidé de porter
l’enrichissement de leur uranium à 60 %, se rapprochant toujours plus des 90 % nécessaires à la fabrication de
l’arme nucléaire. Selon certains, Joe Biden aurait tout intérêt à faire revenir l’Iran dans l’accord, mais il court un
risque politique s’il se montre trop laxiste car les opposants à l’accord de Vienne pèsent au Congrès et au Sénat.
Toujours est-il qu’une des conséquences principales des sanctions renforcées par Donald Trump (« pression
maximale ») a été le renforcement de la coopération irano-chinoise qui a franchi un nouveau cap avec
l’officialisation d’un accord stratégique de vingt-cinq ans entre les deux pays en mars 2020, un rapprochement que
voudrait éviter à tout prix Joe Biden mais qui participe d’une tendance lourde inhérente à la multipolarisation et aux
19
rivalités entre les États-Unis et le tandem russo-chinois .
En fait, en cas d’échec des négociations, la potentielle accession à l’arme nucléaire du pays serait extrêmement
déstabilisante pour toute la région et sur le plan de la prolifération mondiale : certains pays arabes comme l’Arabie
saoudite, ennemie principale de l’Iran, pourraient tenter à leur tour d’obtenir l’arme nucléaire par le biais du
Pakistan, avec qui Riyad entretient des liens stratégiques étroits. Par la suite, la Turquie, à la fois liée au Pakistan et
à l’Iran, et qui ne cache plus ses ambitions nucléaires militaires, pourrait saisir l’occasion pour lancer son propre
programme accéléré. L’Égypte pourrait décider à son tour de relancer son programme nucléaire militaire secret initié
dans les années 1980 et 1990, mais à condition de s’émanciper de sa relation privilégiée avec les États-Unis, ce qui
est moins probable. Enfin, Israël ne pourrait pas ne pas intervenir militairement pour empêcher l’éventualité,
totalement inacceptable, de l’acquisition du feu atomique par Téhéran…
Le commerce des armes à l’heure du système postbipolaire
Les ventes d’armes restent de manière significative (plus de 90 %) le quasi-monopole des États développés. Le
peloton de tête des vendeurs d’armes (commerce officiel s’entend) est ainsi constitué des États-Unis en première
position, de la Russie en deuxième, de la France, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne ensuite, mais en fait de
l’UE en deuxième place devant la Russie si l’on raisonne en UE 27. Seules, mais avec des volumes de transactions
qui restent modestes, quelques nations du Sud émergent, comme le Brésil, ou l’Union indienne, prenant le relais des
seconds couteaux de la période précédente, comme la Pologne, la République tchèque ou la vertueuse Confédération
helvétique, qui a par ailleurs déclaré la paix au monde et s’est réfugiée dans une stricte neutralité depuis des siècles,
ce qui ne l’a pas empêché, sans états d’âme, d’occuper une place dans le top 10 des vendeurs d’armes depuis de
nombreuses années. Quant aux clients, on souligne l’affirmation de la prédominance des pétromonarchies
islamiques du Golfe, la présence de quelques nations en voie de développement du Sud-Est asiatique et l’arrivée aux
tout premiers rangs (démographie oblige) de la Chine populaire et de l’Inde.
Depuis les années 2000, la course aux surarmements s’est indéniablement amplifiée : les ventes d’armes et de
systèmes d’armes ont crû annuellement de près de 10 % au cours de période 2012-2019. Le cap des 750 milliards de
dollars de ventes a été franchi en 2013, et celui des 1 000 milliards en 2018. Ceci en dépit de la signature, en
avril 2013, par quelque 131 États, du Traité sur le commerce des armes (TCA), entré en vigueur le 24 décembre
2014 et aujourd’hui ratifié par 110 nations. Son objectif est de « contribuer à réguler le commerce des armes et lutter
contre le trafic illicite », visant tous types d’armements classiques, à l’exception des armes nucléaires, chimiques et
bactériologiques, concernées par toute une gamme de traités spécifiques (voir infra). Malgré cela, le commerce
20
mondial des armes n’a cessé depuis de s’accroître . En 2019, la hiérarchie établie par l’International Institute for
Strategic Studies (IISS) de Londres a montré que le top 5 assume quelque 75 % du trafic mondial : les États-Unis
occupent le haut du pavé, avec 33 % des ventes, devant la Russie (23 %), la France (7,9 %), talonnée par la Chine
(6 %), l’Allemagne (5,6 %), et la Grande-Bretagne (5,2 %). Une hiérarchie à mettre en parallèle, avec les plus gros
budgets nationaux consacrés à la Défense, États-Unis, Russie ou Chine. Guère de surprises… La France est tout de
même le troisième exportateur d’armes au monde.
D’après le Small Arms Survey (l’annuaire sur les armes légères) et Uppsala Conflict Data Program (programme
de collecte de données sur les conflits de l’université d’Uppsala), la valeur totale des transferts internationaux
d’armes en 2020 s’élèverait à environ 100 milliards de dollars. Quant au « top 5 » des plus grands importateurs
d’armes sur la période 2014-2019, l’Inde, l’Arabie saoudite (qui importe 22 % des ventes américaines d’armes),
l’Égypte, l’Australie et l’Algérie ont totalisé ensemble 35 % des importations d’armes. L’Union indienne (13 %) a
ainsi désormais dépassé l’Arabie saoudite (8,3 %) en raison des tensions avec les puissances voisines : Chine et
Pakistan (voir conflit du Cachemire). L’Arabie saoudite s’arme quant à elle essentiellement face à son voisin iranien.
Les Émirats arabes unis (4,8 %) craignent eux aussi l’Iran, mais sont actifs militairement au Yémen contre les
djihadistes, en Libye contre les Frères musulmans, et équipent leurs alliés égyptiens et libyens. Avec 4,2 %, la Chine
achète les armes qu’elle ne fabrique pas elle-même et s’équipe face aux États-Unis et à leurs alliés d’Asie ainsi que
face à l’Inde. L’Algérie (3,5 %) suit et continue quant à elle d’entretenir des relations conflictuelles avec son
entourage, notamment le Maroc, et poursuit sa stratégie d’indépendance et de domination militaire du Maghreb. Les
crises continuelles au Proche- et au Moyen-Orient, de l’Iran à la Syrie, en passant par l’Irak, la Libye, le Mali ou le
Yémen, n’ont fait que renforcer ces tendances. Rappelons que plus de la moitié des exportations d’armes
américaines ont été destinées au Moyen-Orient entre 2014 et 2018, et que dans la même période, 59 % des
exportations d’armes du Royaume-Uni ont été destinées au Moyen-Orient, la grande majorité des livraisons
21
concernant des avions de combat destinés à l’Arabie saoudite et à Oman . Toujours d’après les estimations de
Small Arms Survey, un milliard d’armes à feu au moins seraient en circulation dans le monde, l’écrasante majorité
étant possédée par de civils.
Au total, depuis 1989, 2 436 351 personnes sont mortes dans des conflits armés, dont 78 000 en 2018, selon
l’université d’Uppsala. Ceux qui veulent « supprimer la guerre », abolir les frontières, promouvoir une humanité
unifiée et refusent l’idée même d’avoir des « ennemis » professent, certes, de belles idées. Toutefois, les actions de
la majorité des États de la planète, y compris les démocraties occidentales, qui donnent des leçons de tolérance
politiquement correctes aux « démocratures » du monde multipolaire, mais comptent parmi le top 5 des pays
vendeurs d’armes, confirment le fait que les États n’ont ni amis ni bons sentiments mais des intérêts, souvent
cyniques…
Contrôle des armements ? Désarmement ?
Ces deux concepts cohabitent encore volontiers avec le domaine de l’utopie. Le surarmement reste, plus que
jamais, comme nous l’avons vu, la règle. Ce constat scelle l’échec cinglant du multilatéralisme et il dément les
thèses irénistes de ceux qui ont proclamé, au sortir de la guerre froide, l’avènement de la paix universelle favorisée
par le triomphe du modèle libre-échangiste McWorld et de la démocratisation sur le totalitarisme soviétique.
L’ombre du nucléaire est plus que jamais présente, et, comme le disait Albert Einstein à son époque : « J’ignore
comment sera la troisième guerre mondiale, mais nous avons la certitude, en revanche, qu’il n’y aura pas beaucoup
de monde pour voir la quatrième » ! En effet, les traités sont finalement peu respectés, ou contournés ou annulés.
Les États-Unis se sont retirés unilatéralement ces dernières années de plusieurs accords internationaux dont
22
er
celui sur le climat, sur le nucléaire iranien, du traité ABM en 2001 , mais surtout, le 1 février 2019, du traité des
armes nucléaires de portée intermédiaire (Intermediate-Range Nuclear Force Treaty, INF) signé en 1987 par Ronald
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, grand symbole de la fin de la guerre froide et qui était jusqu’à maintenant un des
piliers les plus importants de l’architecture sécuritaire européenne depuis plus de trente ans. Ce traité interdit l’usage
de missiles nucléaires d’une portée de 500 à 5 000 km qui sont les armes les plus redoutées et particulièrement
dangereuses car réduisant le temps de réaction à une frappe nucléaire à dix minutes au lieu de trente pour des
missiles balistiques intercontinentaux, rendant une défense très complexe. Le retrait des États-Unis du traité INF
permet de facto un retour en Europe de ces missiles et vient augmenter le risque, certes peu probable, de guerre
nucléaire ou néoguerre froide sur le continent européen et encore plus si le traité New Start, précédemment cité,
vient lui aussi à être abandonné. La raison officielle est une réaction au déploiement de missiles russes appelés
« Novator », qui pourraient frapper jusqu’à 1 500 km (ce qui est démenti par la Russie). Les États-Unis non
seulement sortent des traités, mais voient l’arme nucléaire comme un arsenal tout à fait utilisable, par exemple en
juin 2019, l’état-major américain a publié, peut-être par erreur, un document intitulé « Nuclear Operations »
référencé JP-3-72 qui affirme que « le nucléaire peut s’utiliser comme n’importe quelle munition dès lors que la
23
cible est militaire et qu’obtenir la victoire l’impose »… On peut ajouter à ce constat le fait que Washington a
également contourné la règle en implantant en Roumanie le système Aegis doté de lanceurs verticaux de 4 Mk41 de
Lockheed Martin qui accueille le missile Tomahawk, lequel peut être armé d’une charge conventionnelle ou
nucléaire, sa portée atteignant 2 500 km, donc de quoi frapper une partie de la « Russie utile ».
Le maigre bilan de décennies de désarmement
Le thème du désarmement est loin d’être une affaire récente : les Pères de l’Église déjà, à l’aube du
christianisme, avaient décidé, aux conciles de Nicée et de Clermont, de mettre « hors la loi les armes les plus
cruelles ». L’Église catholique a poursuivi cette action, en prônant l’application (sous peine d’excommunication) de
la « trêve de Dieu », des journées où il était formellement interdit de combattre. Plus tard, en 1648, au lendemain de
la guerre de Trente Ans, les négociateurs du traité de Westphalie ont évoqué l’officialisation des concepts de
« désarmement régional » et d’« équilibre affiché des forces ». En 1899, la conférence de La Haye propose
« l’arbitrage obligatoire », et en 1919, les Alliés ratifient la création de la Société des Nations, et sur les « quatorze
points » de son pacte, dit « de Wilson », trois concernent ce souhait d’en finir avec l’utilisation de la guerre comme
instrument privilégié de résolution des contentieux. Mais les résultats obtenus par la SDN, c’est le moins que l’on
puisse écrire, seront cruellement dérisoires…
À la fin des années 1950, après l’échec cinglant des plans de désarmement général et complet (sic), les armes
nucléaires vont devenir l’objet majeur, jusqu’au milieu des années 1990, des principales négociations, notamment
dans le cadre des discussions bilatérales américano-soviétiques. Les accords et les traités ne vont certes pas
manquer : le but recherché par les deux grands, à cette époque, est d’obtenir des autres nations un engagement de
renonciation à l’acquisition d’armes nucléaires. En termes de contrôle des armements, la stabilité stratégique
impliquait que les deux superpuissances disposent de capacités militaires « essentiellement équivalentes », comme le
soulignait la fameuse doctrine Kissinger : une équivalence n’impliquant pas l’égalité absolue de chacun des deux
partenaires dans les différents secteurs des systèmes d’armes. Et, jusqu’en 1985-1986, chacun, de facto, s’est
renforcé dans le système où son adversaire lui paraissait le plus menaçant.
Les exemples d’accords et de traités n’ont certes pas manqué depuis 1965-1985. Parmi eux, on peut citer une
vingtaine de traités multilatéraux, à portée théorique indéniable, mais aux conséquences concrètes plus que
modestes. Leurs objectifs étaient d’éviter la militarisation, nucléaire ou non, de certaines zones ; de geler ou limiter
le nombre et les aspects qualitatifs des vecteurs d’armes nucléaires ; de restreindre les essais ou systèmes d’armes ;
de prévenir la dissémination de certaines armes parmi les États ; d’interdire différents moyens de guerre ; de faire
observer le droit international dans les conflits armés et de notifier préalablement des activités militaires… Citons
notamment :
a) Des accords destinés à éviter la militarisation de certains environnements :
la convention sur la modification de l’environnement du 5 octobre 1978 (31 signataires) qui interdit
« l’utilisation à des fins hostiles de techniques susceptibles de modifier substantiellement
l’environnement ». Mais la manipulation dudit environnement par le canal de techniques utilisables dans
le cadre d’opérations militaires « tactiques » a échappé à cette interdiction ;
le traité de désarmement sur le fond des mers et des océans du 18 mai 1972 (70 signataires) qui interdit de
placer des armes nucléaires sur les fonds marins au-delà d’une zone de 12 milles mais pas d’installer sur
ces mêmes fonds marins des bases de maintenance des systèmes d’armes nucléaires mobiles.
b) Des accords destinés à éviter la prolifération nucléaire : le plus célèbre est le TNP du 5 mars 1970
(114 signataires), qui visait à interdire les transferts d’armes nucléaires par les États dotés de ces armes et leur
acquisition par ceux qui en sont dépourvus. Cela pour éviter le détournement des matières fissiles destinées à des
fins civiles vers la fabrication d’engins explosifs. Ce traité sera très vite sapé de facto, tant par la politique des
fournisseurs de produits nucléaires que par le non-respect des obligations de désarmement contractées par les
puissances dotées d’armes atomiques.
c) Des accords destinés à interdire la fabrication de certains types d’armes :
la convention sur les armes biologiques du 10 avril 1972, entrée en vigueur le 26 mars 1975
(92 signataires), qui prohibe la recherche, le développement, la fabrication et l’usage de ces armes !
la convention sur l’interdiction de l’utilisation de certaines armes conventionnelles, signée le 10 avril
1981, portant sur les systèmes d’armes « jugés excessivement pernicieux ou aux effets indiscriminés » ;
Parmi les accords portant sur la limitation des essais nucléaires, on peut citer notamment :
le traité d’interdiction partielle des essais, d’octobre 1967 (112 signataires), qui interdit les essais
nucléaires dans l’atmosphère, l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau. Ce traité a contribué à réduire la
pollution radioactive provoquée par les explosions nucléaires, mais n’impliquait pas les essais
souterrains ;
le traité sur l’espace extra-atmosphérique du 10 octobre 1967 (82 signataires) qui interdit la mise en orbite
autour de la Terre des armes de destruction massive… mais qui laisse l’espace libre quant au déploiement
des autres systèmes d’armes !
le traité sur la limitation des essais souterrains, signé le 2 juillet 1974, qui limite la puissance explosive des
armes nucléaires à 150 kt. Un seuil si élevé que les principaux États concernés ont pu le signer sans
réserve tout en poursuivant sereinement leurs programmes de développement !
e) Des accords destinés à éviter la militarisation, conventionnelle ou nucléaire, de certaines zones
géographiques : contrairement aux précédents, leurs bilans se sont parfois révélés positifs. Il s’agit, tout d’abord, du
er
traité de l’Antarctique. Un précurseur, signé dès le 1 décembre 1959, entré en vigueur le 23 juin 1961
(21 signataires) et actualisé à Versailles (108 signataires) en décembre 1991. Les États s’engagent « à ce que le
continent antarctique soit exclusivement utilisé à des fins pacifiques », disposition d’autant plus significative que le
continent recensait un nombre particulièrement élevé de bases militaires, eu égard à sa localisation éminemment
stratégique. Mais le plus riche en enseignements demeure le traité de Tlatelolco, signé en avril 1968 par 22 États
24
latino-américains , qui, pour la première fois, établit une zone dénucléarisée dans toute une région habitée du globe,
l’Amérique latine. Le protocole 1 du traité souligne « que les États n’appartenant pas à l’Amérique latine seront
tenus de maintenir leurs territoires localisés dans cette zone exempte d’armes nucléaires ». La Grande-Bretagne, à
cette date, et la France, avec son département de Guyane, sont visées. Logiquement, quatre nations latino-
américaines susceptibles de se doter du nucléaire militaire et qui ont d’ailleurs émis des projets dans ce sens ne
signent pas : Cuba (exclue de l’OEA depuis la révolution castriste), le Chili, l’Argentine et le Brésil.
Les accords bilatéraux de Salt I et Salt II
25
La décennie 1970 va s’illustrer par la signature de deux accords bilatéraux majeurs, Salt I et son avatar Salt II ,
qui induisent non pas un désarmement mais une limitation. Salt I, signé le 26 mai 1972, par le président des ÉtatsUnis, Richard Nixon, et le numéro un de l’Union soviétique, Leonid Brejnev, portait sur la limitation des systèmes
de missiles antibalistiques. Il stipulait que les États-Unis et l’URSS « déclarent leur intention commune d’arriver à la
date la plus proche possible à l’arrêt de la course aux armes nucléaires ». Si les articles 1 et 2 imposent effectivement
une réduction d’un type particulier de défense et gèlent le nombre total des vecteurs, le traité n’impose aucune
restriction quant à l’amélioration qualitative des armes nucléaires, ni au nombre d’ogives équipant chaque missile…
Rappelons que dès 1974 et la rencontre bilatérale de Vladivostok, les Russes vont moderniser leur arsenal en mettant
26
sur pied des engins balistiques marvés, puis mirvés . Et les Américains, tout en désarmant leurs missiles ABM-1,
vont se lancer, entre 1974 et 1977, via le complexe militaro-industriel, dans une R&D de plus en plus sophistiquée.
Comme l’écrivait le général Pierre Marie Gallois, « la période immédiatement postérieure à la signature de Salt 1,
présenté comme un grand pas vers le désarmement, a vu les Américains passer de quelque 8 000 ogives à plus de
27
20 000 et les Russes en faire autant portant leur arsenal de destruction à distance de 2 600 à 26 500 ». Les ÉtatsUnis et l’Union soviétique, loin de désarmer tout en feignant le contraire, avaient cent fois plus d’équipements que
nécessaire pour exercer une dissuasion et ils étaient en mesure de raser mutuellement des centaines de fois leurs
grandes villes, bref une course aux armements coûteuse devenue irrationnelle… Ces premières négociations ont
largement contribué à renforcer des créneaux de production de plus en plus élaborés, au grand bénéfice du complexe
militaro-industriel américain, d’une part, et du complexe militaro-bureaucratique soviétique, d’autre part.
Compte tenu de l’obligation d’établir un bilan quinquennal de l’application concrète du traité, le successeur de
Salt I, nommé logiquement « Salt II », sera négocié et signé à Vienne, le 18 juin 1979, par Jimmy Carter et Leonid
Brejnev. Face à la dérive décrite plus haut, et suite aux multiples critiques émises notamment au sein des Nations
unies, voire aux États-Unis eux-mêmes, les négociateurs de Salt II vont s’efforcer de travailler sur le nombre total
28
d’ogives équipant de facto les véhicules porteurs . Tout cela aurait effectivement pu aboutir à de probants résultats
si Salt II était entré en vigueur… On le sait, en vertu de la Constitution américaine, c’est le Sénat qui autorise ou pas
la ratification des traités internationaux signés par le Président, ce qui est loin d’être évident, surtout quand la
majorité sénatoriale n’émarge pas au parti du Président. La majorité républicaine refusa alors au démocrate pacifiste
Jimmy Carter la ratification de Salt II pour, une fois encore, des motivations de pure géographie électorale interne.
La période 1985-2020 : du contrôle des armements au concept de
désarmement, Start I, Start II, Start III et New Start
Dans un contexte d’implosion de l’Union soviétique, trois traités illustrent la période : Start l, Start II, et
Start III (New Start). Pour récapituler, Start I (Strategic Arms Reduction Treaty) porte non sur la limitation d’armes
stratégiques défensives, mais sur la réduction des armes stratégiques offensives. Il est signé à Moscou le 31 juillet
1991 par Mikhaïl Gorbatchev et George H. Bush, et entre en vigueur le 5 décembre 1994, pour une durée initiale de
quinze ans. Très ambitieux, Start I envisageait de réduire le nombre d’ogives stratégiques déployées de 10 000 à
6 000 unités pour chacun des signataires. Le bilan dressé à la fin de la période s’avère indéniablement plus modeste :
on passe de 9 986 ogives américaines à 8 556 et de 10 237 russes à 7 449…
Quant à Start II, signé le 3 janvier 1993, par George H. Bush et le successeur de Gorbatchev, Boris Eltsine,
président de la nouvelle-née fédération de Russie, il prévoit la réduction des deux tiers des arsenaux stratégiques.
Ratifié par le Sénat américain en janvier 1996, mais seulement en avril 2000 par les Russes, Start II ne sera jamais
appliqué !
La suite n’est pas plus brillante en termes de réussite : le 24 mai 2002, George W. Bush et Vladimir Poutine
signent le traité Sort (Strategic Offensive Reduction Treaty), ratifié le 8 mars 2003, qui confirme les trois phases de
Start I, projette un nombre total d’ogives déployées à l’horizon 2012 compris entre 1 800 et 2 000 ogives, mais
annule Start II !
Enfin, Start III (généralement appelé « New Start ») est signé le 8 avril 2010, à Prague, par Barack Obama et
Dmitri Medvedev. Il envisage une réduction de la capacité opérationnelle des deux camps à 1 550 têtes nucléaires. Il
n’englobe pas les armes tactiques, limitant le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés à 700. Notons
cependant que les États-Unis, en 2018, ont soutenu que pour le rendre plus crédible, l’accord Start III devrait inclure
la Chine. Toutefois, Pékin, qui considère que son arsenal est encore bien trop inférieur à celui de Moscou ou
Washington, a refusé d’y participer. Son expiration, le 5 février, a été source de tensions entre Washington et
Moscou. En octobre 2020, les États-Unis avaient souhaité que la Russie gèle son arsenal nucléaire, une demande
29
bien évidemment jugée « inacceptable » par le Kremlin . Toutefois, fin 2020, Américains et Russes semblaient
s’être mis d’accord sur la possibilité d’un gel « conjoint » du nombre de têtes nucléaires, d’autant que Joe Biden a
toujours été favorable aux traités de non-prolifération.
Les traités multilatéraux
Le dernier tiers de siècle s’est aussi illustré par trois traités majeurs, l’accord de Washington de 1987, celui de
Paris de 1990 et le traité CTBT de 1996.
L’accord de Washington : signé entre les États-Unis et l’URSS le 18 septembre 1987, à la suite des
rencontres de Reykjavik, qui portait sur le démantèlement progressif des forces nucléaires
« intermédiaires », c’est-à-dire, par convention, à portée inférieure à 5 500 km. Certes, mais ce type
d’armes (bien malencontreusement baptisées « euromissiles », au prétexte que les rampes de missiles
russes basées sur le flanc occidental de l’Oural pouvaient menacer les principales capitales européennes)
est en réalité singulièrement composite. Il regroupe les « Forces nucléaires intermédiaires » (FNI), à
savoir tous les missiles de portée comprise entre 1 000 et 5 500 km ; les « FNI à plus courte portée »
(entre 500 et 1 000 km) ; et les « Forces nucléaires intermédiaires à portée la plus courte » (SNI), c’est-àdire inférieure à 500 km. L’accord de Washington laissait de côté ces derniers, ainsi que l’artillerie
nucléaire tactique et les systèmes basés à terre. Or, à cette époque déjà, rien n’empêchait techniquement
d’équiper des sous-marins nucléaires de missiles de croisière. Bref, les accords de Washington ont permis
le démantèlement de 7 à 8 % des forces nucléaires des 2 superpuissances.
Le sommet de Paris, novembre 1990 : il mérite d’être qualifié d’événement de première importance au
chapitre du contrôle des armements, 35 chefs d’État ou de gouvernement étaient présents, dont l’ensemble
des chefs d’État européens, le président des États-Unis et son homologue canadien.
Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires du 24 septembre 1996 (TICN ou CTBT pour les
anglophones), qui interdit les 4 types d’essais nucléaires : atmosphérique, extra-atmosphérique, sousmarin et, fait nouveau, souterrain. Les 5 puissances membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU
le signent. L’Union indienne s’abstient. Mais pour qu’il puisse entrer en vigueur, ce traité doit être ratifié
par les 44 pays possédant des réacteurs nucléaires. Le 6 avril 1996, Londres et Paris sont les 2 premiers
membres du Club nucléaire à le ratifier, après que la France a procédé, en 1995, à 8 ultimes essais dans le
Pacifique sud (voir supra). En 2019, 183 États l’avaient signé et 28 ratifié. Parmi les 44 nations
directement concernées, 3 ne l’avaient toujours pas signé, l’Union indienne, le Pakistan et la Corée du
Nord ! Et 5 l’avaient signé mais pas ratifié, Israël, l’Égypte, l’Iran, les États-Unis et la Chine de Pékin.
Aux États-Unis, le Sénat en a rejeté la ratification en 1999. Depuis, aucune administration n’a jamais réussi à
faire ratifier le CTBT… En revanche, en 2000, Vladimir Poutine, alors bien disposé vis-à-vis de l’Occident, fit
ratifier par la Douma non seulement le traité Start II, en souffrance depuis 1992, mais également le CTBT, signé en
1996, renvoyant ainsi la responsabilité d’une nouvelle course aux armements aux États-Unis.
Relance de la course aux armements sur fond de néoguerre
froide…
Comme nous le rappelions dans le chapitre IV, les États-Unis, prisonniers d’une vision diabolisante de la
Russie, assimilée à un clone de l’URSS totalitaire, et donc d’une représentation stratégique du monde héritée de la
guerre froide, ont violé l’Acte fondateur Otan-Russie de 1997 qui impliquait de ne pas faire intégrer dans l’Alliance
les pays de l’ex-pacte de Varsovie. Au lieu d’œuvrer à une alliance « panoccidentale » qui aurait donné toute sa
place à la Russie face aux menaces communes, notamment chinoise et islamiste, les stratèges de Washington et les
élites de McWorld n’ont eu de cesse d’exclure la Russie de l’espace occidental et de poursuivre l’encerclement du
Heartland russe par les manœuvres de stationnement et d’extension, toujours plus vers l’est, des forces de l’Otan,
jusque dans « l’étranger proche » russe : Pays baltes, Roumanie, Pologne, ex-Yougoslavie, Bulgarie, sans oublier la
ligne rouge ukrainienne évoquée plus haut. Cet élargissement sans fin de l’Otan vers l’est et le soutien américanooccidental aux rébellions et oppositions antirusses en Géorgie, Ukraine, Kirghizistan ont contribué à rendre la Russie
bien plus hostile encore envers l’Occident qu’elle ne l’était à la fin de la guerre froide. Cette stratégie visant à
encercler la Russie et la priver de l’accès aux Mers chaudes puis à tenter de compromettre l’élargissement de son
marché gazier ouest-européen est, depuis le milieu des années 2000 (guerre d’Irak, révolutions de « couleurs » ou de
« velours » en Ukraine et Géorgie, etc.), un véritable casus belli pour Moscou. En réaction, la Russie poutinienne a
30
renforcé sa coopération avec tous les ennemis de l’Occident : Chine, Corée du Nord, Venezuela, Iran … La
conséquence directe de cette nouvelle guerre froide, dramatique pour la sécurité collective et pour la vieille Europe
prise en tenailles, a été le retrait, à l’initiative des États-Unis, de nombreux accords de non-nuisance, de traités de
non-prolifération (nucléaire et balistique) et de non-dissémination (armes conventionnelles) qui a permis à
Washington, dans le cadre d’une véritable relance de la course aux armements, de retrouver des marges de
manœuvre non seulement vis-à-vis de la Russie, mais aussi de la Chine. Cette dernière n’étant en fait contrainte par
aucun traité de désarmement passé ou présent, le développement massif de son armement nucléaire, balistique et
conventionnel ne souffre plus d’aucune limite… D’évidence, ces retraits américains des grands traités de
désarmement et de contrôle des armes, suivis des réponses russes équivalentes sur fond de tensions en Ukraine, au
Moyen-Orient et en Syrie, ont rendu plus probables que jamais des conflits entre les deux anciens grands du monde
d’avant, y compris nucléaires. Ce retour redouté des conflits interétatiques concerne au premier chef l’Europe,
théâtre d’interposition majeure entre la Russie et les forces atlantistes, mais également le Proche-Orient (armées
russes et américaines se faisant face en Syrie), la mer Baltique, la mer de Chine et l’Asie en général (continent
comptant le plus grand nombre de pays dotés de l’arme nucléaire : Chine, Taiwan, Corée du Nord, Corée du Sud,
Pakistan, Inde). Ainsi, on notera qu’à peine un mois après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis du
traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaires (FNI), en août 2019, Washington a procédé à l’essai d’un
missile balistique de moyenne portée qui a atteint sa cible après plus de 500 km de vol et qui n’a pas manqué de
faire réagir la Russie comme la Chine, laquelle a dénoncé la recherche systématique de supériorité militaire par les
31
États-Unis au risque d’une relance de la course aux armements dans le monde .
À partir de 2010, les États-Unis ont ainsi mis en place par le biais de l’Otan une véritable architecture globale
de défense antimissile balistique en Europe (BMDE), couvrant cette fois tous les territoires des pays européens de
l’Otan et qui, au passage, encercle la Russie, bien que prétextant être dirigée vers l’Iran… Ce système est
objectivement destiné à rendre une frappe russe en retour impossible en cas d’une première frappe nucléaire de
l’Otan. En 2014, il a été poursuivi et amélioré par les Américains qui ont ensuite utilisé l’annexion de la Crimée
comme prétexte pour implémenter des systèmes de détection radar de défense aérienne supplémentaires et des
destroyers.
La course aux armements est donc loin d’être stoppée, car en réponse, les Russes développent leurs systèmes de
défense : un des exemples les plus importants et inquiétants concerne les missiles hypersoniques Avangard, à la
pointe de la technologie. Testé en 2018 et mis en service le 27 décembre 2019 (juste au moment de l’abandon du
traité FNI), ce missile est extrêmement performant, évoluant à une vitesse moyenne de Mach 20 (le maximum étant
Mach 27, tandis que les missiles guidés traditionnels évoluent aux alentours de Mach 5), et pouvant délivrer des
32
charges nucléaires d’une puissance de 2 Mt … Autre particularité, ils sont capables de voler à une altitude
anormalement basse (rasage) qui rend la détection difficile et trop tardive pour une réaction. Ils peuvent ainsi
détruire les missiles intercontinentaux ennemis directement dans leurs silos, remettant en question l’efficacité même
de la défense de l’Otan. Ce système a rendu Vladimir Poutine particulièrement fier du fait que « personne d’autre
que nous n’a d’armes hypersoniques »… Précédemment, la Russie a également mis au point un missile balistique
intercontinental du nom de Satan 2 ou « RS-28 Sarmat », très furtif et qui serait capable de détruire un territoire
comme la France en quelques secondes.
Washington se prépare à un affrontement direct contre la Russie, et cela de manière officielle, comme en
témoigne le programme d’exercice « Defender 2020 », qui avait pour but de simuler l’attaque d’un des pays de
l’Otan. Pour cela, 37 000 soldats dont 20 000 Américains étaient attendus pour un budget de 315 millions d’euros,
chiffre qui a finalement été considérablement réduit en raison de la pandémie de la Covid-19 (6 000 soldats
américains). Cependant, cela met clairement en lumière les objectifs de Washington : afficher leur domination sur
l’Europe et leurs menaces à l’égard de la Russie.
Toutefois, en se concentrant sur « l’ennemi russe », l’Otan semble oublier la Chine, pourtant beaucoup plus
menaçante, à terme, d’un point de vue géocivilisationnel, économique et stratégique, que la Russie. Les forces
armées américaines pourraient en effet être dépassées dans quelques dizaines d’années par la Chine en cas de conflit
dans le Pacifique. Ce déclassement est favorisé par la priorité américaine accordée au Moyen-Orient et à la Russie.
De plus, la plupart des bases militaires américaines du Pacifique ouest manquent d’infrastructures de défense et sont
vulnérables. Enfin, il ne faut pas oublier que la Chine nucléaire possède aussi l’armée la plus vaste au monde avec
plus de 2 millions de soldats opérationnels (et 800 000 réservistes) et un budget de la Défense presque trois fois
supérieur à celui de la Russie (172 milliards d’euros contre 64). En outre, elle a fortement investi dans les missiles
balistiques de haute précision. Même si la puissance militaire américaine dispose encore d’une bonne marge de
sécurité, dans un monde en évolution très rapide, les rapports de force peuvent évoluer de façon surprenante. De
plus, la Chine développe elle aussi les armes hypersoniques, les outils de guerre informatique ou l’intelligence
artificielle, domaine dans lequel elle aurait quasiment déjà atteint l’égalité avec les États-Unis et les aurait peut-être
même déjà dépassés, notamment l’informatique quantique.
1. Projet de recherche qui produisit la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale.
er
2. Statista Research Department, « Worldwide number of nuclear tests from 1945 to 2020 », 1 décembre 2020.
3. Missile balistique intercontinental américain à ogive nucléaire.
4. Bombe nucléaire à hydrogène développée par l’Union soviétique, pesant 57 Mt, considérée comme la bombe la plus puissante ayant été créée
(aujourd’hui abandonnée).
5. Le souffle de l’explosion balayerait tous les bâtiments sur 3 000 km² et les radiations thermiques s’étendraient sur 17 000 km² ; les morts
s’élèveraient (pour Paris) à 7 millions, in « Voici l’étendue des dégâts si une bombe nucléaire Tsar frappait Paris », L’Express, 3 avril 2015.
6. Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.
7. Hans M. Kristensen et Matt Korda, « Status of World Nuclear Forces », Federation of American Scientist, septembre 2020.
8. Sénat : « L’évolution de l’arsenal nucléaire russe », Désarmement, non-proliférations nucléaires et sécurité de la France, rapport d’information,
19 janvier 2021.
9. En plus des SNLE, l’arsenal naval nucléaire comporte des lanceurs de missiles de croisière (SSGN) : BGM109 Tomahawk pour les États-Unis,
SS-N-19 pour la Russie et nom inconnu pour les Chinois. Les États-Unis ont cinquante sous-marins SSGN, le Royaume-Uni et la France en ont
aussi. Les BGM109 sont à double capacité : conventionnelle et nucléaire. On peut y ajouter les missiles de croisière lancés à partir de plates-formes
aériennes.
10. Hans M. Kristensen et Matt Korda, « Status of World Nuclear Forces », art. cit.
11. Sous-marins nucléaires d’attaque.
o
12. « Corée du Nord : Le difficile accès à la dissuasion », Défense et sécurité internationale, n 121, février 2016, p. 21.
13. Traité entré en vigueur en 1970 visant à empêcher la prolifération des armes nucléaires, à favoriser l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire
et à faire progresser l’objectif du désarmement nucléaire.
14. Bombes mêlant des explosifs classiques et éléments radioactifs comme ceux utilisés en médecine ou déchets radioactifs.
15. « Des caractéristiques dangereuses pour la sécurité internationale », rapport d’information du Sénat, 19 janvier 2021.
16. Général iranien commandant de la Force Al-Qods, unité d’élite des Pasdarans, était très populaire en Iran.
17. Physicien, général des Pasdarans et haut responsable dans le programme nucléaire iranien, tué le 27 novembre 2020.
18. Ver informatique conçu par la NSA avec l’unité israélienne 8200 dans le cadre de l’opération Olympic Games.
19. Le « pacte de coopération stratégique » signé le 27 mars 2021 à Téhéran.
20. Le TCA fixe des interdictions pour mettre fin aux transferts d’armes, de munitions et d’articles associés entre États, notamment si l’on
soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre ou faciliter des crimes contre l’humanité ou de guerre.
21. Entre 2014 et 2019, de 4 100 véhicules blindés ont été livrés à l’Arabie saoudite par l’Autriche, le Canada, la France, la Géorgie, l’Afrique du
Sud et la Turquie, et 338 tanks par les seuls États-Unis. La France a livré quant à elle 1 389 véhicules blindés de combat à l’Arabie saoudite.
22. Traité qui limitait les systèmes antimissiles balistiques, retrait présenté par George W. Bush comme une première étape vers un bouclier de
défense antimissiles destiné à protéger les États-Unis et ses alliés.
23. « Du danger pour l’Europe de la stratégie nucléaire des États-Unis et de l’OTAN », Capital, 30 mai 2020.
24. L’accord distingue entre l’énergie nucléaire à but militaire, condamnée, et l’énergie nucléaire civile, encouragée pour contribuer à la croissance
et au développement des États concernés.
25. Salt est l’abréviation de l’anglais Strategic Arms Limitation Talks (« négociations sur la limitation des armes stratégiques »).
26. Missiles marvés : missiles dotés de plusieurs ogives nucléaires programmées sur un même objectif. Missiles mirvés : missiles dotés de plusieurs
ogives nucléaires programmées, chacune sur des objectifs différents.
27. Source : conversations entre Jacques Soppelsa et le général Pierre Marie Gallois rapportées dans son site web.
28. Un plafond de 10 ogives pour les missiles balistiques et de bombardiers et de 14 ogives pour les missiles de sous-marins.
29. « Qu’est-ce que le New Start, ce traité qui ravive les tensions entre Washington et Moscou ? », Le Monde, 14 octobre 2020.
30. Michel Geoffroy, La Nouvelle Guerre des mondes, op. cit.
31. Michel Cabirol, « Pourquoi les États-Unis sont sortis du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire », La Tribune, 23 août 2019.
32. César Frezat, « La Russie à l’avant-garde des missiles hypersoniques », note du Cerpa, avril 2019.
CHAPITRE IX
Le crime organisé : grand gagnant de la mondialisation !
« S’il n’y a pas de banque, il n’y a pas de blanchiment ; s’il n’y a pas de blanchiment, il n’y a pas de crime. C’est
une équation qu’il faut bien avoir en tête. »
Éric Vernier
« Actuellement, l’économie a besoin de l’argent sale pour fonctionner. »
Noël Pons
Accélérée à la fin des années 1980, la mondialisation marchande, avec ses trois volets (libre circulation des
biens, des personnes et de l’argent), ses effets en termes de dérégulation, d’ouverture des frontières et de migrations
de masse, a nettement contribué à l’internationalisation et à l’intensification du crime organisé. Cette accélération a
été portée par trois facteurs liés entre eux : l’extension du marché des drogues sur l’ensemble de la société
occidentale ; la nécessité d’acheminer cette drogue depuis le producteur jusqu’aux principaux pays consommateurs
séparés par des milliers de kilomètres ; l’émergence des paradis fiscaux et sociétés off-shore devenus des centres
financiers recyclant des capitaux illégaux issus de ces trafics parasitaires et nocifs. Cette internationalisation a
étroitement suivi les vagues successives de la mondialisation anglo-saxonne avec ses abolitions de contrôles sur les
frontières et les échanges financiers.
La criminalité transnationale organisée (CTO) est devenue un acteur géopolitique incontournable, certes non
étatique, hybride, illégal, mais qui détient une telle puissance qu’il peut parfois faire plier des États et corrompre
leurs décideurs, leurs fonctionnaires et leurs forces de l’ordre. Les pays les plus faibles sont les plus exposés, mais le
péril est global, car les flux d’argent sale et les stupéfiants pointent presque tous vers les riches économies du Nord
qui sont les plus gros marchés et qui possèdent les grandes banques et paradis fiscaux les plus sûrs. Le souci premier
des CTO est, une fois leurs marchandises illicites vendues, de faire rentrer l’argent sale dans l’économie légale.
Dans une société toujours plus mondialisée et interconnectée, les possibilités ont exponentiellement augmenté
jusqu’à offrir aux mafias l’occasion d’ériger de véritables multinationales du crime où toutes les activités rentables –
en plus de la drogue – sont les bienvenues. Là aussi, l’idée de la « mondialisation heureuse » trouve de sérieuses
limites : les mafias aiment par-dessus tout les accords de libre-échange, l’ouverture des frontières, les
déréglementations, le capitalisme mondialisé et même l’économie digitale. Aujourd’hui, leurs activités
comprennent, outre la production et la vente de drogues, les trafics d’armes, d’êtres humains/migrants, la
prostitution, l’élimination des déchets toxiques, le vol de matériaux, le braconnage, le trafic d’œuvres d’art,
d’animaux, ou toute autre activité illégale, y compris les trafics d’organes et le cybercrime.
D’après l’expert Éric Vernier, qui a croisé les statistiques de l’ONU, du FMI, du Groupe d’action financière sur
le blanchiment de capitaux (Gafi) et d’ONG spécialisées, la richesse dégagée annuelle des mafias au niveau mondial
1
avoisinerait 2 000 milliards de dollars par an. L’expert Jean de Maillard parle ainsi de « produit criminel brut »
(PCB). La comparaison avec les économies légales est vertigineuse, car les réseaux criminels représenteraient alors
la « huitième puissance mondiale » et seraient membres du G8 s’ils étaient un État ! Le PCB des mafias est
supérieur au PIB de pays comme l’Italie ou le Brésil (1 800 milliards de dollars), et comparable à celui de la France
2
3
(2 100 en 2019), ou même du continent africain tout entier , soit près de 2 % du PIB mondial . À noter qu’Eurostat
4
a demandé aux pays de l’UE d’inclure dans le calcul de leur PIB les recettes de la drogue et de la prostitution …
Quant à l’argent sale en général, si l’on inclut dans ce chiffre global l’argent sale « noir » du crime, « l’argent
gris » des petites fraudes ou de l’argent facile, les abus de biens sociaux, les faux bilans et les détournements de
fonds non liés aux mafias, il équivaut à 7 000 milliards de dollars chaque année, soit 10 % du PIB mondial. Les
5
détournements de fonds publics représenteraient environ 2 600 milliards, soit 5 % du PIB mondial . En France, la
seule fraude à la sécurité sociale drainerait chaque année des dizaines de milliards vers des pays africains. La Cour
6
des comptes française a d’ailleurs estimé cette fraude entre 20 et 25 milliards d’euros par an . Les principaux
responsables du blanchiment de masse et de l’argent sale présents sur le marché restent toutefois et de loin les
organisations criminelles de grande envergure (mafias, cartels), notamment grâce au trafic de stupéfiants.
Blanchiment : la mondialisation financière et le capitalisme
dérégulé, des opportunités pour le crime organisé
D’après Rhoda Weeks-Brown, conseillère directrice du département juridique du FMI, le blanchiment d’argent
représenterait entre 1 600 et 4 000 milliards de dollars par an, soit 2 à 5 % du PIB mondial ou près de
3 000 milliards en moyenne ou 10 milliards de dollars par jour, dont 600 milliards chaque année rien que pour le
7
trafic de stupéfiants . Selon la définition du Gafi, le blanchiment de capitaux consiste à « retraiter des produits
d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale, de manière à légitimer des biens mal acquis ». Tout trafic ou
activité illégale d’envergure nécessite à un moment ou à un autre d’être blanchi, recyclé dans l’économie légale, afin
que les organisations criminelles puissent l’utiliser. La méthode classique consiste à créer des entreprises qui
perçoivent l’argent illégal et le transforment en gain légal transférable dans des institutions bancaires officielles. Les
pays où l’argent est blanchi sont d’abord ceux ayant des législations fiscales et réglementations bancaires
particulières et/ou utilisant le secret bancaire. Une fois les fonds entrés dans le système financier, ils « sont
réintroduits dans des activités économiques légitimes (immobilier, produits de luxe, création d’entreprises) »,
processus facilité par les nouveaux moyens de paiement, la libéralisation et la dérégulation des marchés financiers. Il
serait en effet naïf de croire que les criminels sont de simples délinquants analphabètes, car les personnes en charge
des comptes et du blanchiment dans ces organisations sortent souvent des meilleures écoles. Ils connaissent donc
parfaitement le système bancaire et les façons de procéder pour blanchir l’argent grâce aux moyens légaux, via des
techniques de plus en plus complexes (que ce soit à réaliser comme à démanteler). C’est grâce au blanchiment que
les organisations criminelles perdurent, faute de quoi elles ne pourraient pas réinvestir. « Dans de nombreux pays,
elles possèdent des secteurs entiers de l’économie. Les fonds qu’elles détiennent seraient d’au moins 4 000 milliards
de dollars ». Le blanchiment de capitaux permet à la criminalité organisée d’acquérir ou de contrôler des pans
entiers de l’économie par ses investissements. Si l’on compare les moyens humains et financiers des organisations
criminelles à ceux des organismes de lutte, on se rend compte que le combat est inégal : les mafias regroupent bien
plus de monde et surtout des sommes d’argent beaucoup plus importantes… À titre d’exemple, le budget de Tracfin
(organisme de lutte contre le blanchiment international) est de quelques millions d’euros seulement, somme
dérisoire comparée à celles des mafias.
Le trafic de drogue, entreprise presque aussi lucrative que le
pétrole !
En se référant aux données de la production de drogue dans le monde fournies par l’United Nations Office on
8
Drugs and Crime (UNODC) et Europol, on évalue le revenu mondial annuel du trafic de drogue entre 600 et
1 000 milliards de dollars. La production de la seule cocaïne aurait atteint le niveau record de 1 976 tonnes en 2017.
e
« La drogue représenterait la 3 économie du monde, après le pétrole et l’alimentation, devant les ventes d’armes
(dont une partie est vendue en contrebande). Avec un chiffre d’affaires d’environ 1 000 milliards de dollars, le
commerce de la drogue est de surcroît très rentable, puisque les bénéfices atteindraient la moitié de cette somme
9
avec 80 % blanchis . » Pour la distribution, le plus grand marché identifié est sans surprise l’Amérique du Nord, qui
absorbe à elle seule 44 % des ventes, suivie par l’Europe, avec 33 %. Ceci nous rappelle qu’il n’y a pas de vente de
drogue sans consommateurs, notamment dans les pays riches, et que la demande en Occident découle aussi d’une
culture de l’addiction et de l’hédonisme inhérente aux antivaleurs véhiculées par McWorld et les stars ou
antimodèles du show-biz. Pour ce qui est de l’Europe, le marché de la drogue a été estimé à 30 milliards d’euros en
10
2017, selon Europol , le marché du cannabis détenant la première position, avec le Maroc comme premier
fournisseur. Le même organisme international a recensé 5 000 groupes criminels internationaux organisés sévissant
11
dans des pays de l’Union européenne, plus d’un tiers d’entre eux se livrant au trafic de drogue .
Le trou noir narco-islamiste afghan
Depuis l’invasion soviétique (années 1980) et les guerres civiles de 1980-1990, jusqu’à la montée en puissance
des talibans en 2000, l’Afghanistan est devenu la capitale mondiale de l’opium. La culture du pavot s’y est imposée
très tôt (1950), comme une source de revenus importante pour les paysans, car facile à cultiver, peu consommatrice
d’eau, et donc très rentable (bien plus que le blé). L’Afghanistan est le premier producteur d’opium, avec 90 % de la
production mondiale. Selon l’ONUDC, la moitié des revenus des talibans (voire 65 %) en proviendrait. L’emploi et
la sécurité que les talibans ont apportés à la population grâce au trafic leur ont permis de gagner le soutien de celleci, notamment la partie rurale pachtoune. L’ONUDC a estimé que les groupes terroristes et insurgés ont recueilli
environ 150 millions de dollars en 2016 grâce au commerce afghan d’opiacés, et aux taxes prélevées sur la culture
du pavot. Le Pakistan, par sa proximité avec l’Afghanistan, connaît de gros problèmes de santé publique liés à la
consommation de stupéfiants : l’héroïne y est la drogue la plus consommée avec une forte augmentation chez les
adolescents. Idem en Iran, où le ministère de l’Intérieur a annoncé en 2018 que 3 % de la population était
12
dépendante. Par ailleurs, 75 tonnes d’héroïne arriveraient chaque année en Russie , où l’impact est également très
fort, de même dans les pays d’Asie centrale, au Tadjikistan par exemple, où le trafic venant d’Afghanistan générerait
environ 2,7 milliards de dollars par an, ce qui en fait une source de revenus bien plus importante que les activités
légales. Sur la route du nord qui relie l’Afghanistan au marché européen opèrent des organisations criminelles qui
utilisent des voitures de luxe avec des cachettes sophistiquées et impossibles à détecter, même avec des scanners
ultraperformants de dernière génération fournis par les États-Unis. Ainsi, en 2019-2020, à la suite d’opérations
policières entre plusieurs pays, ces gangs, basés notamment à l’est de la Turquie, ont fait passer de l’héroïne afghane
à travers l’Iran, l’Asie centrale, la Russie, la Pologne et l’Allemagne avec pour destination finale les Pays-Bas. Une
véritable multinationale fonctionnait dans tous ces pays en s’appuyant sur les diasporas turques de Hollande. C’est
ainsi qu’en 2019, une saisie record a été effectuée au Kazakhstan avec plus d’une tonne d’héroïne dissimulée dans
des grosses plaques de marbre livrées depuis une usine iranienne.
Aujourd’hui, le bilan est plus que catastrophique : les talibans reviennent sur le devant de la scène par l’accord
historique signé le 29 février 2020 à Doha avec les États-Unis, après une guerre de près de vingt ans menée pour les
éliminer… Cet accord est la marque du profond échec américain dans la région qui se double d’un gâchis de
800 milliards de dollars. Cet accord engage les Américains à retirer progressivement leurs troupes présentes dans le
pays, ce qui constitue un véritable danger pour le Gouvernement et le peuple afghans, car il acte que les talibans sont
redevenus assez puissants pour négocier avec Washington et qu’ils pourraient, par la suite, revenir en force sur la
13
scène politique du pays. Des pourparlers pour un nouvel accord ont débuté le 12 septembre 2020 , les talibans
espérant avoir les mains libres avant l’automne 2021, date à laquelle les troupes américaines devraient avoir
entièrement quitté le pays, si Joe Biden ne revient pas sur cette décision de Donald Trump. Le gouvernement afghan
serait alors à la merci des talibans, qui contrôlaient déjà 80 % du pays en juillet 2021.
Géographie du crime organisé
Bénéficiaires nets de la mondialisation marchande, les groupes criminels et mafieux, qui gèrent des territoires et
quartiers défendus si besoin par les armes – tout en étant connectés à des réseaux mondiaux d’approvisionnement et
d’exportation –, sont les champions de la « glocalisation » (alliage de mondialisation et de local). Ils savent
s’adapter à n’importe quel changement socio-économique et peuvent modifier le système en place en faveur de leurs
intérêts. Ils instaurent des méthodes de gestion sophistiquées et des logistiques internationales et locales
performantes qui permettent d’acheminer les marchandises criminelles sur des dizaines de milliers de kilomètres. La
mondialisation a permis d’étendre le crime organisé sur les cinq continents, avec son lot de violence, de corruption
et de déstabilisation sociale. L’Europe occidentale elle-même n’a pu échapper à certaines formes de criminalité
organisée et territorialisée, dans de nombreux quartiers de non-droit et de contre-société qui vivent de facto sous le
contrôle de narcopouvoirs locaux.
À l’échelle globale, les zones les plus criminogènes se situent dans les milieux les plus défavorisés, nomment
d’Amérique centrale (Salvador, Honduras, Mexique, Haïti…), du Sud (Brésil, Bolivie, Pérou), du Caucase, des
Balkans, d’Asie centrale (Afghanistan, Ouzbékistan, Tadjikistan) et d’Asie du Sud-Est, mais également de l’Afrique
(Nigeria, Somalie, Maroc, etc.). Les mafias et autres organisations criminelles ont d’ailleurs tout intérêt à maintenir
la population de leurs territoires dans la pauvreté et l’illettrisme afin d’augmenter leur pouvoir d’attraction et leur
emprise. On le voit par exemple en Amérique du Sud, où la culture de la coca (comme le cannabis au Maroc) permet
14
à des centaines de milliers de paysans de survivre . Les pays de l’Est européen ne sont pas en reste : les
organisations criminelles y sont particulièrement développées (Kosovo, Albanie, Russie, Bulgarie, Serbie,
Monténégro, Turquie). La drogue qui entre aux États-Unis transite par les Caraïbes, l’Amérique centrale, les Andes.
Les trois principales productions ont longtemps été situées dans le Croissant d’or (Pakistan, Iran, Afghanistan) et le
Triangle d’or pour l’opium (Birmanie, Thaïlande, Laos) et la Ceinture blanche pour la cocaïne (Colombie, Bolivie,
Pérou, Équateur, Brésil). Aujourd’hui, c’est l’Afghanistan qui concentre la majorité de la production mondiale de
l’héroïne. Toutefois, la zone de consommation est essentiellement, en termes de valeur, l’Europe occidentale et
l’Amérique du Nord. Les produits stupéfiants naturels sont nombreux, mais la légalisation du cannabis dans certains
endroits (Espagne, Pays-Bas, Californie) a donné lieu à un développement de la production d’amphétamine,
d’opioïdes, d’ecstasy ou d’autres drogues de synthèse fabriquées dans des laboratoires clandestins extrêmement
mobiles. Afin d’échapper aux saisies, les trafiquants modifient donc sans cesse des composants, souvent légaux,
avant de les utiliser comme psychotropes. Ces drogues sont très souvent vendues au moyen du Darknet et produites
en masse en Chine, notamment, dont les réseaux criminels bénéficient d’une grande partie des délocalisations et
sous-traitance de productions chimiques occidentales, créant ainsi une distinction compliquée entre drogues et
médicaments… L’Asie du Sud-Est est d’ailleurs aujourd’hui l’épicentre du trafic mondial de drogue de synthèse,
avec un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an provenant de laboratoires clandestins.
La production de drogue est telle que, même avec les saisies records de ces dernières années, les trafiquants
sont toujours capables de remplacer leurs marchandises pour agir efficacement sur l’offre. Les organismes de
détection et de répression ne doivent donc plus mesurer leur succès aux quantités de drogue saisies, mais plutôt au
nombre d’organisations et de groupes criminels transnationaux spécialisés dans le trafic de drogue démantelés. Or, il
faut pour cela recourir à des méthodes de plus en plus sophistiquées, développer une masse critique de
connaissances de base et veiller à l’échange d’informations opérationnelles entre les organismes de détection et de
répression et les unités spécialisées de différents pays. Par ailleurs, le « modèle économique » des groupes criminels
organisés évolue, et ils se transforment en réseaux de plus en plus indépendants et difficiles à contrer. Ils ont même
souvent une longueur d’avance sur les États, dont l’évolution des procédures judiciaires et des lois est bien plus lente
que la capacité d’adaptation des mafias. De plus, les moyens pour le transport des marchandises sont de plus en plus
sophistiqués : les groupes criminels transportant leurs drogues par des « narco-sous-marins », des drones, des
bolides et porte-conteneurs sont de plus en plus difficiles à détecter. Certains ont par exemple été interceptés en
15
Espagne avec 3 tonnes de cocaïne en 2019 , et d’autres opérations antidrogue ont même permis de saisir plus de
5 tonnes de stupéfiants dans un sous-marin artisanal au large du Panamá…
Mafias italiennes
Les mafias italiennes constituent un véritable phénomène en Europe parce que ces OCT, qui bénéficient de
complicités d’une partie des populations les plus défavorisées et des classes politiques du sud de l’Italie, sont les
plus anciennes, les plus enracinées et les plus popularisées. Ces organisations sont aussi fort très présentes au niveau
international et pour elles, l’ouverture des frontières inhérentes à l’espace Schengen a été une véritable aubaine, tout
comme l’ont été en général la mondialisation et la libre circulation des biens, des personnes et des services chères
aux responsables européens. À l’origine, le phénomène était purement local et territorialisé, toutefois, après 1945,
les mafiosi ont largement profité de l’immigration massive d’Italiens aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe,
en Australie et au Canada, pour étendre leur réseau criminel à l’échelle planétaire. La plus célèbre, Cosa nostra, pur
produit de la mondialisation anglo-saxonne dans sa version moderne, s’est implantée aux États-Unis, au Canada et
en Italie pour y régner sur le crime, avant d’être remplacée ces dernières décennies par des mafias italiennes
concurrentes calabraise et napolitaine : la Camorra en Campanie, la N’dranghetta en Calabre (la plus puissante et la
plus traditionnelle). La Sacra corona unita des Pouilles et la Stidda en Sicile sont plus récentes, mais elles sont bien
moins puissantes que les pieuvres napolitaine et calabraise.
Selon le criminologue Francesco Calderoni, professeur à l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan et
chercheur au Transcrime (centre de recherche sur le crime international), le montant annuel des gains de ces mafias
serait de 10,7 milliards d’euros par an, soit 0,7 % du PIB italien. L’extorsion de fonds demeure, avec la drogue,
l’activité principale. La Camorra et la N’dranghetta engrangent aujourd’hui les plus hauts revenus, avec
respectivement 3,3 et 3 milliards d’euros annuels, et ces mafias ont dépassé de loin la Cosa nostra sicilienne,
désormais moribonde après avoir été presque vaincue par l’État italien suite aux excès du parrain Toto Riina et à sa
folle tentative de défier l’État par le terrorisme, ce qui a provoqué une série de dénonciations de « repentis » et des
représailles judiciaires sans précédent dans les années 1992-1997. Elles totaliseraient 68 % des activités mafieuses
en Italie. On a recensé depuis toujours les ingérences de la mafia dans la politique italienne, surtout dans la partie
16
sud de l’Italie. D’après l’Autorité nationale anticorruption (Anac ), le secteur le plus touché par la corruption est
celui des travaux publics, suivi de la gestion des déchets, très prisé par les mafias calabraise et napolitaine, qui les
17
enterrent illégalement dans le sol italien
ou ailleurs comme dans les pays de l’Est. D’après le rapport sur la
18
corruption de l’ONG Transparency International , l’Italie, avec 51 points sur 100 et classée 51 sur 198, fait partie
des pays les plus corrompus d’Europe. Depuis des décennies, même des villes du Nord comme Turin ou Milan, de
tradition non mafieuse, ont été investies par les mafias du Sud, surtout la N’dranghetta. Ceci dit, la mondialisation
marchande, couplée à la généralisation de la consommation de drogues dures et douces en Occident depuis la
révolution libertaire de 1968 et l’intériorisation, par les jeunes, des codes des stars du pop, a offert d’immenses
marchés aux autres mafias qui se sont multipliées au point que les clans italiens ont été concurrencés par ceux venus
des Balkans (mafias serbes et surtout albano-kosovares), du monde turcophone (clans turcs et kurdes), du Caucase
(Tchétchènes, Géorgiens et Arméniens), d’Asie (triades chinoises), d’Afrique (mafias nigérianes) et, bien sûr,
d’Amérique latine (narcocartels colombiens et surtout mexicains).
Mafias albanaises
Les mafias albanaise et kosovare sont en progression constante depuis trois décennies en Europe et dans le
monde. Favorisées par la mondialisation et la chute du communisme soviétique et yougoslave, elles se sont
développées dans les années 1980-1990 avec l’ouverture des frontières et l’éclatement de l’ex-Yougoslavie, fruits
des interventions militaires américaines (1992-1999). Quelques années plus tard, en 2007, l’indépendance officielle
du Kosovo – déjà séparé de facto de la Serbie depuis lors – a permis le renforcement du crime organisé transnational
albanophone dans tout le monde occidental à partir de ses bases ethnogéographiques balkaniques (Kosovo,
Macédoine, Albanie, sud-est du Monténégro ou « Croissant balkanique »). Ces clans mafieux prospèrent parmi les
diasporas albanophones d’Europe essentiellement implantées en Grèce, en Italie, en Suisse, en France, en
Allemagne, en Belgique, ou en Autriche, ainsi qu’en Amérique du Nord. Ils sont « spécialisés » dans le trafic d’êtres
humains, de drogue et d’organes (héroïne et cannabis), la prostitution industrielle, les cambriolages et les
19
20
braquages . Ces activités généreraient un « chiffre d’affaires » annuel de plusieurs milliards de dollars .
Composées de familles ou clans qui fonctionnent par les liens du sang et leur code d’honneur, le Kanun (vendettas
intergénérationnelles, loi du silence), ces organisations sont très imperméables (peu de repentis) et aussi
caractérisées par une extrême violence, bien plus encore que les mafias géographiquement proches et rivales de
Serbie ou du sud de l’Italie qu’elles ont concurrencées, voire parfois éradiquées dans certaines zones (Suisse,
notamment).
Ladite mafia albanaise – en réalité composée de clans autonomes albanais, kosovars, macédoniens et
monténégrins – s’est principalement étendue après la quasi-guerre civile survenue en Albanie en 1997, à la suite
d’une grave crise financière, puis consécutivement à la guerre du Kosovo (1998-1999), de nombreux Albanais
d’Albanie et d’ailleurs ayant obtenu un statut de réfugié politique en prétendant être des Kosovars victimes des
Serbes (ils l’étaient vraiment parfois). Les flux de migrants albanais qui ont étoffé les diasporas ont constitué des
21
terreaux de recrutement et des bases de rackets et de trafics pour les clans mafieux qui ont profité de l’ouverture
des frontières intereuropéennes. La manne des éventuels fonds structurels européens fait également rêver. Cette
expansion de la criminalité organisée albanophone en Occident a été sans contexte accentuée par le rapprochement
des Balkans avec le reste de l’Europe (échanges commerciaux, candidature à l’euro et à l’UE, accords dans le cadre
du voisinage de l’UE, adhésions de l’Albanie à l’Otan…), puis par le fait que des clans mafieux ont trouvé un appui
au plus haut sommet de l’État kosovar, lui-même dirigé par les anciens cadres de l’organisation albanaise UÇK
(Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Armée de libération du Kosovo), groupe paramilitaire terroriste lié aux réseaux
criminels albanais. D’évidence, ces organisations voient la perspective de l’entrée – à terme – de l’Albanie dans
l’Union européenne comme une véritable aubaine car cela permettrait de libéraliser les flux de biens, de personnes et
de capitaux, et de rendre encore plus aisés les acheminements de stupéfiants et les trafics d’êtres humains.
Du point de vue des services de sécurité européens, le Kosovo – créé entre 1999 et 2007 avec l’appui
américano-atlantiste –, État jamais reconnu par la Russie, la Serbie, l’Espagne et d’autres pays membres de l’ONU,
peut être considéré depuis sa création comme un État mafieux, à l’instar de certains États fédérés mexicains aux
mains des cartels. Rappelons seulement que l’ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, ainsi que d’autres
22
fondateurs de cet État sont directement issus du « Groupe de Drenica », l’ex-UCK, organisation terroriste
séparatiste elle-même liée à la mafia albanaise. Ce fait a été établi par la Cour pénale internationale de La Haye pour
23
les crimes en ex-Yougoslavie (CPIY). D’après un document du rapporteur du Conseil de l’Europe, Dick Marty,
l’UÇK aurait en effet été impliquée dans maintes activités criminelles (trafics de drogue, de cigarettes et d’organes)
24
comme dans l’accaparement des grands secteurs de l’économie kosovare .
Le trafic de drogue (héroïne et cannabis) est la principale activité des clans albanais. Pour l’héroïne, la source
d’approvisionnement majeure est aujourd’hui l’Afghanistan (via la Turquie et les Balkans), les destinations et
marchés de prédilection étant les pays d’Europe de l’Ouest. Les Balkans jouent en fait le rôle de plaque tournante
obligée des drogues acheminées depuis l’Asie centrale vers l’Occident, via l’Italie et la Suisse, principaux pays
d’accueil et de passage des diasporas albanophones. En plus d’être leaders pour la distribution, l’Albanie et le
Kosovo sont également aujourd’hui d’importants producteurs de cannabis à destination de l’UE, concurrençant ainsi
le narco-État marocain. En témoigne l’augmentation en Italie des saisies de cannabis en provenance d’Albanie,
25
passées de 42 tonnes en 2016 à plus de 90 tonnes en 2017 , ce qui reflète l’intensification du trafic sur l’ensemble
de la mer Adriatique. D’après le rapport d’Europol 2019 sur le trafic de drogue, les mafieux albanais sont également
devenus des acteurs clés du trafic et de la distribution de cocaïne, jadis quasi monopolisés par les cartels latinoaméricains en collaboration avec les mafias italiennes pour l’acheminement vers l’Europe. En avril 2019, une
26
importante opération d’Europol menée en coopération avec la France, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas, a ainsi
permis l’arrestation, pour trafic de drogue, d’êtres humains et blanchiment d’argent, de plus de 60 membres de clans
albanophones. Autre indice révélateur de leur expansion vers l’Europe, notamment la France, le nombre d’Albanais
27
et de Kosovars dans les prisons françaises a bondi de 340 % entre 2011 et 2017 . Le dernier événement médiatisé
en date concerne une guerre de clans kosovars débutée en 2013, qui s’est notamment soldée par l’assassinat d’un
28
homme à Frasses (Suisse) et par la mort de 23 autres et des dizaines de blessés au Kosovo .
Les cartels d’Amérique centrale
Les narcos ont été les grands bénéficiaires de l’ouverture des frontières – chère aux démocrates américains et
aux ONG immigrationnistes – et des traités de libre-échange des années 1990 (Nafta) inhérents à la mondialisation
29
anglo-saxonne. Cinq principaux cartels mexicains contrôlent de vastes zones où ils sont souvent capables de
commander aux gouverneurs des États fédérés. Le cartel de Sinaloa, par exemple, contrôle toute la partie nord-ouest
du Mexique. Il s’est taillé une solide réputation grâce à son célèbre leader El Chapo et à sa violence extrême qui n’a
souvent rien à envier à Daesh, avec plus de 200 000 morts sur une période comparable de onze ans et la terreur
permanente provoquée par les démembrements et les décapitations… Avant d’être arrêté en février 2014 aux ÉtatsUnis, ce parrain était devenu le principal acteur du trafic international de cocaïne, profitant d’un pacte avec le
Gouvernement qui consistait en l’injection de narcodollars dans l’économie mexicaine légale en échange de
protection. Le trafic de stupéfiants illicites aux États-Unis, en Europe et en Asie lui rapportait un chiffre d’affaires
30
annuel de 3,5 milliards de dollars . On sait qu’à partir de 1995, il y a eu un changement dans les relations entre
pouvoir légal et cartels lorsque la politique économique a mis les institutions publiques au service des marchés
internationaux, ce qui a abouti simultanément à la décentralisation du pouvoir légal et à la régionalisation des
cartels. On a alors assisté à un renversement du pouvoir au profit des groupes criminels qui ont su profiter du
système capitaliste-libéral en se faisant reconnaître comme des entrepreneurs privés, autrement dit des
multinationales du crime contribuant au développement économico-social du pays…
Il en a été de même pour tous les grands cartels du pays, qui se sont constitués et renforcés par des alliances
avec les autorités politiques. « Les narcos font des affaires et partagent leurs profits avec les politiques ; les
politiques disposent du monopole de la légitimité et redistribuent une partie des profits des narcos pour l’entretien de
31
leurs clientèles sociales sous forme d’aides personnalisées informelles ou de services publics . » Ils sont devenus si
puissants et indispensables que tout le monde en profite : les trafiquants, leurs « alliés » politiques, les banquiers
blanchisseurs, les entrepreneurs et commerçants, leurs employés directs, ainsi que les paysans qui cultivent les
plantes et leurs familles. Le profit injecté dans l’économie légale permet même d’assurer la croissance du PIB et de
réduire en partie la pauvreté dans un pays dont le taux de précarité est déjà très élevé. Le cartel Nouvelle Génération
de Jalisco, qui contrôle principalement la région de Tierra Caliente, au Mexique, est par exemple un expert de la
distribution de drogues synthétiques sur le continent et entretient des liens étroits avec les marchés asiatiques de la
drogue. « 60 à 80 % de la cocaïne consommée aux États-Unis y entre par la frontière mexicaine ; 50 à 70 % de la
32
consommation de marijuana des États-Unis et 20 à 30 % de l’héroïne . »
Au niveau des différents cartels et gangs répertoriés, 19 sont considérés comme d’envergure nationale avec des
ramifications aux États-Unis, et 5 d’ampleur internationale (cartels du Golfe, de Juárez, de Sinaloa, de Tijuana et de
33
Valencia). Le narcotrafic serait l’employeur direct de près de 400 000 personnes au seul Mexique . Même avec
nombre de leurs membres et dirigeants derrière les barreaux, les organisations sont toujours actives et gèrent les
trafics depuis leur prison. « La famille la plus puissante, la famille Félix Arellano, aurait contrôlé près de 70 % de la
cocaïne transitant à travers le monde », écrit Éric Vernier. Dans la même zone, on peut retrouver les maras, présents
au Salvador et Honduras principalement. Dans certains territoires, les narcocartels ont acquis un tel pouvoir
34
politique qu’ils y redistribuent eux-mêmes les richesses et y choisissent les candidats aux élections . Ils parviennent
à recycler leurs profits dans des activités légales où ils contraignent propriétaires et entrepreneurs à leur céder des
titres. Ils développent ainsi en quasi-impunité leurs activités d’enlèvement contre rançon, de trafic de stupéfiants,
d’armes et de migrants, ces derniers étant transformés en passeurs de drogue. Les cartels assurent souvent euxmêmes l’ordre public en prenant la place de l’État, contrôlant les polices locales et installant des barrages de
contrôle routier…
Récemment, on a pu se rendre compte de l’incroyable puissance des cartels mexicains lors de la tentative
d’arrestation du fils d’« El Chapo », qui a débouché sur un affrontement à l’arme de guerre entre le cartel et les
forces mexicaines, soldé par huit morts, une quinzaine de blessés et la libération du prisonnier par le
35
Gouvernement . On peut aussi citer l’attaque contre le chef de la police de Mexico, Omar García Harfuch,
miraculeusement réchappé après qu’une douzaine d’hommes armés de grenades et de fusils d’assaut ont pris pour
36
cible sa camionnette blindée .
Les cartels ont depuis quelques années commencé à créer des enclaves autonomes dans une explosion de
violence qui s’apparente à une guerre contre l’État mexicain. Le cartel de Sinaloa, par exemple, aurait exécuté à lui
seul plus de 30 000 personnes en vingt ans… La carte de la violence au Mexique montre non seulement des niveaux
élevés de perception de l’insécurité – qui, au cours de l’année 2020, a atteint 64,5 % de la population et dans les
zones urbaines 73,7 % –, mais aussi une augmentation réelle de 16 % du taux de victimes de la criminalité. Entre
2007 et 2018, le nombre d’homicides a plus que doublé, passant d’un taux de 9,3 homicides pour 100 000 habitants
à 21,1 en 2018. À elle seule, l’Amérique latine concentre environ 36 % de l’ensemble des homicides dans le monde.
Dans nombre d’États fédérés mexicains, les cartels se substituent à l’État, fournissant des aides à la population
en échange de leur soutien. En pleine crise de la Covid-19, on a pu ainsi voir apparaître publiquement en star et
patriarche Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, le chef du cartel de Jalisco. Ce parrain a fait construire son
propre hôpital privé pour ne pas avoir à se rendre dans une institution publique, la population locale pouvant elle
aussi avoir accès à ces services, ce qui rappelle Pablo Escobar se faisant construire sa propre prison.
Les cartels sont les grands gagnants de la pandémie, car la crise du coronavirus leur a donné une nouvelle
emprise sur les populations, en leur conférant de facto le statut d’organisation de charité, de pourvoyeur de
nourriture, de médicaments ou de matériel de protection dont les Mexicains manquaient. Aujourd’hui au Mexique,
la confiance de la population en l’État est rompue, la violence extrême s’est démocratisée et la peur s’est installée.
Toutes les solutions mises en place pour endiguer le crime ont échoué. Dans ce pays désormais failli ou plutôt
gangrené, soit on négocie avec les narcos et on accroît la corruption, soit on les réprime et on accentue la violence.
Le lien entre force de l’ordre et narcos est d’ailleurs désormais ancré dans la structure même du système politique du
Mexique.
Mafias russophones
Profitant de la troisième vague de mondialisation qui a été permise dans les années 1980 par la fin de l’exURSS, le crime organisé en provenance de l’espace ex-soviétique, très différent des mafias précitées, et bien plus lié
aux affaires et grandes sociétés, s’est propagé grâce à la libre circulation des biens, des personnes et des services
bien au-delà des frontières de l’ex-URSS : Europe de l’Ouest, États-Unis, Méditerranée orientale, et même jusqu’en
Australie. De puissants réseaux et groupes russophones – souvent non russes ethniquement – y ont blanchi leurs
capitaux, illégalement acquis dans le cadre du pillage de la Russie postsoviétique dans un contexte de libération
anarchique (époque de Boris Eltsine). Les domaines sont surtout l’hôtellerie de luxe, la restauration et les
investissements immobiliers. Selon Interpol, 40 % du PIB russe serait contrôlé par des groupes criminels indigènes.
Mikhail Orskii, écrivain et ancien chef d’un groupe criminel dans les années 1990, déclarait récemment, dans une
interview au journal Moskovskii Komsomolets, qu’aujourd’hui, 431 « chefs mafieux » ou « voleurs dans la loi » sont
en action, dont des Géorgiens (242), des Russes (51), des Arméniens (30), des Yézidis (26), des Azerbaïdjanais (16),
des Abkhazes (10), des Tchétchènes (8), et des Israélites, ce qui permet de relativiser le terme générique abusif de
37
« mafias russes ». Des réseaux du crime organisé russe et géorgien sont régulièrement démantelés par la police
espagnole dans les régions de la Costa Brava et de la Costa del Sol, la Catalogne étant une zone privilégiée en raison
des proximités avec le paradis fiscal d’Andorre et la France. C’est ainsi qu’en décembre 2020, suite à une enquête
policière qui a duré sept ans, l’opération Testudo, les forces de police espagnoles ont arrêté 23 personnes liées aux
38
réseaux mafieux russes, qui opèrent dans les villes d’Altea, Alicante, Finistrat, Ibiza, Madrid et Valence .
39
Dans son livre sur le crime organisé russe , Mark Galeotti explique que, « dans l’ensemble, la pègre russe n’est
pas définie par des structures hiérarchiques comme la mafia italienne ou le yakuza japonais, mais par un écosystème
souterrain complexe et varié ». Galeotti indique qu’il existe six à douze groupes russophones de type mafieux
structuré. Certains sont simplement définis par des intérêts communs (Solntsevo), ou par une culture, une religion ou
une langue commune (Tchétchènes, Géorgiens, etc.). D’autres sont ancrés autour d’individus (groupe de Tariel
Oniani), ont une orientation territoriale précise (Saint-Pétersbourg, Tambovskaya ou l’Association des voleurs
d’Extrême-Orient), ou sont dominés par des activités criminelles spécifiques, comme les routes de contrebande. On
peut citer également le carrefour criminel des « Ukrainiens », qui opèrent à travers la frontière russo-ukrainienne.
La plupart des réseaux mafieux plus vastes qui couvrent une région sont essentiellement confinés dans des
zones particulières, comme le gang Uralmash d’Ekaterinbourg, aujourd’hui. Les groupes mafieux des villes de plus
grande taille sont dominés par des Azéris et des Géorgiens – comme le célèbre Tariel Oniani (« Taro »). Beaucoup
se livrent au racket de protection, fournissant ce que l’on appelle krysha – un « toit » – aux entreprises et aux
particuliers résidant sur « leur territoire ». Les pots-de-vin et les « raids » (saisie d’actifs au moyen de faux
documents et de fausses réclamations juridiques) sont en pleine hausse. Certains de ces gangs sont également actifs
dans le trafic de drogue, la contrefaçon ou l’esclavage moderne. À la différence des cartels mexicains ou albanokosovars, il n’existe pas de preuve d’ingérence mafieuse dans le pouvoir politique, sauf à des niveaux inférieurs. Par
contre, le Kremlin utilise souvent ces groupes criminels comme des instruments secrets dans le cadre de liens de
corruption et de missions spéciales. Bien que le niveau de violence ait spectaculairement chuté depuis les
années 1990, en grande partie en raison de la pression de l’État, les meurtres contre rémunération, les extorsions et
les règlements de compte violents (les razborka) restent des activités essentielles des gangs.
Mafia nigériane
Parmi les organisations criminelles africaines, la mafia nigériane offre l’exemple le plus abouti d’une
internationalisation du crime via les flux migratoires. Les organisations mafieuses nigérianes sont apparues depuis
des décennies en Afrique, et plus récemment en Europe, dans le cadre d’une « division internationale du travail »
criminel. Cette mafia est née au début des années 1980, après la crise pétrolière, ressource clé du pays, qui a conduit
les groupes au pouvoir à rechercher le soutien de criminels pour conserver leurs privilèges, à la suite de la baisse du
cours du baril. Ainsi protégée, la criminalité nigériane a pu développer ses trafics, aidée non seulement par le soutien
d’une partie du monde politique du pays mais aussi par le contrôle limité que l’État exerce sur le vaste territoire
national. Présentes dans de nombreux pays (Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique, Roumanie, Royaume-Uni,
Autriche, États-Unis, Croatie, Slovénie, République tchèque, Hongrie, Ukraine, Pologne, Russie, Brésil, Malte et
Italie), les mafias nigérianes sont actives dans l’héroïne, la cocaïne, la mendicité et la prostitution au sein des
communautés diasporiques nigérianes ou africaines du monde entier. Aux côtés de Black Axe (ou la « Hache
noire »), on peut citer la Supreme Eiye Confraternity (la « Confrérie suprême Eiye »). Ces noms se sont
progressivement frayé un chemin dans le lexique des polices européennes pour prendre place aux côtés de ceux
d’autres organisations mafieuses. Sur leur terre d’origine, ces entités connues de longue date ont pris diverses
formes avant de tremper dans la criminalité. Comme les autres groupes mafieux, la Black Axe est organisée en une
structure pyramidale qui utilise l’intimidation et la violence pour s’implanter, son activité principale – et celle des
mafias nigérianes en général – étant la prostitution industrielle, fortement développée par le biais des trafics des
migrants reconvertis en trafics d’esclaves sexuels internationaux.
Le centre névralgique nigérian de cette traite est Benin City, situé dans l’État d’Edo, au sud du Nigeria, plaque
tournante de la prostitution, d’où de nombreuses filles sont envoyées à l’étranger pour se prostituer, souvent sans le
savoir au départ. Ainsi, des milliers de jeunes Nigérianes – plus nombreuses encore que les Roumaines et les
Albanaises – font le trottoir en Italie et partout dans les villes européennes, après avoir été achetées à des familles
pauvres, à qui on fait miroiter des études en Europe. La logistique de leur acheminement, via la Libye, notamment,
est organisée par des correspondants de la Black Axe dans les différents pays de transit. Une fois sur le sol italien,
elles sont séquestrées et brutalisées. Leurs proches restés au pays sont menacés de mort si la filière est dénoncée par
les filles dont les papiers sont confisqués. La mafia nigériane a établi des règles en Italie et en Europe : refusant
l’usage d’armes à feu, elle assoit son autorité par la machette et la hache (Black Axe signifie « Hache noire »), et
agit en Italie, dans la région de Naples, notamment, en sous-traitant de la Camorra. Le trafic de drogue est aussi prisé
par cette mafia qui offre des tarifs encore plus bas que les organisations concurrentes. Elle développe d’ailleurs de
40
plus en plus les drogues de synthèse qui envahissent l’Afrique . Selon les statistiques du ministère italien de
l’Intérieur, des dizaines de milliers de migrants africains arrivés en Italie depuis le début de la crise migratoire
libyenne (2011-2015) – dont beaucoup de Nigérians – forment ainsi la première communauté de demandeurs d’asile
en Italie, avec 83 870 requêtes. La justice italienne s’inquiète non seulement d’un rapprochement entre les
organisations criminelles nigérianes et les pieuvres italiennes classiques, mais aussi de la collaboration d’ONG
internationales humanitaires promigrants clandestins et des passeurs acheminant la main-d’œuvre des mafias
nigérianes. Un sujet tabou pour maints politiques européens adeptes du mythe de l’immigration bonne par nature. Le
18 novembre 2016, 23 Nigérians soupçonnés d’appartenir à la Hache noire étaient arrêtés par la direction antimafia
de Palerme. Ils étaient accusés d’avoir fait entrer illégalement de jeunes Africaines – acheminées clandestinement
depuis la Libye vers l’île de Lampedusa avec l’aide active des ONG promigrants clandestins – et de les avoir forcées
à se prostituer. Parmi eux se trouvait, selon la police italienne, le « ministre de la Défense » de l’organisation,
Kenneth Osahon Aghaku. Là n’est pas le seul clin d’œil à l’État : cette mafia nigériane est souvent formée d’anciens
militaires, lesquels reversent une sorte de loyer à la Camorra de Naples. Celle-ci lui « loue » un territoire,
notamment les 20 000 logements, immeubles et villas construits illégalement dans les années 1960 par le clan
mafieux local des Casalesi. À Castel Volturno, en Campanie (Naples), on peut aujourd’hui croiser des centaines de
prostituées esclaves nigérianes dont les « passes » démarrent à 5 euros… Ici, on ne parle plus de prostitution, mais
bien de trafic d’êtres humains et d’esclavage.
Cette organisation, bien moins médiatisée que les vieilles mafias italiennes, est étonnamment très peu dénoncée,
les filles exploitées ne parlant pratiquement jamais en raison de la peur extrême de subir des violences de la part de
leurs proxénètes et surtout pour éviter les représailles sur leur famille restée au Nigeria. La raison du silence
médiatique et politique sur cette mafia est aussi due au fait que sa dénonciation impliquerait celle de l’immigration
clandestine, aujourd’hui dépénalisée…
La France, les quartiers de non-droit ou la loi des caïds
Assimilables à des zones non souveraines mondialisées, les nombreux quartiers de non-droit en France ne sont
pas de simples zones hors contrôle qui abritent les trafics en tout genre, mais des réseaux diasporiques
transfrontaliers issus de l’immigration extra-européenne parfaitement connectés à des narco-États et des
multinationales de la drogue et du trafic d’armes. En France, la criminalité ne cesse d’augmenter, en grande partie
grâce au trafic de drogue, hautement lucratif et belligène, alimenté par la mondialisation et les flux migratoires
incontrôlés. Le marché de la drogue a littéralement explosé en France depuis les années 2000 pour atteindre entre 3
et 4 milliards d’euros en 2020, une hausse de presque 1 milliard par rapport à 2010. On recense ainsi en France pas
moins de 3 952 points de deal dont 276 dans la seule Seine-Saint-Denis. Ceux-ci sont répartis dans toute la France
dans ces « quartiers chauds » ou de non-droit où l’économie du narcotrafic rencontre souvent le processus de contresociété islamiste. La consommation de drogues, douces comme dures, est ainsi en pleine expansion partout en
France, avec en tête le cannabis, largement fourni par les réseaux marocains, suivi de la cocaïne (mafias latinoaméricaines) et de l’héroïne (Afghanistan et mafias albano-turques). Dans l’Hexagone, environ 240 000 personnes
vivraient directement du trafic de drogue et feraient vivre à leur tour des centaines de milliers de membres des
familles sanctuarisées au sein de zones interdites de facto à la police et en rupture avec l’ordre républicain établi. En
ce qui concerne le cannabis, les routes du trafic partent quasi exclusivement du Maroc, via l’Espagne. Les
Marocains figurent ainsi en tête des plus gros trafiquants de stupéfiants de France. On peut notamment citer les caïds
Moufide Bouchibi, Reda Abakrim, Sofiane Hambli, Bouchaïb El Kacimi, ou bien d’autres encore. L’augmentation
exponentielle du trafic de drogue dans les quartiers de non-droit et de non-France, de facto « séparés »,
s’accompagne de violences, de règlements de compte en hausse et d’ensauvagement de plus en plus endémique.
Rien qu’en 2020, la France a ainsi compté 60 morts et 250 blessés du fait des violences dues aux trafics de drogue.
Après les Marocains, en tête pour le haschich-cannabis, les réseaux albanais, algériens, manouches et nigériens sont
également très présents, l’immigration de masse et le narcotrafic étant intrinsèquement liés, dans un contexte de
mondialisation, de liberté et d’ouverture des flux incontrôlés de personnes et de marchandises, que celles-ci fussent
légales ou illégales. Cette économie du narcotrafic est par ailleurs légitimée moralement par les réseaux islamistes et
indigénistes qui disculpent les caïds (voir saga Adama et Assa Traoré) à la tête de 4 000 quartiers de non-droit de
l’Hexagone. Ces forces antinationales révolutionnaires entretiennent toute une contre-culture de haine envers la
France et la police « raciste islamophobe », ce qui fait coïncider criminalité d’origine exogène et conflits
intercommunautaires. Cette convergence entre crime organisé et confessionnalisme islamiste s’est manifestée au
grand jour à Dijon, en 2020, lorsque des affrontements violents ont opposé des gangs maghrébins et tchétchènes à la
suite de l’agression d’un jeune Tchétchène, ce qui déclencha l’arrivée subite de 200 Tchétchènes cagoulés et armés
de couteaux et barres de fer prêts à en découdre dans le quartier des Grésilles, avec à la clé des dizaines de blessés.
Le lendemain, en représailles des descentes antiarabes des Tchétchènes, ce sont des groupes maghrébins qui ont fait
une démonstration de force en exhibant des kalachnikovs et fusils à pompe, des scènes totalement surréalistes pour
une ville jadis réputée calme comme Dijon. L’issue a été une pax islamica négociée par un imam frère musulman.
D’autres événements ultérieurs survenus en mai 2020 en région parisienne, à Avignon (assassinat d’un policier par
un dealer) ou ailleurs, ont montré que ce processus durable risque de s’intensifier dans l’avenir en raison de la
persistance de l’immigration incontrôlée, du manque de moyens des polices, du laxisme judiciaire, de la crise
économique, de l’échec de l’intégration depuis les années 1980, et de la « culture de la drogue » véhiculée par les
stars du rap et le show-biz façon McWorld.
Drogue et terrorisme : la face cachée mafieuse de Daesh et al-Qaida
À l’échelle mondiale, la production et le trafic de drogue, directs ou indirects, sont une source importante de
revenus pour les activités terroristes qui sont parfaitement à l’aise dans la mondialisation marchande, tout comme les
multinationales du crime. Dans un certain nombre de pays, les ressources issues des trafics de drogue, étant donné
leurs enjeux énormes, ont contribué à compliquer et à prolonger maints conflits armés et les ont bien souvent rendus
plus meurtriers. En Amérique latine au Moyen-Orient, le financement des groupes armés (Farc, M19, Sentier
lumineux, OLP, Hezbollah, PKK, etc.) est dans bien des cas lié aux trafics de drogue, notamment, ou aux « taxes »
prélevées sur les trafics.
Bien des groupes terroristes comme Aqmi, Aqpa ou Daesh sont impliqués dans ces trafics de drogue ainsi que
dans le prélèvement de « taxes » sur les acheminements de cocaïne en provenance d’Amérique latine via le golfe de
Guinée. D’après les estimations d’Europol, c’est même le premier revenu des terroristes, avec 330 millions de
dollars annuels, devant les hydrocarbures (230 millions). Boko Haram a ainsi été accusé d’aider les trafiquants de
drogue au Nigeria et dans les pays voisins, et, entre 2014 et 2017, Daesh en Syrie et en Irak, alors à leur apogée, a
carrément produit et exporté le captagon, la « drogue du djihad », dont les terroristes sont de très gros
consommateurs et qui représente un marché considérable pour l’État islamique, ainsi que pour les autres groupes
41
terroristes. En Syrie, on a pu le voir en juillet 2020, lors de la saisie de 14 tonnes estimées à 1 milliard de dollars ,
le Liban étant un des principaux points de passage et même un producteur de cette amphétamine. Selon le journal
42
L’Orient-Le Jour, le marché du captagon s’élèverait à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an .
L’espace sahélo-saharien est également devenu ces dernières années un nouveau carrefour des trafics de toutes
sortes. Outre les trafics de cigarettes de contrebande, chers à Aqmi, celui du haschich dans les années 1990, puis de
la cocaïne en provenance de l’Amérique latine depuis l’année 2000, sont des mannes inépuisables. Le haschich,
produit en grosse majorité au Maroc, est l’un des trafics les plus stables et « sûrs », du fait de l’expérience des
Marocains dans le domaine depuis des décennies. Il s’est principalement développé, tout comme le trafic algérien de
cigarettes, par le biais des diasporas immigrées en Europe. La mondialisation et l’ouverture des frontières permettent
là aussi d’établir des connexions et d’ouvrir les marchés internationaux et locaux connectés. La cocaïne provenant
43
de l’Amérique centrale transite par la Guinée-Bissau et toute l’Afrique de l’Ouest , avec le Mali comme plaque
tournante. Un autre trafic a émergé plus récemment : celui des opioïdes, notamment le tramadol, un antidouleur
devenu très populaire qui est un véritable fléau en Afrique de l’Ouest, où les taux d’addiction sont très élevés.
L’Afrique constitue d’ailleurs 67 % du marché mondial de ce produit, bien moins cher que la cocaïne et même que
le crack.
Trafic d’êtres humains et prostitutions : esclavage des temps
modernes
« L’augmentation inquiétante de la traite des personnes représente aujourd’hui le deuxième trafic mondial après
44
celui des stupéfiants », alerte Éric Vernier, spécialiste reconnu des questions de blanchiment et de criminalité. Au
fil des siècles, l’esclavagisme et les trafics d’êtres humains ne se sont jamais arrêtés, y compris dans les pays
occidentaux, car cette activité est extrêmement rentable. Dans cette catégorie criminelle et morbide, on inclut non
seulement la prostitution, mais aussi le commerce pédophile, les trafics d’organes humains, l’esclavage, les
enlèvements et la main-d’œuvre immigrée clandestine ou le travail forcé. Selon l’ONUDC, ce dernier trafic
générerait plus de 32 milliards de dollars de recettes annuelles. Aujourd’hui, les conflits, l’instabilité, le sousdéveloppement et le manque d’opportunités économiques sont autant de facteurs qui rendent les personnes ciblées
toujours plus vulnérables à l’exploitation. Le trafic d’êtres humains est particulièrement répandu en Asie australe et
centrale, tandis qu’en Afrique et au Moyen-Orient, le travail forcé et l’esclavage « traditionnel », ancrés dans des
45
traditions de rivalités intertribales pérennes, sont fort répandus . L’esclavage est toujours d’actualité à notre époque
et il est encore largement existant, principalement en Afrique noire : « en Mauritanie, on estime à 30 % le taux de la
population soumise au servage. Environ, 250 millions d’enfants travaillent illégalement dans le monde, dont un
quart est âgé de moins de 10 ans et 20 000 qui décèdent chaque année d’accidents du travail », écrit Éric Vernier.
À l’échelle mondiale, la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle constitue la forme principale
d’exploitation, la prostitution étant très prisée des organisations criminelles avec un important marché européen à la
clé, dominé par les mafias des pays de l’Est, notamment albanaise et kosovare. Celles-ci sont encore plus actives sur
le continent européen que les mafias italiennes, nigérianes et russes précitées : « Les grandes métropoles d’Europe
occidentale (Bruxelles, Londres, Hambourg et Paris) sont la première destination du trafic de femmes originaires de
l’Europe de l’Est (République tchèque, Bulgarie, Albanie), contrôlé par la mafia albanaise qui achète et viole ces
femmes dans des camps de la région ou les envoie dans des “maisons d’abattage” où elles subissent 200 passes par
jour, explique Éric Vernier. Les femmes de l’Est, les Africaines, sont enlevées, achetées ou abusées, violées,
46
torturées et dépossédées de leurs papiers officiels ». La prostitution existe partout, les réseaux de proxénétisme se
fournissant dans l’ensemble des pays pauvres : Roumanie, Moldavie, Brésil, Thaïlande, Chine, Corée, Viêtnam,
Philippines, Inde, Niger, Guinée équatoriale, etc. Les femmes et les enfants enlevés atterrissent, après différents
transferts, sur les trottoirs de Paris, de Hambourg, de Chicago, etc. Les femmes et les filles représentent non
seulement la majorité des victimes (72 %), mais aussi quasiment la totalité des cibles l’exploitation sexuelle (94 %).
Le trafic et la vente d’enfants sont également assez développés, même en Europe : « Des enfants brésiliens,
sénégalais, marocains, chinois, coréens, philippins, dominicains, haïtiens… sont régulièrement achetés ou enlevés
pour fournir les pays du tourisme pédophile, notamment la Thaïlande, mais aussi les couples occidentaux en mal
d’adoption. Un enfant peut être vendu jusqu’à 100 000 dollars à des familles adoptives américaines, sans aucun
contrôle par la suite », poursuit Vernier. Par exemple, un réseau bulgare démantelé en France, en octobre 2006,
47
vendait les bébés 6 000 euros après les avoir achetés 500 euros aux mères biologiques . Le Guatemala est
particulièrement touché avec le vol d’enfants de familles paysannes déshéritées, qui rapporte aux mafias locales
200 millions de dollars par an. Jusque dans les années 1990, en Roumanie, les familles occidentales achetaient les
enfants alignés devant l’orphelinat. Aujourd’hui en Irak, les enfants sont vendus entre 5 000 et 50 000 dollars selon
l’âge. Ils sont aussi victimes de travail forcé (légal ou illégal), comme les Roms que l’on voit mendier dans les rues
et métros en France ou dans d’autres pays d’Europe.
D’après Juan Martín Pérez, directeur du Réseau pour les droits de l’enfance au Mexique, de nombreux enfants
sont régulièrement kidnappés ou embauchés dans ce pays sur fond de narcotrafic et de guerre des cartels. Les plus
petits travaillent comme guetteurs ou informateurs, puis à partir de 12 ans, ils sont employés pour s’occuper de
maisons, et les plus grands, à partir de 16 ans, s’occupent du trafic de drogue et commencent à être recrutés comme
tueurs à gages. Ainsi, « le crime assure aux enfants et adolescents les récompenses, la reconnaissance et l’argent
48
qu’ils ne trouvent pas dans la société légale ». Une fois enlevés, ils peuvent être utilisés directement pour des
activités criminelles ou comme monnaie d’échange. Au Mexique, le taux de mortalité des enfants de 0 à 17 ans a
ainsi augmenté de 135 % entre 2000 et 2012, et en 2012, 1 612 enfants et adolescents ont été tués pour 1 498 en
2017, dont 1 152 garçons et 345 filles.
L’incroyable business de l’immigration clandestine
Évoqués régulièrement dans les débats médiatiques politiques opposant « populistes » et « immigrationnistes »,
les flux d’immigrés clandestins qui arrivent en masse sur la petite île italienne de Lampedusa, notamment grâce aux
mafias des passeurs nigérians, libyens et aux ONG humanitaires qui les secourent en mer et les acheminent vers les
côtes siciliennes, sont devenus un enjeu d’antagonisme politique et de sécurité nationale. Ces flux convergent
d’ailleurs avec ceux, connexes, des réseaux de trafics de drogue, de prostitution, d’armes, et de terrorisme. Le trafic
de migrants clandestins s’est fortement industrialisé depuis une dizaine d’années, avec les circuits déjà éprouvés des
autres trafics d’êtres humains, car il est extrêmement rentable. On estime que le trafic de migrants a généré, rien que
49
pour l’année 2019, des gains compris entre 5,5 et 7 milliards de dollars . Rappelons tout d’abord que si, au départ,
le migrant clandestin (qui fuit plus souvent la pauvreté que les guerres) est consentant pour être introduit
clandestinement dans un pays en payant les passeurs, le parcours migratoire se termine souvent de manière tragique,
après de nombreux abus, violences, exploitations et chantages, ou pour alimenter des mafias et le travail au noir. Les
migrants clandestins doivent payer plusieurs milliers d’euros pour, dans certains cas, être abandonnés en pleine mer,
d’où la poursuite du parcours avec les bateaux que les ONG affrètent. C’est ainsi que, chaque jour, en Sicile, à
Lampedusa, dans les îles grecques, dans les Balkans, ou encore à Ceuta et Melilla, ou sur les côtes andalouses,
débarquent des milliers de clandestins appelés « récupérés », quotidiennement secourus grâce aux efforts assidus des
navires de sauvetage (souvent illégaux) exploités par des riches ONG idéologiquement fortement engagées et
hostiles par principe aux frontières (Moas, Jugend Rettet, Stichting Bootvluchteling, Médecins sans frontières, Save
the Children, Proactiva Open Arms, Sea-Watch, Sea-Eye, bateau Life). Derrière ces « récupérateurs » qui « prêtent »
leurs bateaux (extrêmement bien équipés et coûteux), on retrouve notamment la fondation Open Society du
milliardaire George Soros, chantre de la mondialisation heureuse et de l’abolition des frontières. Rappelons qu’une
simple embarcation de 200 migrants, qui coûte en revanche très peu en essence, peut rapporter aux passeurs
1 million d’euros, avec très peu de risques financiers, puisque les migrants sont livrés à eux-mêmes par les passeurs
qui restent postés sur la côte libyenne. Grâce aux ONG qui viennent les secourir, les passeurs ont considérablement
diminué leurs coûts sans baisser leurs prix « facturés » aux clandestins qu’ils font exprès de placer dans des
embarcations dangereuses… Au total, le coût total réel du voyage pour le clandestin atteint 7 000 euros. Souvent, les
migrants doivent par la suite se prostituer pour payer leurs dettes, comme certaines femmes asiatiques dépourvues de
titres de séjour ou ces Africaines qui paient le coût de leur passage illégal des milliers d’euros (voir supra « Mafia
nigériane »).
Les gains (pharaoniques, pour les trafiquants) engrangés par l’immigration illégale sont en augmentation
constante. Ils se chiffrent, en France comme en Italie, en milliards d’euros. D’après une étude d’Interpol, la traite des
êtres humains entre l’Afrique et l’Europe rapporterait 6 milliards d’euros annuels, soit le chiffre d’affaires trimestriel
d’une multinationale comme Starbucks… Les cartels de passeurs s’enrichissent non seulement en affrétant des
embarcations rudimentaires, mais aussi en fournissant de faux documents, en conduisant les migrants illégaux de
l’Afrique noire vers la Libye. Outre la traversée en mer, qui coûte 2 000 à 3 500 euros en moyenne par personne, les
migrants déboursent autant pour les parcours dans les déserts et « services annexes » (nourriture, gilet de sauvetage,
réserves de billets pour acheter des puces téléphoniques et survivre une fois arrivés en Europe, infos sur les numéros
utiles, jobs au marché noir possibles, etc.). Pour prendre la mesure de l’incroyable source de lucrativité que
constituent les trafics de migrants clandestins, il suffit de rappeler l’exemple, parmi d’autres, en Libye, du
« gouverneur militaire » de Tripoli, l’ex-chef du Groupe islamique combattant libyen (al-Qaida), Abdelhakim
Belhaj, protégé de la Turquie d’Erdoğan, qui, devenu respectable depuis la révolution libyenne de 2011, aurait
50
acquis grâce au trafic de migrants une fortune évaluée à 2 milliards de dollars …
Les passeurs de clandestins, à la pointe du marketing digital et de la
mondialisation…
Comme la prostitution, qui ne s’exerce pas que dans la rue et les salons, mais de plus en plus sur Internet, les
« parcours migratoires » illégaux sont vendus sur le Web. En quelques clics, ces étranges « touropérateurs »/trafiquants d’êtres humains donnent des prix, des conseils et proposent des « packages » en ligne et
même de falsifier les passeports et cartes d’identité. D’après une étude de l’université de Trente consacrée à la
capacité des trafiquants à utiliser le Web, de nombreux groupes Facebook et Instagram annoncent des voyages
51
illégaux en arabe et donnent des modes d’emploi . Des chercheurs arabophones qui se sont fait passer pour des
migrants ont découvert une véritable boîte de Pandore : tout comme dans une boutique online, les trafiquants
proposent des « remises » pour femmes et personnes âgées, des « forfaits famille », un « service complet »
comprenant transferts navals et aériens et faux documents, et même un service après-vente… Ils offrent des
informations sur les points de départ, les titres de séjour, les aides aux migrants et autres « téléphones utiles ». De
nombreux profils identifiés sont faciles à trouver en cliquant sur les moteurs de recherche en arabe : « voyage pour
l’Europe », « aller vers l’Italie » ou « espace Schengen ». Les applications comme Viber, Skype, WhatsApp ou
Telegram sont utilisées pour échanger avec des « agents de voyages » férus de cryptographies. Ces conseils
« vendus » par les trafiquants sont souvent fournis par les ONG promigrants précitées qui publient les astuces pour
se rendre illégalement en Europe et y contourner les lois. L’expansion d’Internet dans les pays africains est une
aubaine pour les mafias de passeurs de migrants qui connaissent parfaitement les lois des pays d’accueil et
expliquent comment déjouer les contrôles. Un groupe lance par exemple ce message : « Pour tous les Syriens, une
annonce du Soudan indique qu’aucun visa n’est nécessaire. Quiconque souhaite des informations peut me contacter
via Viber. » La Libye n’est pas le seul lieu de passage vers l’Europe : les voyages en provenance de Turquie sont
aussi en pleine expansion : « Pour les frères qui veulent voyager d’Istanbul sur des navires de 80 m, explique une
autre annonce Facebook, le départ est lundi… » Si un voyage depuis la Libye peut coûter 2 000 à 4 000 euros, ces
« agences » vendent 2 500 euros de plus une traversée d’Istanbul à Athènes sur des yachts touristiques que les
polices ne contrôlent pas. Un itinéraire de la Turquie vers la Grèce plus précaire, avec une marche de deux heures,
coûte 1 700 euros. Les voyages rapides et confortables en avion sont vendus 3 500 euros d’Athènes à l’Allemagne
avec faux documents. Pour les navires commerciaux de la Turquie vers l’Italie, le prix varie entre 4 000 et
5 500 euros. Des « publicités » incitent aussi des femmes à se prostituer en ligne ou sur le Web pour financer les
voyages. Pour les forces de l’ordre, ces activités cryptées, en arabe ou sur le Darknet, sont extrêmement difficiles à
déceler et empêcher.
Les problèmes liés aux trafics de migrants sont multiples : la vie et la situation des migrants, vrais ou faux
demandeurs d’asile, leur misère, les risques de décès en mer ou d’exploitation, le danger de voir se faufiler parmi
eux des délinquants, trafiquants ou terroristes, et le coût, pour les États du sud de l’Europe, de la lutte contre les
migrations illégales puis du traitement des personnes que les gouvernements sont sommés d’accueillir, nourrir et
52
loger une fois arrivés dans les ports des pays « sûrs ». D’après le projet de plan budgétaire du ministère de
l’Économie et des Finances italien, la dépense totale pour la gestion des migrants a été de 2,6 milliards pour 2015,
53
3,3 milliards pour 2016, 3,8 milliards pour 2017, et plus de 4,6 milliards en 2018 (voir supra).
Une majorité de migrants illégaux vient d’Afrique subsaharienne et du Maghreb, il s’agit en fait plus de
réfugiés économiques que des demandeurs d’asile fuyant des guerres. Certes, beaucoup de migrants fuient
notamment la Syrie en guerre ou l’Afghanistan, notamment via la Turquie. Celle-ci a d’ailleurs accueilli sur son
territoire 3,6 millions de Syriens. En février 2019, dans un contexte de tensions franco-turques et turco-européennes
en Méditerranée orientale, le Président turc, Recep Tayyip Erdoğan, déclarait ainsi, fort de cette carte migratoire :
« Ô Union européenne […] si vous essayez de présenter notre opération comme une invasion, nous ouvrirons les
54
portes et vous enverrons 3,6 millions de migrants . » Rappelons qu’en mars 2016, la chancelière allemande Angela
Merkel avait négocié au nom de l’UE un accord avec la Turquie visant à dissuader les migrants de traverser la mer
Égée, par lequel Erdoğan acceptait de multiplier les patrouilles en mer et d’accueillir les demandeurs d’asile arrivés
en Grèce. En échange, pour chaque migrant syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, l’Union
s’engageait à réinstaller en Europe un Syrien vivant dans un camp de réfugiés turc, et Bruxelles verserait une aide de
6 milliards d’euros à destination des 2,7 millions de Syriens réfugiés en Turquie. Elle promettait par ailleurs de
rouvrir les négociations sur l’adhésion de la Turquie à l’UE et de faciliter la circulation en Europe des ressortissants
turcs sans visa. Or l’accord a été remis en question plusieurs fois par Ankara qui menace à nouveau de laisser passer
massivement les migrants vers les côtes grecques si l’Union européenne n’accélère pas la libéralisation des visas, et
si les milliards promis ou restant « dus » ne sont pas versés. De son côté, le Parlement européen s’y refuse tant que
la Turquie n’assouplit pas sa loi antiterroriste, qui elle-même bloque le dossier de la libéralisation des visas vers
l’Union.
« Si nous ne prévoyons pas la mesure de l’arrestation immédiate de tout immigré illégal qui arrive
candestinement en Italie, nous n’arrêterons jamais le phénomène », a déclaré en décembre 2018 le général Vincenzo
Santo, ancien chef d’état-major de l’Otan en Afghanistan. Cette mesure choc de l’officier italien est jugée
inacceptable par les lobbys promigrants, et elle est présentée comme contraire aux « traités internationaux » ou
autres conventions sur les droits de la mer, ce qui est un fait discutable, car en réalité, un État a le droit de
contrôler/réduire l’immigration et de sortir de n’importe quel accord international, si celui-ci est détourné pour nuire
à la souveraineté inaliénable de l’État qui l’a cofondé. Et les textes onusiens obligeant soi-disant à accueillir et
financer tous les migrants clandestins ne sont pas contraignants (voir « Pacte de Marrakech »). Rappelons tout de
même que dans des pays démocratiques comme l’Australie ou les États-Unis, l’entrée illégale sur le territoire
national est une infraction pénale passible de prison. En Australie, depuis 2013, tout bateau transportant des
clandestins est systématiquement réexpédié vers des îles extraterritoriales d’Asie dans le cadre de détentions sans
limite de temps pendant la vérification de l’éligibilité au statut de réfugié. Seuls les migrants entrant de façon légale
dans des points d’accueil situés hors du pays sont accueillis et bénéficient éventuellement d’aides. « Jusqu’ici,
conclut le général Santo, nous n’avons jamais mené d’actions coordonnées garantissant le refoulement des migrants
n’ayant pas le statut de réfugié politique ou fuyant la guerre […] avec une volonté politique, on pourrait mettre fin
en quelque mois à l’immigration clandestine et aux arrivées de clandestins en Italie… » Les politiques le savent
parfaitement. Mais ils ont peur de déplaire aux lobbys No Borders et à leurs relais médiatiques.
Trafic d’organes
D’après un rapport du Global Financial Integrity, le marché des organes figurerait parmi les dix premières
activités économiques illégales qui rapportent le plus au monde, les bénéfices allant de 600 millions à 1,2 milliard de
dollars annuels. Couplée aux prouesses médicales et au développement des nouvelles technologies, la
mondialisation marchande a littéralement fait exploser ce marché qui a suscité les convoitises de grands groupes
criminels organisés – comme les clans albanais précités – mais aussi de réseaux de corruption au sein d’États peu
soucieux de défense des droits de l’homme, comme la Chine, Chypre du Nord, Cuba, etc. Ces dernières décennies,
la Chine a ainsi attiré toujours plus de demandeurs fortunés qui, moyennant des dizaines ou des centaines de milliers
de dollars, ont pu se payer des greffes rapides. Le gouvernement chinois a longtemps fermé les yeux sur les
prélèvements forcés d’organes de prisonniers dans les hôpitaux militaires. Les « marchandises » organiques peuvent
par ailleurs être commandées sur Internet, autre effet de la mondialisation. Ce marché a d’autant plus d’avenir qu’il
est le fruit d’une forte demande des élites mondialisées d’Occident ou des pays du Golfe, de riches malades en
attente de transplantation, se payant les services de mafias capables de faire prélever des organes directement sur des
55
êtres vivants, comme cela se pratique hélas en Europe de l’Est, au Brésil, ou en Chine . Cette marchandisation des
organes d’êtres vivants est extrêmement lucrative et alimente à son tour le tourisme de transplantation.
56
En 2008, un réseau mafieux impliqué dans ce trafic juteux et inhumain a été démantelé au Kosovo
: cinq
57
médecins kosovars ayant été condamnés pour trafic d’organes à Pristina par le tribunal de l’Eulex . D’une manière
générale, les migrants – tant des pays de l’Est que du Sud et d’Orient – sont particulièrement victimes du trafic
d’organes et d’êtres humains, comme on le voit en Roumanie, en Bulgarie, dans les Balkans, en Ukraine, mais aussi
en Libye, en particulier là où sévit la milice de Sabratha. Le phénomène est également en plein essor en Asie du
Sud-Est (Thaïlande, Birmanie, Népal, Indonésie). En Irak, Daesh a également été fortement impliqué dans ce trafic
lucratif : ainsi que l’a déploré Mohamed Alhakim, l’ambassadeur d’Irak auprès des Nations unies, nombre de
cadavres découverts dans des charniers de l’EI en Syrie et en Irak présentaient des traces de mutilations avec des
organes vitaux manquants… Le diplomate a ainsi révélé l’existence d’une fatwa d’un cheikh de l’État islamique
déclarant halal (« licite ») le prélèvement d’organes des « infidèles ».
Trafic d’espèces sauvages et braconnage
Selon Interpol, le trafic d’espèces sauvages et le braconnage, en pleine croissance, brasserait 20 milliards de
58
dollars par an, si l’on ne compte que les espèces animales. En incluant les produits forestiers, ce nombre s’élève à
plus de 100 milliards… D’après un rapport d’Interpol consacré à la criminalité forestière, la contrebande illégale de
bois représenterait 15 à 30 % de la production mondiale, ce qui engendrerait des revenus compris entre 51 et
152 milliards de « chiffre d’affaires » par an. Globalement, on estime que la criminalité environnementale en général
représenterait entre 70 et 213 milliards de dollars par an. Celle-ci concerne l’exploitation forestière et minière
illégales, le braconnage et les trafics d’animaux sauvages, la pêche et, ou encore le déversement de déchets toxiques,
qui représentent une menace croissante pour l’environnement.
Pour le braconnage, les exemples les plus connus sont l’ivoire de l’éléphant en Afrique ou en Asie du Sud, ou la
corne de rhinocéros, qui fait l’objet d’une protection attentive. Ce trafic est très prisé par les organisations
criminelles car il procure des profits élevés et un risque réduit. La lutte contre le trafic d’espèces sauvages n’a jamais
été une priorité, les États privilégiant celle contre le trafic de drogue ou d’armes. La corne de rhinocéros est
recherchée par des pays comme le Viêtnam pour être réduite en poudre et utilisée ensuite comme produit
pharmaceutique. Il faut rappeler qu’elle se vend plus cher que la cocaïne ou l’or : entre 40 000 et 50 000 euros le
kilogramme, voire parfois jusqu’à 70 000. Pour de tels revenus, les braconniers sont prêts à tout pour abattre ces
animaux et pas seulement en Afrique mais aussi en France. On se souvient notamment du rhinocéros du zoo de
Thoiry qui avait été abattu par balle le 7 mars 2017 avant que les ravisseurs ne récupèrent la corne à coups de
tronçonneuse. Quant à l’ivoire, selon Interpol, il représenterait pour l’Asie un marché de 165 à 188 millions de
dollars. En Afrique, certaines milices abattent les animaux afin de financer leurs achats d’armes et la corruption. Les
bêtes peuvent également être vendues vivantes pour des zoos ou comme animaux de compagnie. Les prix de vente
des grands singes varient : un braconnier peut échanger un chimpanzé contre 50 à 100 dollars, alors que
l’intermédiaire peut le revendre avec une marge allant jusqu’à 400 %. Le prix de l’orang-outan peut atteindre
59
1 000 dollars , et les tigres entre 4 000 et 6 000 dollars, voire parfois 20 000.
Un autre trafic, également très lucratif, doit beaucoup à la mondialisation : celui de matières premières, comme
le bois, l’or, les diamants ou le pétrole. Ce type de trafic est particulièrement développé en Afrique, dans le contexte
des économies de guerres liées à des conflits intertribaux opposant des milices qui financent leurs activités par les
pillages et trafics de matières premières. Au Liberia, par exemple, pendant la guerre civile, l’ancien président
Charles Taylor a utilisé le bois comme principale source de financement. Selon les estimations, l’industrie forestière
aurait rapporté de 80 à 100 millions de dollars par an pendant la majeure partie de cette période. Ces fonds ont
contribué à élargir l’ampleur du conflit et à le prolonger, entraînant la mort de plus de 250 000 personnes et la
destruction économique du pays. On peut également citer les exemples de la République démocratique du Congo, de
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA, originaire d’Ouganda), mais aussi des milices Janjawid au Soudan et des
Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), directement impliquées dans le trafic d’ivoire, de bois, de
charbon de bois, d’or et de minerais. En ce qui concerne le vol de pétrole, il est très prisé, notamment au Nigeria. La
Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) a ainsi révélé en 2017 que le pays perdait 40 millions de dollars
par jour en raison du vol de pétrole. Les organisations terroristes, notamment Daesh, Boko Haram, al-Qaida, Aqmi,
60
shebabs, etc., sont également souvent impliquées dans ce type de criminalité environnementale .
Contrefaçon et mondialisation marchande
Les filières criminelles mondialisées se professionnalisent dans tous les domaines, et celui de la contrefaçon,
que la globalisation, les migrations et le tourisme ont boostée, est particulièrement prisé. Les industriels évaluent le
chiffre d’affaires annuel mondial de cette activité entre 500 (OCDE) et 1 000 milliards de dollars, soit 3 % du
commerce mondial. Les principaux produits contrefaits sont les équipements électroniques (121 milliards de
dollars), suivis de la bijouterie (41 milliards), des dispositifs médicaux (29 milliards). Les industries
pharmaceutiques chiffrent à 60 milliards les pertes rien que pour les laboratoires européens quand le secteur textile
déplore une « évaporation » de 28 milliards. La situation est très préoccupante non seulement d’un point de vue
économique mais aussi sécuritaire et sanitaire. Ainsi, « en 2012, dans plus de la moitié des 23 réacteurs nucléaires
61
sud-coréens des composants contrefaits avaient été acquis à partir de certificats de conformité falsifiés ». De plus,
20 % du marché pharmaceutique serait aujourd’hui composé de faux médicaments. Ils rapporteraient aux
organisations criminelles jusqu’à 500 fois leur mise initiale, un trafic plus rentable que la drogue ! Selon l’IRACM
(Institut de recherche anticontrefaçon de médicaments), pour 1 000 dollars investis, le gain serait de 200 000 à
62
450 000 dollars (contre 20 000 pour la drogue ). Ce genre de trafic est d’autant plus inquiétant dans le contexte de
pandémie qui sévit depuis novembre 2019 et qui conduit à une explosion de la demande de vaccins. Il est donc
inévitable, vu l’enjeu financier considérable, que de faux médicaments anti-Covid, de faux vaccins et même de faux
tests négatifs sont apparus, principalement dans les pays en développement.
Trafics d’armes
63
Selon le Small Arms Survey , un milliard d’armes légères circulent dans le monde aujourd’hui, mais seules
16 % d’entre elles sont détenues par les forces de l’ordre et l’armée. Sachant que la valeur des transferts légaux
d’armes légères est estimée à 5,7 milliards de dollars par an, celle des armes illicites serait comprise entre 57 et
456 millions de dollars. On estime par ailleurs qu’au moins 75 millions de fusils d’assaut de type kalachnikov ont
été produits depuis sa création. Le trafic d’armes sert en fait un double objectif : tout d’abord, une fin purement
économique, et ensuite répondre à la demande d’armes indispensables au trafic de drogue et au contrôle des
territoires par des organisations criminelles. En Afrique subsaharienne et de l’Ouest également, le trafic d’armes se
développe fortement, rendant ces régions particulièrement vulnérables. Entre novembre 2018 et mars 2019, on a
enregistré 150 000 morts violentes dont 40 000 au moyen d’une arme à feu. Au Brésil, les guerres des gangs et
assassinats par balles coûtent chaque année la vie à près de 60 000 personnes. Les armes issues du trafic illégal
proviennent souvent des stocks nationaux détournés à la suite de vols ou de corruption. On trouve aussi celles
fabriquées artisanalement qui n’ont donc jamais été enregistrées et autorisées, ainsi que celles provenant des guerres
(notamment des Balkans) qui alimentent aujourd’hui le marché européen, et celui des banlieues françaises en
particulier.
L’arrivée sur le marché des armes 3D… La 5G sera un casse-tête
sécuritaire
Autre face noire de la mondialisation et des NTIC, les armes 3D sont maintenant parfaitement accessibles et
utilisables par les acteurs criminels et terroristes. Tout a commencé en 2012, lorsque Cody Wilson, patron de la
firme Defense Distributed, qui proposait des armes grâce à la plate-forme en ligne Defcad, révéla son projet de
conception d’armes à feu afin que « chacun puisse avoir une arme à la maison »… Wilson qualifiait son action de
64
« Netflix des armes » et la concevait comme une sorte de lutte contre la censure gouvernementale. Le premier
fichier pour obtenir les modèles d’armes a été disponible en 2013 et le succès a été immédiat : le fichier a été
téléchargé plus de 100 000 fois en seulement deux jours avant que le gouvernement américain ne le fasse supprimer.
Les armes à feu imprimées en 3D – ou « pistolet fantôme » – ne possèdent pas de numéro de série commercial ni de
marque, et elles sont donc totalement anonymes, ce qui est un véritable casse-tête pour les polices. Le pistolet 3D le
plus connu est le Liberator. L’imprimante 3D peut également permettre de fabriquer des armes en métal (même si
elles doivent être assemblées à la main avec un coût bien plus élevé).
Aujourd’hui, le risque réside surtout dans l’apparition de réseaux de partage de modèles d’armes basés sur la
blockchain pour échanger en toute discrétion. Ainsi, plus de 100 personnes aux États-Unis seraient déjà capables de
développer des technologies d’impression 3D d’armes à feu. Et des milliers participeraient dans le monde au réseau
de diffusion. Ainsi, « fabriquer un fusil à pompe est 100 fois plus simple, 100 fois plus rapide et près de 100 fois
moins cher que d’imprimer un pistolet. Pour 8 dollars, on peut faire un tour à Home Dépot et fabriquer un fusil à
65
pompe ». En France, récemment, des journalistes ont testé s’il était possible de se procurer ce genre d’armes, et ils
ont bien réussi à télécharger le modèle gratuitement sur Internet, à imprimer les composants de l’arme chez un
fabricant, à la monter, puis à tirer avec, et tout cela pour 200 euros seulement. La situation actuelle ne permet certes
pas si facilement de produire des armes de qualité chez soi, car il faut déjà trouver une imprimante 3D, et ces
arseneaux peuvent exploser dans les mains du tireur apprenti armurier. Mais grâce aux progrès de la technologie, à
la qualité des matériaux pouvant être utilisés, mais aussi à la vitesse de production et à la simplicité de la conception,
ces armes vont constituer un danger croissant dès que la technologie permettra à des organisations terroristes ou
criminelles de les fabriquer à grande échelle.
Cybercriminalité et Darknet
D’après Éric Denécé, directeur et fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement, ancien
analyste au secrétariat général de la Défense nationale, « parmi les six menaces majeures auxquelles les pays
occidentaux sont confrontés » arrivent, juste derrière le terrorisme et la subversion islamiste, « les cybermenaces
(cybercriminalité, cyberespionnage, hacktivisme) et l’espionnage politique et technologique, en plein
66
développement, et qui proviennent à la fois d’acteurs étatiques et non étatiques ». Dans un monde toujours plus
connecté et dépendant des réseaux informatiques, en effet, de plus en plus d’États sont confrontés à la
67
cybercriminalité, qui coûte aux consommateurs des milliards de dollars par an. Un rapport de l’entreprise McAfee
(éditeur de logiciels et d’antivirus) a estimé le coût de la cybercriminalité en 2020 à 1 000 milliards de dollars (soit
68
50 % de plus qu’en 2018 ), dont 145 milliards dépensés pour la lutte contre les attaques. « Devenue la première
fraude auprès des entreprises, la cybercriminalité ne cesse de repousser les limites de l’innovation technologique.
Fruit de criminels ou d’États, les cyberattaques ont littéralement explosé en France. La valeur économique pillée en
69
2016 est estimée à plus de 600 milliards de dollars dans le monde », écrit Éric Vernier. La cybercriminalité
menace les réseaux informatiques sensibles des entreprises et des gouvernements, les systèmes financiers, les
banques, les marchés boursiers. Par sa maîtrise croissante, les organisations terroristes et criminelles rendent de plus
en plus vulnérable le système financier international, visant les services de valeur et de cartes, et, plus récemment, la
monnaie électronique et de crédit dont dépend l’économie mondiale. Selon les services secrets américains, les
crimes financiers facilités par des forums criminels en ligne anonymes entraîneraient des milliards de dollars de
pertes pour l’infrastructure financière. Les ordinateurs et Internet jouent aujourd’hui un rôle dans la plupart des
crimes transnationaux, soit en tant que cibles, soit en tant qu’armes utilisées dans le crime. Les enquêtes pour
démanteler les réseaux de cybercriminalité et hackers nécessitent souvent un personnel hautement qualifié car les
problèmes sont d’une extrême complexité. Éric Vernier rappelle ainsi qu’« une attaque massive, le 21 octobre 2016,
a mis hors service les plus gros sites au monde : Twitter, Netflix, Airbnb, Spotify, Sony, Amazon… En 2015, des
hackers russes ont détourné un milliard de dollars en passant par une centaine de banques par petits virements
continus pendant plusieurs mois ». Ainsi, des réseaux sociaux apparemment anodins, comme WhatsApp et
Snapchat, permettent la vente de drogues – douces ou dures. Éphémères ou chiffrées, ces applications facilitent le
trafic et compliquent le travail des enquêteurs pour démanteler ces réseaux. Le Darknet, dit « réseau noir » ou
« superposé », est une collection de pages non indexées, c’est-à-dire introuvables par les moteurs de recherche
classiques, et donc inaccessibles avec un navigateur web normal. On y accède via des logiciels particuliers, comme
Tor. Utilisé par des journalistes ou des opposants politiques, le Darknet n’est pas interdit en soi. C’est le
détournement de son usage à des fins criminelles qui est répréhensible. Sur le Darknet, on peut trouver en vente des
comptes PayPal, des cartes de crédit, des comptes en banques, toute sorte d’armes en pièces détachées, de la drogue,
des réseaux de trafics d’esclaves, de prostitution infantile, de pédopornographie, ou même des réseaux de trafics
d’organes ou de plasmas de bébés… Par exemple, mi-2017, les services de détection et de répression ont démantelé
AlphaBay, l’un des plus gros marchés mondiaux de la drogue opérant sur le Darknet. Ils ont également infiltré un
autre marché important, la plate-forme Hansa, et l’ont laissé poursuivre ses activités afin de recueillir des données
avant de procéder à sa fermeture. Plus récemment, en avril 2019, de vastes opérations d’infiltration ont permis de
démanteler Wall Street Market, alors le deuxième plus grand marché du Darknet au monde après Dream Market.
Quant aux hackers ou pirates privés ou liés à des services de renseignements étrangers, notamment chinois,
vénézuéliens, nord-coréens, iraniens et russes, ils utilisent les réseaux sociaux pour le scamming (arnaques, fraudes
en tout genre), le phishing (le vol de données personnelles allant jusqu’à l’usurpation d’identité), et surtout le spear
phishing (visant une personne en particulier, sur les réseaux sociaux). Cette criminalité peut naître dans n’importe
quel pays, avec la moindre connexion et très peu de matériel. Les réseaux organisés les plus virulents sont situés en
Afrique de l’Ouest (Nigéria), en Roumanie (dans la région de Constanța), en Russie et en Chine. Le réseau le plus
utilisé est sans surprise Facebook : le contact y est facile, beaucoup d’informations sont disponibles, et il est aisé d’y
créer un faux profil suffisamment fourni pour se fondre dans la foule et se faire passer pour une vraie personne.
Les criminels profitent de la crise sanitaire !
Avec la crise de la pandémie, les risques liés à aux actions et à l’influence du crime organisé ainsi qu’au
blanchiment d’argent ont fortement augmenté, comme l’exprime Éric Vernier : « Au cœur d’une crise, le
phénomène s’amplifie car les urgences inhérentes à la situation entraînent précipitation des acteurs économiques et
70
laxisme des autorités de contrôle . » Les organisations criminelles essaient de profiter des diverses crises afin de
s’insérer toujours plus dans le système. Tracfin rappelle ce risque : « En raison du contexte économique dégradé par
la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, des sociétés présentant des difficultés de trésorerie pourraient être
amenées à ouvrir plus facilement leur capital à des investisseurs étrangers afin de garantir la pérennité de leur
activité. » Les banques voient dans l’argent de ces organisations des mannes énormes, et donc un moyen de tenir
bon. De nombreuses banques ont d’ailleurs probablement déjà été sauvées d’une crise grâce à l’argent de la drogue
(2007-2008, notamment). Les criminels peuvent également se positionner comme des banques qui accordent des
« crédits » à des entreprises ou à des particuliers. Les sociétés au bord de la faillite sont de ce fait plus enclines à
accepter ce genre d’arrangement.
À l’instar des organisations terroristes qui utilisent la pauvreté pour rallier les plus indigents à leur cause, les
organisations criminelles distribuent régulièrement – et a fortiori en période de crise – des produits de première
nécessité, comme cela a été observé au Mexique auprès des narcos ou en Italie avec la Camorra. Elles prêtent parfois
même gratuitement de l’argent pour attirer les plus démunis et sembler être plus proches des populations que l’État.
Dans une chronique du journal italien La Repubblica, Roberto Saviano alerte sur l’activité mafieuse au cœur de cette
épidémie : « La pandémie est le moment idéal pour les mafias : si vous avez faim, vous cherchez du pain, peu
importe de quel four il provient et qui le distribue ; si vous avez besoin d’un médicament, vous payez, vous ne vous
71
demandez pas qui vous le vend . » Ainsi, lors de l’opération d’Interpol baptisée « Pangée », menée du 3 au 10 mars
2020 dans plus de 90 pays, 121 personnes ont été arrêtées avec une saisie de 14 millions de masques, produits
pharmaceutiques et gels hydroalcooliques contrefaits. « Les collectivités elles-mêmes ont parfois été victimes
d’escroqueries avec l’achat de masques de contrefaçon. » « Si le trafic de drogue a plutôt eu tendance à baisser avec
la pandémie, d’autres activités se sont intensifiées et de nouvelles sont apparues » : vente de faux médicaments, de
masques et de solutions hydroalcooliques conformes ou non ; cybercriminalité ; blanchiment via les mesures de
relance économique en faveur des entreprises ; détournement et pénurie par rétention de produits sanitaires et
revente au plus offrant ; contrebande de produits sous quotas ; investissements dans les usines de fabrication.
1. Jean de Maillard et Pierre-Xavier Grézaud, Un monde sans loi, Paris, Stock, 2001.
2. Éric Vernier, Technique de blanchiment et moyens de lutte, Paris, Dunod, 2017.
3. Christine Lagarde, « S’attaquer à la corruption avec clarté », FMI, 18 septembre 2017.
4. « Comment l’Insee va intégrer le trafic de drogue dans le calcul du PIB », Le Monde, 2 février 2018.
5. Hayat Gazzane, « Trois chiffres édifiants démontrent que la corruption gangrène le monde », Le Figaro, 9 décembre 2017.
6. Jean-Victor Semeraro, « Prestations sociales : au moins 2,5 millions de bénéficiaires fantômes », Capital, 8 septembre 2020.
7. Voir Rhoda Weeks-Brown, « Halte au blanchiment », Finance & Développement, FMI, décembre 2018.
8. Office des Nations unies contre les drogues et le crime (UNODC) : organe du Secrétariat des Nations unies spécialisé dans la lutte contre le crime
et le trafic de drogue.
9. UNODC, World Drug Report 2019, 2019.
10. Europol, EU Drug Markets Report 2019. Téléchargeable sur le site d’Europol : www.emcdda.europa.eu.
11. ONUDC, World Drug Report 2019, op. cit.
o
12. Jean Rivelois, « Géopolitique mondiale de la criminalité », Diplomatie, Les grands dossiers n 52, septembre 2019.
13. « À Doha, les négociateurs afghans accusent les talibans de vouloir retarder les pourparlers », L’Orient-Le Jour, 5 janvier 2021.
14. Quatre cent mille personnes vivraient des cultures illicites en Colombie, et un million au Maroc.
15. « Trois tonnes de cocaïne saisies dans un sous-marin au large de l’Espagne », Le Monde, 27 novembre 2019.
16. Anac, La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, rapport, 17 octobre 2019.
17. Alfredo De Girolamo, « Mafia e rifiuti : la DIA indica i 4 problemi chiave », Il Sole 24 Ore, 4 février 2020.
18. Voir « Corruption Perceptions Index », www.transparency.org.
19. Leur professionnalisme dans les braquages a été constaté en avril 2019, lorsque les malfaiteurs ont dérobé un avion à main armée sur le tarmac
de l’aéroport de Tirana, s’emparant de plusieurs millions d’euros.
20. « Plusieurs milliards de dollars de chiffre d’affaires », Le Monde, 17 juin 2002.
21. EU Drug Markets Report 2019, op. cit, Europol.
22. Marija Ristic, « The Troubled Trial of Kosovo’s “Drenica Group” », Balkan Transitional Justice, 27 mai 2015.
23. « L’UCK, un groupe militaire et mafieux », Le Monde, 17 juin 2002.
24. Y compris le carburant pour les véhicules et la construction. Voir « Il rapporto di Dick Marty approvato dal Consiglio d’Europa », SWI
swissinfo.ch, 25 janvier 2011.
25. Europol, EU Drug Markets Report 2019, op. cit.
26. Communiqué de presse d’Europol : « Plus de 60 personnes arrêtées dans une série d’actions policières contre la mafia albanaise », 5 avril 2019.
27. Anne Vidalie, « Criminalité : les Albanais, une mafia multicarte », L’Express, 2 mars 2017.
28. « Une série d’assassinats entre deux clans touche la Suisse et le Kosovo », RTS, 2 mai 2021.
29. Cartel de Sinaloa, du Golfe, de Tijuana, de Juárez et Nouvelle Génération de Jalisco.
30. Bertrand Monnet, « Les montagnes du Sinaloa, royaume des “narcos” mexicains et siège d’une multinationale du trafic », Le Monde,
3 décembre 2020.
31. Jean Rivelois, « Géopolitique mondiale de la criminalité », art. cit.
32. Éric Vernier, Technique de blanchiment et moyens de lutte, op. cit.
33. Carlos Malamud, Historia de América, Alianza Editorial, 2010.
34. Jean Rivelois, « Géopolitique mondiale de la criminalité », art. cit.
35. « Les autorités mexicaines publient la vidéo de la brève arrestation du fils d’El Chapo », Le Monde, 31 octobre 2019.
36. Frédéric Saliba, « Au Mexique, un cartel de la drogue déclare la guerre à l’État », Le Monde, 28 juin 2020.
37. Mark Galeotti, « Crimintern: How the Kremlin Uses Russia’s Criminal Networks in Europe », European Council of Foreign Relation, 18 avril
2017.
38. Alain Rodier, « Réseaux mafieux russes défaits en Espagne après sept ans d’enquête », Raids, 4 janvier 2021.
39. Mark Galeotti, The Vory. Russia’s Super Mafia, Yale University Press, 2018.
40. Voir rapport d’Europol sur la drogue et financement du crime, EU Drug Markets Report 2019, op. cit.
er
41. Joël Chatreau, « Énorme saisie d’amphétamines en Italie : 84 millions de cachets de captagon, la “drogue du Djihad” », Euronews, 1 juillet
2020.
42. Patricia Khoder, « Le trafic de Captagon, un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an », L’Orient-Le Jour, 18 janvier 2016.
43. Jean Rivelois, « Géopolitique mondiale de la criminalité », art. cit.
44. Éric Vernier, Technique de blanchiment et moyens de lutte, op. cit.
45. Jean Rivelois, « Géopolitique mondiale de la criminalité », art. cit.
46. Éric Vernier, Technique de blanchiment et moyens de lutte, op. cit.
47. Voir Yves Bordenave, « Un réseau de trafic de nourrissons d’origine bulgare démantelé en France », Le Monde, 19 octobre 2005.
48. CNDH, Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México, rapport, 2019.
49. Jean Rivelois, « Géopolitique mondiale de la criminalité », art. cit.
50. Houda Ibrahim, « Le Libyen Abdelhakim Belhaj : jihadiste, “terroriste” et milliardaire », RFI Afrique, 10 juin 2017.
51. Étude « Surf and Sound », le rôle d’Internet dans les migrations (laboratoire eCrime du Pr Andrea Di Nicola financé par la Commission
européenne).
52. Ministero dell’economia e delle finanze, Documento Programmatico di Bilancio 2017, www.mef.gov.it.
53. Alfonso Langastro, Mariasole Lisciandro, « Migranti : ecco le cifre dell’accoglienza in Italia », Il Sole 24 Ore, 10 février 2019.
54. « Erdogan menace l’Europe d’un flux de migrants en réponse aux critiques », La Presse, 10 octobre 2019.
55. Pierre Haski, « Sida : les contaminés de la misère en Chine », Libération, 13 juin 2001.
56. « Kosovo : cinq condamnations pour trafic d’organes », Euronews, 29 avril 2013. Dans la clinique Medicus, à Pristina, plaque tournante du
trafic, les donateurs touchaient 15 000 euros par organe et les receveurs déboursaient jusqu’à 100 000 euros.
57. Eulex Kosovo, mission civile de l’UE, vise à promouvoir l’État de droit. Elle s’occupe de justice, de police et de douane.
58. Voir site d’Interpol : www.interpol.int/fr.
59. Interpol, The Environmental Crime Crisis ; voir site d’Interpol : www.interpol.int/fr.
60. Les ressources forestières ont permis de financer les Khmers rouges au Cambodge et ont joué un rôle dans les conflits en Birmanie, en Côte
d’Ivoire et en République démocratique du Congo.
61. Jean Rivelois, « Géopolitique mondiale de la criminalité », art. cit.
62. IRACM, Contrefaçon de médicaments et organisations criminelles, rapport 25 septembre 2020.
63. Voir site internet du Small Arms Survey, www.smallarmssurvey.org.
64. « États-Unis : Un site Internet remet en ligne des plans d’impression 3D d’armes à feu », 20 Minutes, 2 avril 2020.
65. Gauthier Virol, « Ces réseaux décentralisés qui relancent l’impression 3D d’armes à feu », L’Usine nouvelle, 30 mai 2019.
66. Alexandre Del Valle, « Nouvelles menaces, nouveaux risques, nouveaux défis, la France est-elle préparée ? », entretien avec Éric Denécé,
Atlantico, 28 janvier 2020.
67. McAfee, The Hidden Costs of Cybercrime, décembre 2020.
68. Rapport McAfee-Center for Strategic and International Studies, 2020.
69. Éric Vernier, Technique de blanchiment et moyens de lutte, op. cit.
70. Ibid.
71. Roberto Saviano, « La mafia del coronavirus. Dalla droga alla sanità, la pandemia aiuta l’economia criminale », La Repubblica, 23 mars 2020.
CHAPITRE X
Géopolitique écoénergétique, guerres du gaz et guerres de
l’eau…
« Celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. »
Confucius
La mondialisation, à certains égards positive, puisqu’elle a permis, grâce aux échanges et aux délocalisations, à
de nombreuses contrées du monde de connaître un développement industriel et économique, a dévoilé à l’occasion
de la crise sanitaire, comme plus de dix ans plus tôt lors de la crise financière de 2008, sa face « malheureuse » : ce
processus d’intensification des échanges marchands, humains et financiers a en fin de compte été retourné contre
l’Europe et les États-Unis par les anciennes puissances pauvres d’Asie envers lesquelles l’Occident dans son
ensemble est durablement et dangereusement dépendant. La désindustrialisation due à cette mondialisation
dangereuse est telle que les nations d’Europe, qui ont par ailleurs réduit considérablement la part de leurs budgets
nationaux consacrés à la R&D, risquent de connaître à terme le « syndrome argentin », c’est-à-dire un processus
d’involution et de déclassement. Par ailleurs, la forte dépendance énergétique des pays de l’UE rend la zone plus
sensible aux aléas géopolitiques. Les approvisionnements énergétiques restent en effet très liés aux relations
o
internationales (exemple du conflit russo-ukrainien, voir carte n 14). Au-delà de l’« anecdote », l’Europe, pour qui
le gaz naturel représente le quart de sa consommation brute d’énergie, se retrouve souvent otage des relations
complexes entre l’Amérique et la Russie, Washington ne voulant surtout pas que cette dernière renforce son statut
de fournisseur principal de l’UE en gaz.
La menace du réchauffement climatique et de ses conséquences
L’ouverture du commerce mondial intensifiant les échanges et donc les activités de transport, elle incite à
consommer toujours plus des produits venant des quatre coins du monde. La mondialisation marchande est de ce fait
une des causes objectives du réchauffement climatique avec la démographie incontrôlée et l’industrialisation des
pays en développement. L’urgence est donc de permettre les relocalisations et la consommation locale, afin de
réduire les temps et les coûts de transport, donc de favoriser les circuits courts, voie privilégiée pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et les impacts dus aux transports transcontinentaux, notamment.
On assiste depuis quelques années à une prise de conscience brutale et planétaire du problème de l’effet de
serre, et plus généralement des enjeux liés au réchauffement climatique – devenu depuis changement, urgence ou
encore choc climatique. En 2005, le film du sénateur démocrate américain, ex-candidat à la présidence, Al Gore,
Une vérité qui dérange, a vulgarisé les travaux de Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
1
climat ), créé en 1988 et dépendant de l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations unies
pour l’environnement. Bien qu’ayant été jugé excessif et unilatéral par la justice britannique, le documentaire
présente la question du réchauffement global de la Terre et les conséquences du changement climatique qui en
découlent, si la quantité d’émissions de CO2 en forte augmentation depuis le début de l’ère industrielle n’est pas
significativement freinée. Le monde découvre alors le rôle de l’excès des gaz à effet de serre dans le réchauffement
2
climatique. Le plus abondant des GES est la vapeur d’eau qui remplit notre atmosphère, mais le plus connu est le
dioxyde de carbone ou CO2. Ils représentent à eux deux 77 % des émissions d’origine humaine et jouent un rôle
fondamental dans la régulation de la température moyenne sur notre planète. Sans eux, la température moyenne de la
terre serait de –18 °C au lieu de +14 °C, et les propres conditions rendant possible la vie sur Terre seraient remises
e
en question… Or depuis le XIX siècle, avec la révolution industrielle et la mondialisation, le recours massif aux
énergies fossiles – pour le transport (marchandises, tourisme), l’industrie, l’éclairage, l’habitat – a considérablement
accru le volume des GES présents dans l’atmosphère, rompant cet équilibrage naturel. En 2020, ce niveau de
concentration a atteint des quantités records. Ce changement, consubstantiel d’une mondialisation, est tenu pour
responsable de la hausse des températures, qui ont augmenté de 0,74 °C entre 1906 et 2010, selon les experts du
Giec. Ce n’est peut-être qu’un début, car les températures pourraient augmenter de 2 à 6 °C avant la fin du
e
siècle, si aucune mesure n’est prise, menaçant ainsi d’extinction la biodiversité et la vie sur la Terre. Le sujet
semble aujourd’hui médiatiquement et politiquement clair et prouvé… Le débat scientifique ne fait pourtant pas
complètement consensus et trouve ses opposants.
XXI
Les climatosceptiques en question
Les « climatosceptiques » remettent en cause les fondements scientifiques non pas tant du réchauffement
climatique, qui est une évidence en tant que tel, mais plutôt la causalité entre émissions de CO2, changement
climatique et responsabilité humaine dans ce phénomène. Ils jugent qu’il y a un manque de preuves scientifiques
établissant les liens de cause à effet, et arguent notamment du fait que la planète a toujours connu des phases de
réchauffement et des accélérations, comme celles constatées ces dernières années. L’administration Bush – proche
de l’industrie pétrolière –, qui gagna les élections face au démocrate Al Gore, n’hésita pas à mobiliser ainsi Fred
Singer, un physicien reconnu qui parcourait les plateaux de télévision en expliquant qu’« aucune preuve ne permet
d’attribuer le réchauffement climatique à des causes humaines, et même que le monde pourrait bénéficier de
quelques degrés de plus ». C’est aussi le cas du scientifique incontesté de l’atmosphère, Richard Lindzen, professeur
au MIT, qui ne nie pas le changement climatique mais estime que le rôle du CO2 est minime. Certains scientifiques,
y compris des membres du Giec, notamment Richard Courtney, consultant en science du climat et de l’atmosphère,
affirment donc qu’aucune preuve d’un réchauffement climatique causé par l’homme n’aurait été apportée. D’autres
font entendre leurs voix au travers d’organisations telles que le NIPCC (Nongovernmental International Panel on
Climate Change) qui, par opposition au IPCC – Giec –, défend la thèse d’un réchauffement non anthropique. En
2015, CO2 Coalition a soutenu le retrait des États-Unis de l’accord de Paris (voir plus loin), et, en septembre 2019,
Clintel, une alliance de 500 scientifiques et professionnels en science climatique, a adressé une lettre aux Nations
unies (« Déclaration européenne sur le climat ») débutant par ces mots : « Il n’y a pas d’urgence climatique. » Parmi
3
ces derniers figurent plusieurs Prix Nobel et scientifiques célèbres tels que Freeman Dyson .
Les éléments de préoccupation s’accumulent
Même si les travaux de recherche continuent, pour analyser plus finement la corrélation entre les activités
humaines et le changement climatique, une grande majorité de scientifiques affirment tout de même être à 90 %
certains de cette responsabilité et soutiennent qu’il faut largement promouvoir la lutte contre le changement
climatique. Les analyses de long terme réalisées par les experts du Giec montrent qu’entre 1880 – date du début de
l’ère industrielle et donc de la mondialisation moderne – et 2012, la température moyenne globale a augmenté de
1 °C (+0,85 °C). Ce lissage ne reflète pas vraiment l’aggravation du phénomène, car la période 1981-2010 a été la
plus chaude depuis mille quatre cents ans. Il ne se passe d’ailleurs pas une semaine sans que des épisodes
climatiques extrêmes (inondations, sécheresses, fonte des glaces, incendies, ouragans, records de températures…) ne
viennent illustrer ce changement devenu urgence climatique. La seule année 2020 s’est imposée comme une « annus
horribilis » tant sur le plan climatique que sanitaire (avec la Covid-19), l’une des trois années les plus chaudes
jamais enregistrées avec une température moyenne mondiale, entre janvier et octobre, supérieure d’environ 1,2 °C à
celles relevées sur la période de référence 1850-1900. Selon l’ONU, cet état de fait accroît le risque de voir dépassé
le niveau de 1,5 °C, prévu d’ici à 2024 par l’accord de Paris. Dès fin 2019 démarraient d’ailleurs de terribles feux de
4
brousse en Australie, poursuivis de nombreuses semaines avec un bilan catastrophique et un impact majeur sur la
biodiversité. De la même manière, la Sibérie a déploré plus de 11 millions d’hectares (soit plus de la superficie du
Portugal) également partis en fumée depuis début 2020. Le phénomène est doublement inquiétant car la Sibérie
(notamment l’Est) connaît un réchauffement deux fois supérieur à celui du reste de la planète (5 °C de plus que les
moyennes saisonnières), ce qui favorise la perte rapide de la couverture de glace.
Les États-Unis n’ont pas non plus échappé aux flammes, notamment en Californie. Après plus de cent jours
sans une goutte de pluie se déclarait à la mi-août 2020 un « giga-incendie » (August Complex) qui allait battre le
record des plus grands feux californiens et détruire plus de 1,6 million d’hectares de végétation (soit le double des
records historiques équivalent à la superficie de la région Île-de-France). La saison des typhons et des supertyphons
a franchi un cran en 2020 : après Bavi (Chine, Corée du Nord) et Maysak (Micronésie), le typhon Haishen (Japon,
Corée du Nord), dans le Pacifique nord-ouest, et juste après le passage de Molave aux Philippines, celui de Goni a
littéralement balayé l’archipel, avant l’arrivée d’Atsani. Goni a été le plus intense de l’année 2020 et a été le plus
violent jamais survenu sur terre, avec des rafales de vent à plus de 300 km/h, des précipitations sur les zones côtières
et sur les reliefs atteignant en vingt-quatre heures l’équivalent de deux à trois mois de pluie. Conséquence du
changement climatique, selon le Giec, le nombre d’ouragans a doublé en cent ans pour atteindre 85 par an et il
devrait continuer à s’accroître. Le réchauffement des océans bat des records, et il entraîne des conséquences
sérieuses sur les écosystèmes marins déjà affectés par l’acidification des eaux due au CO2, dont une majeure partie
provenant des navires de marchandises, outil principal de la mondialisation. Les records de chaleur et les
sécheresses se multiplient, l’eau se raréfie, provoquant des situations de stress hydrique par endroits et des
inondations ailleurs, ce qui entraîne une baisse des rendements agricoles. La biodiversité, désormais reconnue
comme un des enjeux majeurs climato-environnementaux, y est menacée, risquant d’ailleurs de provoquer
l’accélération des pandémies. Encore une fois, tout est lié. En effet, des liens de plus en plus évidents apparaissent
entre la biodiversité et la santé. Cette approche semblerait d’ailleurs être le meilleur bouclier contre les zoonoses, ces
maladies qui passent des animaux aux êtres humains, et dont ferait d’ailleurs partie la Covid-19, d’après les
informations disponibles à date. La situation est d’autant plus grave que le changement climatique que l’on vit
actuellement a lieu à un rythme accéléré jamais connu dans l’histoire du monde… même si apparemment, à la fin du
Pliocène, il y a trois millions d’années, on a déjà eu une concentration en CO2 dépassant pour la dernière fois les
400 ppm au niveau actuel. Toutefois, l’accumulation de CO2 s’était réalisée sur plusieurs millions d’années. Dans le
cas actuel, en revanche, les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté de plus de 40 % dans l’atmosphère en à
peine cent cinquante ans. Sans action massive pour décarboner, on pourrait atteindre une concentration équivalente à
e
un taux de 2 000 ppm au milieu du XXIII siècle, voire avant, ce qui entraînerait un réchauffement de la planète de 3
ou 4 °C, avec des conséquences irréversibles dont, selon les glaciologues, une augmentation du niveau des océans
e
entre 50 cm et 1 m d’ici à la fin du XXI siècle.
L’accord de Paris, enjeux de rivalités de leadership entre nations
Dans le cadre de la COP 21 a été signé, après un marathon diplomatique, l’accord de Paris. Cent quatre-vingtseize pays engageaient (sans contraintes) leurs gouvernements à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C
à travers différentes mesures à mettre en œuvre dans les années à venir afin de réorienter leurs économies vers des
modèles bas carbone fondés sur un abandon progressif des énergies fossiles. Ces dernières constituent tout de même
encore 70 % du mix énergétique mondial. Pour ce faire, les pays doivent faire cause commune et développer des
stratégies de développement à faibles émissions à long terme. Dans la pratique, cela suppose de mettre en œuvre des
plans quinquennaux de plus en plus exigeants pour atteindre au plus vite le pic mondial des émissions de GES et,
ensuite, parvenir enfin à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Ces objectifs – appelés « contributions déterminées
nationalement » (Nationally Determined Contributions, NDC) – expliquent les mesures destinées à réduire les
niveaux d’émissions de GES et à améliorer leur résilience à une élévation des températures. Lors de la COP 22, à
Marrakech, un an plus tard, on disposait d’un document ratifié par 103 États qui représentaient 73 % des GES.
L’Australie, fort dépendante du charbon, et figurant parmi les pires émetteurs par habitant de gaz à effet de serre,
avait ratifié l’accord quelques jours plus tôt et confirmait l’objectif de réduire ses émissions de 26 à 28 % de leur
niveau de 2005 à l’horizon 2030. Rappelons que l’entrée en vigueur de cet accord était conditionnée à la ratification
par au moins 55 pays qui totalisent 55 % des émissions mondiales. Ceci était alors déjà le cas, bien que de nombreux
pays ne l’eussent pas encore ratifié : Turquie, Russie, Japon, Espagne en pleine crise électorale… ou ceux, comme
les États-Unis qui, sous la nouvelle ère Trump, menaçaient déjà de traîner des pieds… L’accord de Paris est entré en
vigueur le 4 novembre 2016. Un an plus tard, en novembre 2017 (la Syrie avait également signé et les États-Unis ne
s’étaient pas encore retirés), 195 pays sur les 197 reconnus par l’ONU s’étaient engagés. En fait, les objectifs sont
volontaires et la seule obligation est que, cinq ans plus tard, l’objectif doit être plus grand, mais sans aucune
précision. De plus, les États en développement n’ont aucune obligation sérieuse ou dissuasive…
Transition énergétique et croissance économique :
l’ultrapolarisation du débat aux États-Unis
L’exemple américain illustre le problème de la polarisation idéologique en matière de politique énergétique et
de décisions impliquant le respect de l’environnement, encore trop souvent vu comme l’apanage de la gauche, même
si les positions évoluent. Aux États-Unis, la question est d’autant plus sensible que le pays paie cher son
indépendance énergétique gagnée à grand renfort de pétrole et de gaz de schiste. Ainsi, il semble difficile de trouver
des positions plus tranchées en matière d’ambitions et de politiques climatiques que celles tenues par Donald Trump
et Joe Biden. Obama avait signé l’accord de Paris. Trump en est sorti et Biden, qui avait promis de réintégrer
5
l’accord , l’a fait le premier jour de son investiture. Les propos de campagne de deux candidats sur la question du
changement climatique ont permis de mieux cerner les motivations et analyses respectives. D’après Trump, pour qui
les principaux responsables de la pollution sont la Chine, l’Inde et la Russie, il n’est pas concevable de sacrifier des
industries et des emplois sur l’autel du changement climatique et de transférer de l’argent des contribuables
américains à la Chine à ce titre. Un propos sans surprise de la part d’un Président qui avait pris la décision de sortir
des accords de Paris jugés « horribles, coûteux, unilatéraux », tout en se targuant que son pays avait gagné la
« guerre du beau charbon propre ». On observera en passant que ce sont la Chine et le Japon, et non pas les ÉtatsUnis, qui sont les plus grands vendeurs de centrales électriques au charbon modernes et efficaces. À l’inverse, Joe
Biden, dans la droite ligne de la pensée démocrate, fort de l’appui de Barack Obama et d’Al Gore, particulièrement
engagés en matière de lutte contre le changement climatique, reconnaissait dans le réchauffement climatique le
« danger le plus essentiel pour l’humanité » et voyait comme un « impératif moral de s’y attaquer » dans les plus
brefs délais. Pour Trump, on pouvait souhaiter avoir « l’eau la plus buvable, l’air le plus pur, et le moins d’émissions
de carbone » tout en dénonçant « les éoliennes, très intermittentes, qui tuent les oiseaux, et le solaire trop cher et pas
assez puissant pour faire tourner les belles industries américaines ». Biden, quant à lui, défendait les « emplois bien
payés dans le solaire et l’éolien » (25 à 30 dollars de l’heure selon lui) et accusait Trump d’avoir éliminé toute la
réglementation en matière d’environnement. Il affirmait vouloir équiper le réseau routier américain avec
« 50 000 bornes électriques », pour ne pas perdre le leadership de l’industrie automobile en pleine mutation au profit
6
de la Chine, avec nombre d’autres propositions et objectifs . Enfin, Trump considérait avoir rendu le pays
indépendant des importations pétrolières, évitant ainsi de nombreuses guerres dans le monde souvent liées à la
géopolitique du pétrole.
Toutefois, la position proclimat de Biden reste néanmoins ambiguë – comme celle de Barack Obama – sur la
fracturation hydraulique qui permet la production de pétrole et de gaz de schiste. Rappelons qu’Obama, malgré sa
volonté de verdir l’économie, a largement contribué à développer cette pratique. De même, Biden, qui promet des
investissements massifs vers la transition énergétique, déclare en même temps devoir gérer une « transition
pétrolière » qui doit s’inscrire dans la durée nécessaire pour permettre d’investir massivement dans les énergies
renouvelables. Autre paradoxe, on rappellera que dans la pratique, le retrait de l’accord de Paris voulu par Donald
Trump était prévu pour ne prendre effet, coïncidence des calendriers… qu’au lendemain du scrutin, c’est-à-dire le
4 novembre 2020, et l’ex-Président climatosceptique n’a jamais totalement gelé les discussions techniques qui ont
continué en coulisse : une délégation américaine était notamment présente à Madrid lors de la COP 25, pour
préparer, le cas échéant, un retour éventuel. Joe Biden devra ainsi flécher les aides massives décidées pour défendre
l’économie américaine face à la Covid vers cette nouvelle économie dite « régénérative », en réconciliant
l’économie, l’écologie et l’investissement. Par ailleurs, les positions anticlimatiques de Donald Trump ont,
paradoxalement, contribué à mobiliser les acteurs américains non fédéraux qui se positionnent aux avant-postes de
la lutte contre le réchauffement climatique : les tribunaux ont été interpellés par vingt-deux États et sept grandes
villes qui ont décidé de porter plainte contre la politique environnementale du gouvernement Trump. Ainsi des États,
des villes et donc bien sûr des citoyens, mais aussi des entreprises, pesant pour plus de la moitié de l’économie et de
la population, se sont engagés à tenir les objectifs de l’accord de Paris malgré le manque de soutien politique fédéral.
En ce qui concerne les entreprises, en Californie ou à New York, le poids des multinationales aidant, Tesla,
totalement acquise à la cause du monde postcarbone, devenue un énorme succès boursier, avec près de 400 milliards
de dollars de capitalisation (soit 2 fois plus que Toyota et plus de 10 fois celle de Ford), en est un exemple
emblématique. À l’inverse, la sortie récente d’ExxonMobil, l’empereur du pétrole, de l’indice du Dow Jones (après
plusieurs décennies) est le signe d’un réveil de certains investisseurs sur le risque climatique qui est aussi un risque
financier pour les entreprises des secteurs carbonés et les institutions financières. Le président Biden devra inciter
les régulateurs financiers pour que ce risque soit intégré dans les réglementations et donc pris en compte dans les
stratégies d’investissement des institutions financières.
Vers une « civilisation écologique », le nouveau leitmotiv de Xi
Jinping
Quant à la Chine, rivale économique des États-Unis, première exportatrice mondiale et grosse consommatrice
d’énergie, qui détient désormais le triste record de pays le plus émetteur au monde avec 20 % des émissions
mondiales, elle annonce construire plus de 250 GW de nouvelles centrales au charbon alors que toutes celles de
l’UE s’élèvent à 150 GW. Pékin a paradoxalement apporté son soutien, dès le début, à l’accord de Paris. Il faut dire
qu’après la COP 21, l’occasion était trop belle pour les Chinois de reprendre le flambeau de la lutte contre le
changement climatique abandonné par Donald Trump… Scrutée par la communauté internationale, Pékin avait
décidé de déployer un plan d’action à la hauteur de ses nouvelles ambitions, affichées haut et fort, de rendre la
7
« Chine plus belle » et d’accélérer son projet d’« éco-civilisation » (EC). Ce projet a été réaffirmé le 18 octobre
e
2020 lors du XIX congrès du Parti communiste chinois : Xi Jinping a notamment annoncé de « promouvoir
l’édification d’une civilisation écologique à l’échelle mondiale » en continuant à déployer de grands efforts
(développement massif des énergies vertes, diminution des consommations, investissements…), et il a de plus
affirmé, à la surprise générale, à l’occasion d’un discours prononcé à l’Assemblée générale de l’ONU, avoir
commencé « à faire baisser les émissions de CO2 avant 2030, et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 ». De ce
fait, la Chine s’impose aujourd’hui comme moteur et leader de l’écologie et des énergies renouvelables.
Cette évolution n’est qu’une des illustrations d’une ambition politique chinoise beaucoup plus large qui vise à
se lancer à la conquête de marchés internationaux avec des gigantesques projets de développement en perspective,
avec, à la clé, le risque d’un autre grand déclassement des démocraties occidentales, ainsi « doublées » sur leur
propre créneau moralisateur climatique et écologique tant à la mode, mais qu’elles sont incapables d’appliquer
concrètement de façon rapide et à grande échelle comme le système autoritaire chinois le permet… Pour Xi Jinping,
l’idée d’éco-civilisation s’appuie sur l’innovation technologique et la croissance qui l’accompagne. À l’opposé de
celle des écolos rouges-verts occidentaux, cette stratégie n’est pas conçue par Pékin, dans le cadre d’un mondialisme
utopique et antifrontiériste justifiant la fin des Nations, mais au contraire comme un autre instrument de puissance
nationale et une « synthèse à la chinoise », c’est-à-dire à marche forcée pour édifier la future hyperpuissance phare
de la « belle Chine » et de son idéologie confucéo-maoïste capitaliste. Lors du dernier Eco Forum Global Annual
Conference de Guiyang, organisé en 2018, le sujet de la « nouvelle ère de l’éco-civilisation » a ainsi lancé la
campagne chinoise mondiale en faveur d’un « développement vert avec une haute priorité pour l’Écologie ». Cette
e
conférence annuelle, qui fêtait sa 10 édition, avait lieu à Guiyang, métropole-vitrine du modèle qui concilie
écologie, innovation et croissance.
Le projet chinois de « croissance verte », aux antipodes de la
décroissance des écolos européens : un autre grand déclassement en
cours…
De fait, Pékin affiche des résultats à faire pâlir d’envie de nombreux pays en matière de développement des
énergies renouvelables, même si le pays reste très dépendant du charbon. La Chine, vu sa taille gigantesque,
s’illustre par de véritables records en matière d’investissements verts porteurs de croissance économique durable :
elle est désormais la première puissance mondiale en matière de production d’énergie renouvelable, et ce n’est pas
fini ! Elle a doublé ses capacités en matière de solaire photovoltaïque entre 2015 et 2020, et elle s’est distinguée
comme le pays ayant installé deux fois plus de capacités de production que la plupart des pays réunis sur la seule
année 2016. Son parc solaire étant devenu cinq fois plus important que celui des États-Unis. En ce qui concerne
l’éolien, elle a déjà déclassé la totalité de la capacité de l’Europe dans ce secteur. En matière de mobilité propre,
Pékin est en pointe, avec des décisions claires, dans la production de véhicules thermiques. Lors du salon de
l’automobile de Pékin d’avril 2020, les experts prévisionnistes ont même émis la crainte que la Chine devienne
bientôt le leader absolu des véhicules électriques, une concurrence terrible pour les constructeurs européens moins
compétitifs qui risquent là aussi le déclassement industriel. Il faut dire que le pays a tout pour réussir ce virage et
développer la totalité de la filière : un gigantesque marché intérieur de près de 1,4 milliard d’habitants, des métaux
rares (voir infra) indispensables au fonctionnement de ces nouveaux moteurs, des capacités industrielles dont celles
nécessaires à la fabrication de batteries électriques, et un vivier de mains-d’œuvre et de compétences
impressionnants. Bref, les Chinois semblent avoir compris qu’ils pourraient parfaitement revendiquer l’industrie
automobile du futur. Le président Xi Jinping a d’ailleurs imposé à tous les constructeurs de réaliser, dès 2019, 10 %
de leurs ventes avec des voitures hybrides ou électriques tout en exigeant des quotas plus restrictifs que partout
ailleurs dans le monde, pour les véhicules trop énergétivores. Ceci est une véritable leçon en matière de capacité de
faire d’une pierre trois coups : un énorme marché à la clé pour les entreprises nationales, une solution concrète pour
réduire la pollution et rendre le ciel des villes encombrées plus bleu, et une position de filière industrielle
prédominante. Rappelons que la Chine a investi 360 milliards de dollars pour construire le premier réseau de lignes
à grande vitesse dans le monde. Avec plus de 22 000 km de lignes, celui-ci permet de desservir la plupart de grandes
villes chinoises autour de huit grands axes. Un chiffre supérieur à la somme de tous les réseaux du reste du monde et
qui laisse rêveurs bon nombre de pays occidentaux ! Bref, le gouvernement chinois semble bien décidé à
promouvoir un environnementalisme politique, avec des moyens de mise en œuvre dépassant de loin le cadre de
l’action possible des gouvernements occidentaux. À n’en pas douter, la guerre économique sans merci à laquelle se
livrent désormais la superpuissance américaine et la Chine se traduira par une accélération des investissements verts
dans une recherche de leadership en matière de neutralité carbone. Joe Biden a quant à lui annoncé être prêt à faire
ce qu’il fallait pour atteindre la neutralité carbone du secteur électrique d’ici 2035, un objectif problématique du fait
que les énergies fossiles représentent 65 % de la génération de l’électricité. En clair, une très forte accélération, en
matière d’investissements, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, sous réserve de se désempêtrer
d’un secteur pétrolier qui, on l’a vu, pèse encore fortement dans la logique économique américaine. En matière
d’infrastructures, on sait que l’Amérique peut aller vite, et si Biden réalise son plan, comme l’affirme le spécialiste
Robert Bell, elle pourrait « devenir le leader incontesté dans le domaine des énergies renouvelables, comme elle l’a
8
fait avec le numérique il y a trente ans ».
Vers un nouveau paradigme écoénergétique
En 2018, la production d’électricité – dite « thermique », c’est-à-dire à partir d’énergies fossiles – qui
représentait 19 % de la production mondiale d’énergie provenait pour 64 % des énergies fossiles. Le reste de la
production électrique au niveau mondial (estimée globalement entre 20 000 et 25 000 TWh) est assuré par l’énergie
nucléaire (10 % du total), et les énergies renouvelables (un quart du total, dont celle hydroélectrique de loin la
principale). Avec près de 45 % de la production mondiale, la Chine et les États-Unis représentent les deux
principaux pays producteurs d’électricité au monde. La part de l’électricité dans la consommation finale d’énergie a
9
plus que doublé en quarante-quatre ans, depuis 1973 . Dans le même intervalle, la consommation finale d’énergie –
toutes utilisations confondues – dans le monde s’est accrue de 109 %, pour s’élever, en 2018, à 9 983 millions de
tonnes équivalent pétrole (Mtep), dont 19 % sous forme d’électricité. Les conséquences de ces hausses sont bien
connues aujourd’hui avec la pollution et le réchauffement climatique, autre revers de la mondialisation marchande.
L’objectif de construire un monde neutre en carbone est donc très ambitieux… Aussi, une transformation
économique et sociale semble aujourd’hui nécessaire dans les pays occidentaux, déjà en retard par rapport à la
Chine, pour faire émerger un nouveau paradigme écoénergétique dans le cadre d’une vision de long terme
susceptible à la fois de viser une croissance verte, voire « régénératrice » pour le bien-être des générations futures.
Pour contenir ce réchauffement climatique, les solutions sont connues : accroître la part des énergies renouvelables,
capture et stockage du CO2, réductions des consommations et déchets, modification des habitudes et transports,
recours au nucléaire, etc. Cette nouvelle dynamique, poussée par les objectifs de développement durable (ODD)
onusiens, sera l’occasion de faire également émerger de nouvelles formes de leadership à la conquête d’un monde
capable de se développer sur la base de règles et contraintes novatrices privilégiant les solutions à faible intensité
carbone. Elle impose également de mobiliser des financements (initialement chiffrés à 100 milliards de dollars par
an) auprès des nations industrialisées en faveur des pays du Sud, plus vulnérables au changement climatique…
Dans de nombreux pays, les énergies renouvelables sont désormais clairement reconnues comme compétitives
face aux fossiles. Toutefois, des voix s’élèvent pour attirer l’attention sur leur face cachée. La compétitivité est
observable aux bornes de la machine qui les produit, mais du fait de leur forte intermittence et de leur très faible taux
de charges – elles ne produisent qu’un cinquième du temps –, la facture d’électricité dans tous les pays qui poussent
cette production ne cesse de croître. Le système électrique est un vaste réseau complexe et ne l’examiner que par la
réduction du coût des installations éoliennes ou solaires conduit à penser erronément que ces énergies sont bon
marché. C’est exactement le contraire, raison pour laquelle si on veut les produire, il faut le faire sous la contrainte
du législateur. Pour le solaire, le secteur prévoit que le photovoltaïque mondial continuera à se développer de façon
exponentielle. Il a déjà dépassé 600 GW de puissance solaire totale installée à ce jour (au-delà des estimations les
plus optimistes) contre 178 GW à fin 2014. Et la course aux infrastructures vertes est loin d’être terminée… En
2024, la capacité solaire mondiale pourrait atteindre 1 448 GW. L’effet d’échelle se traduit par une baisse des
10
coûts qui contribuera à améliorer encore davantage la compétitivité de la production de cette énergie. La même
observation vaut également pour l’hydrogène produit de façon écologique par la technique de l’électrolyse de l’eau,
l’une des grandes solutions de l’avenir, véritable alternative aux hydrocarbures classiques et non conventionnels.
C’est ainsi que les Aéroports de Paris (aujourd’hui Groupe ADP) envisagent d’installer des réservoirs d’hydrogène
en vue de la réception d’une nouvelle génération d’avions « verts » qui pourraient décoller vers 2030 au plus tôt.
D’une manière générale, les constructeurs automobiles se préparent également au changement de motorisation, qu’il
s’agisse de l’électrique ou de l’hydrogène, laquelle impliquera pendant de nombreuses années une diminution de la
production et des prix de vente beaucoup plus élevés.
Depuis la COP 21, les tentatives de résurgence de l’Ancien Monde
paraissent peu à peu s’éloigner…
De nombreux freins contribuent à rendre le passage de l’Ancien Monde vers le Nouveau Monde extrêmement
délicat. Aujourd’hui, les entreprises se doivent de faire du profit tout en veillant aux enjeux environnementaux et
sociétaux, et nombre de firmes historiques du secteur de l’énergie éprouvent d’énormes réticences et/ou difficultés à
se transformer. En matière de transition énergétique, ce paradoxe se traduit toujours par une prédominance des
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) dont la part se réduit encore trop lentement. Le pétrole, à lui seul, représente
30 % du mix en 2020 (vs 37 % en 1990)… La crise de la Covid a provoqué un double choc de l’offre et de la
demande qui s’est traduit par un tel effondrement des prix (30 dollars le baril) que cela remet en question les
conditions de survie même du pétrole de schiste américain, rentable au-dessus de 50 dollars le baril.
Selon certains, l’urgence de la transition énergétique est d’autant plus nécessaire que les coûts de « ne rien
faire » deviendraient aujourd’hui supérieurs aux coûts d’agir. Plus de 200 des plus grandes entreprises cotées du
monde prévoient que le changement climatique pourrait leur coûter près de 1 000 milliards de dollars au total dans
les cinq prochaines années, un montant pourtant encore largement sous-estimé selon un rapport de l’organisation
11
CDP (Carbon Disclosure Project ). Les assureurs paient des notes de plus en plus salées du fait d’épisodes
climatiques extrêmes (inondations à répétition, incendies, tempêtes plus fréquentes et plus violentes, ouragans,
vagues de chaleur, canicules…), mais aussi parce que la démographie et la mondialisation poussent des populations
urbaines à se concentrer dans des zones à risques météorologiques. Pour l’horizon 2030, les grands objectifs, arrêtés
par le Conseil européen dès octobre 2014, envisagent comme priorité la réduction des émissions d’au moins 40 % en
2030 par rapport à 1990. Cet objectif est d’ores et déjà considéré comme une étape de la feuille de route de la
Commission européenne qui parie sur une économie sobre en carbone à l’horizon 2050. Elle propose ainsi des
scénarios pour atteindre de manière optimale l’objectif que s’est fixé l’UE de réduire de 80 à 95 % ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici à 2050, par rapport à leur niveau de 1990. La France soutient cette approche, également
appelée ZEN 2050 (Zéro émission nette). La crise du coronavirus va probablement relancer et accélérer cette
réflexion de fond.
Pétrole et gaz de schiste et filières nucléaires, les énergies
renouvelables n’ont pas encore gagné la partie…
En dépit des nombreux projets ambitieux visant à bâtir une économie entièrement décarbonée, et outre les
contradictions et effets pervers, en matière d’émissions de CO2, de l’économie ubérisée et des nouvelles
technologies consommatrices de terres rares hautement polluantes et émettrices de CO2 (voir infra), le débat sur les
énergies fossiles elles-mêmes est loin d’être définitivement clos, eu égard aux succès de deux énergies non
renouvelables : les hydrocarbures de schistes et les filières nucléaires, tant classiques que de nouvelle génération.
Commençons par les énergies fossiles et notamment le gaz, bien moins polluant et bien plus prisé que le
pétrole. Il convient de rappeler que nos économies industrialisées en sont encore très fortement dépendantes, surtout
des différents gaz. Certains annoncent pour bientôt une économie mondiale débarrassée des hydrocarbures, mais il
s’agit là d’un vœu pieux, car si la part de consommation mondiale de pétrole diminue et aura vocation à être
remplacée en partie par les énergies renouvelables, il n’en va pas de même du gaz, qui sera l’une des énergies du
e
siècle, aux côtés des renouvelables, du nucléaire et de l’hydrogène. Démarrée il y a une dizaine d’années
seulement, donc sous l’ère du pourtant réputé écologique Barack Obama, la révolution du gaz de schiste a
complètement changé la donne énergétique américaine et mondiale, faisant du pays une superpuissance pétrolière et
gazière et bousculant ainsi les équilibres géopolitiques mondiaux. Depuis les années 2000, les réserves américaines
commençaient à s’épuiser. L’arrivée du gaz de schiste à la fin des années 2000 a « réglé » le problème. Les
compagnies pétrolières ont alors commencé à creuser plus profondément pour avoir accès aux réserves. Pour
l’extraire, le procédé choisi est la fracturation hydraulique, consommatrice de produits chimiques et d’eau.
Paradoxalement, l’exploitation de pétrole et de gaz de schiste, contrairement aux hydrocarbures conventionnels, est
rapide à réaliser avec des puits moins coûteux que ceux nécessaires pour l’extraction du pétrole conventionnel (avec
les fameuses pompes : pump jacks). Chaque gisement contient toutefois une quantité limitée d’hydrocarbures, ce qui
XXI
12
nécessite la construction de dizaines de nouvelles installations chaque semaine .
Le pétrole de schiste a connu lui aussi une renaissance depuis les années 2000, en même temps que progressait
la « conscience climatique »… Totalement marginale en 2007, la production de pétrole de schiste représentait en
2018 plus de la moitié de la production de pétrole aux États-Unis. Ainsi, l’Agence internationale de l’énergie (AIE),
pourtant partisane de la décarbonation et des énergies renouvelables, prévoit que la production de pétrole de schiste
atteindra 11 millions de barils par jour d’ici à 2035, soit 66 % de la production totale aux États-Unis.
Longtemps premiers importateurs mondiaux de pétrole, les États-Unis sont devenus exportateurs nets de brut et
13
de produits pétroliers en 2020 . Avec une production qui a atteint près de 12 millions de barils par jour, en 2019, les
exportations de pétrole, de gaz et de charbon combinées ont été supérieures aux importations, pour la première fois
depuis 1953… et les États-Unis, qui ont ainsi gagné leur indépendance énergétique, ne prévoient pas de redevenir
importateurs nets de pétrole avant 2050… Cette croissance prend en compte la relance de l’exploitation de pétrole
off-shore, décidée par l’administration Trump. Dans ce domaine, il est vrai que les États-Unis ont été bien moins
scrupuleux que l’Union européenne eu égard aux conséquences écologiques délétères des systèmes de fracturation
hydraulique propres à la production des gaz et pétroles de schiste.
Officiellement très fortement mobilisées par la lutte contre le changement climatique, les industries privées du
pays ont été autorisées à investir largement dans des gazoducs pour exporter vers le Mexique, le Canada, l’Europe –
comme on vient de le voir – ou l’Asie. Cela ne veut pas dire que les États-Unis n’importent pas. En effet, le pays
continue à s’approvisionner en pétrole canadien, saoudien, mexicain, vénézuélien et irakien, à hauteur de 6 millions
de barils par jour, pour des raisons essentiellement techniques, liées à la capacité des raffineries américaines réglées
pour traiter des bruts plutôt lourds (le pétrole de schiste étant un peu plus léger, ce qui explique qu’on privilégie son
exportation). Bien entendu, l’échiquier politico-énergétique mondial a changé en fonction de cette nouvelle donne.
Ainsi, le blocus et le régime de sanctions américains contre l’Iran ou la Russie – en réalité pas uniquement motivés
par la « morale » mais aussi et surtout par la concurrence énergétique – ont ouvert de nouveaux débouchés au
pétrole et au gaz américains, qui se sont ainsi substitués en partie au brut iranien exporté vers l’Europe et l’Asie et
qui a vocation à concurrencer le gaz russe… Et selon la Commission européenne, les exportations de gaz naturel
liquide américain vers l’Europe ont augmenté de 272 % depuis juillet 2018…
Les gazoducs russo-européens, des épines dans le pied pour
l’hégémon américain…
Le gazoduc South Stream a fait les frais de ce que nous avons baptisé la « néo-guerre froide » États-Uniso
Russie (voir carte n 13). Ce pipeline, long de 3 600 km, destiné à exporter le gaz sibérien en contournant l’Ukraine,
devait fournir jusqu’à 63 milliards de mètres cubes par an aux pays européens grâce à deux branches, l’une vers
l’Autriche, l’autre vers les Balkans et l’Italie. Lancé en 2007, ce projet, appuyé notamment par l’Italie et d’autres
pays d’Europe du Sud et balkanique, a été abandonné, en décembre 2014, en raison des pressions des États-Unis et
des pays les plus antirusses de l’UE. Ces derniers souhaitaient voir leur allié ukrainien demeurer dans le jeu gazier et
surtout ne pas dépendre directement de Moscou. Ce choix russosceptique allait favoriser en réaction un
rapprochement géoénergétique entre Russes et Turcs : ces derniers sont traditionnellement impliqués dans la
réduction de la dépendance européenne vis-à-vis de la Russie, mais ils ont décidé d’offrir leur voie de transit au plus
offrant et ont eux-mêmes fort besoin des hydrocarbures de Russie et des Républiques turcophones ex-soviétiques
prorusses membres de la Communauté des États indépendants (CEI). Cela étant, d’autres infrastructures (Nord
o
Stream, voir carte n 13) permettent d’acheminer du gaz de Russie, notamment vers l’Allemagne, pays figurant
parmi les plus dépendants de l’UE envers la Russie pour sa demande en gaz naturel (63,5 %).
Ce gazoduc, qui passe sous la Baltique et débouche dans le nord de l’Allemagne, a été mis en service en 2012.
Nord Stream 2 visait à doubler la capacité de livraisons directes de gaz russes du réseau Nord Stream 1, pour
parvenir à 110 milliards de mètres cubes par an. Avec des investissements estimés à 11 milliards d’euros, financés
pour moitié par la compagnie russe Gazprom (et le solde par les sociétés européennes OMV, Wintershall Dea,
Engie, Uniper et Shell), le projet s’est attiré les foudres du Congrès bipartisan des États-Unis, qui accusait
14
publiquement l’Allemagne d’être « prisonnière » de la Russie et exigeait son abandon … Nord Stream 2 devait être
mis en service début 2020 mais a été brutalement interrompu pendant près d’un an, sous les intenses pressions de
l’administration Trump, avant de reprendre en décembre 2020, ceci malgré les sanctions « extraterritoriales »
15
adoptées par les États-Unis en décembre 2019 contre les entreprises allemandes et russes collaborant au projet . En
juin 2021, alors que ses 1 230 km étaient quasiment terminés (il manquait en juin 2021 6 % du gazoduc à achever,
74 km), l’administration de Joe Biden a continué à multiplier les pressions pour retarder ou compromettre la mise en
route du gazoduc, voyant dans l’Europe un parfait débouché pour son abondant gaz naturel de schiste. C’est dans ce
contexte que, le 11 juin 2021, Joe Biden a invité la chancelière allemande Angela Merkel à Washington afin,
notamment, de tenter de la convaincre de renoncer au gazoduc atlantistement incorrect… Joe Biden a toutefois
renoncé à poursuivre les sanctions, jugées contre-productives, afin de préserver la relation germano-américaine,
essentielle pour pérenniser l’hégémonie américaine et atlantiste sur le Vieux Continent. Toujours est-il que cette
affaire a confirmé une fois de plus comment la puissance unilatérale étatsunienne instrumentalise des conflits
16
comme l’Ukraine (qu’elle a d’ailleurs contribué à faire exploser ), et des arguments moralistes, pour pérenniser
l’aberration internationale que constituent les lois extraterritoriales américaines. Celles-ci permettent en effet au
Trésor américain de geler des avoirs de n’importe quels État et compagnie au monde (avec à la clé des « amendes »
se chiffrant parfois en milliards de dollars, voir affaire BNP Paribas, Total ou Société générale) accusés de faire du
commerce avec des « États voyous » (Rogue States) sous sanctions, ou dont les intérêts énergétiques (Iran,
Russie, etc.) dérangent ceux des compagnies étatsuniennes et les stratégies d’endiguement du Deep State
américain…
Au-delà du gaz russe, les Européens se fournissent également, bien sûr, en Norvège, en Algérie et au Qatar, ce
qui explique aussi la permissivité de l’UE vis-à-vis des Frères musulmans en Europe, parrainés et financés justement
par Doha… Tout est lié. Et grâce à la diabolisation-éviction du concurrent géoénergétique russe par les États-Unis
au nom des dossiers ukrainien et syrien ou de la question des droits de l’homme – très hypocritement orientée en
exonérant les pétromonarchies du Golfe bien plus dictatoriales que Moscou – l’Union européenne n’est plus le seul
maître de sa destinée énergétique. On est loin de la solidarité russo-européenne et de l’axe géoénergétique ParisBerlin-Moscou désirée par le général de Gaulle dans le cadre de son plan Fouchet pour une Europe des nations
indépendantes des États-Unis et donc « recontinentalisée »… À cet effet, l’ancien secrétaire d’État américain à
l’Énergie, Rick Perry, n’avait pas hésité à vanter les mérites du gaz américain – pourtant bien que plus cher que le
gaz russe – présenté comme « fiable » et synonyme de « liberté » pour les Européens ! En 2019, les importations de
gaz naturel liquéfié (GNL) avaient ainsi bondi de 87 %, et 15 % du total provenaient des États-Unis.
Le nucléaire : énergie de tous les dangers pour certains, solution de
décarbonation pour d’autres…
Abordons maintenant la question du nucléaire civil. Symbole de la puissance technologique et atout majeur des
pays le maîtrisant, le nucléaire est aujourd’hui au cœur des débats et enjeux énergétiques car il permet en fait de
produire local. Ses partisans rappellent que la fission de l’uranium n’émet pas de gaz à effet de serre et que le cycle
carbone de la filière (de l’extraction de minerai à la gestion des déchets radioactifs) est très bas, et même, selon le
Giec, encore plus bas que l’énergie éolienne. De plus, si le nucléaire est décrié pour des raisons de sécurité, d’autres
y voient une solution bas carbone, d’autant que les réserves prouvées d’uranium sont évaluées à plus de cent ans
avec des centrales de plus en plus économes en termes de combustibles. Là encore, les situations diffèrent en
fonction des pays, de leur histoire et de leur sensibilité. Ainsi, avec ses 58 réacteurs nucléaires – devenus 56 depuis
l’arrêt de Fessenheim en 2020 – la France, pays le plus nucléarisé au monde en proportion, produit 70 % de son
électricité dans ses 18 centrales nucléaires, créant ainsi une situation inédite en termes de manque de diversité des
sources d’approvisionnement. Cette situation est souvent analysée comme un obstacle à la production électrique
renouvelable. Comparé au plus grand parc nucléaire au monde, américain (95 réacteurs opérationnels dans
65 centrales nucléaires, plus 2 en construction et 38 mis à l’arrêt définitif), la France est certes loin des États-Unis,
avec une production de 395,91 TWh, contre 808 TWh. Par soucis de compétitivité, le programme nucléaire civil
17
étatsunien, un temps freiné, a en fait été relancé depuis 2010 . Le budget consacré par le Department of Energy
(DoE) à la filière nucléaire est ainsi passé de 986 millions de dollars, en 2016, à 1,493 milliard en 2020. Les ÉtatsUnis semblent de la sorte déterminés à faire renaître la filière énergétique nucléaire, notamment afin d’éviter un
déclassement définitif en faveur de la Chine et de la Russie, ceci au moment où l’Europe se dénucléarise sans réussir
la transition vers les renouvelables, comme on l’a vu en Allemagne qui ne réduit ses émissions qu’à la marge.
La Chine une fois de plus leader dans le domaine
La Chine est toutefois le pays dans lequel l’énergie nucléaire a le plus progressé et à une vitesse record. Pour
réduire sa dépendance au charbon, le gouvernement de Pékin a en effet multiplié par dix le nombre de centrales
nucléaires en fonctionnement en 2000, avec un objectif de capacité de 120-150 GW pour 2030, contre 63 GW
aujourd’hui en France… En 2019, la Chine disposait de 47 réacteurs en fonctionnement (contre 38 en 2018). En
plein été 2020, l’Association chinoise d’énergie nucléaire annonçait, malgré la pandémie de la Covid, la construction
de 6 à 8 réacteurs par an d’ici à 2025, soit le double du rythme actuel, ceci en évitant les retards et les surcoûts qui
18
ont largement handicapé le nucléaire français. Les catastrophes nucléaires successives , qui ont quelque peu refroidi
les ardeurs, expliquent notamment les technologies innovantes du secteur, par hybridation du réacteur américain et
19
de l’EPR français, dont une version chinoise a permis de faire émerger le réacteur phare Hualong-1 . Ce réacteur,
installé dans la centrale de Fuqing, au sud-est du pays, est le premier-né du modèle à eau pressurisée, conçu et
construit 100 % made in China. Ses promoteurs rêvent de conquérir les marchés extérieurs. La Chine a ainsi vendu
2 réacteurs au Pakistan (et 3 supplémentaires en cours), et elle négocie des contrats avec le Royaume-Uni,
l’Argentine, l’Iran, la Turquie, l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Égypte, le Soudan, l’Arménie et le Kazakhstan. Pékin
coopère également avec la Russie – entreprise Rosatom – pour enrichir l’uranium et développer des projets de
centrales équipées des réacteurs russes VVER. La Chine est ainsi devenue un acteur majeur de la filière nucléaire à
l’échelle internationale sur la totalité de la chaîne de conception, de construction et d’exploitation. Elle se distingue
par ses innovations et notamment par un programme basé sur des démonstrateurs appelé le « Dragon Rising 2020 ».
Pékin investit en plus fortement dans l’innovation et effectue des recherches intenses sur la fusion thermonucléaire.
Depuis 2003, le pays est ainsi partenaire du grand projet international Iter de réacteur thermonucléaire (qu’on
appelle également un tokamak). Le réacteur, situé à Cadarache en France, devrait générer son premier plasma en
2035. Mais la Chine possède aussi ses propres réacteurs et a battu, le 28 mai 2021, un record de température de
fusion dans le troisième tokamak qu’elle vient de construire : l’Experimental Advanced Superconducting Tokamak
(East) a atteint 160 millions de degrés Celsius et il a surtout réussi à maintenir son plasma à une température de plus
de 120 millions de degrés Celsius pendant cent une secondes. D’évidence, même dans ces domaines, l’empire du
Milieu promet de ne plus se contenter d’imiter, mais de déclasser l’Europe, et, à terme, les États-Unis…
L’enjeu géoéconomique majeur des terres rares, la Chine toujours
o
n 1
La Chine a pour objectif non dissimulé de concurrencer les pays occidentaux dans tous les domaines
stratégiques, économiques et industriels, puis de remporter les plus grands marchés dans le domaine de la transition
énergétique. Dans cette entreprise pour le leadership global qui passe par le déclassement de l’Occident, elle a déjà
inondé le monde entier en panneaux solaires made in China, bien moins chers que ceux des pays occidentaux, et
cette victoire a été en partie facilitée par le fait qu’elle contrôle 90 % des matières premières nécessaires à leur
fabrication comme les terres rares. Le résultat a été de littéralement détruire l’industrie européenne solaire, la quasitotalité des entreprises spécialisées dans la technologie photovoltaïque étant d’ores et déjà chinoises. De ce point de
vue, la suprématie chinoise en matière d’exploitation des terres rares condamne les pays occidentaux à une
dépendance extrêmement problématique dans l’avenir.
Les terres rares désignent une catégorie de métaux rares aux fabuleuses propriétés physico-chimiques. Leur
nom (en anglais Rare Earth Elements ou REE) vient de leur difficulté d’extraction : elles sont présentes en
abondance, mais avec des concentrations très faibles. Elles sont à la base des technologies NTIC et informatiques,
notamment pour les batteries, et au cœur même des industries liées à la transition énergétique et aux énergies
renouvelables : dans le futur, nous sommes censés produire le plus possible d’électricité à l’aide des énergies
renouvelables (solaire photovoltaïque, éolien), ce qui signifie qu’il sera presque impossible de s’éclairer, de se
chauffer, voire de travailler sans ces précieux métaux. Les terres rares sont utilisées dans le domaine des énergies
renouvelables, dans la fabrication de véhicules électriques, des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, etc.,
mais aussi dans le domaine du numérique (écrans, puces, composants des smartphones, fibre optique), notamment
les réseaux digitaux. Elles sont, bien sûr, également nécessaires à la technologie 5G, dominée par la Chine, sans
oublier les secteurs médical (radiologie), militaire (lasers, composants des drones, des missiles), et plus globalement
à tout équipement connecté. Aujourd’hui, dans un contexte de transition énergétique et de réduction des gaz à effet
de serre, la majeure partie des gouvernements se tourne vers les énergies renouvelables, or les voitures électriques
nécessitent d’investir massivement dans des technologies très utilisatrices de métaux rares. Les enjeux industriels et
politiques sont par ailleurs colossaux : les pays producteurs ont gros à y gagner, et la recherche, l’appropriation et
l’exploitation de ces ressources peuvent conduire à des tensions géopolitiques et commerciales, la transition
écologique étant aussi et avant tout une transition économique.
20
Selon un rapport de la Banque mondiale , la demande en métaux rares va croître énormément dans les
prochaines années : le néodyme, par exemple, utilisé dans la fabrication d’aimants et fondamental pour l’industrie
éolienne et les véhicules électriques, devrait voir sa demande augmenter de 150 à 250 %. Celle de métaux comme
l’aluminium, le cobalt, le fer, le plomb, le lithium, le manganèse et le nickel pourrait être multipliée par plus de 10
d’ici 2030. Quant à la demande d’indium, utilisé massivement dans le solaire, elle pourrait exploser de 250 à 300 %.
Ces ressources viennent de différentes zones : le cobalt provient principalement de la République démocratique du
Congo, le lithium surtout d’Australie et d’Amérique du Sud (Bolivie, Chili, Argentine). Ces métaux rares peuvent
être produits un peu partout dans le monde, mais la Chine, qui détient des réserves colossales, est le premier
21
producteur mondial. Elle produit notamment les deux tiers du graphite et surtout 88 % des terres rares ! Certes, elle
ne dispose « que » de 37 % des réserves de terres rares dans le monde, soit 44 millions de tonnes, mais c’est elle qui
investit, extrait et produit le plus, disposant à la fois des ressources, de la main-d’œuvre, et des contraintes
environnementales faibles qui permettent leur exploitation. Après le pétrole, les métaux rares sont devenus notre
nouvelle dépendance majeure, or leur production est concentrée en Chine. Un véritable problème de sécurité
nationale pour les autres pays qui doivent rattraper le retard. L’industrie américaine des métaux rares s’est quant à
elle écroulée, en partie en raison des polémiques environnementales.
Déjà, en 1992, le Président chinois, Deng Xiaoping, déclarait : « Le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a des
terres rares », preuve que Pékin avait compris très tôt la nature stratégique de ces métaux. Et la Chine est bien plus
ambitieuse que les pétromonarchies du Golfe : elle ne se contente pas du quasi-monopole des mines, mais veut aussi
détenir celui des usines. L’empire du Milieu n’est en effet pas uniquement « l’usine du monde » qui fournit des
produits bas de gamme et bon marché, mais elle s’impose aujourd’hui également comme un des principaux
fournisseurs de haute technologie. La stratégie chinoise d’innovation vise en fait à faire de ce pays la plus grande
22
puissance technologique et innovante d’ici à 2050 en complétant le plan « made in Chine 2025 ».
La Chine concurrence donc les pays occidentaux dans des domaines qu’ils contrôlaient depuis longtemps,
comme l’automobile. Elle est aujourd’hui le premier producteur mondial de batteries au lithium, utilisées dans les
voitures électriques. Dans un contexte de conflit commercial avec les États-Unis, cela rend ces domaines très
dépendants des terres rares pour les industries. Il s’agit là d’un sujet de tensions, surtout depuis l’attaque
commerciale des États-Unis sur la compagnie chinoise Huawei. En effet, dans l’hypothèse d’un blocage de
23
l’exportation des terres rares par la Chine vers les États-Unis , les difficultés d’acheminement pour ces derniers
seraient très importantes. Cette tactique a d’ailleurs déjà été utilisée par la Chine contre le Japon en 2010, lorsque
Pékin a interrompu l’approvisionnement en matériaux à la suite d’un différend territorial en mer de Chine. Nombre
d’entreprises japonaises, notamment celles spécialisées en robotique ou automobile, comme Toyota, dont la gamme
de véhicules hybrides nécessite beaucoup de terres rares, ont été ainsi en rupture d’approvisionnement. Plus
récemment, Pékin a menacé de restreindre ces exportations de terres rares vers les États-Unis, qui en dépendent à
80 %. Le risque de rupture d’approvisionnement de ces matériaux vitaux pour son économie est un véritable
cauchemar pour Washington. Le pays de Xi Jinping, maître du marché, peut donc aujourd’hui augmenter ou baisser
à sa guise les prix. Les États-Unis tentent certes de contrer cette domination chinoise problématique, comme on l’a
vu en 2019, avec la proposition de Donald Trump de racheter le Groenland au Danemark, le Groenland regorgeant
de ressources (hydrocarbures, métaux rares) dont d’importants gisements de terres rares. Mais cette proposition est
restée purement théorique et l’Amérique est loin d’avoir trouvé la parade à cette dangereuse dépendance vis-à-vis de
la Chine. On est d’ailleurs en droit de se demander quelle sera la stratégie de Joe Biden qui ne s’est pas trop exprimé
sur ce défi, sachant que les États-Unis n’ont rien entrepris de concret pour rattraper substantiellement leur retard et
qu’ils n’ont étonnement pas investi les sommes nécessaires dans des plans de long terme visant à produire des terres
rares ou à acheter des mines dans le monde dans le même but.
Autre sujet lié aux terres rares, la production de semi-conducteurs fait débat. L’Europe fabrique aujourd’hui un
peu moins de 10 % des semi-conducteurs, et elle en reste très dépendante, à tel point que sa production automobile a
été ralentie en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. De plus, rappelons que la firme taiwanaise
TSMC, leader mondial, produit 70 % des composants électroniques destinés à l’automobile, or Taiwan pourrait
redevenir chinoise sous peu… Par conséquent, la Chine hériterait une fois de plus du monopole d’un élément
stratégique. Conscients de leur grave dépendance vis-à-vis de la Chine, les États-Unis souhaitent investir
37 milliards de dollars pour soutenir GlobalFoundries, Micron Technology et Intel afin d’approvisionner les
constructeurs automobiles. Intel s’est d’ailleurs dit prêt à construire une usine en Europe et également deux autres en
Arizona. Mais la Chine, qui a toujours un coup d’avance sur les autres, grâce à sa capacité à élaborer des plans de
long terme, a débloqué 88 milliards de dollars pour arriver à 70 % d’autosuffisance d’ici 2025.
Bien que leader de la production des métaux rares, la Chine en est également un très gros consommateur en
raison de ses ambitieux plans industriels et elle en est devenue, en 2018, le plus gros importateur. Elle devrait avoir
des difficultés d’approvisionnement dès 2025. Dans ce contexte, pour ne pas perdre une arme industrielle, Pékin
cherche ces métaux ailleurs, le long des « nouvelles routes de la soie » (BRI). Même si leur objectif n’est pas tourné
vers les terres rares, ces nouvelles routes pourraient favoriser la mise en place de partenariats pour l’exploitation des
ressources. Ce phénomène est déjà observé en Afrique, continent qui détient d’importantes réserves de métaux, et où
la Chine augmente petit à petit son influence, bien qu’encore minoritaire par rapport aux entreprises occidentales.
24
L’investissement chinois dans l’exploitation minière en Afrique progresse très rapidement . Pour l’instant, les
minerais concernés ne sont pas principalement les terres rares, mais d’autres métaux tout autant stratégiques comme
le cuivre, le fer, le cobalt, le zinc ou le nickel. La valeur de la production minière contrôlée par des investisseurs
25
chinois à l’extérieur de la Chine était de 21,5 milliards de dollars en 2018 . Toujours en 2018, les entreprises
chinoises contrôlaient moins de 12 % de la valeur totale des minéraux et des métaux produits en Zambie, 24 % en
République démocratique du Congo (notamment pour le cobalt) et 37 % en Guinée. En Érythrée, où aucune autre
société minière n’est active, les sociétés chinoises partagent le contrôle avec le gouvernement érythréen, avec 60 %
pour la Chine. Entre 2005 et 2013, Pékin a investi 108 milliards de dollars en Afrique, dont 16,3 dans le secteur
26
minier . Les investissements miniers chinois globaux sont estimés autour de 125 milliards pour la même période.
La Chine a donc rapidement développé son influence dans les pays concernés par les routes de la soie, d’où, par
27
exemple, la prise de contrôle du port sri lankais de Hambantota par la Chine . Il ne sera pas impossible à l’avenir de
voir des pays financièrement faibles tomber dans le piège de la dette, et de devoir de ce fait « rembourser » la Chine
avec leurs ressources naturelles. Ainsi, une dizaine de pays (Djibouti, Kirghizstan, Laos, Maldives, Mongolie,
Monténégro, Pakistan, Tadjikistan, Éthiopie, Kenya) ne seraient pas en mesure de rembourser leurs dettes à la
Chine. Récemment, le Monténégro qui s’est retrouvé dans l’incapacité de rembourser un crédit de 1 milliard de
dollars (944 millions) et, après avoir appelé en vain l’UE à l’aide pour un soutien financier, a été touché par la
stratégie chinoise. Depuis quelques années, le gouvernement chinois investit massivement dans les Balkans, car
cette zone stratégique est l’aboutissement des routes de la soie, Pékin exploitant les divisions et rivalités
intereuropéennes pour renforcer son emprise géoéconomique sur le Vieux Continent. Par ce « piège » de la dette, la
Chine pourrait être en mesure non seulement de construire les routes et lignes ferroviaires nécessaires pour le projet
de routes de la soie, mais aussi de prendre littéralement le contrôle d’infrastructures nationales entières, dans une
sorte de néocolonialisme géoéconomique à la chinoise à l’assaut de la souveraineté des États les plus vulnérables.
Les terres rares, clé des énergies renouvelables, mais désastre pour
l’environnement…
La surexploitation et la surconsommation de matières premières poussées par la mondialisation marchande a
des effets dévastateurs, car pour l’exploitation des métaux, la Chine n’a pas hésité à détruire des écosystèmes, à
assécher des nappes phréatiques et à polluer massivement. Pour ce faire, de nombreux produits chimiques sont
utilisés, dont l’acide fluorhydrique, sous forme de poussière, que respirent les mineurs et qui est particulièrement
nocif. Les produits nocifs utilisés se répandent à des kilomètres aux alentours des mines vers les zones agricoles, ce
qui rend les terres de moins en moins fertiles et contamine les récoltes. Des villages entiers ont également été
abandonnés. Mais les vies humaines ont peu de valeur aux yeux des autorités chinoises, comparées à l’intérêt
économique de la production et son enjeu géoéconomique. Le pays compte des milliers de mines et de raffineries de
métaux rares : la ville de Baotou, en Mongolie intérieure, est zone d’exploitation contrôlée par Pékin la plus connue,
avec des infrastructures impressionnantes (dédiées au raffinage des terres rares). C’est aussi une des zones les plus
polluées du monde avec des eaux surchargées de métaux lourds et même parfois radioactifs, relâchés par les
raffineries qui vont ensuite s’infiltrer dans le sol et les nappes phréatiques, ce qui implique de sérieux problèmes de
santé et entraîne le déplacement de populations entières. Les habitants de la région continuent malgré tout à vivre
autour de ces mines dans des villages que l’on appelle aujourd’hui « villages du cancer » en raison de
28
l’augmentation impressionnante des tumeurs . C’est au prix de cette pollution que nos voitures électriques,
panneaux solaires et éoliennes viennent diminuer les émissions de CO2 chez nous. En réalité, les émissions sont tout
simplement délocalisées, car la Chine en émet beaucoup pour assurer la production, et c’est aussi pour éviter les
catastrophes écologiques que les Occidentaux ont délocalisé massivement ces industries en Chine ou ailleurs, ce qui
souligne l’extrême hypocrisie des moralisateurs qui veulent bénéficier des avantages de la nouvelle économie
consommatrice de terres rares et productrices de CO2 mais sans en subir les conséquences sur leur sol…
Stress hydrique et barrages : les guerres de l’eau en question
L’eau, élément vital, est encore plus essentielle à l’humanité que les énergies étudiées plus haut. Elle est
essentielle au développement socio-économique, à la production d’énergie et d’aliments, à la santé des écosystèmes
et à la survie de l’humanité elle-même. Et elle est plus que jamais un enjeu de rivalités entre les nations. L’eau est
également au cœur de l’adaptation aux changements climatiques, lien crucial entre la société et l’environnement. Les
villes ayant toujours été construites en priorité près des points d’eau, l’abondance d’eau dans une région est souvent
synonyme de richesse. À l’inverse, là où l’eau n’est pas présente ou presque, la pauvreté y est plus fréquente et les
conditions de vie plus précaires. Même riches, les pays enclavés n’ayant pas d’accès aux grands fleuves et à la mer
sont en situation de vulnérabilité. Et ceux qui sont situés dans des zones équatoriales et désertiques ont un vrai défi à
relever face à la nature et à leurs voisins pas forcément coopératifs. Indépendamment des rivalités entre nations,
autour de l’accès aux mers et aux fleuves, avoir une bonne gestion de l’eau est un vecteur essentiel de l’amélioration
des conditions de vie et de la cohésion de la société tout entière.
Quelques chiffres
2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à des services d’eau potable gérés de manière sûre.
4,2 autres milliards d’êtres humains manquent de services d’assainissement gérés de manière satisfaisante et sûre.
297 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies diarrhéiques à cause d’eau de mauvaise
qualité. Surtout, près de 700 millions de personnes n’ont toujours pas accès à une eau propre et salubre et deux
autres milliards auraient besoin d’accéder à un assainissement amélioré. Environ 80 % des eaux usées dans le monde
29
sont rejetées dans l’environnement sans traitement. L’agriculture représente près de 70 % des prélèvements d’eau .
L’eau devient une ressource de plus en plus rare et précieuse, notamment dans certaines zones mal dotées, et l’on
estime que les besoins en eau devraient augmenter de 40 à 50 % d’ici une trentaine d’années. Par ailleurs, les États
peu développés ou ayant une économie faible ont les plus grandes difficultés à relever le défi de la pénurie, car ils
n’ont pas les moyens budgétaires et technologiques pour réaliser les investissements nécessaires permettant de
traiter les eaux usées ou de dessaler l’eau de mer. Et du fait de l’augmentation de la demande (qui a plus que triplé
en un demi-siècle), les pays les moins avancés et en pleine explosion démographique et économique auront à
l’avenir de plus en plus de difficultés pour se procurer de l’eau potable. C’est là que le cercle vicieux du
développement et de la mondialisation apparaît : avec les taux de natalité incontrôlés, le fait de manquer de
ressources hydrauliques freine à son tour le développement économique, agricole et énergétique. La consommation
en eau d’un pays est par conséquent un indicateur de développement économique et un motif possible de conflits
entre pays qui se partagent les eaux.
D’après les estimations, la consommation d’eau douce mondiale a augmenté d’environ 1 % par an entre 1987 et
2018. Beaucoup de régions ont ainsi atteint les limites de leur approvisionnement tandis que les échanges,
l’urbanisation et la population mondiale ont augmenté. Il faut aussi savoir que la population s’accroît en majorité
dans les pays en développement, avec en tête l’Inde et le Nigeria, qui sont déjà tous deux en situation de stress
3
hydrique grave. Il y a un siècle, 15 000 m d’eau étaient annuellement disponibles par habitant de la planète. En
2030, il ne devrait en rester que 3 000, le minimum vital étant de 1 800 m³. Les causes majeures de cette baisse sont
la croissance démographique, l’évolution des modes de consommation alimentaire (hausse du niveau de vie) et les
besoins accrus en énergie liés à la mondialisation marchande et au développement. À l’avenir, notre alimentation
risque donc d’être par ailleurs profondément perturbée, quand on sait qu’il faut environ 15 000 litres d’eau pour
produire 1 kg de viande de bœuf, alors que la demande s’accroît dans les pays en développement (Inde, continent
africain et d’autres comme des pays comme les États-Unis, l’Argentine ou le Brésil) en raison de la consommation
démesurée. En France et dans l’ensemble des pays européens du Sud, les épisodes de sécheresse chaque été, les
restrictions d’usage associées et le contexte de crise ont donné un intérêt nouveau au débat sur la gestion de la
demande en eau, en particulier sur les instruments économiques, financiers et fiscaux, tels que les prix et taxes sur
les prélèvements et rejets. On observe aussi en Italie ou en Espagne des mesures de coupure d’eau pendant les
périodes de sécheresse en vue d’économies.
Le réchauffement climatique et la surconsommation de l’eau vident de plus en plus les nappes souterraines et
les rivières à mesure que les besoins augmentent. Ceci fera fortement augmenter le prix de l’eau à l’avenir, les plus
pauvres ne pouvant plus, à terme, satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. De plus, les conséquences du
réchauffement climatique obligent chaque année toujours plus de personnes à quitter des zones arides devenues
invivables et en voie de désertification. Ces migrations et mouvements de populations sont naturellement un
puissant vecteur d’instabilité et de conflits entre nations ou tribus, souvent d’ailleurs sur fond de tensions
ethnoreligieuses (Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, etc.). Il faut savoir que rien qu’en 2019, selon l’IDMC
30
(Observatoire de déplacement interne ), 8 millions de personnes ont été poussées à l’exode à cause de catastrophes
naturelles, dont environ 800 000 liées aux sécheresses. En moyenne, plus de 17 millions de personnes risquent d’être
déplacées par les inondations chaque année, et ces chiffres ne peuvent malheureusement qu’augmenter à l’avenir. En
Afrique également, les fleuves Congo, Niger et le Nil Bleu constituent des théâtres d’investissements autour de
l’énergie hydroélectrique. Les compagnies chinoises rivalisent en lobbying avec les multinationales occidentales et
israéliennes pour y remporter les marchés. Dans le même temps, les projets de barrages hydrauliques ambitieux
comme ceux d’Éthiopie peuvent être de graves sources de tensions, voire de guerre, entre pays voisins, en
l’occurrence entre l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte.
Le contrôle des rivières, mers et océans, source de conflits
L’essor de la mondialisation économique a créé de nouveaux enjeux géoéconomiques dans lesquels l’eau
détient une place fondamentale, que ce soit pour la vie des populations, l’agriculture, ou le contrôle des routes
commerciales ou des réserves énergétiques s’y trouvant. La question de potentialité des conflits autour de l’eau est
en tout cas de taille, lorsqu’on sait que plus de 40 % de la population mondiale est répartie autour de 250 bassins
transfrontaliers. Cela implique pour les populations de devoir partager leurs ressources avec leurs voisins, les risques
de tensions étant très importants lorsque les pays où se trouvent les sources sont tentés de profiter de leur position
avantageuse. Les tensions au sujet de l’eau peuvent venir de plusieurs causes : sécheresse, barrages ou autres
aménagements hydrauliques et détournements des flux qui diminuent les ressources d’un pays aux dépens d’un
autre ; répartitions des zones d’exploitation des fleuves imprécises ; pollution ; usages abusifs. Depuis une dizaine
d’années, les tensions et contentieux interétatiques liés à l’eau sont en nette augmentation, et les « guerres de l’eau »,
spectre régulièrement agité depuis des décennies, mais heureusement jamais concrétisé dans ses modalités les plus
pessimistes, deviennent de plus en plus probables. D’autant qu’au-delà de la simple nécessité d’avoir de l’eau pour
s’alimenter et pour l’agriculture, les mers et les océans regorgent de matières premières et d’hydrocarbures. En
témoignent les récentes disputes autour des réserves de gaz et de pétrole off-shore en mer de Chine (opposant Chine,
pays d’Asie du Sud-Est et Japon) et en Méditerranée orientale (entre la Turquie et la quasi-totalité des pays riverains
voisins). Désertification, ressources hydriques, disputes autour des ZEE et des barrages vont de plus en plus devenir
des sources de déstabilisation, voire de guerres, sachant que les grandes routes commerciales de la mondialisation
sont essentiellement maritimes. Le contrôle de ces mêmes routes est un enjeu vital pour les nations exportatrices.
Les pays privés d’accès à la mer, et donc aux énergies qui s’y trouvent, ou dont les eaux fluviales sont diminuées à
cause des barrages effectués en amont par des pays disposant des sources et peu soucieux de rechercher un
consensus, peuvent être tentés d’instaurer leur propre ordre régional unilatéral. Surtout s’ils ont l’avantage militaire,
comme la Chine, l’Égypte ou la Turquie, par rapport à leurs voisins. Par ailleurs, les normes, accords ou
réglementations internationales autour de la gestion et des partages des eaux manquent cruellement ou sont bafoués
au nom des intérêts nationaux. Ici encore, l’échec du multilatéralisme est patent et les traités de coopération acceptés
– donc fonctionnels sur ces matières – ne couvrent aujourd’hui que 60 des 250 bassins fluviaux précédemment
évoqués.
e
Certains experts n’hésitent plus à pronostiquer qu’au XXI siècle, l’« or bleu » prendra la place de l’« or noir »
dans les conflits entre États. Avoir accès à l’eau est un enjeu économique majeur qui pourrait devenir, dans le siècle
à venir, l’une des premières causes de tensions internationales pour les raisons exprimées précédemment. Depuis
31
plusieurs décennies, le programme des Nations unies pour le développement (Pnud ) a recensé une quarantaine de
situations conflictuelles entre des États au motif de l’accessibilité aux ressources hydriques. Elles concernent pour
l’essentiel les pays moyen-orientaux et africains, même si, pour le moment, aucune de ces crises ne s’est transformée
en un conflit durable. En Asie, par exemple, les litiges autour de l’eau des fleuves ne manquent pas : les grands
travaux chinois destinés à détourner les eaux du Mékong, notamment pour les canaliser vers d’autres cours d’eau, ou
même du Brahmapoutre, du Gange, de l’Indus, de Syr-Daria ou de l’Amou-Daria, inquiètent le Laos, le Cambodge,
le Viêtnam, et d’autres pays d’Asie.
Les réserves d’eau potable peuvent également être les cibles d’offensives militaires ou terroristes pouvant
32
causer des catastrophes humanitaires . Il peut s’agir d’attaques sur des digues, les barrages (dont la destruction
éventuelle rend les villes aux alentours extrêmement vulnérables), ou les centrales hydroélectriques, qui viseraient à
toucher directement les populations civiles et à créer des situations de troubles internes et de chaos. On peut citer ici
l’exemple de la destruction, en juin 1938, de la digue de Huayuankow sur le fleuve Jaune, lors de la guerre ChineJapon, qui provoqua des inondations de milliers d’hectares et fit entre 500 000 et 900 000 victimes et plus de 5 à
10 millions de réfugiés. Il s’agit de l’un des plus grands désastres écologiques militaires de l’histoire. Il en est allé de
même durant la guerre du Viêtnam, avec le déversement, par les forces américaines, de produits chimiques et
défoliants (agent orange chargé de dioxine et d’arsenic) qui ont entraîné une pollution destructrice des sols sur les
populations dont les effets sont encore visibles aujourd’hui.
Guerres de l’eau entre la Turquie et ses voisins
La Turquie est un pays très avantagé pour ses ressources en eau en comparaison de ses voisins syrien et irakien.
Elle s’est donc vue attribuer le nom de « château d’eau de la région », grâce au fait que le Tigre et l’Euphrate
prennent leurs sources en Anatolie avant de se diriger vers la Syrie et l’Irak. Ankara a ainsi construit nombre de
barrages hydroélectriques, notamment en Anatolie orientale, ce qui lui confère des moyens de pression
considérables sur ses voisins, puisqu’elle peut jouer sur les variations de débit du fleuve. Les problèmes opposant la
Turquie à ses voisins irakien et syrien sont certes anciens, mais après avoir été mis au second plan dans les
années 2000, Recep Tayyip Erdoğan les a ressuscités en même temps que son projet irrédentiste néo-ottoman (voir
o
carte n 9) voué à dominer les pays arabes voisins. Ankara refuse de reconnaître que les fleuves Tigre et Euphrate
(dont les sources se trouvent en Turquie anatolienne) sont internationaux, ceci afin de ne pas se voir imposer des
contraintes. Le pouvoir turc poursuit donc sa politique de grands barrages au détriment de ses voisins situés en aval
qui voient de ce fait leur débit diminuer : l’Euphrate draine à lui seul un bassin-versant de 440 000 km² réparti à
33
35 % en Syrie et 45 % en Irak, et le Tigre draine 258 000 km², avec 53 % en Irak et 33 % en Iran principalement .
Depuis les années 1970, le projet GAP (Great Anatolian Project) tient une place stratégique majeure dans la
politique énergétique d’Ankara, et il devrait lui permettre à terme de contrôler près de 90 % du débit de l’Euphrate et
plus de 50 % de celui du Tigre, avec au total 22 barrages. Les baisses de débit des fleuves subies par les pays voisins
ont déjà atteint un niveau insupportable : l’Euphrate a perdu 40 % du débit arrivant en Syrie, et le Tigre 24 % de
celui débouchant sur l’Irak. Les conséquences pour la Syrie et l’Irak sont dramatiques, notamment à cause du
barrage d’Illisu (frontière turco-irakienne), qui pompe l’eau du Tigre. Ces diminutions de son débit côté irakien ont
notamment débouché sur les émeutes de la soif de Bassora, survenues en 2018 après les fortes pénuries d’eau et la
pollution des rivières qui ont entraîné l’hospitalisation d’au moins 118 000 personnes.
La Turquie à l’assaut des réserves de gaz et de pétrole de
Méditerranée orientale
La politique géoénergétique de la Turquie en mer Méditerranée orientale ressemble à celle de Pékin en mer de
Chine méridionale. Sa consommation de gaz augmentant considérablement depuis dix ans en raison de la rapide
croissance économique turque et de l’augmentation de sa population, Ankara a récemment réactivé son vieil
irrédentisme ottomaniste visant à justifier une mainmise sur les énergies de cette mer stratégique et ses ZEE. Le
territoire turc est certes une voie de transit majeure pour le gaz et le pétrole arabes et perses du Golfe, puis
34
turcophones et russes de la zone Caucase-mer Caspienne , d’où l’inauguration du gazoduc russo-turc Turkish
35
o
Stream, le 8 janvier 2020 (voir carte n 13). Toutefois, c’est dans la mer que se trouvent les énergies qui manquent
au territoire turc, peu producteur d’hydrocarbures, et dont le pouvoir d’Ankara veut s’emparer au détriment de ses
voisins. Les énormes réserves de gaz off-shore découvertes et prouvées dans les années 1990-2000 en Méditerranée
orientale (Chypre, mer Égée, Égypte, Palestine-Gaza, Israël, Liban, Syrie), évaluées à 50 milliards de mètres cubes,
constituent un enjeu quasiment vital pour Ankara, d’où le contentieux croissant avec les États riverains partageant
ces eaux. Les deux pays les plus directement visés par les appétits géoénergétiques turcs sont la Grèce et Chypre.
Anticipant les revendications d’Ankara, la république de Chypre – dont 37 % du nord est occupé illégalement depuis
1974 par l’armée turque – avait certes délimité sa frontière maritime avec l’Égypte dès 2004, avec le Liban en 2007,
avec Israël en 2010, et elle signa plusieurs accords avec des sociétés pétrolières internationales comme l’italienne
o
Eni, la française Total, les américaines Noble Energy ou ExxonMobil et la britannique BP (voir carte n 7). Mais le
problème n’a pas pu être résolu sur la base des accords internationaux et les principes du droit de la mer : la Turquie
ne reconnaît pas la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, pourtant reconnue par tous les pays de
l’Union européenne, car elle accorderait, selon Ankara, beaucoup trop peu de souveraineté sur les eaux et îles
avoisinantes à la Turquie. Le gouvernement turc prétend ainsi avoir été injustement « exclu » des marchés des
forages qui impliquent Israël, où les champs gaziers Leviathan et Tamar ont été découverts. Il conteste de ce fait
toutes les frontières maritimes et délimitations entre Chypre, la Grèce et les pays arabes ou Israël, et il affirme en
o
particulier que ni la république de Chypre (non reconnue par Ankara, voir carte n 12), ni les îles grecques de Crète
o
et de mer Égée n’ont droit à des ZEE larges comme celles définies jusqu’alors (voir carte n 7). Comme le pouvoir
de Pékin en mer de Chine méridionale, le régime d’Ankara conteste donc les frontières maritimes établies et
revendique un redécoupage des ZEE, de gré ou de force, comme on l’a vu depuis 2018. La narration turque permet
de revendiquer la moitié des eaux et réserves de gaz off-shore de Méditerranée orientale au détriment des autres pays
riverains et elle sert à légitimer ses forages illégaux et ses actions visant à empêcher, manu militari, les forages
légalement entrepris par les pays riverains…
Conflit avec Chypre et la Grèce
Pour la Turquie, les accords d’exploitations légaux signés par Chypre avec ses voisins ne « représenteraient »
que la partie non turque de Chypre, une accusation rejetée par Nicosie qui déplore que la présence turque dans le
o
36
nord est le fruit d’une invasion (opération Attila, 1974, voir carte n 12) et d’une occupation illégale . Le 22 février
2018, la marine turque a ainsi envoyé quatre navires protégés par son aviation militaire dans le périmètre de l’île
d’Aphrodite pour prospecter et extraire illégalement du gaz, et elle en a même chassé manu militari un navire de
forage du pétrolier italien Eni qui se rendait au champ gazier égyptien de Zohr. Les navires turcs ont empêché la
plate-forme navale de l’Eni (Saipem 12000) de forer dans le sud de Chypre, zone off-shore qui avait déjà été mise
« sous embargo » par la Turquie le 9 février 2018 avec l’envoi de cinq navires de guerre turcs. Début octobre 2019,
Ankara a envoyé à nouveau son navire de forage Yavuz, opéré par la compagnie étatique turque TPAO, sur le bloc
o
de forage off-shore n 7, pourtant octroyé initialement à l’italienne Eni et à la française Total par la république de
o
Chypre (voir carte n 7). La Turquie a donc ainsi violé la légalité et la souveraineté chypriote. La France a été alors
le seul pays de l’UE (hors Grèce) à se montrer diplomatiquement, politiquement et militairement solidaire de Chypre
qui dénonce les forages illégaux turcs au sud de l’île (zones 7 et 8) en violation totale du droit international
maritime.
La Grèce est également contestée dans ses frontières maritimes mêmes : Ankara remet régulièrement en
question le traité de Lausanne, fondateur de la Turquie post-ottomane, qui accordait à la Grèce 43 % des espaces
marins en mer Égée. Cette dénonciation des frontières internationalement reconnues fait de plus en plus planer sur la
Grèce, le pire scénario : celui de l’invasion d’îles grecques égéennes survolées illégalement chaque jour par
l’aviation turque. Ankara menace en effet régulièrement d’envahir des îles grecques si un nouveau partage des eaux
territoriales à son avantage n’est pas mis en œuvre. Cette revendication remet dangereusement en cause le droit de la
mer et les frontières internationalement reconnues entre la Turquie et ses voisins. Athènes dénonce également le
récent accord turco-libyen controversé, signé en 2019, relatif au partage des espaces maritimes entre Ankara et le
gouvernement de Tripoli et qui vise en fait à accroître considérablement la souveraineté maritime de la Turquie en
Méditerranée dans une large zone située entre la Crète et Chypre qui regorge de gaz et où Ankara a effectué des
o
forages exploratoires. (Voir carte n 5). Ces forages illégaux ont été dénoncés par l’Union européenne, qui a menacé
er
en vain Ankara de sanctions. À ce propos, il est instructif de visionner l’audition, le 1
juillet 2020, de
37
l’ambassadeur de Turquie, Ismaïl Hakki Musa, à la commission des Affaires étrangères du Sénat . Le diplomate y
reconnaît que son pays revendique officiellement un plus grand domaine maritime (zones économiques exclusives)
au détriment de deux pays membres de l’UE – Chypre et la Grèce – et qu’il conteste carrément le tracé des frontières
issues du traité de 1923. L’ambassadeur expose ainsi courtoisement la vision turque irrédentiste officielle
décomplexée et justifie les repérages et forages illégaux des navires pétroliers et gaziers turcs dans les eaux
souveraines de Chypre et des îles grecques égéennes. Le 21 juillet 2020, la marine turque a d’ailleurs dépêché dixhuit navires de guerre dans les eaux territoriales grecques chargés « d’escorter » un pavillon de recherche
d’hydrocarbures sous-marin prospectant illégalement les réserves de gaz autour de l’île grecque de Kastellorizo.
Affaire à suivre…
Conflit avec l’Égypte autour de la Méditerranée et de la Libye
Sachant que Chypre et l’Égypte ont conclu un important accord portant sur la construction du premier pipeline
sous-marin transportant du gaz naturel chypriote depuis le gisement off-shore « Aphrodite » jusqu’en Égypte, qui le
transformera en gaz naturel liquéfié, l’Égypte a dû envoyer en février 2018 son porte-hélicoptères Mistral Anouar el
Sadate et des sous-marins pour défendre le champ gazier égyptien de Zohr revendiqué par la Turquie. Les deux pays
s’opposent aussi – et même surtout – au sujet de la Libye, tant pour le pétrole terrestre que pour le gaz off-shore,
l’enjeu étant gigantesque et la mer entrant en scène sur deux plans complémentaires. Outre le fait que, depuis le
printemps 2020, la Turquie d’Erdoğan a pris fait et cause pour les milices des Frères musulmans de Misrata et pour
le régime ouest-libyen de Fayez al-Sarraj – en soi un casus belli pour Le Caire qui mène une guerre interne totale
contre les partisans de l’ancien Président frériste déchu et défunt, Mohamed Morsi –, la défense par la Turquie du
régime de Tripoli a une dimension bien plus concrète et géoénergétique : le 27 novembre 2019, Ankara et Tripoli
ont signé un accord turco-libyen de (re)délimitation des eaux de mer Méditerranée orientale qui attribue illégalement
près de 40 % de cette mer à la Turquie, au détriment des ZEE de la Grèce, de la république de Chypre, et de
o
l’Égypte (voir carte n 7). Face à l’activisme turc grandissant en Méditerranée orientale, Nicosie, Athènes et
Le Caire tentent de constituer un front commun, tandis que la France, très isolée au sein des pays de l’UE et de
l’Otan, y a renforcé momentanément sa présence militaire mi-août 2020 avec le déploiement de deux chasseurs
Rafale en Crète et de deux navires de guerre (frégate La Fayette et porte-hélicoptères Tonnerre, en route vers
Beyrouth), en soutien à la Grèce et à Chypre, qui ont des accords de défense avec Paris. Ankara et Le Caire
s’opposent également autour du territoire palestinien de Gaza (contrôlé par le groupe frère musulman terroriste
Hamas), dont la mer alentour dispose aussi d’une importante réserve de gaz. La Turquie y soutient opportunément
ce mouvement islamiste radical, fortement combattu en revanche par l’Égypte, qui considère Gaza comme une
chasse gardée, tout comme le considère la Turquie d’Erdoğan, ennemi personnel du président égyptien al-Sissi…
Tout est lié, et les velléités propalestiniennes et antisionistes du néosultan Erdoğan à Gaza, présentées comme une
« défense des musulmans opprimés », ne sont pas étrangères aux ambitions à la fois néo-impériales ottomanistes du
reis turc et aux appétits géoéconomiques d’Ankara…
De l’Asie centrale au Golfe arabo-persique
On peut également citer l’exemple de la mer d’Aral, située en Asie centrale, plus précisément entre le
Kazakhstan et l’Ouzbékistan, qui a bien failli disparaître durant l’ère soviétique. Motivé par la culture du coton
destinée à l’industrie textile, le détournement, par les pays riverains, des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria – qui
alimentent normalement la mer d’Aral – a entraîné une privation par cette dernière de ses sources vitales.
Au Yémen, les enjeux autour de l’eau sont dramatiques et la situation est empirée par le conflit qui oppose, au
niveau régional, l’Iran à l’Arabie saoudite, puis, au niveau local, les forces chiites séparatistes houthies au pouvoir
sunnite élu – sans oublier les groupes djihadistes liés à Aqpa (al-Qaida au Yémen) et Daesh. Différentes forces
combattantes terroristes et criminelles utilisent en fait une grande partie des ressources du pays en eau pour produire
une drogue, « le qat », qui consommerait entre 40 et 50 % de l’eau liée à l’agriculture. En conséquence de la guerre
civile endémique et de cette narco-industrie, les nappes phréatiques sont extrêmement polluées, ce qui entraîne un
grave manque d’eau potable : sur les 24 millions d’habitants au Yémen, 13 millions n’y ont pas accès pas plus qu’à
un assainissement correct de l’eau, maintes maladies se répandent ainsi, de sorte que chaque année, 3 000 personnes
meurent de diarrhée et de famine, ceci dans la quasi-indifférence générale des politiques et médias occidentaux qui
sont les obligés des monarchies islamistes sunnites du Golfe et dont le sort des civils chiites accusés de connivence
avec l’Iran ne suscite pas outre mesure la compassion…
De gros contentieux sont également observés autour de la répartition des débits du Nil. Ce dernier, avant
d’alimenter l’Égypte et le Soudan, traverse et irrigue une dizaine de pays (Soudan du Sud, Érythrée, Éthiopie,
Kenya, Ouganda, République démocratique du Congo, et même Rwanda, Burundi et Tanzanie). Et la plupart d’entre
eux sont soumis, comme l’Égypte, à un rude climat et à une démographie explosive, par conséquent à une
augmentation exponentielle des besoins en eau. Le barrage d’Assouan a ainsi provoqué un grave litige ainsi que des
tensions croissantes entre l’Égypte et le Soudan, notamment à propos de la répartition de l’eau, car il a en effet
conduit à la création du lac Nasser, situé en grande majorité en Égypte avec une petite partie au Soudan (500 km de
long dont 150 au Soudan). La majeure partie de l’eau est donc à disposition et sous contrôle de l’Égypte.
Quant à l’Éthiopie, son contentieux fluvial avec l’Égypte risque de façon récurrente de déboucher sur une
guerre : la goutte qui a fait déborder le vase a été, en 2011 (pendant le printemps arabe égyptien), la construction
d’un énorme barrage hydroélectrique nommé « barrage de la Renaissance » sur sa branche du Nil, probablement le
plus grand d’Afrique et qui devait devenir opérationnel en 2022. Pour l’Égypte, ce projet a comme conséquence
inacceptable de provoquer la baisse de son propre débit et donc de lui faire perdre des ressources en eau pendant la
durée du remplissage du réservoir du barrage, ce qui ne peut être en fin de compte que néfaste pour son agriculture.
Par ailleurs, l’Éthiopie refuse toute implication de l’Égypte dans le chantier. Le ton est de nouveau monté en 2019,
lorsque le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a déclaré, lors d’une séance de questions-réponses au
Parlement : « Aucune force ne pourrait empêcher l’Éthiopie de construire le barrage… Un quart de la population est
38
pauvre et jeune, donc nous pourrions en mobiliser des millions s’il le faut . » Le président égyptien Abdel Fattah alSissi a rétorqué aux Nations unies : « l’Égypte ne laissera jamais Addis-Abeba imposer une situation de fait », et il a
même menacé l’Éthiopie d’une réplique militaire… Plus récemment, en mai 2021, l’Égypte a reçu le soutien
inconditionnel du Soudan pour faire face à l’Éthiopie au cas où cette dernière ne mettrait pas un terme au
remplissage du grand barrage de la Renaissance après l’expiration de l’ultimatum égyptien (juin 2021). Si l’Éthiopie
persiste, une guerre ouverte peut être déclenchée par l’Égypte, pour qui la privation d’une partie du débit du Nil est
une question existentielle. Les conséquences humanitaires et géopolitiques pour toute l’Afrique de l’Est et du Nord,
et même au niveau mondial, seraient dramatiques en raison des interdépendances entre les risques stratégiques,
migratoires, énergétiques, terroristes et de la centralité du Nil, du canal de Suez, de la mer Rouge et du détroit de
Bab el-Mandeb dans le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques.
La Chine à la conquête de la puissance maritime et des ressources
subaquatiques
Les guerres de l’eau ne se limitent pas, loin s’en faut, à la nécessité vitale de l’approvisionnement aquatique
pour survivre, se nourrir, se laver, ou pour entretenir l’agriculture et l’industrie, car les océans et les mers regorgent
de métaux précieux et de réserves d’hydrocarbures. Le spectaculaire développement économique de la Chine ces
dernières années l’a poussé à développer sa puissance diplomatique et bien évidemment militaire dans le monde et
plus particulièrement en mer de Chine du Sud, comme déjà évoqué au début de cet ouvrage. Cette zone est très
stratégique pour la Chine, comme pour d’autres pays, car un tiers des transports maritimes mondiaux transite par la
mer de Chine méridionale. La nation qui aura la mainmise sur cette zone contrôlera donc l’une des routes
commerciales les plus importantes. Ceci est fondamental pour l’objectif de la Chine (parallèlement aux routes de la
soie) de disposer de toutes les ressources que ces eaux recèlent. La mer de Chine abriterait en effet de réserves
39
d’hydrocarbures équivalentes à 5 380 milliards de mètres cubes de gaz et 11 milliards de barils de pétrole .
Toute la zone est par conséquent devenue un théâtre de rivalité, principalement entre, d’une part, les États-Unis
et leurs alliés du Sud-Est asiatique et, de l’autre, le pouvoir chinois qui y voit une zone stratégique qui lui
appartiendrait de droit : l’empire du Milieu y revendique 90 % des eaux potentiellement riches en hydrocarbures et
traversées par des voies maritimes de première importance, et Washington y perçoit un danger pour ses alliés dans la
région ainsi qu’une menace directe contre sa flotte navale présente. La Chine y a donc déployé ses troupes, elle y
patrouille et y réalise régulièrement des exercices militaires croissants en vue d’intimider ses rivaux. Sa stratégie
consiste à s’approprier progressivement des îlots, archipels ou espaces maritimes stratégiques afin d’asseoir ses
revendications territoriales. Le gouvernement de Pékin a réussi depuis quelques années à s’y implanter
40
physiquement avec la construction d’îles artificielles appelées la « grande muraille de sable ». Dans l’archipel des
Spratleys, la Chine a ainsi construit 7 îles artificielles abritant des canons antiaériens, des missiles et des drones et
capables d’accueillir 24 avions de chasse par île, soit 72 avions. Ceci semble assez éloigné de l’usage civil que Pékin
affiche pour ces îles… Dans les Paracels, la Chine a également construit, en 2014, une base avec une piste
41
d’atterrissage et un port, autre pierre d’achoppement majeure avec le Viêtnam, notamment … En fait, le
gouvernement chinois a profité de la pandémie mondiale et de l’attention généralisée des États-Unis et autres pays
sur le virus pour renforcer ses positions en mer de Chine du Sud. Le 3 mars 2020, un bâtiment des garde-côtes
chinois a ainsi éperonné et coulé un navire de pêcheurs vietnamien dans le secteur des îles Paracels. Une semaine
plus tard, le porte-avions chinois Liaoning a traversé deux fois le détroit de Miyako, situé dans ZEE du Japon. Le
pouvoir de Pékin a également installé dans la même période deux centres de recherche dans les îles Spratleys (voir
o
carte n 6). L’édification d’îles artificielles a été clairement une stratégie payante pour la Chine qui subvertit ce
qu’on appelle le « droit de la mer » en revendiquant une souveraineté sur ce qu’elle considère comme étant sa mer
territoriale, soit 12 milles et une ZEE s’étendant jusqu’à 200 milles autour de chaque récif aménagé. Ceci donne à
Pékin un libre accès aux ressources halieutiques et à l’exploitation du sol et du sous-sol. Dans le cadre d’une tension
ascendante, début août 2020, les États-Unis et la Chine ont successivement effectué des exercices militaires en tirant
plusieurs missiles balistiques. Le risque à l’avenir pourrait même être une escalade militaire entre les deux
superpuissances, voire un conflit armé qui, en plus d’impliquer la Chine et les États-Unis, associerait également
leurs alliés respectifs, notamment le Japon, l’Indonésie, les Philippines, Taiwan, la Thaïlande ou le Viêtnam.
1. En anglais, IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change.
2. Quarante gaz à effet de serre sont recensés par le Giec : vapeur d’eau (H2O) ; dioxyde de carbone (CO2) ; méthane (CH4) ; ozone (O3) ;
protoxyde d’azote (N2O) ; hydrofluorocarbure (HFC) ; perfluorocarbures (PFC) ; hexafluorure de soufre (SF6).
3. Morgan Freeman (1923-2020), scientifique ayant reçu vingt et un titres de docteur honoris causa, ex-membre de la Royal Society et de
l’Académie nationale des sciences américaine, critique l’alarmisme sur le climat, lié selon lui à un manque de validité des modèles informatiques
utilisés et fondé sur des prévisions non vérifiées.
4. Trois cents millions de tonnes de CO2 émises ; 18,6 millions d’hectares brûlés (15 fois l’Île-de-France), 5 900 bâtiments détruits, 100 000
évacués, 500 morts, 4 000 hospitalisés. Trois milliards d’animaux tués/impactés (rapport WWF de juillet 2020).
5. Revenir dans l’accord suppose de réduire de 26 à 28 % les émissions de GES du pays d’ici à 2025. Un défi pour ce deuxième plus gros émetteur
de GES responsable de 17 % de la pollution mondiale (après la Chine, 20 %).
6. Il souhaitait lancer les travaux de rénovation énergétique pour des millions de bâtiments afin d’épargner des dizaines de millions de barils de
pétrole, créant des millions d’emplois, améliorant la santé des citoyens et nettoyant l’environnement.
7. Le terme « éco-civilisation » (« EC ») vient d’ailleurs d’être inscrit dans la Constitution chinoise dans le cadre d’une révision constitutionnelle
approuvée, en mars 2018, par l’Assemblée populaire nationale.
8. « Les 100 jours de Joe Biden : “De quelle ampleur sera la politique de transformation énergétique ?” », Le Monde, 26 mars 2021.
9. Elle représentait alors 9,4 % du total de la consommation mondiale. En 2018, elle est passée à 19,3 %.
10. Le coût du solaire photovoltaïque a baissé de 50 % entre 2020 et 2015 et une autre diminution de 60 % est à prévoir d’ici 2025, d’après l’Irena –
Agence internationale de l’énergie renouvelable.
11. Rapport du CDP (Carbon Disclosure Project) : Climate Change Report. Major Risk or Rosy Opportunity, 2019.
12. Source : Statistiques de la compagnie parapétrolière Baker Hughes (Houston).
13. Annonce du 10 décembre 2019, source : Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).
14. Dans les années 2000, l’UE et les EU appuyaient le projet de gazoduc Nabucco devant alimenter l’Europe avec du gaz de la mer Caspienne et
d’Asie centrale afin de réduire la dépendance de l’UE vis-à-vis de la Russie.
15. Le groupe suisse Allseas, impliqué dans les travaux, a ainsi suspendu son activité par crainte de sanctions, voire d’une saisie des avoirs
américains de la compagnie.
16. Voir Alexandre Del Valle, Les Vrais Ennemis de l’Occident, op. cit.
17. Construction des nouveaux réacteurs AP1000 de Vogtle en 2013, et Watts Bar, dans le Tennessee, en 2016.
18. Fukushima (2011), vingt-cinq ans après celle de Tchernobyl (1986) et trente-deux ans après l’accident de Three Miles Island aux EU (1979).
19. « Premier dragon » en mandarin.
20. Daniele La Porta Arrobas et Kirsten Lori Hund (coll.), The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future, World Bank
Group, juin 2017.
21. Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui libèrent, 10 janvier
2018.
22. Programme stratégique chinois visant à faire de la Chine un leader industriel haut de gamme en développement les technologies axées sur
l’innovation tout en réduisant certaines dépendances vis-à-vis des puissances étrangères.
23. Louis Torres Tailfer, « Les terres rares, un enjeu géopolitique sino-américain », La Tribune, 25 août 2019.
24. En 2018, il y avait 10 mines de fer, 20 mines de cuivre (dont certaines produisaient également du cobalt) et 14 mines d’or exploitées et
totalement ou partiellement contrôlées par des investisseurs chinois.
25. Magnus Ericsson, Olof Löfet Anton Löf, « Chinese Control over African and Global Mining–Past, Present and Future », Mineral Economics,
vol. 33, 22 juillet 2020.
26. Henri-Louis Vedie, « Les investissements miniers chinois en Afrique », OCP Policy Center, avril 2017.
27. Après une demande d’aide financière chinoise, le Sri Lanka n’a pas pu rembourser ses dettes envers la Chine et a dû céder le port d’Hambantota
aux Chinois pour quatre-vingt-dix-neuf ans avec 6 000 ha de terrains autour.
28. Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares, op. cit.
29. Données des Nations unies, voir site officiel : www.un.org/fr.
30. IDMC, Rapport mondial sur le déplacement interne 2019, PDF téléchargeable sur le site de l’IDMC : www.internal-displacement.org.
31. Le Pnud, programme et fonds de l’ONU, est l’un des principaux organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la pauvreté
et réduire les inégalités et l’exclusion.
32. Et les deux protocoles d’accords internationaux de l’ONU qui les interdisent n’ont pas été ratifiés par nombre de pays et n’ont aucune valeur
dissuasive pour les pays souverains qui préfèrent rectifier des délimitations de ZEE par la force que de se soumettre à une quelconque juridiction ou
entente internationale de toute façon non contraignante.
33. Pascal Le Pautremat, Géopolitique de l’eau, L’Esprit du temps, 2020.
34. Le territoire turc reçoit du gaz iranien, azerbaïdjanais, turkmène et russe, et la Turquie couvre 60 % de sa consommation par du gaz russe.
Ankara a tenté de persuader Tel-Aviv de faire passer le gaz israélien et chypriote par la Turquie, en échange d’eau turque passant par Chypre à
destination d’Israël.
35. Le gazoduc pourra acheminer chaque année 31,5 milliards de mètres cubes de gaz.
36. Les 37 % du nord de Chypre (« prétendue République turque du nord de Chypre », nom que l’ONU emploie officiellement) n’ont en effet
jamais été reconnus par l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’UE.
er
37. « L’ambassadeur de Turquie s’explique face aux sénateurs : une audition sous haute tension », 1 juillet 2020, site du Sénat français :
www.publicsenat.fr/article/politique/l-ambassadeur-de-turquie-s-explique-face-aux-senateurs-une-audition-sous-haute.
38. « Tension élevée entre l’Égypte et l’Éthiopie autour du projet de méga-barrage sur le Nil », Le Monde, 24 octobre 2019.
er
39. Hortense Goulard, « Les tensions sino-américaines en mer de Chine en cinq questions », Les Échos, 1 septembre 2020.
40. Patrick Saint-Paul, « Pékin construit une “grande muraille de sable” en Mer de Chine », Le Figaro, 13 avril 2015.
41. Julien Licourt, « La Chine construit des îles artificielles pour revendiquer des zones maritimes », Le Figaro, 10 février 2015.
PARTIE III
NOUVEAUX DÉFIS
CHAPITRE XI
Les défis démographiques
« L’inflation démographique a pour corollaire la guerre totale. »
Gaston Bouthoul
« Si fondamentaux sont les problèmes de population qu’ils prennent de terribles revanches sur ceux qui les
ignorent. »
Alfred Sauvy
1/ L’explosion démographique. De quelques chiffres édifiants
D’après les estimations les plus fréquemment évoquées, la population mondiale s’élevait à 300 millions d’êtres
au début de l’ère chrétienne, 700 millions en 1750, 1,4 milliard en 1850, 2 milliards en 1930, 5 milliards en 1990,
6 milliards en 2000, 7 milliards en 2010, et le cap des 7,55 milliards d’âmes a été franchi en 2019. La population
devrait augmenter de quelque 90 millions de personnes par an ou, plus symboliquement encore, de quelque
250 000 individus par jour. Cet essor démographique totalement hors contrôle et exponentiel est sans précédent.
e
Rappelons que cette progression est restée relativement lente jusqu’au milieu du XV siècle et à la grande Révolution
industrielle qu’a connue l’Europe de l’Ouest. Ensuite, les choses se sont accélérées sous l’effet de la colonisation
puis du développement sous influence occidentale qui a apporté d’importants progrès médicaux dont les effets
immédiats ont été de diminuer la mortalité infantile, sans toutefois que l’évolution des mœurs ne suive et n’implique
un contrôle des naissances, principalement en terres africaine et musulmane où cette politique s’est toujours heurtée
aux mentalités fortement natalistes. De ce fait, la mondialisation et les échanges entre le Nord et le Sud, à la suite de
la colonisation, n’ont fait qu’accentuer l’énorme décalage, potentiellement explosif, entre, d’une part, une dénatalité
quasi suicidaire de la civilisation occidentale – surtout de la vieille Europe, dévitalisée par son hédonisme inhérent à
la « mcworldisation » et son individualisme anomique – et, de l’autre, une surnatalité du monde islamique, africain
(sahelo-saharien) et, dans une certaine mesure, indien. Cette surnatalité hors contrôle alimente inévitablement à son
tour des migrations massives de peuplement, elles-mêmes favorisées par les instances mondiales onusiennes,
européennes et par la doxa droits-de-l’hommiste des élites occidentales mondialisées. Le contrôle des naissances n’a
donc pas suivi la baisse desdits taux de mortalité et l’accroissement naturel a amorcé une expansion de plus en plus
spectaculaire.
Ceci dit, depuis un tiers de siècle, les spécialistes de la démographie – science ô combien complexe et parfois
paradoxale – constatent que l’accroissement annuel s’est également en partie ralenti : 10 % en 1970, 9 % en 1980,
8 % en 1995, 7 % en 2000, 6,5 % en 2010 et 6 % en 2015 ; à moyen terme, la population du globe (hypothèse basse,
voir infra) pourrait se stabiliser. Cependant, le phénomène de déclin relatif est à mettre exclusivement au crédit (ou
au débit, si l’on préfère) des pays développés. Certaines nations « en voie de développement » ont vu récemment
(voir supra) leur taux de fécondité diminuer légèrement mais cette transition démographique reste encore modeste,
eu égard à la chute brutale de leurs taux de mortalité, et elle concerne bien plus l’Asie et l’Amérique latine que
l’Afrique et le monde islamique… D’une manière générale, l’évolution démographique résulte arithmétiquement du
solde entre accroissement naturel et migrations. Les chiffres liés à ces dernières (voir infra) incitent à la prudence
quant aux appréciations des projections de la population mondiale proposées par les experts. Cependant, au-delà
1
d’imprécisions incontournables, les données proposées notamment par l’ONU sont tout à fait parlantes .
Explosion de la population mondiale
2
D’après les prévisions des statistiques démographiques des Nations unies comme d’après celles de l’Institut
3
national d’études démographiques , la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes au cours
des trente prochaines années, passant de 7,7 milliards actuellement à 8,5 milliards en 2040, à 9,7 milliards entre
2050 et 2075, et elle pourrait atteindre un nombre proche de 11,2 milliards d’individus vers l’an 2100. Au cours de
ce siècle, avec 2 milliards de personnes supplémentaires sur la planète en 40 ans, le monde sera confronté aux effets
de la plus grande explosion démographique de l’histoire de l’humanité. Des milliards d’êtres humains dans le monde
feront de plus en plus face à la soif, à la faim, et aux conflits qui en découlent.
Le ministre indien de la Santé, Ghulam Nabi Azad, déclarait de ce fait en 2011 qu’une population mondiale de
7 milliards d’êtres humains « ne doit pas nous réjouir mais nous inquiéter ». Il est clair que pour nombre d’analystes,
si nous ne parvenons pas à désamorcer la bombe démographique, nous ferons face à un avenir de pauvreté
croissante, de pénuries alimentaires, de conflits et de dégradation de l’environnement. Une véritable bombe à
retardement. Plus de bouches à nourrir et les changements alimentaires impliqueront : un doublement de la
production agricole en quatre décennies, une augmentation de 30 % de la consommation d’eau d’ici 2030, et au
milieu du siècle, des logements urbains pour 3 autres milliards de personnes. À cela s’ajoute le besoin d’énergie
pour soutenir la croissance économique dans les pays post-industriels, industriels et nouvellement industrialisés, en
tenant compte d’une demande qui doublera d’ici 2050.
Part dans la population mondiale (%) et par zone géographique
1950
1970
1990
2010
2017
Europe
21,7
17,8
13,5
10,6
9,8
Asie
55,3
57,7
60,4
60,2
59,6
Amériques
13,5
14,1
13,7
13,6
13,5
Afrique
9,0
9,9
11,9
15,1
16,6
Océanie
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Le déséquilibre démographique international
Face à l’hiver démographique européen, le monde doit faire face à l’explosion démographique africaine. Pas de
juste milieu. D’un point de vue géopolitique, la démographie peut avoir des effets déstabilisateurs ou engendrer des
changements de rapport de force entre les États. La taille démographique peut donc avoir un impact direct sur le
poids politique des États et parfois en termes de violences et même de guerre. « La grande majorité des guerres
civiles depuis les années 1970 sont intervenues dans les pays connaissant des croissances démographiques
importantes. Les cas de l’Irlande du Nord, du Sri Lanka, du Liban, de l’Algérie, de la Tchétchénie, du Kosovo, du
Rwanda, du Congo, pour citer quelques exemples. Plusieurs des révoltes arabes (Tunisie, Yémen, Maroc, Libye,
4
Syrie, Égypte) sont intervenues dans des pays connaissant la même situation . » Dans les années 1970, la forte
croissance de la population musulmane au Liban avait conduit l’élite maronite à adopter des réactions défensives,
tandis que l’afflux massif de réfugiés palestiniens (à la surnatalité islamique) contribua à la déstabilisation du pays.
Par ailleurs, lorsqu’une très grande partie de la population est jeune, surtout en pays pauvres, cela crée une
opportunité pour des groupes terroristes, des milices ou des organisations criminelles qui disposent ainsi d’une
importante ressource humaine facile à soudoyer et susceptible d’accroître leurs activités.
Les disparités de l’accroissement naturel sont, par définition, le reflet de celles que l’on peut noter au chapitre
des taux de natalité et à celui des taux de mortalité. Là encore, les chiffres publiés par l’ONU s’avèrent tout à fait
édifiants. Les taux de natalité varient en effet (chiffres de 2018) de 49,6 ‰ au Niger à 8,10 ‰ au Japon, donc d’un
rapport de quasiment 1 à 6 ! La Iiste des dix premiers États du globe souligne de manière criante le rôle du natalisme
et de ses causes sociétales dans des pays pauvres où, c’est le moins que l’on puisse dire, la contraception est loin
d’être entrée dans les mœurs. Ainsi, plus de la moitié de la croissance démographique dans le monde d’ici à 2050
aura lieu sur le continent africain avec la population d’Afrique subsaharienne, qui devrait doubler d’ici là. On y
constate ainsi des taux de natalité par femme extrêmement élevés, le record étant détenu par le Niger, avec 7,4 entre
2010 et 2015, suivi par la Somalie (6,6), la RDC (6,4), l’Angola et le Burundi (6,0), l’Ouganda (5,9) et le Nigeria
(5,7).
L’Afrique devrait capter 52 % de la croissance démographique mondiale d’ici 2050 (soit 1,05 milliard
5
d’habitants supplémentaires ). L’Inde devrait dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé du monde en 2022.
Le Nigeria devrait voir sa population doubler par rapport à aujourd’hui pour atteindre environ 410 millions
e
6
d’habitants en 2050 et devenir le 3 pays le plus peuplé du monde . Cela créera une pression considérable pour
l’augmentation de la production alimentaire nationale, ainsi que pour l’eau et pour les sources d’énergie. Combinées
aux tensions sociales et politiques résultant d’une urbanisation incontrôlée et d’une expansion dramatique des
bidonvilles de banlieue, cela pourrait donner lieu à des conflits internes et frontaliers, déstabilisant de ce fait les
routes du commerce international et conduisant à des migrations massives de zones de conflits vers des régions plus
stables, comme l’Europe, avec les problèmes socio-économiques et civilisationnels que l’on imagine.
L’hiver démographique des Occidentaux et d’une partie de l’Asie ?
« L’hiver démographique » est un terme certes fort, mais loin d’être irréaliste. Il a été introduit par Michel
Schooyans, professeur à l’Université catholique de Louvain, pour décrire le vieillissement ou l’augmentation de
l’âge moyen de la population, principalement en Europe et au Japon. Michel Rocard, à l’issue de la conférence dite
« famille », du 20 janvier 1989, a quant à lui déclaré : « La plupart des États d’Europe occidentale sont prédisposés à
7
se suicider, un suicide démographique . » On sait qu’un pays doit théoriquement maintenir un taux de natalité de
2,1 enfants par femme pour remplacer sa population actuelle. Cependant, en Europe, le taux de natalité est en
moyenne de 1,3 et l’on estime que d’ici 2030, l’Europe aura un déficit de 20 millions d’habitants. Dans le même
temps, la Russie devrait perdre un tiers de sa population actuelle d’ici 2050. De nombreux pays n’ont pas assez de
jeunes pour renouveler leur population et ainsi faire face au fardeau économique du vieillissement. En Italie par
8
exemple, de 2008 à 2019, les naissances sont passées de 576 000 à 420 084 par an. Depuis 2007, le bilan naturel est
négatif : la moitié des femmes en âge de procréer n’a même pas d’enfants. Certaines des régions les plus riches de la
planète – notamment le Japon, la Corée, l’Espagne, l’Italie et une grande partie de l’Europe de l’Est – perdent des
habitants chaque année. « Nous sommes un pays mourant », déclarait ainsi en 2015 Beatrice Lorenzin, ministre
italienne de la Santé. Les États européens, qui combinent à la fois la faiblesse quantitative de tels flux et un
comportement démographique national malthusien, ont ainsi contribué à l’apparition concrète d’une
quasi-« révolution » en se dotant désormais du statut de pays à « décroissance démographique absolue » : il s’agit
notamment de l’Ukraine, de la Hongrie, de la Roumanie, ( – 0,4 %), de la Croatie, de la Biélorussie ( – 0,2 %), de la
Lettonie, de la Serbie et de la Bulgarie ( – 0,1 %), toutes anciennes démocraties populaires, auxquelles il faut
ajouter, mais ce n’est plus guère une surprise, l’Allemagne et le Japon ( – 0,2 %). Ce phénomène – gravissime à
moyen et long termes – ne semble pas préoccuper outre mesure les élites dirigeantes occidentales, excepté quelques
populistes honnis, car elles comptent depuis des décennies sur l’immigration de peuplement de masse – malgré les
problèmes socioculturels et sécuritaires associés – plutôt que d’adopter des politiques natalistes, considérées comme
réactionnaires ou attentatoires aux acquis des femmes et des individus, cela alors même que tous les experts savent
que l’immigration ne règle pas le problème du vieillissement, mais prive le Sud de ses élites, cadres, et ouvriers
qualifiés, ainsi que nous le verrons plus bas.
Russie, trop grande trop vide…
La Russie est de loin le plus grand pays du monde, mais sa population est en déclin potentiel, à peine freinée
par la politique démographique très généreuse mise en œuvre il y a dix ans et par une forte immigration issue des
anciennes républiques soviétiques. Avec une superficie de dix-sept millions de kilomètres carrés, la Russie couvre
11,4 % des terres émergées de la planète, mais les 147 millions de personnes qui y habitent représentent moins de
2 % de la population mondiale. Son immensité signifie une abondance de ressources naturelles, mais la population
clairsemée et inégale est aussi son talon d’Achille géopolitique, aggravée par le choc démographique causé par la
chute du régime soviétique et par le détachement des nouvelles républiques de la Baltique, de l’Europe de l’Est et de
l’Asie. Si l’on examine les indicateurs démographiques de la Russie, de 1950 à aujourd’hui, on observe que la
population est passée de 103 millions en 1950 à 148 au début des années 1990, ralentissant progressivement ; elle
est ensuite passée à 143 millions (avec une reprise ultérieure jusqu’à 147 millions aujourd’hui, notamment due à
l’arrivée de migrants d’Asie centrale et de l’annexion de la Crimée en 2014). Depuis la chute de l’URSS, la baisse
dramatique de la natalité s’est aggravée d’une augmentation de la mortalité due à la crise sociale et sanitaire,
partiellement compensée par une immigration nette soutenue. L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) russe, qui
est à peine de 1,2 ou 1,3 enfant par femme au tournant du siècle – soit bien inférieur au minimum vital de 2,1 –, a été
considéré par le gouvernement de Vladimir Poutine depuis les années 2000 comme un des pires dangers pour le
pays sur les moyen et long termes. Le Président russe est conscient qu’une nation dotée du plus grand territoire au
monde ne pourra pas longtemps le sécuriser et le contrôler sans un repeuplement nataliste face à des empires rivaux
et des voisins revanchards comme la Chine ou les puissances islamiques. Il déclare ainsi régulièrement dans des
discours : « un pays aussi vaste [que la Russie] devrait avoir au moins 500 millions d’habitants », et il a tenté avec
des succès mitigés, depuis 2007, de lancer une politique nataliste. Celle-ci s’est traduite par une reprise (avec un pic
de 1,7 en 2015) que beaucoup considèrent toutefois comme transitoire. Et l’immigration en provenance de Chine,
vue comme une menace à long terme pour la Sibérie russe – jadis chinoise – encore modeste pour le moment, se fait
sentir sur un territoire qui a besoin de main-d’œuvre, de technologie, de populations et d’investissements.
La démographie, un facteur critique pour l’alimentation
La préoccupation primordiale concernant l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture est de savoir si les
systèmes mondiaux seront en mesure de nourrir durablement l’humanité jusqu’à 2050 et au-delà. En effet, nourrir
toute la population en 2050 représente un des défis majeurs futurs sachant que, selon l’OMS, 690 millions de
9
personnes ont souffert de la faim en 2019 . Poussée par une mondialisation excessive, la demande mondiale de
produits agricoles continue de croître sous l’effet des changements alimentaires, de la croissance démographique, de
la hausse des revenus et de l’urbanisation accrue. L’amélioration des conditions de vie entraîne une consommation
10
supplémentaire, voire une surconsommation et du gaspillage , ce qui demande une hausse de la production,
provoquant des dégâts collatéraux considérables, comme la dégradation des terres, la déforestation, la
surexploitation des eaux souterraines, les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation excessive de pesticides ayant
un impact non négligeable sur la population (comme la culture du soja au Brésil ou en Argentine), la perte de la
biodiversité et la pollution des masses d’eau. Non seulement l’agriculture affecte l’environnement et contribue aux
changements climatiques, mais c’est aussi l’un des secteurs les plus touchés…
11
Comme expliqué par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO ), la
croissance de la production agricole est freinée par la rareté accrue et la diminution de la qualité des terres et des
ressources en eau, car évidemment, ce qui peut être produit dépendra de la disponibilité et de la productivité des
ressources, et notamment de la terre et de l’eau. Ces ressources sont déjà sous pression et, bien que les progrès
techniques aient permis d’accroître la productivité, ou du moins la croissance des rendements des cultures, ralentit.
De plus, la perte et le gaspillage exercent une pression inutile sur les ressources en terres, en eau et en énergie le
long de la chaîne de valeur alimentaire.
12
Taux de natalité en naissance pour 1 000 habitants
Pays (plus haut)
Taux
Pays (plus bas)
Taux
Niger
46,1
Monaco
5,9
Tchad
42,2
Corée du Sud
6,4
Somalie
41,8
Porto Rico
6,7
Mali
41,5
Italie
7,3
Congo (RDC)
41,2
Japon
7,4
Angola
40,7
Espagne
7,9
Burundi
39,0
Grèce
8,1
Gambie
38,5
Bosnie-Herzégovine
8,1
Ouganda
38,1
Portugal
8,5
Burkina Faso et Nigeria
37,9
Finlande
8,6
À l’exception de l’Afghanistan (et de son contexte géopolitique particulièrement spécifique), le « Top ten » des
pays à très fort taux de natalité est monopolisé par l’Afrique subsaharienne. A contrario, la liste des dix derniers
États du globe révèle l’omniprésence du monde occidental d’économie libérale et des anciennes démocraties
populaires.
On peut évoquer trois catégories de pays concernant la situation démographique :
Les économies postindustrielles matures, à l’opposé des pays africains étudiés plus haut et de l’Inde,
sont largement caractérisées par des populations stables ou en déclin. Par exemple, le nombre d’habitants
de l’Union européenne devrait diminuer de 20 % d’ici 2100. Ce pourcentage pourrait être revu à la baisse
si l’immigration augmente ou si l’on prend en compte la présence d’immigrés non naturalisés ou
clandestins installés durablement et prévus dans l’UE d’ici à 2100. La proportion des 60 ans ou plus
atteint aujourd’hui 13 %. Les populations d’une cinquantaine de pays vont décliner dans les années qui
13
viennent, notamment en Europe orientale et en Asie de l’Est . La réduction conséquente des jeunes
générations aura diverses implications sur des aspects tels que l’assistance sociale, les soins de santé et la
composition de la main-d’œuvre. Un cauchemar pour les systèmes de retraite et plus généralement pour le
dynamisme économique et la croissance, qui est ralentie ou en récession si le taux est trop faible.
Les économies en développement au dernier stade, actuellement caractérisées par des niveaux élevés
d’industrialisation, connaîtront un ralentissement de la croissance démographique parallèlement à la
croissance de la richesse nationale. Par exemple, en Asie, où vit déjà la moitié de la population mondiale,
la croissance démographique n’augmentera que de 25 %, pour atteindre son apogée en 2065, avant de
reculer de la même manière que certaines économies postindustrielles. Bien que modeste, la croissance
démographique continue de cette région au cours des cinq prochaines décennies, associée aux niveaux
élevés de revenu personnel et de croissance de la richesse, entraînera probablement des tensions
géopolitiques entre certains pays sur les ressources naturelles, telles que les sources d’eau et les matières
premières communes d’abord pour l’industrie.
Les pays récemment en développement et les économies les moins avancées sur le point d’entrer dans la
phase d’industrialisation. Une croissance démographique plus rapide, responsable de la majeure partie de
l’augmentation mondiale jusqu’en 2075, sera la caractéristique clé de ces nations. L’Afrique est la
principale région concernée, de nombreux pays de ce continent pouvant doubler ou tripler leur population
d’ici 2050.
Relativisons les chiffres catastrophiques
Inutile de préciser que ces données (surtout les dernières) doivent être appréhendées avec beaucoup de
prudence. « Le pire n’est jamais certain », et les défis attendus pourraient être relevés avec des techniques déjà
connues et des solutions durables : l’application de méthodes d’ingénierie telles que la biotechnologie ; la
mécanisation et l’automatisation accrues ; la réduction des déchets ; un système de stockage et de distribution
amélioré puis une meilleure gestion de l’eau ; des ressources alimentaires suffisantes. De même, la consommation
future peut être couverte par des améliorations dans la gestion des eaux souterraines, la collecte et le stockage des
eaux pluviales, la réutilisation de l’eau et le dessalement. Par ailleurs, les chiffres alarmistes ne mettent pas en
évidence les tendances démographiques régionales importantes et donc les disparités.
Démographie et Inégalités
Espérance de vie à la naissance (source : Banque mondiale, 2018)
Pays
Espérance de
vie
Pays
Espérance de
vie
1) Hong Kong
84,9
245) République
centrafricaine
52,8
2) Japon
84,2
244) Lesotho
53,7
3) Région de Macao
(Chine)
84,1
243) Tchad
54,0
4) Suisse
83,8
242) Sierra Leone
54,3
5) Espagne
83,4
241) Nigeria
54,3
6) Italie
83,3
240) Somalie
57,1
7) Singapour
83,1
239) Côte d’Ivoire
57,4
8) Liechtenstein
83,0
238) Soudan du Sud
57,6
9) Îles anglo-normandes
82,9
237) Guinée-Bissau
58,0
10) Islande
82,9
236) Guinée équatoriale
58,4
Quatre-vingt-cinq ans pour le Japon, 48 pour la Sierra Leone ou la Centre-Afrique ! Voilà sans doute la plus
scandaleuse des inégalités dans le monde contemporain, en dépit des progrès de la médecine et de leur exportation à
l’échelle de l’ensemble des pays dits « en voie de développement ». La mondialisation n’est pas la même pour tout
le monde…
Cette inégalité devant la mort apparaît aussi au plan qualitatif des causes principales de mortalité à l’échelle du
globe, tel que le montrent des chiffres de l’OMS de 2015.
1) Maladies infectieuses : 29,7 % dont voies respiratoires 6,8 %, sida : 3,1 %, tuberculose : 2,4 %.
2) Cancers : 13 %.
3) Cardiopathies : 12,8 %.
4) Accidents cardio-vasculaires (AVC) : 10,8 %.
5) Sous-nutrition : 5,9 %.
6) Suicides : 1,6 %.
Ce classement masque toutefois des différences flagrantes en changeant d’échelle : dans les pays du Nord, les
cardiopathies apparaissent au premier rang (18,2, %) devant les AVC (12,8 %), les cancers (9,1 %), le diabète
(4,2 %), les maladies neurologiques (4,1 %) et les accidents de la route (2,3 %). En revanche, pour l’ensemble des
États du Sud, ce sont les maladies infectieuses (17,2 %) qui tiennent le haut du pavé, devant les maladies
respiratoires stricto sensu (9,2 %), le sida (4,4 %), la tuberculose (3,2 %) ou le paludisme (2,6 %). Ces inégalités
face aux causes de mortalité sont de toute évidence directement liées au contexte sociétal et à un encadrement
médical plus ou moins dense. Songeons qu’en 2013 (source : OMS), on recensait 1 médecin pour 300 habitants pour
l’ensemble des pays développés et 1 pour plus de 20 000 au sein du monde non développé… Dans ce contexte, il
n’est guère surprenant que des maladies endémiques comme la fièvre jaune, la lèpre, la bilharziose, le paludisme
perdurent, mais que réapparaissent des fléaux que l’on croyait définitivement éradiqués, comme la tuberculose. Audelà de sa valeur symbolique et, à juste titre, très fortement médiatisée, le sida continue de faire des ravages, en
particulier dans la zone intertropicale. Alors que le virus avait été repéré dans un premier temps dans les quartiers
gays de San Francisco, cette infection s’est très vite répandue dans le monde. Certes, aujourd’hui, la situation s’est
stabilisée au sein des pays « nantis ». En revanche, le fléau n’a pas été éradiqué, loin de là, dans les contrées
défavorisées, et particulièrement sur le continent africain. Lors de la première grande conférence mondiale sur le
sida, on a appris que sur 40 millions de personnes porteuses du VIH, 28 millions vivaient sur ce continent ! Et, en
2010 encore, d’après le rapport annuel de la Commission ONUSIDA, l’Afrique subsaharienne comptait plus des
trois quarts des personnes contaminées. En 2017, la même commission citait le chiffre de 70 % ! Un fléau qui n’est
toujours pas combattu de manière responsable !
2/ Les migrations internationales
« Si la démographie dicte le destin de l’histoire, les mouvements de population en sont le moteur. »
Samuel Huntington
L’évocation des « défis démographiques » ne peut, in fine, faire l’impasse sur un phénomène complémentaire :
l’évolution des migrations internationales et leur ampleur récente. La surnatalité dans plusieurs régions du monde ne
va cesser de favoriser toujours plus de migrations, dans le cadre d’une mondialisation des échanges et de la doxa
sans-frontiériste des États providences occidentaux qui créent ainsi des appels d’air. Cela aura des conséquences
majeures sur le volume des populations concentrées dans les villes et posera aussi des gros problèmes de gestion, de
contrôle et d’intégration aux pays d’accueil des migrants, sans oublier les pays touchés par une hausse massive des
flux de réfugiés de guerre (Liban, Jordanie, Turquie, notamment). Cet essor démographique est un sérieux défi, dont
la nécessité d’intégrer ces populations dans le marché du travail et de leur fournir une éducation de qualité et des
services de santé dont elles auront besoin pour être productives, mais que la crise et le chômage en Europe rendent
de plus en plus difficiles. Les pays d’accueil sont d’ailleurs appelés de façon récurrente par les instances onusiennes
et européennes (Pacte mondial sur les migrations des Nations unies – PMM – dit « pacte Marrakech » de
décembre 2018 ; dépénalisation des migrations clandestines voulue par l’ONU et l’UE, etc.) à créer les
infrastructures nécessaires pour soutenir l’emploi, le logement et la sécurité sociale des immigrés désirés ou non
(illégaux, faux et vrais demandeurs d’asile, vrais ou faux mineurs non accompagnés, réfugiés économiques,
migrants légaux, etc.). Or cet appel d’air, difficilement supportable pour les pays européens en crise économique et
frappés par le chômage, ne peut pas ne pas créer des tensions sociales et politiques que la montée des populismes
rend manifestes.
Face aux répercussions négatives de la baisse de la natalité, qui frappe surtout l’Occident, le Japon, la Russie et
la Chine, certains réclament des politiques publiques natalistes, mais les dirigeants et les élites d’Occident, inhibés
par un vrai tabou démographique et culpabilisés par les groupes de pression malthusiens, woke et féministes
radicaux, les présentent comme impossibles, inutiles ou inacceptables, en raison de l’obsession connue des
totalitaires (notamment nazi-fascistes ou islamistes) de procréer en masse. Pour beaucoup, la solution au problème
du déclin démographique serait donc d’importer massivement des populations étrangères pour combler le manque
de jeunesse et payer les futures retraites. Cette idée, chère au Premier ministre canadien diversitaire, Justin Trudeau,
implique l’acceptation du multiculturalisme, lequel peut poser des problèmes de compatibilité et donc
d’antagonismes communautaires dès lors que, par principe, les élites multiculturalistes d’Occident se refusent de
conduire une politique d’immigration culturellement compatible. La question de l’islamisation radicale des
métropoles industrielles occidentales est à cet égard le révélateur le plus flagrant de cette bombe géocivilisationnelle
à retardement.
En 2018, les Nations unies estimaient qu’il y avait quelque 260 millions de migrants internationaux à travers le
globe, soit 3,5 % de la population mondiale (une augmentation de plus de 40 % depuis le début de ce nouveau
siècle). Bien sûr, il y a migrants et migrants, et si les médias font prioritairement allusion aux « réfugiés politiques »
(et à leur sort généralement peu enviable), leur poids dans les données statistiques est faible : moins de 20 millions
de réfugiés dans le monde, dont 15 millions en situation de guerre (voir supra). Les plus gros contingents
d’immigrés concernent en réalité essentiellement les migrants économiques qui alimentent les flux du « sud vers le
nord » (près de 120 millions) et du « sud vers le sud », moins souvent évoqués, bien que quantitativement
comparables (110 millions). Toutefois, les États providences d’Europe de l’Ouest ont créé un tel appel d’air que
nombre d’immigrés extra-européens choisissent le Vieux Continent en raison des droits et avantages accordés par
principe aux non-citoyens, même illégaux, et que leurs propres pays d’origine n’offriront jamais, pas plus que les
richissimes monarchies islamiques du Golfe. Ces dernières, bien que de même religion que nombre d’immigrés, ne
connaissent pas la culpabilisation postcoloniale de l’Europe de l’Ouest et ne se sentent pas solidaires des masses
afro-musulmanes, pas plus d’ailleurs que des démocraties non européennes comme le Japon ou la Corée du Sud, ou
encore les pays ex-communistes d’Europe orientale. En 2018, la moitié des migrants internationaux à l’échelle
mondiale est née en Asie, notamment dans le sous-continent indien, mais c’est l’Afrique qui présente les chiffres les
plus élevés, avec 85 % de personnes originaires d’un autre État africain et, tout étant relatif, moins de 15 % pour
ceux qui tentent, de manière parfois dramatique, d’atteindre l’Eldorado européen. Encore faut-il aussi distinguer,
parmi les migrants économiques, deux grands types de profils : la masse des braceros dépourvus de toute
qualification, les déshérités venant, dans un premier temps, se réfugier dans les banlieues de métropoles, puis tentant
l’aventure vers les pays riches ; et les personnels qualifiés nourrissant le flux du célèbre « brain drain », un « exode
des cerveaux » qui contribue au dynamisme des nations développées du Nord. Cette perte de compétences locales
contribue en fait au non-développement des pays quittés par leurs propres forces vives. Cela a été notamment
fortement dénoncé par le cardinal guinéen Robert Sarah, en Afrique ou par le dalaï-lama au niveau mondial. En
septembre 2018, le prélat tubétain déclarait à Malmö, en Suède, que « l’Europe appartient aux Européens » et qu’à
14
terme il était souhaitable que les réfugiés « retournent chez eux pour reconstruire leur propre pays ». Quant au
cardinal Sarah, il fustigeait en novembre 2019 une Europe qui prétendait pouvoir faire face au tsunami migratoire,
refusant de voir que le bateau était déjà prêt à couler : « Ceci est irresponsable sur le plan économique : accueillir, ce
n’est pas seulement laisser entrer les gens, c’est leur donner du travail, or comment offrir un travail aux nouveaux
arrivants, alors qu’en 2020, 16 millions d’Européens sont au chômage ? Si finalement, les migrants obtiennent un
travail, ce pourrait être au détriment des Européens eux-mêmes ; ou bien, au prix de conditions de travail
déplorables. » Ainsi, cette migration massive pourrait même bien aboutir à l’établissement d’un « nouvel
15
esclavage », conclut-il. En investissant des sommes astronomiques dans l’accueil des migrants, y compris illégaux
ou hostiles aux valeurs occidentales pluralistes, l’Europe crée donc un appel d’air, et se donne à voir comme un
Eldorado qu’elle n’est plus, au lieu de régler les problèmes de pauvreté et de conflits en Afrique en aidant à son
16
développement. L’idée de « plan Marshall pour l’Afrique », notamment développée par l’expert international
Me Jean-Michel Nogueroles, permettrait à sa population de ne pas avoir à émigrer. Tout l’argent dépensé dans les
prestations sociales accordées aux migrants, notamment clandestins, en Europe pourrait en effet, s’il était investi
dans une optique de développement durable, permettre à de nombreux habitants africains d’avoir, par exemple,
accès à l’électricité ou à des services d’hygiène décents.
L’autre problème, rarement évoqué, est que les pays d’origine supportent les dépenses considérables liées à
l’éducation du futur migrant et n’en tirent aucun bénéfice, au contraire du pays d’accueil. Songeons, par exemple,
que deux Prix Nobel américains sur cinq sont nés hors des États-Unis ! Mais si le phénomène du brain drain
n’ignore pas les pays membres de l’Union européenne, ces derniers doivent surtout faire face aujourd’hui à
l’accélération brutale des flux migratoires, notamment clandestins, en provenance du continent africain, via la mer
Méditerranée. Près de 3,5 millions de personnes venues des pays pauvres ont immigré au sein de pays membres de
l’UE en 2018, et 2 millions ont quitté l’un de ses États membres. En 2018, selon la Commission européenne, c’est
l’Allemagne qui comptait le plus grand nombre de non-nationaux (8,8 millions) devant le Royaume-Uni (5,7),
l’Italie (5,2), I’Espagne (4,6) et la France (4,2).
« Préparez Venus viendra Mars… »
On doit cette formule à Gaston Bouthoul, qui consacra dans son traité majeur un long chapitre aux dimensions
démographiques des guerres. Selon lui, les États disposent en permanence de jeunes hommes dont l’économie peut
se passer, et lorsque la natalité est incontrôlée et le surplus de jeunes trop important, la situation « démoéconomique » devient « une structure explosive », la guerre nécessitant toujours la « consommation » ou le
17
« sacrifice » de ce surplus d’hommes. Ils forment alors ce que Bouthoul appelle une « force perturbatrice »
utilisable pour la guerre ou les conquêtes. Certes, le raisonnement de Bouthoul, alors banal, choquerait les esprits
politiquement corrects d’aujourd’hui, le thème de l’immigration ayant été accaparé par les mouvements populistes
antimigrants et par l’extrême gauche immigrationniste, de sorte qu’aborder en sortant de cette polarisation
manichéenne est peu aisé. Il est en effet devenu de bon ton de n’appréhender les phénomènes de l’immigration que
de manière positive et victimaire. La polémologie, l’histoire des civilisations et la stratégie sont bien plus neutres et
réalistes de ce point de vue, car tout comme la mondialisation, désoccultée dans ce livre, l’immigration peut être
analysée comme un phénomène neutre qui peut tout autant apporter des richesses à un État et enrichir une société
que créer des difficultés de coexistence et de cohérence civilisationnelle. Selon Bouthoul, la guerre revêtant un
caractère pulsionnel de conquête et les pertes qu’elle engendre entraînant la mort d’individus jeunes, les flux de
migrants (a fortiori issus de pays anciennement colonisés et travaillés par des visions revanchardes postcoloniales ou
et antioccidentales, en l’occurrence islamistes) « peuvent être utilisés à l’expansion brusque, dont les deux formes
18
classiques sont la migration en groupe et l’expédition guerrière ». Certes, Bouthoul précise que la natalité ne
constitue pas le facteur unique dans la genèse des guerres et que la guerre est le fruit de déséquilibres socioéconomiques, mais il souligne que l’élément démographique s’ajoute de façon déterminante aux autres causes qu’est
le rôle des « mentalités », des idéologies, de l’environnement culturel et, bien sûr, de l’intention des dirigeants
d’exploiter les « structures explosives ». On songe, bien sûr, à l’islamisme radical.
Le lien entre immigration, sécurité, démographie et géopolitique est donc évident. De ce point de vue, la
combinaison du fait que l’Union européenne est entrée en phase de dépopulation depuis les années 2010 (sa
population n’augmente que du fait de l’immigration extra-européenne) et que l’immigration familiale, illégale et
d’asile est devenue difficilement contrôlable, aura des conséquences sociopolitiques et civilisationnelles sur les pays
d’Europe les plus concernés. L’« Europe élargie » (donc en incluant les ex-républiques soviétiques hors Asie
centrale) est dans le monde le seul ensemble géocivilisationnel qui va décliner d’ici à 2030-2040. À ce double
phénomène d’immigration de peuplement (regroupement familial) et de dénatalité s’ajoutent les phénomènes de la
hausse de la mortalité (alcoolisme, déclin des systèmes de santé, en Russie, en Europe orientale et
méditerranéenne…) puis des difficultés d’intégration des communautés musulmanes subsahariennes, turques et
maghrébines. Le malaise ressenti par les populations, exprimé par des votes dits « populistes », ne doit pas être sousestimé ou simplement ignoré par principe pour ne « pas faire le jeu des extrêmes », car c’est justement le meilleur
moyen d’attiser les réactions radicales, complotistes, et la défiance croissante envers les dirigeants en place qui
omettent la question identitaire et démographique. Les réactions populaires en Italie, en Autriche, en Hongrie ou en
Grèce face aux flots de réfugiés des années 2015-2017 entrent dans ce contexte hautement sismique tout comme
l’inquiétant phénomène des abstentions électorales en Europe qui n’augurent rien de bon pour l’avenir des
démocraties libérales.
Les conséquences sociopolitiques et géocivilisationnelles de
l’immigration
Les partisans de la mondialisation heureuse et de l’ouverture par principe affirment que le phénomène
migratoire est toujours une chance et est bon en soi. Pareille attitude ne tient pas compte du fait que l’immigration ne
peut être perçue comme un simple remède pour régler le problème des retraites d’Européens inféconds (vision
d’ailleurs assez méprisante envers les migrants), et qu’elle a forcément des conséquences sociales, sécuritaires et
culturelles. Si nombre d’immigrés sont certes des travailleurs acharnés sans lesquels des filières comme, la
restauration, l’hôtellerie, le bâtiment, ou même l’agriculture connaîtraient des difficultés de recrutement, en
revanche, nombre d’entre ceux dont l’émigration est motivée par les aides sociales octroyées par les États
providences européens sont quant à eux peu productifs. Ce problème n’est pas dû à l’immigration en elle-même, qui
peut être fort positive lorsqu’elle est intégrée, assimilée, donc choisie et productive, mais au caractère non sélectif et
de moins en moins choisie de la politique d’immigration en Europe, dominée, depuis l’arrêt officiel de
l’immigration de travail en 1975, par le regroupement familial, les flux clandestins non désirés et les demandes
d’asile largement détournées. Les coûts humains, économiques et sociétaux du traitement de la délinquance et des
difficultés d’intégration qui résultent de cette non-politique d’immigration hors contrôle sont devenus exorbitants
dans plusieurs pays européens, même si cela concerne surtout l’immigration postcoloniale issue d’Afrique noire et
maghrébine et beaucoup moins l’immigration latino-américaine et surtout asiatique. Secundo, si l’objectif utilitaire
des migrations n’avait pour but que de compenser la dénatalité des habitants « de souche » – ce qui n’est pas le cas –
les flux nécessaires seraient bien plus massifs et donc ingérables, et par conséquent encore plus explosifs : selon les
estimations des Nations unies et de l’Union européenne, onze millions de nouveaux migrants par an seraient
nécessaires pour maintenir la population active européenne à l’horizon 2050, avec sur le long terme des dépenses
sociales impossibles à financer (formation, éducation, intégration, sécurité, retraites et santé). La « fermeture des
frontières » est certes illusoire, mais les pays européens pourraient mieux maîtriser les flux migratoires dans le cadre
d’une immigration légale et choisie, faute de quoi les conflits identitaires autour de cette question risquent d’être un
jour hors contrôle. Par ailleurs, présenter l’immigration extra-européenne comme une fatalité ou une
« compensation » postcoloniale est irresponsable, quand on sait que le « surplus » de jeunes à absorber, selon les
termes de Bouthoul, représentera pour l’Afrique au moins un milliard d’individus en plus dans trente ans. De plus,
l’immigration de masse ne concerne pas seulement les plus pauvres des Africains, mais aussi des forces vives et
intellectuelles qui vont manquer aux pays d’origine, ce qui empêchera une stabilisation et un développement du
pays. En Italie, la fondation Farefuturo, qui a réalisé une étude sur les nouveaux flux migratoires depuis les
années 1990, a observé que près de 80 % des demandeurs d’asile et plus de 60 % des migrants légaux bénéficiant
des mesures de regroupement familial professent la foi musulmane (voir Michèle Tribalat, op. cit.), or face à un
monde musulman « réislamisé » de façon ultraconservatrice (islamisme politique), les sociétés d’accueil
européennes ne peuvent pas être étanchéisées par magie et ne peuvent pas éviter les conséquences prévisibles, à
savoir hériter des problèmes des pays afro-musulmans : islamisme radical, djihadisme, sort peu enviable des
femmes, polygamie, rapports problématiques à la laïcité (voir affaires Charlie Hebdo, Mila, etc.) et aux droits des
minorités (judéophobie, christianophobie, athéophobie, condamnation à mort des apostats et des polythéistes dans la
charia, etc.).
Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes
D’après la Commission européenne, le nombre total de migrants – non éligibles au statut de réfugiés
19
politiques – arrivés entre 2015 et 2020 sur son territoire s’élèverait à 2 millions . Ce chiffre est vraisemblablement
en dessous de la réalité, car rien qu’en France, sur la période du seul quinquennat, le nombre total d’immigrés
(légaux ou illégaux) durablement installés et profitant de nombreuses aides – toujours plus coûteuses pour les
collectivités publiques – avoisinerait les 2 millions de personnes, soit une moyenne de 350 000 à 400 000 personnes
par an. Ce chiffre a notamment été avancé par le député européen et ex-ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, qui
20
a recoupé les données des ministères compétents et ceux de l’Insee . Sur plusieurs décennies, le total accumulé
s’apparente à une « immigration de peuplement » qui ne peut que contribuer à changer progressivement le tissu
social et civilisationnel du pays, donc son identité nationale même, ce qui n’est pas un simple détail que les
responsables politiques peuvent se permettre de négliger.
En 2019, l’immigration due au regroupement familial (90 502 titres de séjour) ainsi que les titres accordés aux
étudiants (90 336), quasiment équivalents, ont été les principales filières, suivies des titres accordés aux demandeurs
d’asile, en augmentation (voir infra) – environ 36 275 demandes acceptées en 2019 et 24 118 en 2020. Les premiers
pays d’origine de l’immigration (titres de séjour délivrés en 2019) étaient le Maroc, en tête, suivi de l’Algérie, de la
Tunisie, de la Chine et de la Côte d’Ivoire. Curieusement, l’immigration dite « économique », officielle, donc
désirée, ne représente qu’un peu plus de 13 % du nombre total de titres, soit 32 815. Enfin, environ 20 000 titres de
séjour dans le cadre du « passeport talent » ont été délivrés la même année. De ce fait, si l’on additionne ces
255 000 entrées légales aux estimations d’entrées illégales précédemment évoquées, nous atteignons le nombre de
400 000 nouveaux immigrés par an, sachant que moins de 10 % des immigrés clandestins sont effectivement
reconduits dans leur pays après des mesures d’expulsion, et que l’immigration clandestine tend à être dépénalisée
dans les pays de l’UE. À ces centaines de milliers d’immigrés qui arrivent chaque année – et qui s’ajoutent à ceux
précédemment arrivés puisque la plupart restent sur le territoire français –, il faut additionner le nombre de
naturalisés, soit 80 000 personnes en 2018, selon le ministère de l’Intérieur.
Spécialiste des questions migratoires, la démographe française Michèle Tribalat, directeur de recherche à
l’Ined, apporte quelques précisions assez difficilement réfutables sur les chiffres liés au nombre d’étrangers et de
Français issus de l’immigration. Sachant que la population d’origine étrangère, dans la statistique publique, désigne
« l’ensemble formé par les immigrés (personnes nées à l’étranger, qu’elles aient encore une nationalité étrangère ou
qu’elles soient devenues françaises depuis leur arrivée en France) et les personnes nées en France d’au moins un
parent immigré », elle rappelle que, selon les derniers chiffres connus de l’Insee (issus de l’enquête Emploi et de
l’enquête annuelle de recensement, 2015), 20,1 % des Français de France métropolitaine seraient d’origine partielle
ou pleinement étrangère, un taux qui monte à 42,1 % en région francilienne pour les jeunes de moins de 18 ans.
Avec Bernard Aubry, Tribalat a mené nombre d’enquêtes détaillées sur ces sujets, et les deux chercheurs en ont
21
conclu que depuis 2015, 1,3 million de jeunes en Île-de-France seraient issus de l’immigration .
D’une manière générale, d’après les chiffres de l’Ofii (l’Office français de l’immigration et de l’intégration), la
France compterait environ 10 % d’immigrés actuellement, bien loin des 6,5 % souvent cités. Toutefois, d’après la
démographe Michèle Tribalat, 20 millions de citoyens français seraient en fait d’origine étrangère (au moins un
parent né à l’étranger et non français ou fils de parents non français nés à l’étranger), soit 4 fois plus qu’il y a une
vingtaine d’années. Cette augmentation continue – excepté durant la première année de la Covid – est en fait le
résultat d’une combinaison de facteurs objectifs et subjectifs : 1/ la pression des lobbys et instances nationales et
internationales qui poussent à ouvrir les frontières aux migrants – quels qu’ils soient – et à dépénaliser l’immigration
illégale puis à accorder à ces derniers les mêmes droits et aides économiques que ceux normalement réservés aux
citoyens autochtones et aux migrants réguliers ; 2/ le laxisme judiciaire qui bloque 90 % des expulsions de migrants
illégaux et faux réfugiés ; 3/ le contournement croissant du droit d’asile ; 4/ le refus d’une immigration choisie et la
généralisation du droit du sol, du regroupement familial et de l’accueil des demandeurs d’asile, souvent faux, au
détriment d’une immigration économique ciblée et concertée.
Le droit d’asile, principal prétexte à la migration clandestine
Dans un entretien accordé au Figaro, Michèle Tribalat estimait l’immigration illégale à partir de
« recoupements de chiffres (interpellations, placements en centre de rétention, aide médicale d’État, déboutés du
droit d’asile) à 200 000 à 400 000 personnes ». Quant à l’ex-ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, il avait évalué,
fin 2017, le nombre total d’étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire français à 300 000. Cette
estimation – minimaliste –, basée sur des statistiques de l’Insee et sur le nombre de bénéficiaires de l’AME (aide
médicale d’État), n’est cependant pas suffisante, puisqu’elle ne tient pas compte de l’ensemble de la population
étrangère en situation d’irrégularité en France dont une partie ne se déclare pas à l’AME. Depuis les années 2000, la
moyenne des arrivées de clandestins se situant autour de 80 000 à 140 000 par an, le nombre cumulé d’immigrés
clandestins est en fait bien plus proche du million, sans même compter les centaines de milliers d’étrangers arrivés
de façon illégale depuis les années 1970 qui ont été régularisés, et qui ont de ce fait disparu des statistiques
concernant les illégaux et les étrangers. Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l’Immigration,
22
donne au moins 900 000 étrangers séjournant illégalement sur le territoire français . D’une manière générale,
durant la dernière décennie, les arrivées illégales directes ont augmenté partout en Europe, particulièrement avec la
« crise des migrants » ouverte en 2015. Les filières passent essentiellement par trois grandes zones aux frontières
méridionales de l’UE : les côtes grecques de la mer Égée ; les îles du sud de l’Italie ; le détroit de Gibraltar et les
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, récemment prises d’assaut par des milliers de migrants sahéliens et
maghrébins (mai 2021), suite à une brouille entre l’Espagne et le Maroc. Les immigrés ainsi entrés tendent ensuite à
se disperser dans le continent. Depuis des décennies, le nombre de demandes est en constante progression : +7,3 %
entre 2018 et 2021. La France est ainsi devenue le pays d’Europe le plus « attractif », avec 154 620 demandes
23
enregistrées en 2019, contre environ 120 000 en Allemagne . On sait par ailleurs que 85 % des demandeurs d’asile
déboutés restent et ne sont presque jamais reconduits dans leurs pays. Selon le préfet François Lucas, « le
doublement des demandes ces cinq dernières années révèle un détournement de la procédure, pas seulement une
24
faillite du système Dublin. Il s’agit en effet de migrations économiques ». En d’autres termes, il existe un « stock »
de demandeurs d’asile déboutés, qui restent et ne sont pas reconduits. En 2015 déjà, la Cour des comptes annonçait
que 96 % des déboutés du droit d’asile resteraient sur le territoire français.
Toutefois, on notera qu’à la suite de la crise sanitaire, les chiffres de demandes d’asile et en général de
l’immigration ont connu un ralentissement relatif et prévisible en Europe, avec une baisse de 33 % en 2020. En
France, quelque 95 600 demandes d’asile, mineurs inclus, ont été introduites à l’Ofpra, soit une baisse de 28 % par
rapport à 2019. Parmi ces demandes, 86 620 étaient des premières candidatures et 8 830 des réexamens. Précisons
que ce chiffre, tout de même impressionnant malgré la crise sanitaire et son lot de mesures de confinements et
restrictions des voyages, n’inclut pas les demandes enregistrées en préfecture et placées en procédure dite « Dublin »
sous prétexte que la France n’est pas responsable de leur examen, et dont l’Ofpra ne peut légalement être saisi. En
2020 et 2021, les principaux pays de provenance des primo-demandeurs d’asile demeurent l’Afghanistan, la Guinée,
le Bangladesh, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Turquie et le Pakistan, les demandes de ressortissants de Géorgie et
25
d’Albanie ayant commencé à diminuer . L’ensemble des pays africains représenterait 40 % des requêtes. L’Ofpra
notait ainsi « une progression notable de la demande en provenance de pays d’Afrique de l’Ouest comme la Côte
d’Ivoire et la Guinée ». Quant aux Syriens, dont les médias et lobbys promigrants parlent en permanence pour
légitimer, par leur drame, la cause des demandeurs d’asile arrivés illégalement – très souvent de faux réfugiés
politiques –, ils sont très peu représentés. Selon la même source, sur ces 138 420 demandes d’asile, seulement
33 330 ont été acceptées, ce qui signifie qu’environ 100 000 personnes se sont vu refuser ce droit, sans toutefois
jamais quitter la France, et ce malgré les notifications d’obligation de quitter le territoire.
Le tabou du coût de l’immigration
Quant au coût annuel de l’immigration, dans le contexte d’un État providence très généreux en France – à
savoir la différence entre ce qu’elle rapporte et ce qu’elle coûte –, certains experts l’évaluent – avec chacun des
critères fort différents – entre 5 et 70 milliards d’euros. Ces chiffres les plus maximalistes, étonnants et vivement
contestés par les partisans de l’immigration de masse, sont pourtant le fruit d’études qui ajoutent aux coûts
« classiques » des migrations illégales les dépenses inhérentes, directes et indirectes, aux aides (logement, santé,
justice…) et au traitement social et sécuritaire de l’immigration. Pour les estimations les plus minimalistes, un
rapport de la Cour des comptes publié le 5 mai 2020 a évalué les coûts « de l’entrée, du séjour et du premier accueil
des personnes étrangères en France » pour l’année 2019 à 6,57 milliards d’euros, un montant qui n’a pas pris en
compte le coût des dépenses sociales (assurance maladie, retraites et aides sociales de droit commun en général, type
RSA ou APL), de celles liées à la justice et à la politique de sécurité, et la prise en charge des mineurs isolés par les
collectivités locales. Ainsi, le 22 janvier 2020, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de
l’Assemblée nationale a souligné, dans un rapport relatif à l’évaluation des coûts et bénéfices de l’immigration en
matière économique et sociale, que le document de la Cour des comptes a sous-évalué les coûts de scolarisation des
26
enfants immigrés par le ministère de l’Éducation nationale . Par exemple, si l’Éducation nationale avance le chiffre
de 161 millions d’euros pour les coûts de l’immigration dans son domaine d’action publique, le ministère de
l’Enseignement supérieur évoque la somme de 2,2 milliards d’euros, correspondant aux 10,6 % d’étudiants étrangers
du secteur public. Quant aux coûts inhérents à la police aux frontières et ceux des infractions pénales spécifiques
relevant du séjour sur le territoire (exemple : refus d’exécuter une mesure d’éloignement), la police nationale a
avancé le chiffre de 1,2 milliard d’euros en 2020 pour ce seul poste. De la même manière, une étude publiée par le
Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii, service de recherche économique rattaché au
27
Premier ministre ), intitulée L’Impact budgétaire de 30 ans d’immigration en France, avait déjà estimé en 2011 le
coût de l’immigration à 1,64 point de pourcentage de PIB, soit, ramené à l’année 2019, l’équivalent de 40 milliards
d’euros, sachant que le phénomène migratoire n’a cessé de s’accroître depuis dix ans. Et cette étude n’est pas la plus
maximaliste puisqu’elle exclut par principe les coûts de l’immigration irrégulière, pourtant en hausse depuis des
décennies et surtout depuis 2015. Ces coûts sont évalués à 1 milliard annuel pour l’AME et 2 milliards par an pour
28
les 50 000 mineurs non accompagnés (MNA), chiffres confirmés par un rapport du Sénat en 2021 . La Cour des
comptes déplore d’ailleurs le détournement des demandes d’asile qui expliquerait un tiers de la progression des
coûts ainsi que l’aide médicale d’État (un cinquième). Les magistrats précisent que ces dépenses exorbitantes ne
peuvent qu’augmenter à l’avenir de façon quasi mécanique en raison de la progression constante (hors année de la
Covid 2021) de l’immigration légale de peuplement (regroupement familial) et de l’immigration illégale, favorisées
par les appels d’air inhérents au droit du sol, à la dépénalisation de la migration clandestine, au regroupement
familial, et aux aides d’État indiscriminées, qui ne connaissent aucune restriction sensible. Sur un quinquennat et sur
ces bases, certains ont chiffré le montant à plus de 50 milliards d’euros de dépenses publiques liées à l’immigration
au total.
Pause migratoire ?
C’est en s’appuyant sur les chiffres évoqués plus haut qu’un certain nombre de responsables politiques – et pas
seulement des « populistes » ou des partis accusés de « xénophobie » – se sont déclarés ces dernières années
favorables à la suppression du droit du sol, principal vecteur de naturalisation de migrants qui ne sont pas toujours
intégrables, et dont une part importante est issue de l’immigration illégale et a été régularisée en masse par la suite
(« circulaire Valls » du 28 novembre 2012). Ainsi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse,
déclarait : « L’acquisition de la nationalité française ne doit plus être automatique. Il faut la demander, la désirer, pas
l’obtenir à 18 ans dans une pochette-surprise », ajoutant : « La France, ça doit être un choix. » D’autres préconisent
de supprimer l’AME ou de la réserver à la prise en charge des maladies les plus graves, sachant qu’elle coûte un
milliard chaque année aux contribuables et qu’elle contribue à faire de la France un pays attractif aux yeux
d’immigrés clandestins attirés « non pas par le plein-emploi mais par la générosité de notre politique sociale »,
poursuivait l’ex-ministre.
Dans les années 1960, le célèbre démographe Alfred Sauvy avertissait que le phénomène de l’immigration de
masse extracommunautaire aurait des conséquences civilisationnelles, sociales, économiques et sécuritaires
majeures, probablement hautement sismiques si des mesures de sélection et de contrôle n’étaient pas prises.
Soixante années plus tard, à l’heure des débats houleux sur les quartiers de non-droit et de non-France, de
l’indigénisme francophobe et de l’islamisme occidentalophobe qui progressent au sein d’une partie de l’immigration
désassimilée et abandonnée par l’État laxiste aux lois des quartiers et des imams intégristes, un sondage de l’institut
29
Ipsos a révélé que 60 % des Français percevraient désormais les migrants comme une « menace », et 45 %
estiment que ces derniers les priveraient de services sociaux. Bref, les immigrés intégrés et l’immigration choisie
paient en termes d’image et de perception négative les dérives de l’immigration non choisie, illégale ou/et non
intégrée.
Le général de Gaulle disait qu’il était « simple d’assimiler un individu, mais difficile d’assimiler un peuple ».
Or si la politique migratoire européenne et française n’est pas réformée dans le sens d’une assimilation exigeante, ce
sont bien des peuples – pour la plupart originaires de civilisations bien différentes – qu’il faudra intégrer de façon
communautariste, l’assimilation se faisant de plus en plus difficilement pour des raisons à la fois de déterminisme
culturel et confessionnel, de nombre et en vertu d’une mondialisation qui permet aux fanatiques du monde islamique
d’embrigader à distance des communautés musulmanes d’Occident. En Europe et en France, une pause migratoire,
comme cela fut le cas aux États-Unis entre 1920 et 1965, suite à la dépression de la fin des années 1920 et 1930,
serait une voie raisonnable qui permettrait de consolider l’intégration des immigrés déjà arrivés en masse et même
d’assimiler ceux qui sont arrivés de longue date ainsi que leurs descendants, trop souvent travaillés par des
puissances étrangères étatiques ou transnationales, notamment islamistes, opposées à l’intégration de leurs
coreligionnaires aux mœurs « impies ». Les propos de l’ancien roi du Maroc, Hassan II, pourtant francophile,
confirment rétrospectivement ce constat d’une intégration compliquée d’un trop grand nombre de personnes venues
d’une civilisation arabo-islamique, parfois antinomique, et donc de l’impératif d’investir plus dans l’assimilation :
« L’intégration est possible entre Européens. La trame est la même, c’est le même continent. Ils [les Marocains] ne
30
seront jamais 100 % français, ils seront de mauvais français, je peux vous l’assurer . » On se souvient de Michel
Rocard et sa fameuse formule : « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce
qu’elle est, une terre d’asile politique […] mais pas plus », avait lancé l’ancien Premier ministre en 1989. Ou de
Georges Marchais, secrétaire général du PCF (Parti communiste français) dans les années 1980, farouchement
opposé à l’immigration de masse qui déclarait (déjà) : « Nous posons le problème de l’immigration. » Ces deux
figures de la gauche alertaient déjà les risques d’une immigration non choisie. Ils n’étaient pourtant ni « fascistes »
ni xénophobes… Une fois de plus, la démarche géopolitique montre que l’irénisme et le manichéisme moralisateur
ne permettent ni de formuler un jugement froid, ni de prévoir les risques et menaces à venir ou en cours de façon
lucide, car l’idéologisation et le tout émotionnel qui domine aujourd’hui nos élites politiques au diapason des modes
médiatiques sont l’ennemie de l’analyse.
1. Jacques Soppelsa, op. cit., supra.
2. Voir site des Nations unies : www.un.org/fr/sections/issues-depth/population/index.html
3. Communiqué de presse, Institut national d’études démographiques, 17 juin 2019.
4. « Le défi démographique : mythes et réalités », Institut Montaigne, juillet 2018.
5. Rapport des Nations unies, World Population Prospects 2019.
6. « Sous pression, le poids de la démographie mondiale », Magazine trimestriel du FMI, mars 2016.
7. Michel Schooyans. Le Crash démographique, Paris, Le Sarment-Fayard, 1999.
8. « Popolazione Italia (2001-2016) Grafici su dati ISTAT », Il Sole 24 ore, 29 novembre 2017.
9. Communiqué de presse de l’OMS, publié le 13 juillet 2020. Voir site de l’Organisation : www.who.int/fr
10. Chaque année, un tiers de la production alimentaire mondiale destinée à la consommation – environ 1,3 milliard de tonnes – est gaspillé. Les
pays industrialisés et en développement gaspillent respectivement 670 millions et 630 millions de tonnes.
11. Rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, The Future of Food and Agriculture, Alternatives Pathways to
2050, 2018.
12. Source : Banque mondiale, 2018, données téléchargeables sur le site de la Banque mondiale : donneesbanquesmondiales.org.
13. « Le défi démographique : mythes et réalités », art. cit.
14. « Migrants : pour le Dalaï-Lama, “l’Europe appartient aux Européens” », Le Parisien, 12 septembre 2018.
15. « Cardinal Sarah : “Ceux que vous accueillez doivent s’intégrer à votre culture” », InfoCatho, 19 avril 2019.
16. Voir Jean-Michel Nogueroles, « Pourquoi il faut un plan Marschall pour l’Afrique », Fild Fildmedia, 9 février 2021.
17. Gaston Bouthoul, Traité de polémologie. Sociologie des guerres, Paris, Payot, 1970, p. 115-120.
o
18. Frédéric Coste, « Bouthoul et la polémologie : l’étude des causes profondes de la guerre », Les Champs de Mars, février 2002, n 12, p. 9-30.
19. L’Inspection générale des affaires sociales (Igas), l’Inspection générale de l’administration (IGA), l’Inspection générale de la justice (IGJ) et
l’ADF évaluent d’ailleurs à 2 milliards d’euros le coût pour les départements par an et ils déplorent qu’au moins « une personne sur deux est évaluée
comme majeure ».
20. L’immigration légale représentant 255 000 entrées par an, si l’on ajoute à ce chiffre les déboutés du droit d’asile (90 000) dont la majorité reste
en France comme indiqué par la Cour des comptes, le chiffre annuel de 350 000 est plus réaliste.
21. Site internet de Michèle Tribalat : www.micheletribalat.fr/439632260.
22. Patrick Stefanini, Immigration. Ces réalités qu’on nous cache, Paris, Robert Laffont, 2020.
23. Cour des comptes, « L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères », 2020, p. 150.
24. Ministère de l’Intérieur, « L’essentiel de l’immigration », 21 janvier 2020, www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-etstatistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles.
25. Ministère de l’Intérieur, « Les principales données de l’immigration », 21 janvier 2021.
26. Qui n’impute à la politique d’immigration que le montant des dispositifs fléchés sur des enfants allophones ou issus de familles itinérantes et de
voyageurs (0,5 % des effectifs).
27. Cepii, L’Impact budgétaire de 30 ans d’immigration en France : (I) une approche comptable , document de travail.
28. Marie-Cécile Renault, « Près d’un milliard d’euros pour l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière en 2021 », Le Figaro,
28 septembre 2020.
29. « La France en tête des pays en attente d’un leader “fort” pour “casser les règles” », Ipsos, 13 septembre 2019.
30. Interview d’Hassan II au palais royal de Rabat.
CHAPITRE XII
Puissances multinationales et digitales face aux États
souverains
« De nombreuses rivalités stratégiques sont en train de passer du domaine matériel à celui de l’information dans
la collecte et le traitement des données, la pénétration des réseaux et la manipulation psychologique. Faute de
définition d’un minimum de règles de conduite internationales, la dynamique interne du système provoquera une
1
crise . »
Henry Kissinger
Les multinationales digitales occupent une place à part sur l’échiquier géopolitique mondial de par leur taille,
leur influence, et leur omniprésence dans des sociétés structurées par les technologies de l’information. Forts de ce
constat, certains, comme le politologue Bertrand Badie, affirment que les multinationales, les ONG et organisations
internationales puis les mouvements identitaires et religieux transnationaux auraient détrôné l’État souverain qui ne
2
serait plus la seule unité de base du système international . Ce processus, qu’il appelle le « retournement du
monde », ébranlerait de façon inédite la puissance étatique et provoquerait une crise encore plus large de l’autorité,
l’État-nation n’étant plus capable d’établir les normes faisant consensus.
Nous estimons, quant à nous, que si des entraves croissantes pèsent en effet sur les prérogatives traditionnelles
des États, les acteurs non étatiques « mondialisés » n’affaiblissent que les États les plus faibles ou démissionnaires
de leur souveraineté. Du point de vue géopolitique autant que juridique, l’État-nation souverain demeure le décideur
en premier et dernier ressort : il peut se retirer de n’importe quel traité international, poser, s’il le veut, des règles
strictes et des limites aux ONG, aux multinationales et aux réseaux sociaux, et il est donc capable de rester encore
longtemps l’unité dominante de l’ordre mondial. Notre postulat est que la mondialisation marchande, indéniable,
certes, n’est pas un acteur mais un phénomène neutre, un processus économique, digital, informationnel, et que ses
outils technologiques peuvent autant être des opportunités que des contraintes pour les États qui peuvent en tirer
parti et même accroître leur puissance et leur souveraineté en les utilisant à leur avantage (Chine, États-Unis). Quant
aux firmes multinationales (FMN), aux ONG et aux organisations internationales, elles ne peuvent pas avoir le
dernier mot en tant qu’acteurs face à des États puissants ou/et volontaristes (États-Unis, Chine, Russie, Inde, Brésil,
Japon, Turquie, etc.). Du point de vue réaliste, la mondialisation marchande et digitale peut être vue comme un
immense théâtre de compétition entre nations, et donc d’hyperconcurrence que les « meilleurs » et les plus offensifs
sauront utiliser et canaliser à leur profit…
La puissance des firmes multinationales
Ceci dit, il est indéniable qu’avec la mondialisation marchande et les délocalisations, associées à l’économie
virtuelle et digitale sans frontières, les relations internationales, loin de se limiter aux aspects politiques et
diplomatiques, sont concernées par les réalités économiques et financières, au point que pour certains, les grandes
3
FMN , fruit de l’expansion du capitalisme international, sont considérées comme de nouveaux acteurs à part entière
de la géopolitique et de la nouvelle diplomatie commerciale. Jusqu’à présent, ces firmes n’ont pas fait l’objet de
réglementations internationales et nationales à même de limiter leur pouvoir pourtant souvent concurrent de celui
des États. Or ceux qui ne s’accommodent pas de cela n’ont pas dit leur dernier mot, même s’ils ont souvent un train
de retard…
Aujourd’hui, un peu moins de la moitié des 100 premières puissances économiques mondiales sont des États
(sur 197 reconnus et répertoriés par les Nations unies au total), l’autre moitié est représentée par des entreprises
multinationales. Cela signifie que ces dernières sont bien plus puissantes que de très nombreux États dans le monde.
Un seul exemple suffit à prendre la mesure incroyable de ce pouvoir non étatique : l’enseigne de supermarché
américaine Walmart, la plus grosse entreprise au monde en termes d’effectifs, qui emploie 2,2 millions de personnes
(soit l’équivalent de la population parisienne), réalise un chiffre d’affaires d’environ 524 milliards de dollars, selon
4
le classement de Forbes , c’est-à-dire autant que le PIB de l’Argentine ou de Taiwan… Il existe actuellement dans
le monde quelque 60 000 FMN, qui contrôlent plus de 500 000 filiales, responsables de la moitié des échanges
commerciaux internationaux, en particulier du fait de l’importance du commerce intrafirme (entre les filiales d’une
même entreprise). Grâce à leur forte présence virtuelle, certaines peuvent opérer partout dans le monde sans aucun
ancrage national ; les exemples de Netflix ou Amazon étant les plus évidents.
En ce qui concerne la France, en 2017, les firmes multinationales représentaient 1 % des entreprises des
secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, mais occupaient 49 % des salariés et généraient
57 % de la valeur ajoutée brute produite sur le territoire français. Par conséquent, beaucoup d’emplois en France se
retrouvent sous contrôle étranger : 2,2 millions en 2017 contre 1,8 en 2016, soit 400 000 de plus en une seule année,
principalement dans des entreprises de taille intermédiaire. Ces entreprises sont elles-mêmes contrôlées par des
5
multinationales étrangères d’origine américaine (533 000 emplois) et allemande (324 000 ) et pour
16 800 entreprises, ces emplois concernent en majorité l’industrie. Le développement des FMN et de leur activité est
à la fois la conséquence et l’un des moteurs essentiels de la mondialisation, tandis que, grâce au numérique, ces
firmes transforment le monde et, avec lui, le commerce, dont elles constituent aujourd’hui le vecteur principal par la
rapidité des transactions et l’échange d’informations instantané. Avec la croissance du commerce électronique, qui
ne nécessite aucune présence physique d’entreprises sur le marché d’exportation, les FMN échappent très souvent
aux taxes, et leur activité commerciale est rarement encadrée par des règles multilatérales. En outre, la régulation des
pratiques commerciales est moins du ressort de la législation publique instaurée par les États (soumis au vote
démocratique) que de celui des firmes internationales privées qui instaurent ainsi leur propre ordre parallèle.
Qu’il s’agisse des FMN liées à la finance, à l’industrie pétrolière, à l’automobile, à l’énergie ou aux autres
secteurs dont les domaines digitaux, leur poids économique est tel qu’elles concentrent puis contrôlent la majorité
des marchés et de l’emploi dans certains secteurs. Elles ont la capacité d’influencer les politiques fiscales et sociales
des États. La mise en place des tribunaux d’arbitrage internationaux permet par exemple aux multinationales de
poursuivre un État en justice dans le cas où celui-ci mettrait en place une loi qui réduirait ses prérogatives ou profits.
Les FNM peuvent ainsi faire condamner les États à verser des dédommagements très élevés. Que les pays concernés
soient de grandes puissances ou des pays moins avancés ou en voie de développement, ils subissent presque tous
(excepté peut-être des régimes dictatoriaux et nationalistes comme la Chine) cette « justice » internationale non
étatique et non issue d’accords entre États souverains, non pas en raison d’une fatalité mais d’un habitus et d’une
abdication en réalité réversibles. Les prérogatives exorbitantes du droit public impactent les droits les plus
fondamentaux des citoyens, à commencer par la santé, les droits salariaux, mais aussi l’environnement ou les droits
de l’homme. Un des points de crispation des traités de libre-échange récemment portés par les États-Unis et l’Union
6
européenne comme le Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) concerne d’ailleurs l’introduction du
dispositif dit « d’arbitrage privé », présent dans la majorité des accords commerciaux internationaux. Ce dispositif
est censé garantir une juste impartialité aux investisseurs étrangers afin qu’ils puissent se défendre contre les abus
éventuels des États ou contre des législations trop contraignantes pour eux. Or les arbitres de ces tribunaux ne sont
pas des juges mais des avocats d’affaires qui peuvent être à tour de rôle arbitres, défenseurs d’un État ou d’une
entreprise. Issus d’une élite mondialisée très restreinte, ces avocats donnent logiquement très souvent gain de cause
aux investisseurs. Les entreprises multinationales peuvent donc attaquer un État pour un investissement qui n’a
même pas eu lieu, juste pour le manque à gagner qu’une loi aurait empêché. C’est ainsi qu’en 2016, McDonald’s a
réclamé 17,8 millions d’euros à la ville de Florence uniquement pour le fait de ne pas l’avoir laissé ouvrir un
restaurant sur la place principale !
Les États – surtout ceux dirigés par des élites occidentales libertariennes qui ne luttent pas contre ces abus par
parti pris – voient ainsi une logique économique s’imposer à eux au détriment des décisions de leur pouvoir
législatif et de la souveraineté des peuples. Il est clair que les dédommagements obtenus par les multinationales au
titre du « manque à gagner » cité précédemment peuvent léser les droits des citoyens du fait même de l’effet
dissuasif direct de ces entités sur l’adoption de réglementations jugées trop protectrices des consommateurs et qui
nuiraient aux intérêts financiers des FMN. Par exemple, un État qui ferait adopter une loi visant à éliminer un
produit jugé nocif pour la santé peut être attaqué en justice par l’entreprise multinationale s’estimant lésée. Cela
fonctionne également pour un permis d’exploitation de terres qui viendrait à être annulé par un gouvernement. Avec
ces tribunaux d’arbitrage privé, les multinationales imposent leur volonté, ceci dans le plus grand secret.
D’évidence, les États souverains et leurs dirigeants pourraient, s’il y avait une réelle volonté de reprendre le
contrôle, combattre ce système qui menace leurs prérogatives régaliennes. Cependant, les liens d’intérêts entre
grandes entreprises et gouvernements sont souvent forts, ces derniers étant désireux d’attirer les investissements
étrangers dans leurs pays et ainsi motivés à signer des traités favorables aux multinationales. Cinquante-quatre pays
ont ainsi adopté en 2019 107 mesures relatives à l’investissement étranger dont 76 % visant à libéraliser,
7
promouvoir et faciliter les investissements .
Les multinationales sont souvent qualifiées de footloose, ou « jambes légères », car elles s’installent dans un
pays, récupèrent des subventions et avantages, puis partent ailleurs dès que d’autres pays offrent des conditions
encore plus attractives. Ces multinationales nomades sont de deux types : celles qui s’implantent dans un autre pays
suivant des avantages comparatifs, leur objectif étant de créer une chaîne de valeur transfrontalière pour baisser les
coûts ou accéder à des ressources spécifiques et à des capacités d’innovation d’un pays ou de mains-d’œuvre
hautement qualifiées, puis celles qui cherchent le profit avant tout et dont la logique d’implantation est celle des
portefeuilles de valeurs. Leurs actionnaires sont des entités institutionnelles, des fonds de pensions, des entreprises
hedge funds, des fonds de spéculation, des fonds d’investissement et des private equity. Leur modèle de
développement est le « capitalisme impatient » et footloose, selon lequel les investisseurs cherchent à obtenir des
profits à très court terme, ce qui est aux antipodes du modèle européen qui s’appuie sur le développement des
chaînes de valeur qui nécessitent beaucoup de patience.
Les footloose prolifèrent partout, n’apportent pas toujours de création de valeurs et leur marketing agressif
participe du fait que leurs produits ne sont ni utiles ni vertueux : Coca-Cola, qui nuit à la santé de millions de
personnes et dont la popularité est fondée sur des publicités agressives surfant sur le soft power américain, couvre
par exemple la quasi-totalité de la terre avec ses filiales locales si denses que la firme peut servir la grande
distribution et les magasins de proximité du monde entier. L’idée est celle de l’impérialisme marchand :
commercialiser des produits vides de sens et addictifs.
Délocalisation, fiscalité avantageuse et comportements parfois
criminels
Afin de réduire les dépenses et d’augmenter les bénéfices, les FMN délocalisent leur production pour profiter
des faibles coûts de main-d’œuvre et des normes sociales, environnementales et de sécurité très basses, voire parfois
nulles, offertes par les pays en développement, en particulier ceux d’Asie du Sud-Est et d’Afrique. La chaîne de
production de ces entreprises est aujourd’hui répartie entre de multiples unités là où la main-d’œuvre est la moins
chère, ce qui crée dans le même temps du chômage dans les pays d’origine. Les stratégies de communication et de
marketing se font à l’échelle mondiale et les profits sont localisés dans des paradis fiscaux afin de minimiser
l’impôt. Les FMN en paient en effet bien moins que les firmes locales de plus petite envergure. Elles doivent, certes,
composer avec les lois élaborées dans les États « hôtes », mais celles-ci varient fort d’un pays à un autre et sont plus
ou moins strictes et respectées. Certains pays sont tellement conciliants qu’ils autorisent l’exploitation de leur maind’œuvre dans des conditions inhumaines, offrant ainsi une quasi-impunité juridique pour des faits qui seraient
gravement sanctionnés dans les États occidentaux d’origine. Les FMN essaient donc souvent, et avec succès, de
saper le pouvoir des États qui peinent à adopter des lois et à s’entendre entre eux pour limiter leur influence.
Grâce à leurs avantages fiscaux et à leurs moyens de pression économiques gigantesques, les FMN rachètent
bon nombre d’entreprises locales pour mettre parfois tout un marché et un secteur sous leur coupe monopolistique.
Leur puissance est telle qu’elles sont en mesure de déstabiliser des zones géopolitiques entières, voire de collaborer
avec des États ou des organisations criminelles. Ces entreprises se font une forte concurrence à l’échelle
8
internationale et tous les moyens – ou presque – semblent bons pour conquérir de nouvelles parts de marché .
De fait, leur influence financière, économique, politique et souvent même géopolitique, est impressionnante, et
grâce à cette force financière et géoéconomique, les FMN ont toujours plus d’ambition pour se mesurer aux États,
voire tenter de les dépasser dans certains domaines, ainsi qu’on l’observe de façon flagrante avec Tesla et le projet
spatial de son P-DG, Elon Musk, qui a conçu et mis en service des lanceurs réutilisables sur sa fusée Falcon 9 (la
plus puissante du monde). Une première dans l’histoire spatiale, puisque, outre le fait que ce domaine industriel est
d’habitude une prérogative régalienne, ce projet n’avait jamais été réalisé par la Nasa, qui, après avoir mal vécu cette
concurrence, a finalement composé et signé des contrats de partenariat avec Tesla. Récemment, le patron d’Amazon,
Jeff Bezos, a lui aussi décidé de créer sa propre industrie spatiale. Les deux créateurs ont d’ailleurs comme projet de
développer dans un futur proche le « tourisme spatial », signe des ambitions démesurées que peuvent poursuivre les
dirigeants des plus puissantes entreprises du monde.
Les Gafam en question… ou l’économie virtuelle à l’assaut du
monde ancien
Ceci nous amène à aborder le cas spécifique des multinationales du domaine digital, les fameuses Gafam
(acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), entreprises stars de la Silicon Valley californienne,
qui ont envahi notre quotidien, influencent l’opinion dite « publique », et créent les nouveaux besoins des
consommateurs rendus de plus en plus dépendants. Elles sont désormais capables de faire et défaire les rois mieux
que les médias classiques. Elles constituent aussi une nuisance sécuritaire, étant donné la présence du crime organisé
et des réseaux islamistes, extrémistes et terroristes sur leurs forums et sur le Net en général. Elles ont même fondé
e
des succursales avec les Natu (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber). Ces entreprises ont su renouveler au XXI siècle le
mythe américain des chercheurs d’or ou de pétrole devenus milliardaires en quelques coups de pioche. Ces start-up,
parfois créées dans un garage, sont ainsi devenues les plus grandes capitalisations boursières mondiales et leurs
patrons, des icônes de l’entrepreneuriat à succès puisque ces entreprises ont parfois à peine plus de 20 ans (Facebook
a été créé en 2004 et Google en 1998). Pourtant, ces Gafam n’acquittent pratiquement pas d’impôts dans de
nombreux pays, ou extrêmement peu, ce qui constitue un manque à gagner gigantesque pour les États. Champions
de l’optimisation fiscale, elles font ressortir leur chiffre d’affaires dans les pays les moins fiscalisés et paient bien
moins d’impôts que d’autres entreprises (« dumping fiscal »). Les calculs de la Commission européenne montrent
que l’impôt sur les sociétés (IS) payé par les méta-plates-formes serait de l’ordre de 9 %, contre 23 % pour les
acteurs de l’économie traditionnelle. Si une nouvelle taxe plus élevée était instaurée pour les acteurs du numérique,
le montant annuel pour l’UE pourrait atteindre 415 milliards de dollars ! D’après certaines études, les pays
européens auraient ainsi perdu à eux seuls 5,4 milliards d’euros en impôt de la part des seuls Google et Facebook,
9
rien qu’entre 2013 et 2015 ! Quant aux experts du Cepii, ils estiment que les cinq Gafam ont payé moins de 10 %
d’impôts sur leurs bénéfices hors États-Unis en 2016, Apple a même payé 0,005 % de taxes sur ses bénéfices
10
européens en 2014, et Google 2,4 % sur ses profits hors États-Unis entre 2007 et 2009 . Certes, on n’est pas loin de
trouver un consensus au niveau européen avec le projet de taxation des Gafam, mais ces derniers ont au moins vingt
ans d’avance sur les États souverains, et une très forte capacité d’adaptation et d’inventivité, sans oublier leur
pouvoir d’influence et leurs capacités à exercer des pressions sur les dirigeants politiques pour obtenir des
avantages.
Les Gafam ont ainsi acquis des positions dominantes sur les marchés numériques mondiaux en prenant le
contrôle des plus importantes plates-formes de services internet en termes de nombre d’abonnés ou d’utilisateurs.
Ces multinationales américaines du Web ont la caractéristique commune d’avoir toutes réussi à imposer des
standards technologiques et sociétaux majeurs. Elles rendent ainsi les consommateurs dépendants de leurs services,
grâce au contrôle de l’ensemble des écosystèmes d’utilisation d’interfaces (applications, logiciels, terminaux,
équipements, accessoires) et des produits dérivés.
Ces cinq sociétés hors norme ont su imposer des produits et des services d’une valeur exceptionnelle à leurs
clients avec des offres d’une utilité telle qu’elles ont su s’imposer massivement dans le monde. À tel point que dans
les pays développés, un utilisateur lambda passe plus de 80 % de son temps à surfer et à vivre dans le monde
numérique, 51 % de sa journée étant consacrée à ces sociétés (messagerie électronique, e-commerce, musique,
vidéo, réseaux sociaux…). Cette tendance s’explique par le fait que ces plates-formes proposent des services et des
solutions en lien avec tous les domaines de la vie quotidienne en s’adaptant et en répondant quasiment en temps réel
aux besoins des utilisateurs. Cela leur permet, bien sûr, d’écraser la concurrence de n’importe quelle entreprise car
elles gèrent le marché et donc les prix selon leur bon vouloir. Les Gafam occupent tous des positions dominantes
dans leur propre secteur. Google détient par exemple 90 % de la part de marché mondial en matière de recherche sur
le Web, avec en moyenne plus de 5 milliards de recherches par jour. Facebook totalise plus de 2,7 milliards
d’utilisateurs actifs et s’impose comme le seul réseau social à dimension mondiale. Quant à YouTube, avec des
versions localisées dans une centaine de pays et la traduction de son site possible en 80 langues, il compte plus de
2 milliards d’utilisateurs mensuels qui regardent plus d’un milliard d’heures de vidéo par jour. « YouTube (racheté
11
par Google en 2006) est vu bien plus que n’importe quelle chaîne de télévision . » De plus, les Gafam se
complètent dans leurs activités : nous avons besoin d’un téléphone Apple pour surfer sur Google pour ensuite aller
sur Facebook et Amazon. Pour information, Apple (Apple iOS) possède 52 % des abonnés détenus par les systèmes
12
d’exploitation, en concurrence avec Google Android qui en possède 47 % .
La puissance financière, politique et technologique démesurée des
Gafam
La capitalisation boursière de ces sociétés dépasse le PIB de certains États. Pour chacune d’elles, à l’exception
de Facebook, le montant dépasse 1 000 milliards de dollars, soit le produit intérieur brut des Pays-Bas, qui sont tout
e
de même à la 17 place du classement des États les plus riches du monde ! Le PIB des Gafam, soit 5 170 milliards de
13
dollars , est supérieur à celui de l’Allemagne, du Japon ou de la France ! Ils sont même plus riches que la valeur
cumulée des constructeurs automobiles ou que les deux tiers des entreprises du CAC 40, ce qui est inouï puisqu’ils
sont fondés sur une activité virtuelle et ne produisent pas de biens manufacturés et industriels. « Beaucoup de
consommateurs croient qu’Internet est gratuit. Nous savons, au regard des profits de Google [27,8 milliards d’euros
de bénéfices en 2018], que ce n’est pas le cas », remarque le Texan Ken Paxton, l’un des cinquante procureurs
d’États américains. Paxton vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête accusant Google de monopoliser et de fausser le
14
marché . La puissance de ces entreprises est donc de plus en plus liée à leur capacité à utiliser l’or noir du
e
siècle, à savoir les data et big data. Quelle entreprise peut-elle parvenir, en partant de zéro, à disposer de près de
10 milliards de dollars de revenus en seulement quelques années ? C’est la prouesse que vient pourtant de réussir
Amazon avec son service Prime Video, et cela grâce à sa capacité à savoir quels pourraient être les films que chacun
de nous préférera.
Alors que la plupart des entreprises ont souffert économiquement de la pandémie, ce n’est pas du tout le cas des
Gafam : Apple, Amazon, Microsoft ou Facebook ont tous augmenté leur chiffre d’affaires pendant la crise. De plus
en plus souvent en situation de télétravail, les employés utilisent plus Internet et les réseaux sociaux pour
communiquer et travailler. Ce phénomène de digitalisation de l’économie est en augmentation exponentielle, comme
on l’a vu avec les ventes d’Amazon qui ont littéralement explosé, son chiffre d’affaires étant en hausse de 40 %,
avec 89 milliards de dollars et un bénéfice net qui double à 5,2 milliards avec 175 000 emplois créés au deuxième
XXI
15
trimestre 2020 . Cette concurrence est plus que déloyale pour les petits commerces : elle est souvent mortelle, car
nombre d’entre eux ont dû mettre la clé sous la porte et laisser leur part de marché aux géants du Web.
Les Gafam dépassent désormais nombre d’États dans le domaine de la recherche : des entreprises comme
Google ou Facebook recrutent déjà les meilleurs ingénieurs du monde grâce à leur attractivité et à leurs moteurs de
recherche. Grâce à eux, ils entreprennent des recherches sur l’intelligence artificielle, la santé ou le spatial, comme
Tesla ou Amazon, dont les budgets de R&D sont nettement supérieurs à ceux de la plupart des États du monde,
excepté les deux ou trois plus puissants. Ils ont acquis une puissance et une influence si considérables que certains
pays comme le Danemark ou la France ont nommé des « ambassadeurs numériques » auprès d’eux ! Cette nouvelle
forme de diplomatie numérique incite souvent les États à négocier avec eux plutôt que d’encadrer leurs activités par
des lois et réglementations. Certes, ce laxisme des États face aux activités sans contre-pouvoir des Gafam est de plus
en plus remis en question, mais cette réaction des États arrive avec au moins une décennie de retard… Les pouvoirs
étatiques n’ont jusqu’alors jamais tenté d’imposer une régulation d’Internet, ni d’encadrer les activités de ces firmes
dont le soft power est supérieur à celui de la plupart des nations souveraines. Et elles interfèrent même à présent sur
le hard power étatique puisqu’une part croissante des conflits se déroule sur les réseaux sociaux et le Net. Ce
pouvoir des Gafam revêt également une dimension idéologique et sociétale, car ils ont les moyens d’imposer leur
vision libérale-libertaire du monde en implantant dans les consciences, via un consumérisme hédoniste, les
dispositions addictives de leurs produits, modes et idées, ainsi que leur sans-frontiérisme et la doxa woke.
Avec les Gafam et leurs émules, la taille critique de l’échange d’informations est en effet devenue le monde luimême : ils se veulent « tout public », d’où l’expression de Benjamin Barber McWorld. Alors que les pionniers de la
première génération (Microsoft, Oracle, Netscape, Nokia…) s’adressaient à des publics spécialisés (professionnels,
geeks, etc.), les prestataires de la deuxième génération se veulent vraiment globaux en s’appuyant sur des réseaux
sociaux couvrant aussi bien la vie privée que professionnelle, les enfants, les retraités. Un autre aspect de l’échange
d’informations est l’uniformisation culturelle et notamment des styles de vie. Si la jeunesse nord-coréenne est privée
d’une grande partie des produits et services sous licence américaine, elle n’en consomme pas moins – pour les plus
fortunés, certes – des hamburgers et des jeans et utilise des clones d’iPhone, de Google et de Facebook.
Multinationales prédatrices et capitalisme ubérisé : l’émergence
d’un nouveau sous-prolétariat
Incontestablement, les Gafam sont l’expression même de la puissance McWorld, cet empire d’expression
anglo-saxonne qui défie les États et ubérise la société en justifiant ses prédations sociales et économiques et sa
création d’un uber-précariat par l’idéologie transnationaliste. Certes, au tout début de sa présidence, Joe Biden a
lancé le chantier ambitieux de mettre au pas fiscalement ces empires nomades en réclamant, conformément aux
demandes de l’OCDE, une augmentation drastique des seuils d’imposition minimaux des Gafam, entreprises qui ont
le plus profité de la pandémie mondiale. Ils sont désormais sommés de payer et de plier aux lois et prérogatives des
États souverains. Le combat est toutefois loin d’être terminé.
La généralisation du télétravail n’a pas fait que ruiner les investisseurs de l’immobilier professionnel, avec son
cortège de bureaux abandonnés, mais elle a de facto obligé les employés à mettre leur domicile à disposition de
l’entreprise, ce qui implique des factures d’électricité et d’énergie accrues, et a entraîné un coût social non encore
évalué à sa juste mesure : dépressions, désocialisation, obésité accrue, alcoolisme, dépendance, violences
conjugales. Du point de vue des fameux « acquis sociaux », le passage au télétravail va aboutir à délocaliser
virtuellement encore plus que jadis, comme cela se passe déjà avec les centres d’appels délocalisés au Maroc ou en
Tunisie, et il va accroître la pression à la baisse sur les salaires des pays avancés comme la France. Ce processus est
inévitable, car quitte à payer un employé à distance, autant le recruter là où il est le moins cher, ce qui annonce un
dumping social via la digitalisation qui va de pair avec l’ubérisation des métiers permis par les applications web de
la Silicon Valley. De la même manière, le principe de l’autoentrepreneuriat, qui séduit au départ un jeune au
chômage hostile à la hiérarchie directe, annonce la fin du marché national du travail, le dumping salarial et la
précarisation des emplois, certes ainsi moins fiscalisés, mais analysables comme une régression en termes de
protection sociale. Ces externalités sociales créées par les plates-formes des multinationales de l’ubérisation
bouleversent totalement l’ordre social et réglementaire, réduisent les protections et même le droit du travail, puis
inaugurent ainsi un nouveau sous-prolétariat ubérisé dont les retraites seront quasi inexistantes.
Le poids de la plate-forme de livraison logistique d’Amazon, par ailleurs, est si fort qu’il impose de facto un
dumping des prix qui ruine les concurrents locaux nationaux ainsi écrasés et remplacés par des autoentrepreneurs
locaux ubérisés qui cotisent peu et rapportent plus aux Gafam. Cela a donc instauré une incroyable fracture entre,
d’une part, l’économie nationale classique caractérisée, comme en France, par une relation au travail compliquée
mais sécurisée et réglementée et, de l’autre, la nouvelle économie ubérisée des plates-formes et des
autoentrepreneurs qui travaillent pour elles et qui permet, certes, à des personnes très peu qualifiées d’acquérir des
emplois et qui n’ont pas pu être gérés par le monde de l’économie classique. Ainsi, sur 800 000 entités
d’autoentrepreneurs créées par an, 30 % travaillent avec ces plates-formes ou vont être hybridées, comme un taxi qui
est à mi-temps Uber.
Ce capitalisme ubérisé ou de plate-forme, qui consiste à digitaliser à outrance les activités de services, jadis
contrôlées de façon éclatée mais réglementée nationalement, est révolutionnaire : une plate-forme comme Airbnb,
bien que ne possédant presque aucun actif et aucune infrastructure, et qui met simplement en contact, grâce au Web,
clients et hébergeurs, est d’ores et déjà la première entreprise d’hébergement dans le monde, loin devant les
conglomérats hôteliers. Elle ne génère toutefois pas de valeur ajoutée et enrichit des milliardaires en prélevant juste
pour cela 20 à 30 % des gains des hébergeurs privés, concurrence redoutable pour les hôteliers classiques obligés
d’accepter, pour ne pas disparaître, de baisser leurs prix et de tirer les vrais salaires de leurs employés vers le bas.
L’autre exemple est offert par Booking, plate-forme hébergée aux Pays-Bas, qui vampirise quant à elle les hôtels,
de facto obligés de suivre cette spirale du dumping des prix.
Le bras de fer entre les cryptomonnaies et les États
Défendues par les adeptes d’un projet d’une mondialisation libertaire, les cryptomonnaies, fruits des
technologies NTIC et de la blockchain, sont également au cœur de la nouvelle économie mondiale ubérisée. Elles
incarnent jusqu’à son comble l’immense défi pour les États souverains qu’est devenue la finance décentralisée et
désouverainisée. Nous avons vu dans le chapitre consacré aux mafias et aux CTO qu’elles sont déjà utilisées par
toutes les entités qui veulent échapper au contrôle des États et/ou à la justice. Cela explique pourquoi les puissances
souverainistes les plus opposées à McWorld, notamment la Russie et surtout la Chine, ont banni les cryptomonnaies
occidentales ou liées aux Gafam et ont créé leurs propres monnaies virtuelles sous le contrôle de leurs banques
centrales en les indexant à leur devise officielle.
Rappelons tout d’abord qu’une cryptomonnaie est une forme d’« actif virtuel », suivant la définition du Gafi,
qui repose intégralement sur la cryptographie, qu’il s’agisse de leur création (le processus de « minage »), de leur
rôle de réserve de valeur, ou de la sécurité du système de paiement. La plus célèbre est le bitcoin, fondé sur la
16
blockchain . Le but officiel était au départ de créer une monnaie, ou plutôt un moyen de transaction
indépendamment des banques centrales, des États et du système bancaire traditionnel. De ce fait, ces monnaies
posent la question du danger et des conséquences de l’affranchissement des leurs opérateurs vis-à-vis des émetteurs
des États. Ces cryptomonnaies ont gagné en popularité en très peu de temps. Le bitcoin a vu sa valeur s’envoler en
17
un temps record : entre janvier et décembre 2017, son cours a bondi de 2 000 %, passant de 953 à 20 089 dollars .
La capitalisation des cryptomonnaies oscillait, début janvier 2021, autour des 850 milliards de dollars (toutes
18
cryptomonnaies comprises ). On comprend pourquoi autant de personnes ont décidé d’y investir. Cependant, tandis
que la valeur du bitcoin ne cesse de fluctuer et que des investisseurs opportunistes espèrent faire fortune en peu de
temps, le risque de fraude grave augmente en parallèle. Les vols par des cyberattaques sont récurrents, et il est
presque impossible de tracer et retrouver les fonds volés. De plus, les dépôts ne sont pas assurés ni protégés en cas
de faillite, et la monnaie numérique n’est pas protégée par des régimes d’assurance-dépôts fédéraux ou provinciaux.
D’évidence, si les monnaies classiques adossées à l’autorité des pays ne valent pas grand-chose, une monnaie fondée
sur aucune contrepartie et contrôlée par aucune autorité ne vaut rien. Les cryptomonnaies n’ont en réalité de valeur
qu’au sein de la communauté qui les utilise. On sait que les trois fonctions de la monnaie sont d’être une unité de
compte, un intermédiaire des échanges et une réserve de valeur. Or si le bitcoin remplit les deux premières, il est
loin de la troisième, car il n’est fondé sur aucune création de richesses, aucune contrepartie de la masse monétaire ne
se trouvant à l’actif d’une banque centrale (or, devises-titres).
Les cryptomonnaies peuvent par ailleurs servir de vecteur pour le blanchiment d’argent sale. Un simple dépôt
dans un bureau de change, et l’argent sale est ainsi blanchi. Un rapport de l’OCDE sur la sensibilisation au
blanchiment de capitaux observe qu’aucune identité n’est liée à une adresse de portefeuille ni à une transaction
donnée. L’identité de l’utilisateur peut uniquement être connue du fournisseur du portefeuille ou de la plate-forme
19
d’échange, si l’utilisateur choisit de recourir à de tels prestataires . Certes, la plupart des plates-formes d’échange
sont officiellement réglementées par les autorités financières nationales, donc théoriquement soumises aux mêmes
conditions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, les plates-formes d’échange appelées
« pair à pair » permettent de contourner les contrôles et les protocoles d’identification. Ces monnaies, qui
garantissent l’anonymat, suscitent naturellement l’intérêt des adeptes de la fraude fiscale, du blanchiment, et même
d’opérations terroristes qui s’organisent souvent sur le Web clandestin. Hans-Jakob Schindler explique que « pour se
financer, les terroristes ont cherché des alternatives auprès de la cryptomonnaie, dont le bitcoin […]. La
cryptomonnaie a l’avantage d’être accessible au plus grand nombre et comme elle n’est pas considérée comme un
20
actif financier, elle ne peut être ni saisie ni gelée ». Les cryptomonnaies sont donc un des meilleurs moyens de
réaliser des transactions sur les marchés du Web clandestin sans que les parties se rencontrent physiquement. Elles
sont l’outil idéal des prises d’otages informatiques, via les mails malveillants ouverts par inadvertance qui
permettent de capter et crypter toutes les données d’un ordinateur et de réclamer des rançons en bitcoin pour les
récupérer. On se souvient aussi de l’affaire Quadriga, cette première Bourse de cryptomonnaie, canadienne, qui
21
servit de moyen de spéculation pour son fondateur, Gerald Cotten , et dont les fonds de dizaines de millions de
dollars investis par les clients n’étaient plus disponibles, lui seul connaissant le mot de passe du système… En
réalité, l’argent des clients avait été transféré sur les comptes personnels de Cotten qui spécula ensuite sur d’autres
plates-formes. Un flagrant démenti des affirmations de ceux qui vantent l’hypersécurisation de l’économie
numérique. « Au Canada, les transactions bancaires sont réglementées et protégées, mais une plateforme de
cryptomonnaies peut être lancée sans qu’on s’assure d’une chose aussi simple que le mot de passe ne soit entre les
22
mains que d’une seule personne », déplore Gérald Fillion . Certes, si le bitcoin est moins traçable qu’une banque ou
qu’une carte de crédit, il l’est tout de même plus que d’autres monnaies encore plus anonymes, comme le monero,
qui masque l’identité de l’expéditeur par le mixage de plusieurs transactions à la fois. Ceci rend ces cryptomonnaies
totalement intraçables grâce à des clés à usage unique pour les paiements individuels, et en fait des instruments
extrêmement attractifs pour les activités criminelles.
Pour ce qui est des ransomwares, c’est-à-dire lorsque banques, avocats, notaires, architectes, hôpitaux,
entreprises ou municipalités subissent les assauts de criminels dits « rançongiciels », ou lorsque les données
essentielles du réseau informatique de sociétés du CAC 40 sont encryptées par le virus-cheval de Troie ransomware,
les cryptomonnaies les plus utilisées sont le bitcoin, le monero et le zcash. L’un des grands experts des
cryptomonnaies, dont l’entreprise gère la sécurité informatique de plusieurs d’entre elles et qui a cofondé la
cryptomonnaie africaine « afro », David Nataf, précise que « si les demandes de rançon sont souvent effectuées en
bitcoins, les cybercriminels changent immédiatement ces derniers en monero ou en zcash, qui ne respectent pas du
tout les normes des États, contrairement au bitcoin ». Il précise que d’autres cryptomonnaies ou utility coins qui
respectent scrupuleusement des chartes et qui sont sécurisées par la blockchain peuvent en revanche être vertueuses
et se conformer aux lois des États. « Ce sont en fait les escroqueries spéculatives occultes et les cryptomonnaies sans
projet et sans application réelle qu’il faut bannir, pas l’innovation qui fait progresser la liberté des nations, combat le
23
crime par la transparence . » Il ajoute de façon ironique que, depuis des décennies, « la monnaie qui absorbe le plus
de transactions criminelles et qui sert le plus à blanchir de l’argent sale, avec des montants immensément plus élevés
que celui des cryptomonnaies, demeure le dollar »…
Dans des pays en banqueroute ou en crise grave, les cryptomonnaies peuvent prendre la place du système
bancaire traditionnel et national, comme l’a souvent fait jadis le dollar (Argentine, Liban, etc.) en cas de crise
majeure. Ainsi, en 2019, au Venezuela, lorsque l’inflation est montée à 9 585,5 %, suite à la gravissime crise
économique, financière et politique survenue dans le pays autour de la réélection controversée de Nicolás Maduro en
2018, nombre de Vénézuéliens ont abandonné le bolivar au profit des cryptomonnaies, en particulier le bitcoin,
24
demeuré à l’abri des conséquences des décisions du Gouvernement . En août 2020, la plate-forme B2B
LocalBitcoins a ainsi connu une hausse historique de 50 % : les échanges y ont représenté un montant record de
5 millions de dollars américains. Vingt mille points de vente dans tout le pays ont alors accepté le bitcoin comme
monnaie de paiement. En réponse, le gouvernement du président Maduro a dû créer sa propre cryptomonnaie
25
nationale, le « petro », dans le but de contourner l’embargo américain .
Dans certains pays, les monnaies virtuelles séduisent de plus en plus, car elles peuvent favoriser le processus
d’intégration monétaire et constituer une monnaie alternative plus fiable qu’une monnaie souveraine trop dévaluée.
Ainsi, début juin 2021, le Salvador a adopté le bitcoin comme seconde monnaie nationale au côté du dollar
salvadorien. Le Mexique est lui aussi en train de l’adopter comme sa deuxième devise officielle nationale. En
Afrique, les cryptomonnaies ont également le vent en poupe, parfois pour le pire (rançonnage informatique, évasion
fiscale, blanchiment) ou pour le meilleur (voir infra). Le Nigeria totalise ainsi à lui seul 8 % des transactions
mondiales de bitcoin, et les monnaies virtuelles gagnent également du terrain au Kenya ou en Égypte, qui y voient
une assurance contre la hausse due à l’inflation. On peut également mentionner le succès naissant de l’afro, qui est
en train d’être agréé par plusieurs États africains. L’afro est la première blockchain ayant été adoptée pour une
mission de service public gouvernementale et dont la traçabilité s’ajoute au fait que, contrairement à d’autres, les
gains sur les transactions sont reversés aux États dans le cadre d’accords de coopérations comme celui signé en 2021
avec la poste de Côte d’Ivoire. Toutefois, la stabilité des monnaies virtuelles les plus fiables et traçables, comme le
bitcoin, n’est pas forcément une garantie éternelle pour les États défaillants qui y voient une solution contre leur
monnaie souveraine : en mai 2021, la décision d’Elon Musk de refuser subitement les paiements en bitcoin, qui a
fait s’écrouler d’un coup la valeur de celui-ci sous la barre des 40 000 dollars (30 % de perte), a démontré la grande
instabilité de ces monnaies.
Excepté des cas comme l’afro, ces monnaies servent trop souvent à contourner le système financier officiel et
participent de la sorte à son affaiblissement : si tout le monde venait à utiliser les cryptomonnaies pour le stockage et
la transaction d’argent, plus aucune règle internationale de contrôle et de réglementation ne serait en vigueur. Par
exemple, avec sa cryptomonnaie « libra » – que la firme digitale voulait adosser à un panier de monnaies et d’actifs
sûrs en créant l’équivalent du DTS, les droits de tirage spéciaux du FMI totalement virtuels –, Facebook
ambitionnait de gérer (ou contrôler) tous les flux d’argent de la vie quotidienne. L’objectif démesuré de ce géant des
Gafam, s’il était atteint, aboutirait à acquérir un pouvoir inouï en remplaçant le système en place, ce qui pose la
26
question de la souveraineté des États dans lesquels la monnaie serait utilisée . La France, l’Allemagne et l’Italie se
sont d’ailleurs fermement opposées à l’instauration de la libra, le risque étant qu’une entreprise multinationale privée
acquière la même puissance monétaire que celle de l’État qui, lui, reste soumis au contrôle démocratique et
judiciaire. Il est vrai que, contrairement à une cryptomonnaie étrangère, les monnaies souveraines contrôlées par les
banques centrales des États permettent aux gouvernements de collecter des impôts.
La réponse en cours des États souverains consiste à plus inciter leurs banques centrales à créer des monnaies
numériques parallèles. Un des premiers exemples a été offert par la Chine, avec le yuan numérique, ou « e-yuan ».
Ainsi, après avoir interdit les paiements et le minage de bitcoins et autres cryptomonnaies sur son territoire,
considérés comme menaçants, les autorités chinoises les ont remplacés par une cryptomonnaie souveraine. À terme,
la Chine ambitionne de concurrencer les cryptomonnaies occidentales tout en contrôlant les flux. Dans la même
logique, mais avec une efficacité bien moindre, la Banque centrale européenne (BCE) songe à lancer un e-euro pour
27
contrer les cryptomonnaies privées hors contrôle . L’autre tendance consiste à conclure avec les Gafam et autres
créateurs de cryptomonnaies, parfois dans le cadre de rapports de force, des accords de non-nuisance réciproque et
de délimitations des rôles. En conclusion, il est clair que les États, loin d’être impuissants, ont les moyens
d’empêcher les opérateurs de monnaies virtuelles d’empiéter sur leurs prérogatives régaliennes, s’ils le décident…
Liberté individuelle, espionnage
En dépit de l’apparente gratuité, les Gafam et autres multinationales déterritorialisées font d’abord des affaires
et s’enrichissent avec la publicité omniprésente et le pillage des données personnelles des citoyens et usagers, le plus
souvent à leur insu, à des fins de marketing. Le fait que ces entreprises aient un monopole international et un libre
accès aux données de millions, voire de milliards, d’utilisateurs signifie que les Gafam sont aujourd’hui capables de
connaître toutes nos habitudes et de traiter nos données avec ou sans notre accord, sans que cela puisse réellement
être vérifié.
Au cours de la dernière décennie, ces firmes ont étendu considérablement leur territoire. En prenant d’abord le
contrôle des smartphones : Android de Google et iOS d’Apple se sont imposés comme les seuls systèmes
d’exploitation de nos appareils. Ils sont devenus la porte d’entrée d’Internet, en contrôlant notamment les magasins
d’applications mobiles. Grâce à son moteur de recherche puis à YouTube et à son assistant vocal, Google a amassé
une quantité astronomique d’informations sur les internautes, un atout qui lui permet de dominer la publicité en
ligne. Cette capacité de ciblage est égalée seulement par Facebook, avec Amazon en embuscade, grâce aux
informations sur les achats de ses clients et son majordome vocal, Alexa. Cette montagne de données permet à ces
groupes de dominer le secteur émergent de l’intelligence artificielle, avec des services qu’ils monnaient aux autres
entreprises via leurs filiales de location de serveurs à distance. Mais aussi d’avoir un avantage significatif pour
pénétrer d’autres secteurs, comme l’automobile et la santé. Apple, Google, Facebook et Amazon ont aussi
bouleversé les médias avec leurs services de streaming de vidéos et de musique.
Songe-t-on ainsi que l’émission d’identité, aujourd’hui prérogative des États, pourrait bientôt tomber entre leurs
mains ? Les Gafam ont d’innombrables moyens de vérifier plus sûrement que les États notre identité, au travers
d’empreintes biométriques et digitales (yeux, voix, vitesse et mode de frappe sur un clavier…), du traçage de nos
déplacements et destinataires de nos messages ou de notre façon de naviguer, etc. Il est ainsi probable qu’un
28
passeport soit prochainement jugé moins fiable qu’une identité certifiée par Apple …
Le premier front ouvert par les grandes démocraties est celui de la protection des libertés individuelles. Les
Gafam ont récupéré tout ce qu’il est possible de savoir sur les hommes et les femmes qui ont, une fois dans leur vie,
touché une souris d’ordinateur. Ils exploitent nos données grâce aux algorithmes très performants d’Amazon,
Google ou certaines agences de voyages qui gèrent les publicités adaptées aux divers profils et modifient même les
prix sur les différents sites de vente en ligne pour nous faire acheter plus, plus cher. Ainsi, Internet et les réseaux
sociaux permettent aux entreprises internationales de prendre le contrôle de nos désirs, de vendre nos données
personnelles au plus offrant en contournant les droits des citoyens et les prérogatives des États, imposant ainsi une
concurrence déloyale aux petites entreprises qui ne peuvent survivre face à l’ubérisation généralisée. Elles sont
également, via les réseaux sociaux et l’incontrôlabilité du Web, de formidables instruments de manipulation de
l’opinion publique. La collecte de ces données est devenue le modèle économique de ces géants technologiques, qui
les vendent à des tiers. Dans la plupart des cas, sans le consentement explicite de leur utilisateur ou sans l’en avertir
clairement. Ce business a été révélé lors du scandale Facebook/Cambridge Analytica quand 30 à 70 millions
d’utilisateurs Facebook ont vu leurs données recueillies sans leur consentement en passant par un quiz qui a absorbé
non seulement leurs informations personnelles mais aussi celles de leurs amis. On peut aussi citer le scandale de
l’enseigne H&M qui, entre 2014 et 2019, a enregistré les données des salariés d’un site à Nuremberg à leur insu, afin
d’établir des profils individuels et un système de surveillance puis de rendre les informations visibles pour une
cinquantaine de responsables du groupe. L’enseigne a par la suite été condamnée à une amende de 35 millions
d’euros.
En relation avec Facebook, de nombreux autres scandales récents ont mis en évidence la dangerosité de ces
29
sociétés hors contrôle. On peut citer l’exemple du piratage, par des hackeurs, de 50 millions d’utilisateurs qui a
permis à des cybercriminels de prendre le contrôle de comptes d’utilisateurs et d’accéder à des données
30
personnelles. En 2019, un autre scandale a concerné Facebook, dévoilé dans le Wall Street Journal , lorsqu’on a
découvert que la firme recueillait des données personnelles comme le poids, la pression sanguine, mais aussi les
cycles menstruels ou les phases d’ovulation, y compris de personnes n’ayant pas de compte Facebook (grâce à des
posts et messages)… En 2018, l’agence de presse de Bloomberg dévoilait ainsi un accord secret entre Google et
Mastercard aux États-Unis concernant les clients Mastercard américains détenant un compte Gmail et ayant accepté
la politique de suivi publicitaire dans les paramètres de leur compte Google. Ceux-ci ont fait l’objet d’un
recoupement entre les données bancaires de tous leurs achats et leurs profils utilisateurs. Malgré les nombreuses
voix qui se soulèvent contre cette collecte massive de nos données personnelles et les abus, les récents événements
suggèrent que cette tendance va continuer à empirer, nos vies étant appelées à être toujours plus digitalisées.
L’arrivée de la 5G, qui va multiplier de façon exponentielle les fonctionnalités et capacités de l’économie digitale,
contribuera à rendre de plus en plus réel le scénario, jadis de science-fiction, décrit par George Orwell dans 1984.
Les Gafam, danger pour les États… sauf pour les deux
hyperpuissances qui les ont créés…
Si elles offrent des opportunités, obtentions d’informations, échanges et acquisitions de savoirs extraordinaires,
en plus du fait qu’elles permettent de « raccourcir les distances » entre les hommes et faire l’économie de
déplacements, les multinationales du digital ont aussi leurs zones d’ombre : elles menacent la souveraineté des États,
elles sont de plus en plus dénoncées pour leur mainmise tentaculaire sur l’économie mondiale et leur pratique de
corsaire fiscal. Leur puissance colossale et planétaire ne découle pas uniquement de leur force de frappe économique
mais également de leur capacité à influencer et donc potentiellement à déstabiliser l’ordre international puis à
s’affranchir de règles et lois en vigueur dans les territoires soumis au contrôle des États et des juridictions qu’elles
défient. Quant aux dirigeants de ces entreprises, ils sont attendus et reçus à chaque déplacement comme des chefs
d’État, et ils n’hésitent pas à se poser eux-mêmes comme leurs égaux.
En rachetant systématiquement les start-up les plus innovantes susceptibles de les concurrencer, les Gafam
créent des situations quasi monopolistiques (« économie de plate-forme »). Leurs dirigeants défient les États dans
leur souveraineté et réussissent souvent à imposer leur volonté par le droit fiscal et social, l’éducation, les normes
techniques, les choix industriels, mais aussi par le chantage économique, l’obsolescence programmée, l’imposition
des standards ou les pratiques anticoncurrentielles. De plus, les Gafam contrôlant tous les flux d’informations
peuvent manipuler les opinions et pratiquer l’influence ou la désinformation de masse, à des fins politiques ou
idéologiques, en bloquant certaines informations ou certaines personnes, tout en mettant en valeur d’autres. Ils
peuvent favoriser l’apparition de certains sites internet plutôt que d’autres lors des recherches dans leurs moteurs.
Malgré leurs dénégations publiques, et en dépit des professions de foi politiquement correctes de leurs dirigeants, les
Gafam et leurs organismes de censure qui traquent le populisme mais laissent s’exprimer des groupes criminels
(drogue, armes, prostitution, etc.), fanatiques, islamistes ou même complotistes et terroristes, ont en fait assez peu de
considération pour la protection des lois et de la sécurité des sociétés démocratiques.
Réseaux sociaux, entre trop grande liberté et néocensure très
orientée…
Donald Trump, définitivement interdit sur Twitter, mais pas Recep Tayyip Erdoğan, Mahathir Mohamad ou les
plus grands prédicateurs islamistes ! En réalité, les réseaux sociaux peuvent être de formidables outils de propagande
et de désinformation pour maints lobbys, manipulateurs, extrémistes de tout bord, y compris des islamistes radicaux
et des djihadistes, et pas seulement les « populistes », ainsi qu’on l’observe notamment sur Instagram, Twitter ou
Facebook, où des « influenceurs » islamistes ont des dizaines de millions d’abonnés. Une étude de la Brookings
Institution a démontré qu’au moins 46 000 comptes Twitter ont été liés à l’État islamique entre septembre et
décembre 2014, et que 9 200 autres sont toujours directement liés à des groupes djihadistes, la firme digitale n’ayant
jamais voulu les faire disparaître une bonne fois pour toutes. Les comptes soutenant l’EI ont en moyenne
1 000 abonnés, soit « bien plus qu’un compte habituel ». Ils n’ont pas été censurés par les Gafam pendant des
années, et il a fallu que les États fassent pression après les vagues d’attentats et crimes contre l’humanité commis par
Daesh pour que Facebook et Twitter commencent à réagir, preuve que l’État peut réguler les Gafam s’il le veut. Les
cyberdjihadistes continuent toutefois d’y recruter. Twitter est dans ce cas précis le réseau privilégié, car il permet de
créer très rapidement un compte facile à suivre dès qu’une autorité impose la fermeture du compte précédent et de
poster des liens vers des plates-formes où se trouvent les véritables documents, vidéos ou enregistrements, comme
archive.org. Gilles de Kerchove, coordinateur européen chargé de la lutte contre le terrorisme, a ainsi déploré que le
« jihad virtuel est favorisé par le phénomène de “l’enfermement algorithmique” : lorsqu’un mot-clé est inscrit dans
un moteur de recherche, les algorithmes l’enregistrent et l’internaute reçoit ensuite des contenus similaires. Un
individu qui recherche des informations via Internet sur le jihad et l’État islamique reçoit naturellement du contenu
31
faisant écho à sa recherche ».
Malgré les avertissements de lanceurs d’alertes et des services de sécurité ou judiciaires de pays inquiets des
activités des prédicateurs fanatiques sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes sont ajoutés chaque jour qui
profitent en fait d’un vide juridique dû au fait que les législations des États ne sont pas adaptées aux nouvelles
réalités compliquées du monde virtuel et digitalisé. Parfois, les logiques de Facebook sont étonnantes : les organes
de censure de ce géant des Gafam sont très vigilants contre les activistes nationalistes et les suprémacistes blancs,
ainsi que les milieux d’extrême gauche ou d’extrême droite antivaccins, à juste titre, mais très peu a été fait contre
les milieux islamistes pourtant encore plus hostiles aux démocraties et en général aux États régaliens souverains de
tous les pays du monde.
Le 8 janvier 2021, suite à l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021, et en réponse aux tweets de Donald Trump et
aux discussions sur d’éventuelles manifestations armées à Washington DC, Twitter a définitivement banni l’exPrésident américain de sa plate-forme sous prétexte que ses derniers tweets risquaient d’inciter à plus de violences.
La firme a également fait supprimer les messages envoyés sur le compte @POTUS, ainsi que sur d’autres comptes.
Facebook lui a également infligé une interdiction « indéfinie » jusqu’au jour de l’inauguration. On remarquera
toutefois que les réseaux sociaux n’ont commencé à prendre des mesures contre le Président qu’après que le Parti
démocrate a pris le contrôle du Sénat, le 5 janvier 2021, la première fois qu’il détient une majorité à la fois à la
Chambre et au Sénat depuis une décennie, ce qui lui donne le pouvoir de superviser Big Tech…
Par contraste, le président Recep Tayyip Erdoğan, qui dispose sur Twitter de 17,3 millions d’abonnés, et sur
Facebook de 9 805 204 « j’aime » et plus de 10 millions d’abonnés, n’a jamais été censuré alors qu’il a provoqué
des violences et répressions bien plus meurtrières et volontaires que son homologue américain. Malgré maintes
provocations, insultes, menaces proférées contre plusieurs pays et appels à la haine ou au négationnisme, il n’a
jamais été suspendu sur les grands réseaux sociaux. Erdoğan a pourtant fait bien pire que Trump : il a muselé
l’opposition et la presse depuis 2017, s’est fait accorder les pleins pouvoirs, son gouvernement « national islamiste »
a fait massacrer les Kurdes en Syrie, tente de s’emparer des eaux souveraines et du gaz de la Grèce et de Chypre du
Nord, occupée, nie activement le génocide arménien, a fait envoyer en Libye et en Azerbaïdjan des djihadistes
recrutés en Syrie, appuie le mouvement terroriste palestinien Hamas à Gaza et a même soutenu Daesh entre 2014 et
2016 et al-Qaida en Syrie jusqu’à présent, puis a lancé en octobre 2020 une campagne mondiale de haine contre la
France et Emmanuel Macron…
L’ex-Premier ministre malaisien, Mahathir bin Mohamad, connu pour ses positions antisémites et
négationnistes et ses récents appels au meurtre, dispose de 3 668 228 « j’aime » et de 4 millions d’abonnés sur
Facebook, et de 1,3 million sur Twitter. Il a pu écrire le 29 octobre 2020, sur Twitter et sur son blog, après la
décapitation de Samuel Paty, que « les musulmans ont le droit d’être en colère et de tuer des millions de Français ».
Le pire est que ce texte a été maintenu dans un premier temps par les autorités de régulation de Twitter, qui ont
invoqué un « intérêt pour le public », tout en l’accompagnant d’un avertissement, et la firme a fini par retirer le
tweet sous les pressions des États, mais sans pour autant supprimer le compte de celui qui appelle au meurtre…
Twitter connaissait pourtant depuis longtemps son radicalisme islamiste antioccidental : lors de son discours
d’ouverture du dixième sommet de l’Organisation de la Conférence islamique des 16-18 octobre 2003, Mahathir tint
des propos ouvertement antijuifs et complotistes en affirmant que « quelques millions de juifs ne sauraient triompher
d’un milliard trois cents millions de musulmans ». Et face aux réactions d’indignation venues du monde entier,
Mahathir récidiva peu après : « Eh bien, que le monde ait réagi ainsi démontre qu’ils [les juifs] contrôlent le monde.
[…] Israël est un petit pays. Il n’y a pas beaucoup de juifs dans le monde. Mais ils sont arrogants au point de défier
le monde entier […], ils tiennent de nombreux médias qui présentent les choses de manière complètement
unilatérale et influencent beaucoup de gens » (30 octobre 2020). Mais ni Twitter ni Facebook n’ont jugé bon depuis
son dernier appel au meurtre de « millions de Français » de fermer ses comptes…
On peut également citer d’autres preuves de ces deux poids deux mesures : l’émir du Qatar, Tamim Al Thani,
qui dispose de 925 000 abonnés sur Twitter, n’y a jamais été censuré, bien qu’il ait soutenu les révoltes des Frères
musulmans depuis le printemps arabe qui ont déstabilisé plusieurs États, et bien que son pays ait appuyé et financé
maints groupes djihadistes dans le monde. L’homme fort de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, avec 400 000 abonnés
sur Facebook, a simplement été brièvement suspendu en 2017 mais jamais banni des réseaux sociaux alors qu’il a
appelé à massacrer les homosexuels, les blasphémateurs, commis des carnages et récemment gravement insulté et
menacé le président Emmanuel Macron et la France suite à la décapitation de Samuel Paty par un Tchétchène
(16 octobre 2021). Son protégé, le champion d’arts martiaux Khabib Nurmagomedov, Daghestanais, qui a « prié
pour que Macron soit défiguré », ainsi que « tous ses disciples de la liberté d’expression », continue librement de
communiquer avec ses 25 millions d’abonnés sur Instagram et n’a jamais été lui non plus banni des réseaux
sociaux… Dans un autre registre, Nicolás Maduro, le révolutionnaire bolivariste, successeur de Hugo Chávez, qui a
empêché le processus démocratique, ruiné et conduit son pays à la guerre civile, muselé l’opposition et fait exécuter
des milliers de personnes, n’est pas censuré : sur Facebook, il a 977 634 mentions « j’aime » et 1,2 million
d’abonnés, et sur Twitter près de 4 millions d’abonnés. Récemment, un tweet du Guide suprême de la révolution
islamique iranienne hostile aux vaccins a été supprimé sur ses 2 comptes (335 000 et 880 000 abonnés), mais le
dictateur théocratique du régime iranien, Ali Khamenei, qui a appelé si souvent à tuer des « ennemis de l’islam »,
des opposants et autres ennemis de Téhéran, et dont le régime finance le terrorisme international, n’a jamais été
banni des réseaux sociaux ni ses comptes supprimés comme ceux de Trump.
L’Arabie saoudite, les Frères musulmans, leur protecteur et financier, le Qatar, ont très rarement été sanctionnés
par Twitter, alors que ces pays et organisations professent et diffusent la version la plus fanatique et totalitaire de la
charia, et que nombre de prédicateurs wahhabites et fréro-salafistes officiels disposent de comptes sur les réseaux
sociaux parmi les plus suivis au monde. Il est vrai que l’Arabie saoudite est l’un des plus importants actionnaires de
32
Twitter … Autre fait révélateur, en mars 2020, on apprit que le Conseil de surveillance de Facebook et Instagram a
intégré en son sein le Prix Nobel de la paix yéménite, Tawakkol Karman, militante des Frères musulmans qui s’est
fait connaître pour son engagement provoile islamique et durant le printemps arabe par son action révolutionnaire
islamiste.
Dans un rapport de l’Institut Montaigne intitulé La Fabrique de l’islamisme, on apprend que parmi les
200 comptes au monde ayant le plus de followers figurent 5 abonnements arabophones de prédicateurs wahhabites
salafistes. Le rapport mentionne ainsi Muhammad al-Arifi, avec ses 21,4 millions d’abonnés sur Twitter (et
25 millions sur Facebook), ce qui fait de sa page le premier compte saoudien et le premier abonnement religieux du
e
monde et le 86 mondial tous tweets confondus. Ce docteur en théologie, qui enseigne à l’université du Roi-Saoud
de Riyad, justifie notamment le droit pour les maris de battre leurs femmes et le meurtre des apostats. On trouve
ensuite le théologien Ayid al-Qarni, qui, avec 19 millions d’abonnés Twitter, professe l’idéologie salafiste du Sahwa
qui rejette les valeurs occidentales et vante la même charia totalitaire antimécréants ; le Saoudo-Palestinien Ahmad
Al Shugairi, 18 millions de followers, qui prône le salafisme obscurantiste et la haine envers les mécréants dans de
nombreuses émissions de télévision religieuses ; Salman al-Ouda (14,2 millions d’abonnés), proche des Frères
e
musulmans, qui anime le site Islam Today, le Koweïtien Mishari Rashid Alafasi (16 position, avec 14 millions
d’abonnés), récitateur du Coran, expert en nasheeds, chants islamiques interdisant les instruments de musique très
prisés par les djihadistes. Tous diffusent une conception du monde chariatique liberticide hostile aux nonmusulmans, vus comme inférieurs ou/et hostiles, aux apostats et aux blasphémateurs promis à la peine de mort.
Du côté des prédicateurs frères musulmans, le plus célèbre et populaire d’entre eux, cofondateur des grandes
associations fréristes occidentales et téléprédicateur vedette d’Al Jazeera, Youssef al-Qardaoui, dispose de
3 millions d’abonnés sur Twitter et de 642 362 sur Facebook. Ses comptes n’ont jamais été définitivement bloqués,
alors qu’il a écrit des ouvrages et lancé maintes fatwas incitant à tuer les apostats, les juifs, les homosexuels, les
blasphémateurs, les adultères et les dirigeants arabes laïques nationalistes, puis a justifié les attentats suicide… L’un
de ses disciples en Europe, Tariq Ramadan, petits-fils du créateur des Frères musulmans, Hassan al-Banna, n’est ni
censuré ni interdit sur Twitter, où il a 702 000 abonnés, ou sur Facebook, avec ses 2 233 408 « j’aime » et ses
2 324 900 abonnés. Son frère, Hani Ramadan, qui continue de codiriger la principale association des Frères
musulmans en Suisse, qui a souvent été signalé par les renseignements et les polices françaises et suisses pour son
radicalisme, justifie les répudiations, la lapidation, l’infériorité des femmes et autres mesures totalitaires
chariatiques, dénonce en permanence Israël, le sionisme et les intellectuels juifs, n’est pas plus censuré sur Twitter
(5 665 abonnés) que sur Facebook (16 626 « j’aime » et 16 800 abonnés). Proche de ces derniers, le prédicateur
islamiste frère musulman, Hassan Iquioussen, antisémite notoire et fanatique traqueur de sionistes, diffuse quant à
lui tranquillement son venin idéologique depuis 2009 sur Twitter, où il a 2 500 abonnés et surtout sur Facebook, où
il en a 144 000.
Oligopole des Gafam face au Big Brother chinois des « BATX »
Face aux Gafam et aux Natu occidentaux, pour l’heure encore les plus puissants, se dressent les équivalents
concurrents chinois BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). Ces géants ont été créés au départ dans le but de
limiter en Chine l’influence et le contrôle des Gafam américains, puis de les concurrencer au niveau mondial sur leur
propre terrain. Les deux groupes de multinationales digitales se livrent depuis une véritable guerre géoéconomique,
financière et idéologique planétaire, chacun véhiculant des intérêts et des valeurs opposés et entretenant des rapports
étroits avec les services de renseignements respectifs. Ils s’infiltrent discrètement dans l’économie mondiale en
rachetant des entreprises de tous les pays, notamment occidentaux, ou en nouant des partenariats visant à créer de
véritables monopoles. Même s’ils l’ignorent le plus souvent, les utilisateurs de Paytm, de Bigbasket (en Inde), de
Tokopedia (en Indonésie), de Lazada (à Singapour) ou encore de Trendyol (en Turquie) sont en réalité des clients
d’Alibaba, géant chinois. Créé en 2000, le moteur de recherche Baidu a quant à lui longtemps été cantonné au
marché chinois. Sa valeur sur les marchés est certes encore loin d’égaler celle d’Alphabet, la maison mère de
Google, mais il est déjà le quatrième site le plus visité du monde, et ses techniciens sont à la pointe du progrès en
matière d’intelligence artificielle et de voitures autonomes. À l’instar de l’outsider géopolitique, stratégique et
technologique chinois, qui défie de plus en plus et cherche à terme à dépasser le numéro un américain, les rapports
de force peuvent évoluer très vite et les BATX chinois pourront un jour s’imposer au niveau mondial. Alibaba est
d’ores et déjà le concurrent direct le plus redoutable d’Amazon, et le premier distributeur mondial, devant Walmart.
Son atout principal est un système de paiement en ligne à la fiabilité reconnue : Alipay. Mais le conflit sino-
américain concerne également le domaine du développement de la technologie 5G.
La guerre froide sino-américaine et l’enjeu géoécomique majeur de
la 5G
La 5G est la cinquième génération de technologie de réseau mobile, qui permet une « hyperconnectivité »,
censée être dix fois plus rapide que la 4G. En fait, la 5G n’a pas seulement pour objectif la vitesse du réseau, mais
aussi la possibilité d’interconnexion des services et objets comme les véhicules sans conducteurs, les robots, les
villes intelligentes (smart cities), la reconnaissance faciale ou encore la télémédecine. D’après l’entreprise
33
américaine Qualcomm, la 5G devrait générer des ventes de l’ordre de 13 200 milliards de dollars d’ici 2035 . Il est
vrai que le nombre de téléphones portables explose littéralement : on compte plus d’un abonnement mobile par
habitant sur terre, et selon la Banque mondiale, on dénombrait déjà environ 104 abonnements mobiles pour
34
100 habitants dans le monde en 2018 ! De quoi faire la fortune des géants des télécoms comme Apple (leader des
smartphones aux États-Unis), Samsung (leader en Europe) ou Huawei (dominant en Chine). Jusqu’alors, les
standards étaient créés et imposés par l’Occident, en particulier les États-Unis, ce qui leur permettait de contrôler la
35
majorité des communications mondiales via leur agence de renseignements, la NSA , et les accords de coopération
d’échanges d’informations et d’espionnage mondial des câbles transportant les communications sous les mers et
océans, conclus entre les cinq pays anglo-saxons « Five Eyes », sous l’égide de la NSA (réseau Echelon et Prism).
Diverses polémiques de collecte de données et/ou d’espionnage par la NSA ont d’ailleurs été rendues publiques par
36
l’affaire Snowden . De son côté, la Chine est déterminée à avoir ses propres systèmes de télécommunications, de
réseaux sociaux et de téléphonies mobiles dans un double intérêt : que cela rapporte à l’économie chinoise et
prémunisse la Chine de l’espionnage mondial anglo-saxon préjudiciable à la sécurité nationale et à la souveraineté.
Le conflit sino-américain autour de la 5G, et plus globalement autour de l’enjeu stratégique de demain, a pris
forme lorsque Donald Trump, à peine arrivé à la Maison Blanche en janvier 2016, a voulu « rendre sa grandeur à
l’Amérique », notamment en réduisant le déficit commercial avec la Chine qui allait atteindre un niveau record deux
ans plus tard : 621 milliards de dollars en 2018, son plus haut niveau en dix ans. Pour Donald Trump, cela était dû à
la concurrence déloyale chinoise, il s’agissait donc pour lui de faire pression sur Pékin afin de pouvoir négocier un
accord commercial à l’avantage de Washington. Début 2018, les taxes américaines ont ainsi commencé à être
augmentées sur les panneaux solaires en provenance de Chine, puis sur l’aluminium et l’acier (25 % de taxes
annoncées sur les importations d’acier et 10 % sur celles d’aluminium). La Chine a ensuite contre-attaqué en taxant
128 produits américains. États-Unis et Chine se sont rendus coup pour coup, et en mai 2019, Washington a
augmenté les droits de douane pour un montant total de 200 milliards de dollars. Ce conflit commercial et les
enchaînements de représailles réciproques ont fait craindre une réduction de l’investissement des entreprises, une
perturbation des chaînes d’approvisionnement et donc un ralentissement de la croissance avec, à l’issue, une
augmentation des coûts pour les producteurs et les consommateurs. D’après la présidente du FMI, Kristalina
37
Georgieva , une guerre commerciale pourrait coûter 700 milliards à l’économie mondiale.
En réalité, l’objectif des Américains, et pas seulement de Donald Trump, inquiets de la montée en puissance de
la Chine, est d’empêcher cette dernière de devenir la première puissance mondiale et surtout de ne pas perdre
l’hégémonie technologique. Le conflit entre les deux superpuissances s’est donc dirigé vers le secteur des nouvelles
technologies entre les Gafam américains et les BATX chinois, auxquels on pourrait ajouter Huawei (entreprise
fortement liée au régime communiste de Pékin), au sujet des réseaux sociaux et surtout, actuellement, de la 5G. Les
États-Unis ont de ce fait ciblé le géant chinois des télécoms Huawei afin que celui-ci ne puisse plus se fournir auprès
des entreprises américaines.
Pour la première fois, la domination technologique ne vient pas de l’Occident mais de la Chine, plus
précisément du groupe chinois Huawei, créé à Shenzhen. La Chine est en effet déterminée à devenir la première
puissance mondiale d’ici 2049, et elle vise clairement le leadership mondial, notamment grâce à la 5G, dont Huawei
est l’acteur clé. Le 22 mai 2020, Huawei avait déjà écoulé 15 millions de smartphones compatibles 5G. Ainsi, en
juillet 2019, Monaco est devenue « le premier pays 5G au monde » en équipant toute la principauté de 23 sites
d’antennes dernière génération. Pour Washington, cette fulgurante expansion de Huawei est inacceptable, le matériel
chinois diffusé partout dans le monde ne pouvant que faciliter l’espionnage ou d’éventuelles cyberattaques
chinoises. Dès janvier 2018, les États-Unis ont donc réagi en interdisant toute vente de technologie américaine à
Huawei (très dépendante du système d’exploitation Android de Google notamment). En décembre 2018, la
directrice financière du groupe Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada à la demande des États-Unis,
accusée de « violation des sanctions contre l’Iran instaurées par les États-Unis »… En représailles, Pékin fait arrêter
deux Canadiens en les accusant d’espionnage. Encore un signe que les États peuvent réagir face aux FMN s’ils sont
motivés.
Dans cette guerre froide géoéconomique sino-américaine, le protectionnisme technologique a rejoint
l’affrontement commercial et les tensions militaires en mer de Chine. En 2019, Donald Trump a banni Huawei des
futurs réseaux 5G américains. Depuis 2018, chaque pays accuse l’autre d’espionnage dans le contexte de lutte pour
la souveraineté technologique, contraignant de facto les autres nations du monde à choisir leurs camps. Ainsi, le
16 mai 2019, l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Taiwan et les États-Unis ont banni les produits Huawei de
38
leurs réseaux mobiles . Mais d’autres pays comme le Brésil, le Canada ou l’Inde pourraient, à l’avenir, emboîter le
pas aux États-Unis.
En dehors de Huawei, ce conflit géoéconomique et technologique sino-américain oppose plus largement les
Gafam américains aux BATX chinois. Avec ces entreprises, en dehors de l’objectif économique évident, le but
stratégique de Pékin est de : 1/ contrôler les réseaux et flux d’informations sur son territoire ; 2/ maîtriser les chaînes
et flux d’informations au niveau régional et mondial échappant totalement aux réseaux contrôlés par les États-Unis ;
3/ couper la population chinoise de l’influence occidentale subversive (démocratie, droits de l’homme, libertarisme)
qui mettrait en péril à terme la dictature chinoise confucéo-communiste. Bien que les BATX soient encore loin des
résultats des Gafam, ils remplissent pour l’instant parfaitement cet impératif de contrôle de l’information au niveau
national. La capitalisation boursière des Gafam est encore nettement supérieure à celle des BATX, mais les
39
concurrents chinois commencent à inquiéter : depuis 2018, Tencent a quasiment rattrapé Facebook , avec
respectivement 356,7 et 403,9 milliards de dollars. Autre exemple de ce rattrapage rapide : en 2020, l’application
TikTok, qui appartient à l’entreprise chinoise ByteDance, a réussi une percée fulgurante à l’international, y compris
aux États-Unis, puisque 26 millions d’Américains utilisent la plate-forme. D’où la menace américaine de les
interdire dans leur pays.
Là aussi, l’Europe se retrouve totalement déclassée et prise en tenailles par tous ces géants de l’information
étrangers : sur les dix premiers acteurs de l’informatique via le cloud, où toutes les données sont stockées, le Vieux
Continent ne figure sur aucune position, les grands champions étant américains et chinois, avec notamment Amazon
Web Service (AWS), qui domine 32 % du marché selon le Synergy Research Group ; Google, qui suit avec 9 %
devant le chinois Alibaba (6 %), lui-même suivi par IBM Cloud, Salesforce, Tencent et Oracle. La conclusion peu
reluisante pour l’UE est que 84 % du cloud européen est américain, le reste chinois…
« Le Yalta des mondes digitaux »
En dehors de la Chine, les autres États du monde demeureraient-ils impuissants à freiner, contrôler ou enrayer
la puissance des Gafam et leurs sous-jacents idéologiques libertaires consuméristes et « antisouverainistes » portés
par leurs réseaux sociaux ? Les autres puissances du monde multipolaire sont-elles capables de contrecarrer ce que
les stratèges de Pékin décrivent comme le « nihilisme » hédoniste occidental, menace mortelle pour les
démocratures ? En réalité, les Gafam imposent leurs postulats libertaires McWorld uniquement là où des pouvoirs
politiques les laissent faire : tout comme la pornographie est totalement bannie sur le Web dans les pays musulmans
et la propagande pédophile également bloquée sur le Net en Occident, la Chine, l’Iran, la Turquie ou la Russie
bloquent les flux du Net qu’elles ne veulent pas voir arriver dans leur espace de souveraineté virtuel et les réseaux
sociaux peuvent y être fermés à n’importe quel instant. Lorsque les États se mettent en travers de leur route, les
Gafam n’ont d’autre choix que de s’aligner, car leur but est avant tout de vendre les produits publicitaires sur leurs
espaces virtuels et d’attirer de nouveaux utilisateurs en permanence pour croître.
La réalité crue est l’instauration d’un « Yalta des mondes digitaux » : deux univers de communication distincts
sont en train de s’imposer avec, d’une part, l’univers libéral-libertaire de McWorld, propre aux démocraties
occidentales, et, d’autre part, l’univers oriental des démocratures qui soumettent ces Gafam et de la Chine qui les
remplace par leur propre « Big Brother » digital des BATX. L’anglais, qui était en passe de s’imposer comme
langue des réseaux sociaux dans les années 2000, commence d’ailleurs à reculer sur le Web au fur et à mesure,
précisément, de l’extension des réseaux sociaux venus d’autres horizons géocivilisationnels. La communication est
sans doute l’élément le plus volatil de la globalisation. La conclusion est que la mondialisation communicationnelle
peut échapper à son créateur occidental, et que la modernité devient de plus en plus a-occidentale.
La nationalisation des moyens d’information
Face aux scénarios posés par nombre d’observateurs qui craignent que les Gafam fassent barrage aux pouvoirs
régaliens des États, d’autres analyses, plus cyniques encore, mais réalistes, suggèrent que les choses sont bien plus
paradoxales et moins manichéennes qu’il n’y paraît. La preuve imparable que le pouvoir des Gafam est limitable par
celui des États qui refusent d’abdiquer leur souveraineté est apportée chaque jour par la Chine maoïste capitaliste :
l’Internet y est totalement encadré de façon drastique par un système complexe de censure dénommé « la Grande
Muraille électronique » qui bloque automatiquement les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ainsi que YouTube et
Google. Les entreprises du Digital Big Brother chinois que sont Baidu, Tencent et Alibaba profitent du blocage des
rivaux internationaux sur le marché chinois pour développer les réseaux sociaux domestiques comme WeChat et
Weibo. Les dirigeants de ces entreprises sont eux-mêmes soumis à un contrôle strict, comme l’a illustré la
disparition, pendant plusieurs semaines, de Jack Ma, patron d’Alibaba, après des propos controversés…
Même en Europe, les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît et le pouvoir des Gafam est plus le fruit du
vide digital de l’UE que le résultat d’une hyperpuissance intrinsèque. Des initiatives européennes afin de
concurrencer les Gafam américains ont certes pour l’instant échoué : le moteur de recherche Qwant peine à
s’imposer quand le projet Galileo de GPS européen a dû se cantonner aux seules applications professionnelles. La
seule initiative européenne commune concerne le projet de taxation des Gafam qui n’entravera pas pour autant leur
position monopolistique en Europe et leur diffusion d’une contre-société libéral-libertaire en réalité acceptée par les
social-démocraties européennes. Les acteurs français du numérique, tout comme les Israéliens – les plus en pointe –,
préfèrent généralement s’appuyer sur les Gafam plutôt que les concurrencer. En revanche, dans les États plus
« souverainistes », comme la Russie, la démocratie indienne, la démocrature turque, la république islamique d’Iran,
les pays arabo-musulmans et d’Asie, des politiques de censure parfaitement assumées bloquent les informations et
communications sur les réseaux sociaux et le Net. Et les Gafam préfèrent s’en accommoder plutôt que de risquer d’y
être remplacés par les BATX chinois ou autres plates-formes non occidentales moins regardantes sur les valeurs
libéral-démocratiques. Bref, les Gafam sont en fait souvent « du côté du manche », ainsi que l’élection de Biden l’a
démontré à travers le bannissement subit de son ennemi Trump… Inversement, l’administration de Donald Trump,
dont l’élection n’aurait pas été possible sans les réseaux des multinationales digitales, les a soutenus lorsque les
concurrents économiques européens ont évoqué au sein de l’OCDE et des G20 des projets de taxation qui visaient
en fait des instruments de l’empire américain McWorld.
Est-ce aux réseaux sociaux de contrôler l’État ou à l’État de contrôler les réseaux sociaux ? En réalité, s’il est
vrai que les entreprises digitales ont une nette préférence, comme la quasi-totalité des journalistes, des stars et du
deep state américain – CIA-NSA et lobby militaro-industriel interventionniste compris – pour les démocrates
américains, on observera que les Gafam ont attendu d’être certains de la défaite de Donald Trump pour supprimer
ses comptes Twitter, Facebook et Instagram, et qu’au début, le Président américain le plus combattu de l’Histoire
par l’establishment américain a tout de même pu arriver au pouvoir et « gouverner » à coups de messages tonitruants
envoyés sur les réseaux sociaux… L’État a en réalité toujours les moyens de contrôler ces réseaux s’il dispose en
son sein d’une majorité suffisante pour le faire. En contrôlant les deux chambres, Biden pourrait réaliser ce que
Trump n’a pas pu obtenir. L’Europe, dans ce cas, emboîterait le pas aux États-Unis. Une méthode pour
l’administration Biden serait d’imposer aux réseaux sociaux une « éthique citoyenne » et une pratique de
l’autocensure au service des principaux projets de son gouvernement : lutte contre les propos haineux, mais aussi
information orientée en direction de certains sujets d’intérêt global tels que la lutte contre le réchauffement, et les
discriminations. Ces sujets, déjà bien intégrés dans les agendas de grandes firmes (voir le concept de responsabilité
sociale des entreprises), pourraient dans ce cas être imposés à l’ensemble des agents économiques dans le cadre
d’une communication institutionnelle coordonnée imposant la transition numérique aussi bien que la transition
écologique et la préparation aux prochaines pandémies.
En conséquence, certains États, dont la France, essaient d’instaurer un premier niveau de taxation sur le chiffre
d’affaires en attendant un cadre plus structurant au sein de l’Union européenne ou de l’OCDE. L’Europe est en
première ligne sur ce dossier, et des pays comme la France ont proposé de taxer les Gafam sur le chiffre d’affaires
réalisé dans le pays où ils travaillent. Certes, une taxe sur le chiffre d’affaires est très différente d’un impôt sur les
profits, et en matière fiscale, l’Union européenne a besoin de l’accord unanime de tous les États membres. Or
certains pays qui ont tout à gagner en accueillant les Gafam – comme le Luxembourg, l’Irlande et plusieurs États
40
d’Europe centrale et orientale – ne voteront jamais une telle disposition fiscale. En ce qui concerne les États-Unis,
l’administration Biden a récemment rouvert le débat de la taxe Gafam. Washington propose ainsi de créer une taxe
internationale sur les géants du numérique qui reposerait sur les revenus nets. Signe fort de sa détermination à
remettre les géants du digital au pas, la nomination de la juriste Lina Khan à un poste de commissaire à l’autorité
américaine de la concurrence (FTC), connue pour être très critique à l’égard des positions monopolistiques des
Gafam, ne trompe pas. Et les pays de l'OCDE sont en train de se mettre d'accord sur cela.
Notre thèse est qu’il y a bien une reprise en main de la finance et du numérique par les États, mais qu’elle passe
par un bras de fer et probablement une alliance entre les deux qui a comme préalable un « recadrage » des
multinationales digitales et qui pourrait relancer la croissance. Dans la mesure où la baisse séculaire de la croissance
est due à l’absence d’innovations majeures comparables à celles des première et deuxième révolutions industrielles
qui ont multiplié par dix, voire par cent, la productivité grâce à l’énergie du charbon, puis du pétrole et à la
mécanisation, et sachant que les énergies alternatives comme l’hydrogène, l’éolien ou le solaire sont surtout des
technologies de substitution qui n’augmenteront pas très rapidement la productivité, les vrais vecteurs d’une
augmentation de la productivité seront les domaines de l’information, de l’intelligence artificielle, de la blockchain,
de l’ordinateur quantique et des biotechs. Ce qui leur manque, c’est une cohérence, or celle-ci passe par un modèle
centralisé inhérent à l’autorité publique, qu’il s’agisse d’États, d’unions régionales d’États ou de confédérations.
Bref, c’est l’État stratège et la puissance souveraine qui, si possible en coopération avec les FMN ou en les
recadrant, comme l’a fait la Chine, seront les acteurs majeurs de la relance dans les années à venir, d’autant que
l’État demeure, comme on l’a vu avec la crise sanitaire, le seul protecteur de la sécurité et des droits des citoyens.
1. Henry Kissinger, L’Ordre du monde, Paris, Fayard, 2016, p. 327.
2. Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté. Les États entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999.
3. Les firmes multinationales/transnationales sont des sociétés privées ou publiques déployées via des filiales sur au moins deux pays ou continents.
4. Classement disponible sur le site de Forbes : www.forbes.com.
5. « Les entreprises de taille intermédiaire concentrent 45 % de l’emploi sous contrôle étranger en France », Statistiques Insee, 5 novembre 2019.
6. Le TTIP en anglais, ou traité de libre-échange transatlantique, est un projet d’accord commercial entre l’UE et les EU créant une zone de libreéchange ou grand marché transatlantique (GMT). En avril 2019, le Conseil de l’UE a autorisé la Commission européenne à ouvrir de nouvelles
négociations commerciales avec les EU plus limitées que le projet initial.
7. Cnuced, Rapport sur l’investissement dans le monde, 2020.
8. « Entreprises multinationales et intégrité publique : le rôle des principes directeurs de l’OCDE », communiqué de l’OCDE, mai 2002.
9. « Gafa : l’UE a perdu 5,4 mds de revenus fiscaux », Le Figaro, 14 septembre 2017.
10. « L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ? », La Lettre du CEPII, juin 2019.
er
11. « GAFA, GAFAM ou NATU : les nouveaux maîtres du monde », La Finance pour tous, 1 décembre 2020.
12. S. O’Dea, « U.S. Smartphone Subscriber Share by Operating Platform 2012-2020 », Statista, 25 novembre 2020.
13. Alexandre Baradez, « Google, Amazon… les Gafa sont au plus haut en Bourse, gare aux déceptions ! », Capital, 20 avril 2020.
14. Philippe Bernard, « Les Gafam défient désormais les principaux États du globe. Et ces derniers contre-attaquent », Le Monde, 24 septembre
2019.
15. « Ces incroyables profits d’Amazon pendant la pandémie », Capital, 31 juillet 2020.
16. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de
contrôle.
17. Stéphane Berlot, « Les dangers d’engranger de la cryptomonnaie », Les Échos, 12 juin 2018.
18. CoinMarketCap : fournisseur de données de cryptomonnaies de référence mondial, https://coinmarketcap.com/.
19. OCDE, Manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme à l’intention des contrôleurs des impôts, Paris,
OCDE, 2019.
20. CAT, Compte-rendu de la conférence internationale sur le terrorisme, op. cit
21. Sead Fadilpašić, « Le cas incroyable de Quadriga : faux comptes et millions de dollars de perdus », Cryptonews.com, 25 juin 2019.
22. Gérald Fillion, « Le risque réel des cryptomonnaies », Radio-Canada, 5 février 2019.
23. La blockchain peut permettre de tracer les vrais médicaments, identifier les faux, inscrire la propriété intellectuelle, fixer des œuvres originales
(NFT), servir de registre mondial de propriété foncière, de registre d’inscription de la preuve (Afro), de jeton de téléphone mondial (Elya), de
monnaie des objets connectés (Iota), utiliser l’intelligence artificielle pour engendrer une épargne automatisée (Peculium, PCL), et servir de monnaie
commune aux grandes fraternités (World Masonic Coin Solidus, WMCS).
24. Kévin Comitogianni, « Le Bitcoin, une valeur refuge au Venezuela », Cryptonaute, 18 septembre 2020.
25. « La course aux cryptomonnaies d’États est lancée », The Conversation, 7 janvier 2020.
26. « Libra : l’UE fait bloc contre le projet de monnaie virtuelle de Facebook », Le Figaro, 8 novembre 2019.
27. « La BCE intensifie ses travaux sur un euro numérique », communiqué de presse de la BCE, 2 octobre 2020.
28. Gilles Babinet, « La fin de l’État-nation ? Partie 2, les méta-plateformes au service du bien commun », Institut Montaigne, 30 novembre 2018.
29. « Facebook victime d’un énorme piratage, 50 millions de comptes touchés », La Tribune, 28 septembre 2018.
30. Sam Schechner et Mark Secada, « You Give Apps Sensitive Personal Information. Then They Tell Facebook », The Wall Street Journal,
22 février 2019.
31. CAT, Compte-rendu de la conférence internationale sur le terrorisme, op. cit. Voir www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-againstterrorism/counter-terrorism-coordinator/.
32. En 2015, le prince saoudien Al-Walid ben Talal est devenu le deuxième actionnaire de Twitter, dépossédant le P-DG de la société Dorsey.
33. « 5G Economy to Generate $13.2 Trillion in Sales Enablement by 2035 », Qualcomm, 7 novembre 2019.
34. Source : Banque mondiale, voir site officiel de l’organisation : donnees.banquemondiale.org.
35. Créée en 1952, la National Security Agency est une des 17 agences de renseignements américaines. Elle a inauguré fin 2013 un data center à
Bluffdale (Utah), le plus grand centre d’interception des communications du monde. Avec 10 000 employés et un budget annuel de 10 milliards de
dollars.
36. Edward Snowden, ex-consultant de la CIA et de la NSA, a révélé que l’agence espionnait illégalement les Américains et le monde via la
surveillance d’Internet, des téléphones et de tous les moyens de communication (Prism), via Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram
scannés par ses méga-ordinateurs.
37. Kristalina Georgieva, « Decelerating Growth Calls for Accelerating Action », 8 octobre 2019, voir site du FMI
38. Claire Jenik, « Quels pays ont banni Huawei de leur territoire ? », Statista, 20 mai 2019.
39. Tristan Gaudiaut, « Les BATX font trembler les GAFA », Statista, 12 décembre 2020.
40. Jean-Marc Sylvestre, « Les GAFA sont devenus tellement puissants qu’ils sont capables de résister à tous les pouvoirs politiques », art. cit.
CHAPITRE XIII
Crise sanitaire et biotech, l’Europe déclassée ?
« La crise due au coronavirus est la première d’un monde postaméricain. »
Thomas Gomart
La crise sanitaire a touché l’ensemble de la planète. Elle a suscité des réponses nationales non concertées et
encouragé les logiques nationales et souverainistes. Elle a accentué la tendance mondiale au multipolarisme puis
renforcé le discrédit du multilatéralisme. La pandémie a déjà secoué l’ensemble de la politique et de l’économie
mondiales après être sortie de son berceau sino-asiatique. Peu d’événements ont bouleversé le fonctionnement
global du monde comme l’a fait cette crise. De plus, la propagation de la Covid a provoqué un électrochoc dans les
circuits de la mondialisation avec le ralentissement du commerce international, l’effondrement des économies, la
prise de conscience des trop fortes interdépendances créées par la globalisation et le déclassement des économies
industrielles occidentales par l’usine du monde chinoise.
La pandémie planétaire a eu et continuera d’avoir pendant des années des conséquences géopolitiques majeures.
Certains disent qu’il y aura un avant- et un après-Covid-19. En réalité, du point de vue des rapports de force
géopolitiques et économiques mondiaux, la crise sanitaire n’aura fait qu’accentuer les grandes tendances observables
depuis deux décennies. Elle a été à l’égard de la multipolarisation en cours, à la fois un test et un révélateur pour les
nations et les institutions : la Chine « total-capitaliste » (Baverez), sortie vainqueur du fléau sanitaire, qu’elle aurait
pourtant transmis à l’humanité – faute d’avoir averti ses partenaires et d’avoir respecté les normes de sécurité des
1
laboratoires P4 de Wuhan –, poursuit sa marche vers l’hyperpuissance. Le multilatéralisme est plus en crise que
jamais, et pas seulement l’OMS ou les Nations unies. La Russie et l’Amérique (puis l’Otan) sont toujours à couteaux
tirés, les États-Unis et la Chine en marche vers une guerre froide du troisième type. Ils s’accusent mutuellement
d’avoir créé ou laissé s’échapper le coronavirus, dans le cadre de ce que des experts ont qualifié d’expériences de
modifications de virus en vue de recherches sur les vaccins ou même sur les armes biologiques.
Toujours est-il que les puissances émergentes d’Asie ont démontré une supériorité en matière de gestion de la
crise, d’efficacité technologique et organisationnelle. Elles continuent d’être l’épicentre de la nouvelle « économiemonde », pendant que l’Occident – réputé à la pointe du progrès et de la bonne gouvernance, mais zone la plus
touchée au monde par le virus – poursuit (Europe en tête) son décrochage économique, technologique et
géopolitique. Les sommets du G7 et de l’Otan de juin 2021 ont semblé annoncer une reprise en main occidentale et
une volonté de relever le défi chinois, clairement désigné par Joe Biden, mais l’avancée industrielle chinoise est
difficilement conjurable. La gestion bien plus rapide et efficace de la crise sanitaire par les puissances industrielles et
technologiques asiatiques a poussé certains à conclure que l’Occident – surtout la vieille Europe – risquait de plus en
plus d’être déclassé, tant du point de vue économique que technologique et scientifique, par les pays de tradition
néo-confucéenne holistique, et donc pas seulement par la Chine dictatoriale.
L’Asie confucéo-taoïste et industrielle a démontré qu’elle a été plus à même que les démocraties libérales
occidentales de faire face à des crises imprévisibles comme la pandémie de la Covid-19. La plus grande propension
de ses élites à mener des politiques d’anticipation comme des stratégies de long terme a donné des leçons de vertu et
de responsabilité aux démocraties de l’Union européennes engluées dans leurs agendas électoralistes de court terme,
paralysées par leurs lourdeurs bureaucratiques et inhibées par leurs états d’âme droits-de-l’hommistes et leur
individualisme forcené qui confine parfois à l’anarchie au détriment de l’intérêt général et national. En effet, les
pays de l’UE, dont les trois sacro-saintes libertés fondatrices sont celles de la circulation des biens, des personnes et
des capitaux, ont été les derniers États à fermer leurs frontières, et ils ont été encore plus lourdement contaminés que
l’Inde, les États-Unis et le Brésil, en proportion, faute d’avoir osé rompre leur dogme de « l’ouverture » à la
mondialisation, à l’évidence pourtant pas toujours « heureuse ». Inversement, l’Asie « holiste », qui fait primer le
groupe sur l’individu et l’efficacité sur la liberté, a été bien plus réactive, bien plus efficacement et plus rapidement
que les démocraties libérales occidentales. En Occident, les pays anglo-saxons, qui se sont relevé plus vite que
l’Europe de la crise, ont fermé leurs frontières et ont, à la différence de l’Union européenne, privilégié leurs
nationaux et vacciné ces derniers de façon bien plus rapide que les pays de l’UE : au moment où ce livre était
terminé, le 8 juillet 2021, en France 35 millions de personnes avaient été primo-vaccinées (52,75 %) et
26,35 millions avaient reçu toutes les doses (39,33 %). Des pourcentages similaires à l’Allemagne, l’Espagne,
l’Italie, etc. À la même date, le Royaume-Uni comptait 45,6 millions de primo-vaccinés (68,4 %), et 34,2 millions
de pleinement vaccinés (51,3 %). L’un des pires élèves de l’Union a été sans surprise la Bulgarie, avec 14,2 % de
primo-vaccinés et 12 %… Ce retard des pays de l’UE (excepté les pays scandinaves) par rapport aux voisins
brexiteurs s’explique notamment par les lenteurs inhérentes à la bureaucratie bruxelloise et aux prises de décisions à
27 : l’Union a ainsi perdu un mois pour autoriser les vaccins, début janvier 2021, puis un autre à cause d’une
désorganisation massive dans la distribution. Le système britannique peu bureaucratique a été en fait bien plus
efficace que l’UE pour accorder les autorisations, s’approvisionner en vaccin et déployer rapidement les centres.
D’autres pays anglo-saxons comme la Nouvelle-Zélande, qui ressort presque indemne de la crise, avec 11 morts
seulement, ou l’Australie, également très peu touchée par la pandémie, l’ont bien mieux combattue que les États
providences et ouverts de l’UE : outre leur moindre intégration à la mondialisation et leur éloignement des autres
continents développés, leur recette a été la même que les pays nationalistes d’Asie : fermeture des frontières ;
isolation drastique des clusters dès le départ, fermeture des aéroports à tous les non-vaccinés. Une recette qu’un seul
pays européen, de tradition politique anglaise, Malte, a appliquée (en plus de ses 68 % de pleinement vaccinés).
A contrario, l’Europe altruiste, qui avait fourni une partie de ses stocks de masques à la Chine au début de la crise et
qui a refusé tant qu’elle a pu de fermer ses frontières par dogme mondialisant, a payé le plus lourd tribut au niveau
mondial.
État des lieux et chiffres
2
Selon le Congressional Research Service (CRS ), et d’après des études de la fondation Bill Gates, qui travaille
étroitement avec l’OMS sur la gestion des pandémies, le coût de la crise due à la Covid-19 pour le monde entier était
3
estimé au moment de la rédaction de cet ouvrage à 30 000 milliards de dollars et 120 millions de pertes d’emploi .
Pour le cofondateur de Microsoft, qui avait d’ailleurs averti dès 2015 quant au risque de pandémie mondiale, ce
chiffre colossal aurait été bien moindre si les gouvernements avaient anticipé de façon plus responsable. Le
milliardaire préconise depuis des années de créer une « force de réaction rapide » de 3 000 professionnels répartis
dans le monde, des « pompiers de la pandémie » en alerte en permanence et capables de répondre dans l’urgence à
une nouvelle crise sanitaire et de l’éteindre à son début. Il appelle à se préparer aux prochaines pandémies, comme
on se prépare à une guerre, ce qui implique d’investir des dizaines de milliards de dollars chaque année afin de
« sauver des milliers d’autres milliards » comme on vient de le faire, faute d’avoir pris les mesures nécessaires.
« Nous ne pouvons pas nous permettre d’être à nouveau pris au dépourvu. La menace de la prochaine pandémie
pendra toujours au-dessus de nos têtes – à moins que le monde ne prenne les mesures pour l’empêcher […]. Je pense
4
que c’est la meilleure et la plus rentable des polices d’assurance que le monde puisse se payer . » Diabolisé par les
complotistes de tout bord, notamment en raison de ses positions provaccins, Bill Gates avait toutefois émis le même
diagnostic que celui des services de renseignements américains et français entre 2005 et 2009. Comme pour les
maints autres avertissements concernant l’islamisme, l’immigration, le terrorisme ou les mafias transnationales, les
services de sécurité n’ont une fois de plus pas été écoutés par les élites politiques dont les décisions sont motivées en
premier lieu par les lobbys financiers, les conseils en « Com », et les émotions portées par les médias jugées
électoralement utiles…
La crise de la Covid-19, vite devenue « 21 », avec ses moult variants, a mis à jour les manques de solidarité
dans l’ensemble du monde et l’impréparation des dirigeants des pays les plus avancés, notamment en Occident. En
dépit des très nombreux accords internationaux, de règles communes dans le domaine sanitaire, et du rôle supposé
responsable d’institutions comme l’OMS, la coopération a été plus que mauvaise entre les États qui ont globalement
adopté des logiques strictement nationales et tenté chacun de son côté d’accumuler médicaments et masques, parfois
par des moyens peu déontologiques. L’Occident – Europe en tête – a abandonné sa souveraineté en matière de
médicaments en conséquence des nombreuses délocalisations au profit de la Chine, devenue aujourd’hui le
producteur de plus de 80 % des principes actifs, l’Union européenne étant presque totalement dépendante des
productions chinoises ou indiennes. Il en va de même pour les masques : la Chine détient plus de la moitié de la
capacité de production mondiale, avec plus de 200 milliards d’unités exportées en 2020 ! Le dirigeant chinois Xi
Jinping a ainsi exploité au maximum la « diplomatie des masques » pour démontrer son poids géopolitique au
niveau mondial avec une capacité de production supérieure à n’importe quel autre pays. La Chine possède
également trois vaccins et en est le premier producteur, avec 33 % de la production mondiale devant les États-Unis
(27 %). Elle les exporte dans de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient ou d’Amérique latine. Certains
ont rétorqué que les vaccins chinois sont peu efficaces, que l’OMS a mis du temps à les valider, mais personne ne
dispose du recul nécessaire pour affirmer qu’ils ont été moins protecteurs que les équivalents occidentaux, d’autant
que si les sérums chinois ne semblent efficaces qu’à 50 % contre les nouveaux variants de la Covid-19, ils protègent
apparemment à 100 % contre les formes graves. Toujours est-il que la Chine s’est relevée de la crise sanitaire plus
efficacement et plus rapidement que tous les pays occidentaux. Et la plus grande efficacité des vaccins de l’industrie
Big Pharma occidentale à virus actifs ou à ARN, quant à eux hâtivement homologués par les gouvernements, n’a pas
plus été démontrée que ne l’a été l’infériorité supposée des équivalents russes comme Spoutnik ou chinois, comme
Sinovac.
On a également assisté à une guerre des représentations entre les États-Unis et la Chine, chacune des deux
superpuissances accusant l’autre d’être à l’origine de la pandémie, ce qui n’a fait qu’intensifier la guerre
commerciale les opposant depuis 2017. Alors que Trump conspuait la Chine communiste, non sans arrière-pensées
électorales, Xi Jinping tentait de limiter au maximum la transmission d’informations sur le virus aux partenaires
étrangers, cachant même durant plusieurs mois au monde l’ampleur de la menace, ce qui a réduit la préparation des
autres pays dans leur gestion de la crise. La rivalité stratégique et géoéconomique sino-américaine croissante a ainsi
primé sur un sujet pourtant vital qu’est la santé publique des citoyens des pays du monde entier.
De la même manière, la rivalité russo-occidentale a considérablement nui à l’intérêt des citoyens européens.
Ces derniers n’ont en effet pas pu s’approvisionner en vaccins assez vite mais, malgré cela, l’Union européenne a
refusé d’homologuer le vaccin russe Spoutnik, par logique atlantiste, certes, mais également en raison de la toutepuissance des laboratoires pharmaceutiques mondialisés – principalement anglo-saxons. Rappelons que le marché
pharmaceutique mondial, dont les acteurs essentiels sont américains – même s’ils produisent et sous-traitent
massivement en Inde et en Chine –, asiatiques, et, dans une moindre mesure, en Europe, représente environ
1 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires et que ses dix premières entreprises comptent plus de 800 000 salariés.
Les cinq premiers groupes, Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, Bayer et Novartis, représentent un quart du marché à
eux seuls. Le degré de concentration de ce secteur est illustré par le fait que seule une vingtaine d’entreprises
dépasse les 10 milliards de chiffre d’affaires. Par ailleurs, et sans tomber dans les théories conspirationnistes, on
peut supposer que le fait que ces firmes aient obtenu une autorisation provisoire de vaccination de masse tant que
des traitements ne sont pas disponibles ne les a pas incités à privilégier la commercialisation des médicaments
antiviraux, souvent issus de produits déjà existants et donc moins coûteux que les vaccins. Selon certains, les
conflits d’intérêts des mondes médical et politique expliqueraient pourquoi les dirigeants occidentaux ont privilégié
5
la piste des vaccins et interdit aux médecins de soigner (décision sans précédent) avec des traitements classiques .
On soulignera également l’étonnant refus des instances européennes d’appuyer le projet de vaccin de la start-up
biotech française Valneva, qui siège à Nantes, associée à un labo autrichien. Son sérum à spectre large promettait
pourtant d’être au moins aussi efficace que ceux de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, car capable de stimuler les
défenses immunitaires face aux nouveaux variants avec un virus désactivé, mais moins dangereux que les nouveaux
vaccins de Big Pharma à virus actif ou à ARN. Ces derniers nécessiteront d’ailleurs des rappels perpétuels au gré
des « variants » et leurs effets sur la santé à long terme sont encore méconnus. Initialement bloqué par l’Union –
soumise aux pressions des grandes multinationales pharmaceutiques, Valneva s’est donc tournée vers le
gouvernement britannique brexiteur – donc pleinement souverain – qui a appuyé les essais cliniques de l’entreprise
française et la construction d’une de ses usines en Écosse pour fabriquer son sérum prometteur en masse, que les
Français auront donc bien après les Britanniques ! La gestion de la pandémie a rappelé que la mondialisation
marchande, même médicale, est d’abord un théâtre de guerre économique et de rivalités, et que les logiques
nationales sont souvent plus efficaces que celles du multilatéralisme ou du supranationalisme (OMS, ONU, UE).
Pour ce qui est de la limitation de l’expansion du virus, le souverainisme semble avoir été plus efficace que le
sans-frontiérisme européen, et à cet égard, les puissances asiatiques s’en sont sorties beaucoup mieux. Le leader
chinois, Xi Jinping, soutenu par l’OMS, et qui a facilité l’élection du directeur général, l’Éthiopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pour certains à la solde de Pékin, en a ainsi profité pour glorifier les « capacités extraordinaires » du
Parti communiste chinois et de sa nation, « la seule » capable de gagner la guerre contre le virus, contrairement aux
démocraties occidentales engluées dans leurs fractures politiciennes internes. Force est de reconnaître que le système
chinois a été capable de réagir très vite et très fort, que ce soit sur le sanitaire comme sur la relance, en remettant tout
le monde au travail et en déconfinant plus tôt et plus sûrement. Les pays industrialisés et démocratiques d’Asie, non
moins souverainistes, comme la Corée du Sud, Taiwan ou le Japon, ont également été bien plus réactifs que les
démocraties occidentales. Certains ont pu ainsi voir dans l’éthique du confucianisme le fondement d’un modèle de
société hautement hiérarchisé (discipline, sens du devoir, piété filiale, respect des personnes âgées, humilité) qui
continue aujourd’hui de façonner les habitants de Hong Kong, de Taiwan, de Singapour, de la Corée du Sud, du
Japon, voire du Viêtnam, et qui pourrait relever les défis modernes évoqués par Bill Gates et les services de
renseignements mais que les démocraties libérales devenues libertaires semblent peu à même de régler, faute de
discipline, de sens commun et d’autorité… Ces pays de l’ère taoïste-confucéenne et shintoïste ont démontré une
incontestable aptitude à la discipline en temps de crise et à la « technologie civique » dans la guerre sanitaire que les
peuples du monde entier ont fini par envier.
La crise économique est une crise sanitaire
D’après les estimations actuelles, le monde traverse la crise économique la plus lourde de l’Histoire. Le PIB
mondial a ainsi baissé de 3,2 % en 2020. Les hausses de chômage sont massives dans certains pays : près de 25 %
d’augmentation en France, ce qui a propulsé le taux de chômage à plus de 11 %. À la fin de l’année 2020, il y avait
6
près de 600 000 emplois salariés de moins qu’à la fin de l’année précédente . La flambée a été de 50 % au Portugal,
le taux de chômage y passant de 6 à 9 %. Le taux de chômage mondial a certes fortement baissé au deuxième
trimestre. Mais avec la fin du confinement et la reprise d’un comportement habituel de recherche d’emploi, il a
augmenté de 1,9 point au troisième trimestre, passant ainsi à 9 %. Et les phénomènes de « quatrième vague » ou de
nouveaux « variants » – brésilien (Gamma), sud-africain (Bêta), britannique (Alpha), indien (Delta), ou encore
Lambda, Epsilon –, couplés avec la lenteur de la vaccination de masse au niveau mondial et les incertitudes sur son
efficacité, rendent l’avenir moins prometteur que ce que l’on a pensé en juin 2020 lorsque certains, notamment le
Pr Raoult, affirmaient que le virus était en train de disparaître… D’autant que les vaccins, par ailleurs pas aussi
fiables que prévus face aux variants, ne sont devenus massifs que dans les pays développés, ce qui permet au virus
de progresser et muter indéfiniment ailleurs.
La Covid a provoqué une nouvelle poussée de la pauvreté, comme en Inde, où elle a explosé dans les zones
rurales. L’économie indienne, déjà en ralentissement depuis 2017, a été très sévèrement touchée, de sorte que son
retard vis-à-vis de son rival et ennemi chinois s’est accentué. La crise sanitaire a mis au chômage 120 millions de
personnes et a jeté sur les routes la moitié des 40 millions de travailleurs migrants internes qui ont quitté les centres
7
urbains et ont ainsi contribué à répandre le virus dans les campagnes. Selon les Nations unies, 260 millions
d’Indiens pourraient retomber dans la pauvreté (soit quasiment autant que les 271 millions qui en étaient sortis entre
2006 et 2016). Ce retour en arrière pose au pays des défis considérables, en particulier au niveau de la malnutrition.
Depuis longtemps, la recherche académique a tenté de quantifier les liens qui existent entre crise économique et
conséquences sanitaires. Une étude publiée en 2016 dans la revue Current Epidemiology Reports expliquait que la
crise de 2008 avait eu de nombreuses conséquences sanitaires en Europe : augmentation des suicides, baisse de la
santé générale perçue, hausse de la mortalité, baisse de la fertilité… D’autres études ont démontré le lien entre la
pauvreté (et sa hausse en cas de crise) et les risques de développer un cancer. Une étude publiée dans The Lancet a
stipulé que la crise économique de 2008, en fragilisant les systèmes de santé, avait augmenté à près de 260 000 le
8
nombre de morts du cancer dans le monde . Et les conséquences indirectes de la crise sanitaire liée à la Covid
pourraient être encore plus douloureuses. Indicateur significatif : le Secours populaire a enregistré une hausse de
45 % de sa fréquentation en 2020. Dès le 23 mars 2020, Santé publique France a lancé l’enquête CoviPrev auprès de
2 000 personnes, afin de suivre leur état psychologique et l’évolution de leurs comportements dans un contexte
inédit. Après une semaine de confinement, l’anxiété touchait 26,7 % des personnes interrogées, contre 13,5 % en
er
2017. Au 1 avril, la prévalence de la dépression atteignait 19,9 %, soit le double d’une moyenne de près de 10 %.
Et jeudi 19 novembre, le ministre de la Santé a révélé que le numéro d’aide mis en place sur ces questions (le
08 00 13 00 00), géré par des associations, recevait « près de 20 000 appels par jour ».
Au niveau mondial, l’ONU s’attend à ce que 71 millions de personnes rechutent dans l’extrême pauvreté en
2021, soit la première augmentation dans le monde depuis 1998. Le Dr Andreea Stoian Karadeli, chercheur à
l’université de South Wales et au Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), a fait valoir que le manque de
confiance et la peur causés par le coronavirus sont pires que le virus lui-même. Cette conscience des effets de la peur
est chère aux groupes djihadistes comme l’EI qui ont théorisé l’idée que l’ennemi devait être frappé sur le terrain
psychologique en faisant tout pour « jeter l’effroi dans le cœur des mécréants ». Les grandes catégories
d’extrémistes – djihadistes, sectes, extrême droite et extrême gauche – ont d’ailleurs tenté de profiter de ce moment
pour réactiver les vieilles théories conspirationnistes qui ont prospéré sur les réseaux sociaux au-delà même des
sphères « extrémistes » (« démocratisation des thèses complotistes »). Daesh, Al-Qaïda et maintes sectes fanatiques
ont présenté le virus comme « une punition de Dieu contre les infidèles ». Des groupes radicaux ont ciblé les
Asiatiques, accusés d’être la cause du virus, ainsi que les juifs, qui sont toujours une cible. Les milieux
révolutionnaires d’extrême gauche ou anarchistes ont blâmé le système capitaliste et affirmé que le confinement
serait le fruit d’un complot gouvernemental visant à priver les gens de leurs libertés, appelant ainsi à attaquer les
symboles capitalistes.
Géopolitique de la Covid-19
L’échelle de cette crise est si importante que les vaccins sont devenus des facteurs géopolitiques qui définissent
les rapports de force entre pays et qui permettent de projeter la puissance souveraine à l’international. Le meilleur
exemple a été offert par la Russie de Poutine qui a su instrumentaliser des livraisons de Spoutnik un peu partout
dans les pays du Sud et même dans certains d’Europe, dans le but d’améliorer son image (soft power) auprès des
élites et des populations. Moscou a privilégié cette action d’influence à l’international à la livraison massive de
vaccins à ses citoyens, le but étant de renforcer son soft power dans sa sphère d’influence (Kazakhstan, Kirghizistan,
Caucase) et de l’élargir en Amérique latine et au Moyen-Orient. La Chine a adopté une stratégie similaire en
exportant ses vaccins (laboratoires Sinovac et Sinopharm, fondés sur une méthode classique à virus désactivé) dans
9
des dizaines de pays, notamment africains – jusqu’à les offrir parfois – mais aussi au Moyen-Orient,
particulièrement aux Émirats arabes unis, qui produisent directement sur leur territoire le vaccin chinois Sinopharm.
L’Union européenne s’est quant à elle résolument opposée au vaccin russe Spoutnik, privilégiant les fabricants
américains ou européens, bien que certains pays européens aient plaidé pour l’introduction rapide des vaccins russes,
comme l’Italie ou l’Allemagne. Imitant les responsables de l’UE, l’Ukraine a rejeté le vaccin russe par pur choix
idéologique et stratégique, préférant ceux américains ou européens, au détriment des prix plus bas et des intérêts des
citoyens/malades eux-mêmes.
Toutes les économies et les gouvernements du monde ont été touchés par la crise sanitaire, et ces derniers y ont
presque tous répondu par un important soutien budgétaire. En raison des divers plans de relance et de sauvetage des
entreprises, la récession provoquée par la pandémie a propulsé la dette mondiale en pourcentage du PIB à un
nouveau record de 355 % début 2021, contre 320 % fin 2019. À la suite de l’introduction de mesures de
confinement dans le monde depuis mars 2020, le PIB dans la zone OCDE a diminué brutalement de 9,8 % fin 2020,
la plus forte baisse jamais enregistrée, nettement supérieure au 2,3 % du premier trimestre 2009, en pleine crise
10
financière . Au Royaume-Uni, le PIB a chuté de 9,8 % sur l’année 2020, tandis qu’en France, la chute a atteint
8,3 %.
Les campagnes de vaccination, les politiques de santé et le soutien financier des gouvernements étaient censées,
fin 2020, faire augmenter le PIB mondial de 4,2 % en 2021, après une baisse de 4,2 %. La reprise aurait été plus
forte si les vaccins avaient déployé rapidement. Les retards dans le déploiement de la vaccination, les difficultés à
contrôler les nouveaux foyers du virus, les deuxième, troisième vagues, et autres « nouvelles » mutations du virus
ont vite affaibli les perspectives. Le rebond s’est certes confirmé en 2021, mais il a été bien plus fort dans les pays
asiatiques qui ont mieux maîtrisé le virus. Quant à la Chine, elle « a mis en œuvre des mesures efficaces lui
permettant de connaître un rebond important et surtout durable, le pays aura été le seul à connaître une croissance
11
positive dès 2020 ».
En ce qui concerne l’Afrique, dans la première phase, elle a été peu touchée par la pandémie. Certains pays
africains, comme le Sénégal, l’Afrique du Sud et le Kenya, seront probablement en mesure de faire face à la grave
urgence sanitaire. Mais d’autres, comme la Tanzanie, le Mozambique, l’Ouganda, la République démocratique du
Congo ou l’Éthiopie, sont particulièrement à risque, tandis que certains États comme la République centrafricaine, la
Somalie ou le Soudan du Sud n’ont aucune chance de réagir à une propagation généralisée du virus. Au Maghreb,
dix ans après les printemps arabes, les espoirs de transition démocratique portés sur le pays de la révolution du
Jasmin, la Tunisie, seul pays arabe qui avait réussi une réelle transition démocratique, risquent d’être balayés par la
crise sanitaire. Le pays est sur le point de faire faillite, comme le Liban, et la récession de –8,5 %, couplée au
chômage sidéral, à l’opposition entre islamistes et nationalistes, à la faillite du système de santé et à la ruine des
finances publiques, risquent de plonger le pays dans le chaos.
Les pays producteurs de pétrole ont également été touchés car affectés par la volatilité des prix et variations des
marchés. Une économie hydrocarburière comme l’Algérie, pénalisée depuis des années par un prix du baril de
pétrole très bas, et qui importe massivement, risque de fortes pénuries. Les monarchies du Golfe et les pays
pétroliers d’Afrique ont à leur tour investi très peu dans le secteur de la santé. Dans de nombreux cas – Libye
(bombe à retardement compte tenu de la porosité de ses frontières), Syrie (militaires infectés d’Iran et du Pakistan),
Yémen (déjà à genoux en raison de la pire catastrophe humanitaire de la planète), on constate un chevauchement
géopolitique entre les situations préexistantes (conflits et crises de diverses natures), les effets du virus, les conflits
armés en cours et l’urgence virale.
L’Inde a quant à elle été touchée d’une manière particulièrement préoccupante en mai 2021 avec
412 000 nouveaux cas en vingt-quatre heures (moyenne de 350 000 à 400 000) et près de 4 000 décès journaliers. À
l’opposé de la Chine confucéo-maoïste, l’Inde démocratique, fédérale et ouverte a été incapable de maîtriser la
situation par manque de moyens (soins intensifs, oxygène…), et surtout faute d’être dotée d’un système politique
suffisamment autoritaire et centralisé pour contrôler la société et une population de 1,4 milliard d’habitants.
En Europe, l’Espagne et l’Italie, par exemple, qui sont plus dépendantes du tourisme de masse, ont été plus
touchées par la crise que les pays d’Europe du Nord. D’une manière générale, la crise due à la Covid-19 a provoqué
une chute spectaculaire des investissements directs à l’étranger (IDE). D’après les chiffres de l’ONU, les
12
investissements directs étrangers dans le monde ont chuté de 42 % en 2020 et sont par conséquent passés sous la
barre des 1 000 milliards de dollars (environ 850 milliards) pour la première fois depuis 2005. La baisse s’est
concentrée dans les pays développés, où les IDE ont chuté de près de 70 % pour s’établir à environ 229 milliards de
dollars.
La situation est encore plus préoccupante pour les pays en développement, la pandémie ayant entraîné une
prudence accentuée des investisseurs. Les pays dépendants de ces investissements ont donc subi une forte baisse des
entrées de capitaux. En Afrique, les IDE sont passés de 46 à 38 milliards de dollars, et la baisse des projets sur site
vierge dans les pays en développement atteint 46 % et 63 % pour les pays africains. Ces régions sont plus
vulnérables parce qu’elles dépendent davantage des investissements et qu’elles ne peuvent pas mettre en place les
mêmes mesures de soutien économique que les pays développés. En revanche, les pays asiatiques sont ceux qui ont
le mieux résisté, avec une baisse des IDE de seulement 4 %.
13
Au niveau global, l’économie mondiale a reculé de 3,3 % en 2020 avec plus de 10 000 milliards de dollars de
pertes, selon les estimations du Fonds monétaire international, en raison du confinement et des mesures de
restrictions sanitaires dues à la pandémie. Le ralentissement causé par la pandémie n’a fait qu’accentuer un
mouvement de croissance négative ou nul initié depuis des années et il a donc aggravé une tendance baissière déjà
ancienne. Les flux mondiaux d’IDE vont rester assez faibles en 2021, et les Nations unies prévoient une nouvelle
baisse de 5 à 10 % par rapport à l’année écoulée, annonçant la vraie reprise pour seulement 2022, sous l’effet de la
restructuration des chaînes de valeur mondiales en faveur d’une plus grande résilience, de la reconstitution du stock
de capital et du redressement de l’économie mondiale. Mais tout dépendra de la résolution définitive de la crise
sanitaire…
En ce qui concerne la croissance du PIB, les dernières estimations du FMI confirment là aussi des inégalités
avec, sans surprise, la Chine en tête, cette dernière ayant déjà retrouvé une croissance fin 2020 de 8 %, suivie par les
États-Unis (6,4 %, soit une révision à la hausse de 1,3 point par rapport à janvier 2020 due aux plans de relance de
Joe Biden), et de la zone euro qui pourrait connaître un rebond de 5,8 %, estimation elle aussi revue à la hausse en
raison des retombées bénéfiques pour la zone UE du plan de relance américain. Mais rien de cela n’est certain.
L’endettement colossal et le spectre d’une banqueroute de
l’économie mondialisée
Pour faire face à la pandémie, nombre de pays, notamment industrialisés, ont lancé des plans d’aides massives
en vue d’amortir la récession subite. En avril 2020, l’Union européenne a ainsi lancé un vaste plan d’urgence de
540 milliards d’euros. Deux autres instruments de relance ont été adoptés par la suite : un budget 2021-2027 de
1 075 milliards d’euros et un plan de relance de 750 milliards d’euros, réévalué en avril 2021 à 806 milliards d’ici à
2026. Les banques centrales ont donc inondé les marchés pendant que les gouvernements ont renfloué les entreprises
fragilisées par la crise, ceci au moyen d’emprunts et donc d’endettements supplémentaires devenus surréalistes. La
BCE a joué bien évidemment un rôle clé en rachetant massivement les dettes émises par les gouvernements
européens pour rassurer les marchés financiers et permettre aux États de s’endetter à bas coût. Son programme
d’urgence face à la pandémie (PEPP), lancé en mars 2021, a atteint le montant astronomique de 1 850 milliards
d’euros.
Le plan de relance américain a quant à lui mobilisé, tout d’abord sous Donald Trump, à partir de mars 2020,
2 200 milliards de dollars (10 % du PIB), auxquels s’ajoutent 900 milliards adoptés en décembre 2020. Le nouveau
Président américain, Joe Biden, a ajouté trois plans de relance supplémentaires : le premier de 1 900 milliards de
dollars, adopté en mars 2021 par le Congrès et destiné à stimuler la reprise économique par l’aide aux personnes les
plus modestes, l’accélération des vaccins, puis l’aide aux autres secteurs touchés par la crise, financé en grande
partie par la dette. Le deuxième plan, destiné aux infrastructures (2 250 milliards de dollars sur huit ans), vise à
rénover le secteur des transports, de l’industrie et de la transition énergétique. La mesure phare de ce financement est
l’impôt sur les sociétés que Biden, à l’inverse de l’administration Trump, veut augmenter à 28 % contre 21
actuellement, provoquant ainsi l’opposition des républicains et des entreprises concernées. Le dernier plan prévu
(1 800 milliards), dédié à l’éducation et l’aide aux familles, devrait être financé par une hausse d’impôt pour les
ménages les plus riches. Les deux derniers plans n’ont pas encore été approuvés au moment de la rédaction du livre.
Au total, 6 000 milliards de dollars de dépenses ont été annoncées, soit l’équivalent du PIB de la France, de l’Italie
et de l’Espagne réunies !
Tous ces plans de relance au niveau mondial n’ont fait que rendre encore plus grave un fléau déjà ancien qui
promet de punir les générations à venir : l’endettement endémique qui menace, à terme, le système capitaliste
mondial mis en place par les Occidentaux. Depuis les années 2000, en effet, les plus grandes instances
internationales, dont la Banque des règlements internationaux (BRI) et l’Institute of International Finance (l’IIF),
tirent la sonnette d’alarme sur la situation de la dette mondiale (États, entreprises et ménages réunis), qui, d’après
14
l’IIF, a atteint 281 000 milliards de dollars fin 2020 , soit 355 % du PIB mondial ! Pour les seules années 2020 et
2021, le chiffre avancé est de 65 000 milliards de dollars. Et les plans de relance ont accentué un phénomène
préexistant : les banques centrales détiennent des parts de plus en plus importantes de dettes souveraines. Le spectre
du surendettement est rendu certain par l’augmentation exponentielle des dépenses liées au traitement de la
pandémie. À ce rythme, l’IIF évalue l’endettement mondial global à 360 000 milliards de dollars d’ici 2030. Il existe
par conséquent une grande incertitude sur la façon dont l’économie mondiale va pouvoir se désendetter dans l’avenir
sans conséquences socio-économiques dramatiques pour les populations (austérité). L’endettement asphyxie bien
évidemment en premier lieu les pays les plus pauvres. Certains ont déjà déclaré un défaut de paiement (Liban,
Venezuela) ou sont sur le point de le faire (Tunisie). La dette du Venezuela et du Liban a déjà atteint
15
77 700 milliards de dollars en 2020 (contre 55 000 milliards en 2018 ), selon l’IIF.
Les pays développés sont toutefois à l’origine de la moitié de la progression de l’endettement mondial. La dette
16
publique américaine s’élève ainsi à 23 000 milliards de dollars en 2021, soit 102,3 % du PIB, taux qui va encore
augmenter avec les trois plans de relance voulus par Joe Biden (pas encore tous approuvés à la rédaction de
l’ouvrage). La dette des firmes américaines a quant à elle littéralement explosé depuis la crise de 2008, pour
17
atteindre 10 600 milliards de dollars , soit la moitié du PIB américain…
Concernant la dette totale de la Chine, curieusement rarement évoquée, elle a atteint 40 000 milliards de dollars
18
en 2021, soit 15 % de l’endettement total de la planète, et 335 % du PIB chinois ! Il est certes vrai que le
souverainisme chinois couplé à ses excédents commerciaux et à la dépendance du monde industriel vis-à-vis d’elle
la prémunissent contre un scénario de banqueroute. Tel n’est toutefois par le cas de la zone euro, dont la dette
publique a grimpé en flèche (+1 240 milliards d’euros) en raison des mesures financières pour soutenir l’économie
19
touchée par la pandémie, atteignant ainsi 11 100 milliards d’euros, soit 98 % du PIB, contre 83,9 % en 2019 . Par
ailleurs, l’augmentation des indicateurs de stress de liquidité du marché des obligations annonce des turbulences sur
les marchés mondiaux et une hausse des taux d’intérêt à venir. La conséquence d’une dette élevée et croissante est
de réduire l’épargne, d’augmenter les intérêts de cette même dette, de limiter la capacité des décideurs à réagir à des
événements imprévus, et d’accroître la probabilité d’une crise financière majeure.
Face à cet endettement mondial sans précédent, aucun consensus n’existe parmi les économistes et les
gouvernements nationaux quant au montant maximal de dette publique soutenable, pas plus que sur le moment à
partir duquel cette dette va inévitablement saper à son tour la croissance du PIB. Dans son rapport paru en
avril 2020, le FMI a averti qu’une augmentation des restructurations de dettes et des défauts sera inévitable dans les
pays les plus fragiles et que le surendettement des entreprises non financières et des ménages est également
extrêmement alarmant, le pire scénario étant une banqueroute générale du système capitaliste libéral. Les mesures
d’endettement mises en place pour faire face à la crise sanitaire représentent donc un risque majeur, d’autant que de
nombreux autres signaux sont préoccupants pour la stabilité financière mondiale, que ce soit
l’hyperinterventionnisme des banques centrales, le niveau élevé des indices boursiers, la volatilité des actifs, le
risque d’éclatement des bulles immobilières et boursières, ou encore l’endettement des sociétés non financières.
S’ajoute à cela la guerre commerciale sino-américaine qui n’augure rien de bon pour l’économie et la stabilisation
des marchés et pour le multilatéralisme…
La France et l’Europe au bord de la faillite ?
20
En juillet 2021, la dette publique française s’établissait à 2 700 milliards d’euros, soit 177 % du PIB . D’après
21
un scénario émis par le rapport Arthuis , avec 10 % de déficit, et sur la base d’une croissance économique à 1,5 %
en moyenne, l’endettement de la France devrait ainsi s’élever à 128 % du PIB d’ici 2030, certes à politique
inchangée. Il est vrai que Paris connaît un déficit annuel depuis… 1974, et à partir de cette date, même les
meilleures années se sont terminées par des déficits. La France était déjà parmi les mauvais élèves de l’Europe bien
avant la pandémie, mais elle a aggravé son cas en mettant sur la table des centaines de milliards d’aides publiques
afin de renflouer les entreprises les plus touchées par la crise. En font partie aussi les interventions directes en capital
pour les entreprises en difficulté, ainsi que les dispositifs de garanties en faveur des prêts bancaires aux entreprises et
de l’assurance-crédit, soit un total d’intervention d’environ 470 milliards d’euros. Comme l’a expliqué Marc Touati :
« En 2020, pour la première fois de son histoire, la France est devenue le premier contributeur de la dette publique
de l’ensemble de la zone euro. La part de la dette publique française dans cette dernière est désormais de 24,1 %,
22
contre 23,1 % . » Or la croissance diminue en parallèle de l’augmentation de la dette… L’économie française va
donc mal, le chômage augmente (le secteur des services s’est effondré avec les confinements), comme la précarité,
avec le risque de crises sociales, ethnocommunautaires et donc de violences en zones sensibles.
Dans les pays où les systèmes de protection sociale sont encore faibles ou presque inexistants, comme dans les
sociétés anglo-saxonnes, en Espagne, en Allemagne, ou dans certains pays de l’Europe orientale et centrale, ces
conséquences risquent d’être encore plus dramatiques socialement qu’en France, en l’absence d’amortisseurs
sociaux puissants et de redistribution efficiente. Marc Touati alerte également sur les obligations d’État : « La bulle
des obligations d’État […] se traduit par une baisse des taux d’intérêt des bons du Trésor et donc une flambée du
cours de ces derniers, en dépit de l’accroissement permanent de la dette […], même si l’État vendait ses trésors ou
une partie de son patrimoine, il ne parviendrait pas à rembourser ses dettes, l’actif de l’État français étant
globalement négatif. » Un krach obligataire est donc fort probable, les taux d’intérêt sur les obligations de l’État
pouvant augmenter et donc entraîner une perte de confiance des investisseurs internationaux qui, pour accepter de
financer la dette, imposeraient des primes de risques ou taux d’intérêt très élevés, ce qui obligerait le pays à
s’endetter sans fin…
La Cour des comptes a dévoilé plusieurs scénarios de sortie de crise pour l’économie française. Le premier
23
(positif), dit de « rattrapage », prévoit une relance assez rapide de l’activité, bien qu’il faille au moins trois ans
pour que la France retrouve sa situation d’avant crise, avec une croissance potentielle de 1,25 % par an sur la
période. Dans ce scénario, le fonctionnement de l’économie ne serait que temporairement altéré et les capacités de
production sortiraient indemnes de la crise, la dette devant même baisser légèrement. Le deuxième (défavorable) est
celui d’une « perte limitée », c’est-à-dire un PIB qui retrouve son niveau d’avant crise mais sans pouvoir récupérer
les pertes dues aux faillites d’entreprises et le report de projets d’investissements. Le bilan s’élève à plus de deux
années de croissance perdues à cause de la pandémie. Enfin, le troisième dépeint une « faiblesse persistante » avec
une relance de l’activité plus faible que prévu et des investissements affectés sur le long terme, ce qui ferait diminuer
le taux de croissance sur plusieurs années avec un PIB remontant bien plus lentement que souhaité. La dette
augmenterait alors jusqu’à 140 % du PIB dans les dix prochaines années. Le nombre de chômeurs et de travailleurs
précaires exploserait, le climat politico-social se dégradant de plus en plus, augmentant le sentiment d’inquiétude et
l’éventualité de soulèvements…
Explosion de la dette et risque d’implosion de l’euro
La question de l’annulation de la dette souveraine française par la BCE se fait de plus en plus entendre,
phénomène qui se produit déjà en Europe pour nombre de nations, mais on peut aisément imaginer qu’il y a une
limite à l’action de la BCE et qu’elle ne va pas pouvoir racheter les dettes infiniment. Il est clair qu’elle devra un
jour réduire, voire arrêter, sa « distribution » de capitaux, en partie sous la pression de l’Allemagne. La France
subira alors une forte augmentation des taux d’intérêt de ses obligations d’État. Marc Touati estime que « dès lors,
même si la BCE et Angela Merkel ont réussi à calmer le jeu temporairement […], le rachat des dettes souveraines
par la BCE finira par devenir illégal en Allemagne. Et ce, a fortiori lorsque Angela Merkel ne sera plus chancelière,
à l’automne 2021. Cela relancera immanquablement la crise de la dette publique, qui, ne l’oublions pas, n’est
24
qu’endormie depuis 2015 et n’attend qu’un prétexte pour se réveiller avec pertes et fracas ». En plus d’engendrer
un krach obligataire et boursier international, « ce scénario viendra également réactiver la crise existentielle d’une
zone euro qui est toujours aux abois. Ce qui alimentera de nouveau la hausse des taux d’intérêt obligataires et
relancera la récession ». L’opposition structurelle entre l’Europe du Nord, riche, bien gérée et peu endettée,
favorable à un « euro fort », et l’Europe du Sud, paupérisée, surendettée et mal gérée, deviendra intenable et
menacera la survie même de l’UE.
La Commission européenne a estimé qu’il faudra au moins deux ans pour se remettre de la crise sanitaire.
D’autres experts parlent plutôt d’un cycle de dix ans… Or certains pays comme l’Espagne ou l’Italie ne possèdent
pas de manœuvre budgétaire à la hauteur de la crise. D’après Marc Touati, « l’Union économique et monétaire telle
que nous la connaissons aujourd’hui aura disparu avant 2022. Cela ne signifiera d’ailleurs peut-être pas la fin de
l’euro, mais l’avènement d’une zone monétaire plus restreinte, avec une vraie intégration, une véritable union
25
fédérale, des règles strictes et une entraide à toute épreuve ». L’éradication du virus étant plus laborieuse que
prévu, les perturbations de l’économie seront plus durables en Occident et partout en dehors de la zone asiatique.
Nous assistons de la sorte à la récession la plus sévère jamais connue depuis l’entre-deux-guerres, en temps de paix.
L’arbitrage qui a été fait au profit de la santé – après des années de réductions folles des personnels de santé et de
nombre de lits d’hôpitaux – au détriment de l’économie et au prix d’un méga-endettement – avec les multiples
confinements – va avoir des conséquences désastreuses dont on ne perçoit pas encore les manifestations les plus
chaotiques.
In fine, ce seront les citoyens qui paieront la facture, en particulier les épargnants et les retraités. Jusqu’à peu, la
crise financière avait été noyée et différée artificiellement par les flux de liquidités injectées par les banques
centrales, mais une fois que les solutions d’assistanat auront été épuisées et que l’endettement endémique aura
conduit à la banqueroute et/ou à une austérité difficilement supportables pour les peuples, avec son corollaire de
surtaxations et de spoliations possibles des rentiers (spectre des bail-in, comme à Chypre après la crise de 2008),
l’heure des grandes secousses et des confrontations interétatiques et infra-étatiques sonnera le glas de la
« mondialisation heureuse » et du multilatéralisme.
Perdants et gagnants de la crise sanitaire
Les grands gagnants de la crise sanitaro-économique sont les multinationales de l’Internet (WebSoft/Gafam), le
monde de l’entertainment, les producteurs de jeux vidéo, et, d’un point de vue stratégique et géoéconomique, la
Chine et les économies industrielles d’Asie en général. Le chiffre d’affaires du commerce en ligne des
multinationales digitales, dont Amazon représente plus d’un tiers, a bondi de 17,5 % et son bénéfice net de 15 %. La
grande distribution (surtout alimentaire) a profité de cette tendance avec une hausse de 8,5 % des recettes et de
18,4 % du bénéfice opérationnel, voire +40 % pour Walmart ou Carrefour. Les ventes en ligne de la grande
distribution ont également progressé de 115 %. Les sociétés de paiements électroniques sont donc également
gagnantes, tout comme les télécommunications et les réseaux de distribution on-line et à domicile et autres livreurs.
Après l’apparition de la Covid-19, en effet, de nombreux gouvernements, citoyens et acteurs des Gafam ont
considéré les paiements numériques comme un moyen efficace d’effectuer des transactions tout en réduisant le
risque de propagation du virus. Sans surprise, si 2020 a été la pire année pour les commerces de proximité,
l’hôtellerie, la restauration et les transports internationaux aériens et ferroviaires, elle a été l’année de gloire pour les
Gafam. Le confinement et les mesures de prévention de l’épidémie ont en effet constitué un terreau de croissance
idéal pour les géants du numérique. Ils ont profité de l’essor du télétravail, de l’e-commerce et du divertissement
digital pour afficher des ventes records, qui ont bondi de 18 % au premier trimestre 2020 avec une hausse de 31 %
du bénéfice par rapport à la saison précédente. Entre avril et décembre 2020, les Gafam ont augmenté de 45 % leur
26
chiffre d’affaires (CA) cumulé . Amazon a été le grand gagnant, avec un CA en hausse de 40 % (89 milliards de
27
dollars) et un bénéfice net qui double à 5,2 milliards au deuxième trimestre 2020 . D’après un rapport de
28
l’Oxfam , les bénéfices réalisés pendant l’épidémie par 32 multinationales (américaines pour la plupart, dont les
Gafam) se sont accrus de manière significative. Comparativement à sa marge bénéficiaire pré-Covid, Microsoft a
ainsi réalisé près de 19 milliards de dollars de profits supplémentaires, Google plus de 7 milliards et Amazon, Apple
et Facebook plus de 6 milliards chacun. Le secteur de la « tech » est particulièrement représenté dans la liste, avec,
outre les Gafam, les américains Intel (8,2 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires), Cisco Systems
(3,2 milliards) et Oracle (1,9 milliard). Le secteur de l’électronique (Apple, Samsung, Dell…) a également profité de
« l’accélération numérique », du télétravail et de l’enseignement à distance (CA en hausse de 5,5 % et un bénéfice
opérationnel augmentant de 17 %), et va continuer à progresser avec l’arrivée de la 5G qui devrait accroître encore
plus la demande de smartphones, en léger recul en 2020.
Le secteur pharmaceutique est également l’un des grands vainqueurs naturels de la crise sanitaire, même si les
ventes dans ce secteur ont augmenté au départ de façon modeste, en 2020 (3 %) et début 2021, avec un bénéfice
opérationnel en hausse de 1,4 %, pour Johnson & Johnson, Roche, Bayer, notamment. L’augmentation des ventes,
soutenues au départ par les médicaments et tests pour la Covid, est logiquement devenue massive avec la
commercialisation des vaccins en 2021. Pfizer annonce ainsi une prévision de CA en 2021 à 33,5 milliards de
dollars et Moderna à 19 milliards de dollars. Les profits des géants américains Merck et Johnson & Johnson sont
29
aussi en hausse (+4,9 milliards de dollars pour l’un et +3,1 milliards de dollars pour l’autre) . Les fabricants de
masques et de gel ont quant à eux enregistré une véritable explosion de leurs ventes, avec une prédominance
escomptée des industries chinoises.
Les grands perdants sont le transport, l’industrie automobile, les constructeurs d’avions, les secteurs pétroliers
et de l’énergie en général, ceux de la mode, de l’assurance et, bien sûr, du tourisme. Ainsi, le chiffre d’affaires du
secteur pétrolier (Aramco, Shell, BP…) a chuté de 32,9 % et son résultat opérationnel de 85 %, en raison de
l’effondrement des cours et de la baisse de la demande de pétrole de 9 % en 2020. La faiblesse de la demande
d’énergie risque d’ailleurs d’être prolongée de quelques années avant de redémarrer ensuite grâce à la démographie
mondiale, notamment, et en raison de la lenteur de la transition énergétique, certes engagée dans maints pays. En
2020, les ventes de l’industrie automobile (Fiat Chrysler, PSA, Volkswagen…) ont chuté de 12 % et ses marges de
42 %. Seules les ventes de véhicules électriques et hybrides ont tenu la route. Le secteur du tourisme a connu une
baisse de 26 % et des pertes opérationnelles énormes. Les ventes du secteur de la mode (LVMH, Adidas…) ont
connu une chute de 17,3 %, malgré une hausse de 50 % du commerce en ligne, tandis que les bénéfices
opérationnels ont plongé de 47,9 %. Après une embellie au quatrième trimestre 2020, le secteur devrait croître
d’environ 14 % en 2021, tiré une fois de plus par le luxe et la demande chinoise. D’après le centre d’études de la
banque Mediobanca, trois secteurs vont devoir muter : la grande distribution, le transport et le tourisme, tandis que
trois autres vont particulièrement prospérer dans l’ère de l’après-Covid-19 : la santé, les « Big Tech » et le bien-être.
Biotech, ordinateurs quantiques, thérapies génétiques : la Chine et
l’Asie en voie de déclasser l’Occident ?
Lorsque l’Union européenne et les États-Unis ont gravement manqué de masques au début de la crise sanitaire,
et lorsque les médias occidentaux ont décrit la façon dont les pays asiatiques – les premiers touchés – ont su très
rapidement combattre la pandémie et protéger leurs populations grâce à des moyens technologiques de traçage
avancés couplés à des fermetures de frontières, les citoyens et les élites d’Occident ont subitement pris conscience
que l’Asie n’était plus seulement une usine mondiale à bas coût. Ils ont compris que, loin de n’être qu’une zone de
délocalisation des entreprises occidentales cantonnée à produire et – dans le meilleur des cas – à imiter, l’Asie,
Chine en tête, est la plus grande zone d’expansion commerciale, industrielle et technologique du monde, désormais
capable de donner des leçons d’efficacité, de modernité et de progrès scientifique aux anciens maîtres occidentaux
bientôt déclassés.
Les innovations liées aux biotechs, aux nanotechnologies et au biomédical, en pleine expansion, domaines dans
lesquels les pays d’Asie sont en passe de dépasser les Européens, représentent, après les technologies de
l’information, la prochaine vague de croissance de l’économie des pays avancés, avec de grandes opportunités pour
30
les entreprises et l’emploi . Aussi les acteurs qui auront la plus grande avance dans ces domaines seront-ils en pole
position dans la compétition entre puissances, sur les plans économiques, politiques, médicaux et militaires. Or force
est de constater que l’Europe, qui accuse déjà un certain retard, faute d’investissements suffisants en R&D en raison
des freins éthiques, quasi inexistants en Chine, risque le grand déclassement en laissant de facto le quasi-monopole
dans ces domaines aux puissances asiatiques et, dans une moindre mesure, aux États-Unis. Les États encourageant
massivement et sans frein ces technologies pourraient accélérer la capacité des laboratoires à développer des
thérapies qui améliorent l’espérance de vie et la productivité des travailleurs par exemple. À la différence de la
vieille Europe et du monde musulman, la Chine, mais aussi le Japon, la Corée du Sud ou Taiwan, qui bénéficient
d’un environnement réglementaire favorable à la fois à la recherche sur les cellules souches et aux essais cliniques,
obtiendront des résultats significatifs bien plus rapidement que l’Occident. Ainsi, après avoir formé de nombreux
experts chinois et asiatiques, les puissances occidentales risquent de voir cette force se retourner contre eux et de
perdre leur avance et leur leadership…
Nanotechnologies
31
Les nanotechnologies , les cellules souches, les thérapies génétiques, ou autres biotechs, sans oublier les
ordinateurs quantiques, sont à l’origine d’extraordinaires avancées. Ces innovations, combinées aux progrès dans les
neurosciences et dans l’intelligence artificielle, vont révolutionner de nombreux domaines : médecine, industrie,
défense, énergie. La combinaison de ces technologies pourrait susciter de nouvelles innovations comme les
biocarburants synthétiques, les nano-ordinateurs, la robotique à usage militaire et médical, l’extension des domaines
de la fabrication 3D à la médecine et à l’alimentation (viandes in vitro). Les pays réussissant à avoir le monopole de
ces innovations auront une force technologique majeure et changeront les rapports géopolitiques.
Les nanotechnologies, qui concentrent une bonne partie des investissements en R&D et en innovation, sont un
enjeu stratégique de compétitivité entre puissances ayant les moyens d’être dans la course. Or l’Occident est en
passe de perdre sa domination, notamment dans le domaine des technologies médicinales, au profit des puissances
asiatiques, avec en tête la Chine. Le marché mondial des nanotechnologies devrait dépasser 125 milliards de dollars
32
d’ici 2024 . La course aux résultats met en scène États-Unis, Allemagne, France, Chine, Japon et Taiwan. Et
comme dans presque tous les domaines, la Chine s’est donné pour objectif de devenir leader : elle a connu la
croissance la plus rapide de la recherche en nanosciences au cours de la dernière décennie. Parmi les 100 plus
grandes institutions de recherche en nanosciences au monde en 2018, la Chine en compte déjà 33, contre 30 pour les
États-Unis… L’armée chinoise possède également 6 établissements parmi les 10 premiers au monde, l’Académie
chinoise des sciences étant largement en tête du peloton. Sur la période 2012-2017, les universités chinoises ont reçu
500 millions de RMB (près de 80 millions de dollars) pour la recherche sur les nanotechnologies, et l’Académie des
sciences chinoise a lancé un programme de recherche stratégique prioritaire sur la nanotechnologie avec un
33
investissement d’environ 1 milliard de RMB, soit près de 155 millions de dollars . Au total, les investissements
chinois en R&D sont extrêmement élevés et en constante augmentation. Pour l’année 2019, ils atteignaient
34
320 milliards de dollars, soit une hausse de 12,5 % par rapport à 2018 .
Physique et Internet quantique
Le grand déclassement des Occidentaux par les Asiatiques concerne également les ordinateurs quantiques,
supercalculateurs, très différents des ordinateurs actuels, qui pourraient permettre, dans le futur, d’effectuer des
calculs impossibles pour les ordinateurs classiques (simulations pour l’énergie, le climat, la chimie, la médecine).
Aujourd’hui, la Chine est déjà leader : elle a récemment atteint le stade de la « suprématie quantique » grâce à un
ordinateur de ce type, une avancée qui dépasse toutes les compétences de Google ! Le test qu’auraient fait les
Chinois aurait été réalisé avec une vitesse 100 000 milliards de fois plus rapide que l’ordinateur le plus puissant du
monde… C’est dans ce domaine que la progression de la Chine a été la plus impressionnante, sachant qu’elle en
était totalement absente il y a vingt ans.
Médecine régénérative et édition génomique
Le même constat vaut pour la médecine régénérative, qui consiste à utiliser ces cellules et des tissus fabriqués à
partir de cellules souches dans le but de réparer et régénérer des organes, des tissus ou n’importe quelle autre partie
du corps endommagée, mais aussi pour des maladies. La recherche est active depuis de nombreuses années et des
essais cliniques ont déjà été réalisés pour le traitement de plusieurs pathologies graves comme les organes abîmés,
les cancers, les maladies neurodégénératives, la colonne vertébrale, etc. Alors qu’en Occident, les états d’âme
« éthiques » interdisent la culture médicale des cellules souches, ce qui bloque les progrès médicaux en matière de
médecine régénérative, la Chine (mais aussi Taiwan), qui n’a pas ces scrupules, en a fait une priorité de la R&D. Ces
dernières années, Pékin a financé très massivement les recherches. C’est ainsi que le douzième plan quinquennal
(2011-2015) chinois a consacré 3 milliards de yuans (435 millions de dollars) sur les seules cellules souches et la
médecine régénérative, et que le treizième plan (2016-2020) a lancé un vaste programme dénommé « Stem Cell and
Translational Research » de 2,7 milliards de yuans (423 millions de dollars), consacré aux applications des cellules
35
souches aux maladies neurologiques, vasculaires, du foie et de la reproduction . En 2018, des médecins du Nanjing
Drum Tower Hospital à Nankin ont réussi à soigner des patientes atteintes d’insuffisance ovarienne à l’aide de
cellules souches et, en 2019, deux hommes ont été les premiers à recevoir un traitement à base de cellules souches
« reprogrammées » pour une maladie cardiaque, une première mondiale. L’autre avancée majeure médicale a
consisté à associer la médecine régénérative et l’impression 3D. La Chine a ainsi conçu la première bioimprimante 3D capable de fabriquer des vaisseaux sanguins, mise au point par l’entreprise Sichuan Revotek qui
utilise une encre biologique composée des cellules souches prélevées à partir de cordon ombilical humain. Cette
technique biomédicale vise à modifier le génome d’une cellule, d’origine végétale, animale ou humaine
(modification d’ADN). Les possibilités en fonction de l’avancement de la science sont multiples. Les chercheurs
peuvent créer des mutations dans des gènes pour en observer les effets et corriger des problèmes en insérant des
fragments d’ADN ou en modifiant des gènes. Là aussi, les avancées sont limitées dans les pays occidentaux qui
posent la question éthique des risques d’abus ou tentatives de modifier des êtres humains directement dans leur
ADN. Ainsi, lorsque des « bébés transgéniques » ont été expérimentés dans un laboratoire chinois, la communauté
scientifique internationale – surtout occidentale – s’indigna quasi unanimement. Le scandale a révélé une fois de
plus l’énorme choc culturel, éthique et déontologique qui oppose, d’une part, un Occident rempli de scrupules et de
principes de précaution et, de l’autre un régime autoritaire sino-maoïste animé par la seule logique de l’efficacité et
de la recherche de la puissance par tous les moyens.
1. Voir la polémique américaine autour des révélations de l’ex-conseiller médical de la Maison Blanche, Anthony Fauci : « États-Unis : le Dr Fauci
exhorte la Chine à partager les dossiers médicaux des chercheurs malades de Wuhan », Le Figaro, 4 juillet 2021.
2. Institut de recherche sur les politiques publiques du Congrès des États-Unis.
3. CRS, Global Economic Effects of COVID-19, rapport, avril 2021.
4. « Our Annual Letter. The Year Global Health Went Local », site de la fondation Bill Gates, 27 janvier 2021.
5. Xavier Bazin, Big Pharma démasqué, de la chloroquine aux vaccins, la crise du coronavirus révèle la face noire de notre système de santé,
Paris, Trédaniel, 2021.
6. Insee, « Emploi et chômage », note de conjoncture, 15 décembre 2020 ; Point de conjoncture, 2020.
o
7. « Quel monde en 2021 ? », Alternatives économiques, n 122, janvier 2021.
8. Clément Fournier, « Et si les conséquences sanitaires de la crise économique étaient pires que celles du coronavirus ? », Youmatter, 28 octobre
2020.
9. « La Chine fait don de 200 000 doses de vaccin anti-COVID-19 à la Sierra Leone », Xinhuanet, 26 février 2021.
10. Publication de l’OCDE : « GDP Growth – Second Quarter of 2020, OECD », 26 août 2020.
o
11. Alternatives économiques, hors-série n 122.
12. Cnuced, « Les investissements directs étrangers dans le monde ont chuté de 42 % en 2020 », 25 janvier 2021.
13. FMI, Perspectives de l’économie mondiale. Reprise : des situations divergentes à gérer, rapport, avril 2021.
14. Institute of International Finance, Global Debt Monitor. COVID Drives Debt Surge—Stabilization Ahead ?, 17 février 2021.
15. Banque mondiale, « Le niveau d’endettement dans le monde augmente avec une ampleur et un rythme sans précédent depuis 50 ans »,
19 septembre 2019.
16. « États-Unis : “le niveau actuel de la dette est tout à fait viable”, selon la Fed », Le Figaro, 14 avril 2021.
17. Mayra Rodriguez Valladares, « U.S. Corporates Continue to Gorge at the Debt Trough », Forbes, 10 avril 2021.
18. IIF, Global Debt Monitor. Sharp Spike in Global Debt Ratios, rapport, 16 juillet 2020.
19. « La pandémie a fait exploser la dette de la zone euro en 2020 », Les Échos, 22 avril 2021.
20. Statistiques disponibles sur le site de l’Eurostat, www.ec.europa.eu.
21. Commission pour l’avenir des finances publiques, mars 2021 www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/03/rapport__commission_sur_lavenir_des_finances_publiques.pdf.
22. Marc Touati, « La France, premier fournisseur de dette publique de la zone euro », Acdefi, 8 décembre 2020.
23. Paul Louis, « Coronavirus : les trois scénarios de sortie de crise de la cour des comptes », BFM Business, 30 juin 2020.
24. Marc Touati, « La France est le premier fournisseur de dette publique… », op. cit.
25. Marc Touati, « Le coronavirus va-t-il sonner le glas de la zone euro à 19 ? », Capital, 15 mai 2020.
26. « GAFAM : La pandémie, qui a profité aux géants du numérique, pourrait accélérer leur régulation », Novethic, 5 novembre 2020.
27. « Ces incroyables profits d’Amazon pendant la pandémie », Capital, 30 juillet 2020.
28. « Power, Profits and the Pandemic » de septembre 2020, in art. cit.
29. « Gafam, actionnaires… Qui s’est le plus enrichi depuis le début de la pandémie ? », art. cit.
30. « Sciences du vivant et biotechnologie – Une stratégie pour l’Europe », communication de la Commission européenne, 23 janvier 2001.
31. Les nanotechnologies rassemblent un grand nombre de disciplines scientifiques traditionnelles comme la physique, la chimie, les sciences et
technologies de l’information et de la communication (Stic), et biologie médicale.
32. Zhang Zhihao, « Chinese Researchers Head the Field in Nanoscience », China Daily, 19 août 2019.
33. Springer Nature, Small Science in Big China, août 2017.
34. « China’s Spending on R&D Rises to Historic High », Xinhua, 27 août 2020.
35. Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, « Éclairage sur la médecine régénérative en Chine », 19 juin 2018. Entre 1999 et 2018, la
Chine a créé 30 centres de recherche en médecine régénérative. En nombre d’articles publiés, elle est, avec 2 091 articles (2008-2018), derrière les
États-Unis (7366) mais devant la France, le Japon, la Corée, l’Allemagne.
CHAPITRE XIV
Démondialisation ou désoccidentalisation de la mondialisation
?
« Tout pour nous et rien pour les autres, voilà la vile maxime qui paraît avoir été dans tous les âges, celle des
maîtres de l’espèce humaine. »
1
Adam Smith
L’évolution de l’échiquier géoéconomique mondial de ces dernières années et les crises de 2008 – financière –
et de 2020-2021 – sanitaire et économique – ont porté un rude coup à la mondialisation heureuse, tant vantée par
Alain Minc et les démocrates américains dans les années 1990. Longtemps indiscutable, cette doxa ne fait plus
l’unanimité. Elle est même fortement combattue à l’intérieur de l’Empire américain par les adeptes du nouveau Parti
républicain – et pas seulement par l’aile gauchisante du Parti démocrate autour de Bernie Sanders – depuis que le
Grand Old Party a été métamorphosé et resouverainisé par les adeptes du Tea Party et Donald Trump, dont les
électeurs s’autoqualifient fièrement de « Patriots ». Ces adeptes du « Make America Great Again » accusent ceux
qui ont une lecture mondialiste de la globalisation marchande et financière d’avoir affaibli les États-Unis et appauvri
les Américains anglo-saxons natifs en faisant subir aux ouvriers étatsuniens la concurrence déloyale mexicaine et
asiatique ainsi que l’immigration incontrôlée.
2
À l’opposé des partisans du libre-échangisme économique , qui voient la mondialisation comme bénéfique en
soi, les interventionnistes de droite et de gauche, adeptes de l’État stratège, prônent une altermondialisation ou une
démondialisation qui passe par la réglementation, les cycles courts, la réindustrialisation et les relocalisations, voire
par une forme de protectionnisme. Dans les années 1990-2000, ceux qui dénonçaient le plus la mondialisation
marchande dite « néolibérale » étaient les anticapitalistes No Global (voir mouvement Attac), situés à gauche et à
l’extrême gauche, marqués par un tiers-mondisme et un internationalisme prolétarien, qui proposaient un modèle
alternatif à la mondialisation capitaliste néolibérale, donc une altermondialisation fondée sur le mantra paradoxal :
act local (déglobaliser/renationaliser les entreprises, combattre les multinationales et le capitalisme financier) but
think global (mondialiser les institutions publiques, c’est-à-dire supprimer des frontières qui empêchent les
migrations – présentées comme bonnes en soi – et promouvoir une citoyenneté universelle). La contradiction
résidait dans le fait qu’ils étaient identitairement mondialistes et économiquement nationalistes. Depuis que le
monde est en voie de multipolarisation, ce sont des forces plus identitaires et nationalistes qui remettent le plus en
question la mondialisation libérale à l’anglo-saxonne et qui œuvrent à une démondialisation. Ces puissances
nationalistes ne se limitent pas à des États semi-autarciques comme la Russie. La plus hégémonique d’entre elles, la
Chine mercantiliste, cherche plus à désidéologiser, désoccidentaliser et retourner la mondialisation contre ses
protagonistes anglo-saxons qu’à la détruire. Les puissances montantes y voient en fait un gigantesque champ de
concurrence, le théâtre d’une guerre géoéconomique et géocivilisationnelle qu’elles escomptent gagner face aux
pays concurrents ou hégémoniques, notamment occidentaux.
La démondialisation ne décrit donc pas, selon nous, l’aspiration – irréaliste et folle – à mettre fin aux échanges
entre êtres humains, ni le « repli sur soi », qui provoquerait inéluctablement le retour des guerres et des
nationalismes, d’après les adeptes de la mondialisation heureuse. Elle désigne la volonté des États de récupérer leur
souveraineté – politique, économique et financière – et l’aspiration des peuples à défendre leur identité nationale.
Celles-ci ont en effet été mises en danger par une mondialisation dérégulée à l’anglo-saxonne, une financiarisation
excessive de l’économie, une désindustrialisation corrélative ainsi que par l’action des puissances supranationales et
multinationales dont la croissance a semblé s’opérer au détriment des États-nation.
Cette démondialisation, que nous pourrions aussi nommer la postmondialisation, signifie donc plutôt une
redistribution des cartes économiques sur des bases géographiques plus cohérentes. Elle implique la réorientation
des économies vers la priorité de la production destinée aux marchés locaux ; le rétablissement des « circuits
courts » ; l’interdiction ou la limitation des délocalisations ; l’instauration d’un protectionnisme intelligent ;
l’imposition de taxes douanières plus élevées aux pays à bas salaires qui pratiquent le dumping social et/ou – comme
la Chine – une concurrence déloyale et des échanges inégaux. On peut également mentionner les dernières mesures
instaurées sous l’impulsion de Joe Biden et de l’OCDE visant à taxer à une moyenne de 20 % minimum les
multinationales et les Gafam. Les penseurs de la démondialisation ajoutent la règle d’une nette séparation entre
banques d’investissement et de dépôts, la lutte contre les fraudes et même parfois l’abandon du dollar comme
monnaie de réserve mondiale, grande requête des pays multipolaristes de l’OCS et des Brics. L’idée générale est
qu’il serait possible de donner un autre contenu à la mondialisation, et empêcher que les délocalisations et la
désindustrialisation ne continuent d’appauvrir les peuples et de rendre l’UE toujours plus dépendante, donc à la
merci, des puissances commerciales asiatiques ou nord-américaines.
La démondialisation, longtemps assimilée aux protectionnistes d’extrême gauche ou d’extrême droite, a
commencé à être prise au sérieux depuis les effets dévastateurs de la crise financière de 2007-2008 et les mesures
d’austérité insupportables pour les peuples qui ont suivi. Le terme est apparu pour la première fois en 2002, sous la
plume du penseur philippin Walden Bello, auteur de l’ouvrage Deglobalization (2002), qui explique que la
mondialisation s’est construite aux dépens des pays du sud de la planète et qui appelle à un contrôle politique des
systèmes économiques ainsi qu’à un démantèlement des institutions financières internationales (notamment la
Banque mondiale, le FMI, l’OMC), dans une logique assez tiers-mondiste et dirigiste. Outre-Atlantique, c’est le
libéral-conservateur américain Donald Trump qui s’est fait élire en 2017 sur un programme de dénonciation des
effets pervers de cette mondialisation jugée dangereuse, source de chômage et de perte de souveraineté au profit de
l’ennemi géoéconomique chinois, notamment. Une idée jugée au départ belliciste dans la bouche de Donald Trump
mais que Joe Biden semble reprendre à son compte en partie aujourd’hui. En Grande-Bretagne, le Brexit a triomphé
grâce au vote des régions dévastées par la désindustrialisation et donc des souverainistes – conservateurs comme
travaillistes – ainsi que par l’action de Nigel Farage, créateur de partis politiques eurosceptiques Ukip (Parti pour
l’indépendance du Royaume-Uni, 2016), puis le Parti du Brexit (2019). Ses idées seront reprises par un autre leader
non réputé pour son tiers-mondisme ou son étatisme, Boris Johnson, qui table non pas sur une démondialisation à la
façon des No Global socialisants mais sur une canalisation de la mondialisation en fonction des intérêts premiers de
sa nation redevenue souveraine et capable de sortir de tous les traités internationaux et supranationaux jugés
attentatoires à la souveraineté. Il est intéressant de noter que chez ces personnalités occidentales, la logique qui a
inspiré les travaux de Walden Bello est renversée : alors que chez le penseur philippin, les politiques de
démondialisation devaient servir à protéger les pays du Sud de ceux du Nord, les démondialistes d’Occident veulent
protéger les pays du Nord des logiques qui dépassent leur souveraineté nationale, des agressions économiques et du
dumping social des anciens pays du Sud et de l’ex-tiers-monde devenus émergents ou même riches.
En France, des personnalités issues de bords aussi différents que le politique Arnaud Montebourg (PS),
3
l’économiste iconoclaste Jacques Sapir , ou l’économiste et journaliste François Lenglet, ont adapté les thèses des
démondialistes à la réalité française et européenne. Arnaud Montebourg, ancien ministre du Redressement productif
de François Hollande, s’est emparé du thème du made in France et de la réindustrialisation à la suite de la crise
financière de 2008 et des mesures d’austérité drastiques imposées par les dirigeants européens et les instances de
Bruxelles, chantres de la mondialisation et de la financiarisation de l’économie. Montebourg rappelle que si les
États-Unis dirigent l’ensemble de la technologie mondiale, c’est parce qu’ils protègent leurs technologies et donc
leurs intérêts, parce qu’ils ont pratiqué la guerre économique et surtout parce qu’ils n’ont pas laissé faire le marché
mondial chez eux, tout en l’exigeant des autres… Et le leadership dans le spatial (lanceurs) qu’ils sont en train de
ravir aux Européens est selon lui dû au fait qu’ils ont subventionné Elon Musk et SpaceX, même si en réalité,
SpaceX s’est aussi imposé grâce à une série d’innovations et à la supériorité de son business model qui a permis de
baisser les prix de production en comparaison avec la Nasa sclérosée. L’homme politique plaide en faveur d’un État
fort et reconnaît même que la politique économique de Donald Trump a fonctionné avant la Covid-19 grâce à cette
reprise en main de l’économie par le politique en fonction des intérêts nationaux. Il affirme que la France et l’UE
devraient suivre l’exemple de Trump face à la concurrence déloyale chinoise en surtaxant les importations de
produits chinois et en rééquilibrant l’énorme déficit commercial par une forme de protectionnisme et la fin de la
fermeture d’usines ou leur rachat afin de préserver notre capacité de production ainsi que les emplois. Il préconise
un capitalisme à l’allemande, comme l’a incarné l’ex-chancelier Gerhard Schröder, aux antipodes du modèle
dérégulé anglo-saxon, plus organisé autour de l’humain, des responsabilités, de la participation d’inspiration
gaulliste, et il appelle à une reconstruction écologique de l’industrie et de l’agriculture qui favorise les
relocalisations et les circuits courts.
4
De son côté, François Lenglet, auteur de La Fin de la mondialisation , explique que cette dernière a été
durablement freinée depuis la crise financière et économique de 2008, phénomène renforcé par la crise sanitaire, au
point de remettre en cause le « consensus de Washington », cette doxa mondialisante qui posait le primat des
échanges commerciaux et des pouvoirs financiers, de moins en moins régulés par les États. L’auteur constate
« l’ensablement » de l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce – que la Chine a intégrée étonnamment vingt
ans plus tôt que la Russie honnie mais dont les règles ont systématiquement été violées par Pékin –, et il voit dans le
rapatriement des chaînes de production vers les États-Unis, notamment, le début d’une tendance lourde initiée sous
l’ère Obama et poursuivie par ses successeurs. On peut, certes, lui répondre qu’il serait presque impossible de
rapatrier la plupart des usines car cela conduirait à l’augmentation du coût de vie que la société américaine ne pourra
pas accepter. Il pronostique par ailleurs que les cures de désendettement imposées aux pays touchés par la crise
impliqueront un mouvement généralisé de « renationalisation » financière. Selon lui, la crise sanitaire aurait
précipité la fin du cycle libéral enclenché dans les années 1960 avec la génération des baby-boomers et qui atteignit
son apogée dans les années 1980-1990. Elle légitimerait la reprise en main de l’économie par les États, le retour
d’une forme de souverainisme économique et même d’un protectionnisme raisonné.
Postmondialisation ?
5
Dans son livre La Démondialisation , l’économiste hétérodoxe Jacques Sapir explique, quant à lui, que la
mondialisation doit être complétée, régulée, reprise en main par les États et donc équilibrée par un « patriotisme
économique ». Sapir conteste ce qui a été présenté depuis des décennies par les néolibéraux comme le mérite majeur
de la mondialisation : les succès universels du libre-échange depuis les années 1990. Chiffres en main, l’auteur
rappelle que ces échanges libéralisés dans le cadre de la mondialisation anglo-saxonne n’ont pas induit la forte
croissance prophétisée au départ par ses promoteurs : l’impact sur les pays les plus pauvres a été en effet plutôt
négatif, et surtout, les seuls cas où la concomitance de la mondialisation et du développement économique s’est
vérifiée se situent dans les pays où des « politiques nationales puissantes » ont été instaurées. Pour limiter les échecs
de la mondialisation, l’économiste plaide en faveur d’un nouveau Bretton Woods et de la mise en œuvre des idées et
méthodes keynésiennes, comme celle consistant à pénaliser les déficits ou les excès de balance des paiements. Il
rappelle à ceux qui n’ont qu’une lecture « progressiste » de Keynes et qui l’opposent aux partisans du patriotisme,
que ce dernier n’était pas seulement un partisan de la coopération internationale mais d’abord un « farouche
opposant aux mécanismes supranationaux qui privent les gouvernements de leur souveraineté ». Pour Jacques Sapir,
« l’échec du FMI dans la crise asiatique de 1997 a redonné une vitalité significative aux politiques nationales
souveraines ». Comme plusieurs Prix Nobel d’économie, Sapir affirme que la seule solution pour conjurer les
conséquences de la crise née de la mondialisation serait d’abandonner l’euro, monnaie incapable de concurrencer le
dollar s’il n’est pas soutenu par une Europe-puissance, d’autant que les divergences entre les stratégies économiques
des pays de la zone euro sont presque impossibles à supprimer, ce qui compromet la constitution d’une zone
économique et monétaire optimale, condition de la viabilité d’une monnaie unique. Sapir est toutefois favorable à
une monnaie commune ou d’échange hors des frontières de l’Union européenne. Pour l’auteur, la fin de la
mondialisation financière à l’anglo-saxonne, qui a atteint son apogée avant la crise financière de 2008, serait
imminente : les indices les plus évidents de cette postmondialisation seraient notamment l’échec des négociations de
Doha, le refus de la Chine d’assumer les responsabilités monétaires que la mondialisation était supposée lui imposer
et, plus généralement, le retour massif des États stratèges désireux d’imposer à nouveau le primat du politique sur
l’économie. Cette tendance, observable tant aux États-Unis, en Hongrie, en Russie, en Grande-Bretagne, qu’en
Chine ou ailleurs, serait permise par le fait que le commerce mondial, qui avait augmenté jusqu’en 2011, n’a cessé
de se contracter depuis lors, donc bien avant la crise sanitaire, les économies en développement, en transition et
développées connaissant toutes un recul. À l’appui de ces constats, le rôle des pays du G7 les plus industrialisés
(États-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni) sur le PIB mondial s’est fortement réduit
depuis les années 2000 : les pays riches, traditionnellement très ouverts, n’ont cessé de perdre du poids dans le PIB
mondial, cédant la place aux émergents et aux Brics les plus développés qui ont rejoint – et parfois dépassé – les
pays occidentaux. Or la croissance de ces pays est de moins en moins due à l’extérieur, puisqu’elle repose toujours
plus sur des facteurs internes, la Chine elle-même ayant pour objectif stratégique économique d’augmenter son
marché domestique et de moins dépendre de l’étranger pour sa production de richesse, tout en continuant, certes, à
« miser sur l’intégration à l’économie mondiale » comprise comme à sens de plus en plus unique et à son avantage
(voir programmes Made in China 2025 et Obor). Le postulat des démondialistes est que les facteurs qui ont motivé
l’ouverture de nombreux pays ont cessé et qu’il existerait maintenant des facteurs alternatifs qui déplaceraient
l’intérêt vers l’intérieur.
Ralentissement de la mondialisation chinoise et postmondialisation
régionalisée
Quelques constats relatifs à l’évolution de la mondialisation depuis des siècles et les dernières décennies sont
éclairants : il est bon de rappeler que la mondialisation n’a jamais été un processus linéaire et éternel, pas plus
e
qu’elle n’a été exclusivement occidentale. Jusqu’au XVII siècle, en effet, ce fut la Chine, son argent métal, et ses
routes de la soie qui portèrent la première mondialisation, avec les échanges de ses deux produits phares : la
porcelaine et la soie. Pékin représentait alors une grande part de l’économie mondiale, jusqu’à ce qu’elle se ferme au
monde de sa propre initiative, avec les conséquences dramatiques que l’on sait (guerres de l’opium et réactions
impérialistes britanniques, françaises et occidentales). De la même manière, la mondialisation anglo-saxonne
(McWorld), lancée par les États-Unis « vainqueurs » de la guerre froide à la fin des années 1980, n’a pas seulement
été permise par la chute de l’URSS, l’ouverture consécutive de cet espace ainsi que de l’Amérique latine et de l’Asie
du Sud-Est au commerce mondial, mais surtout par l’arrivée de la Chine. Celle-ci a en effet porté la mondialisation
par son extraordinaire croissance économique à deux chiffres sur plusieurs décennies, à son immense marché et au
fait qu’elle est devenue l’usine du monde. Or ce processus de mondialisation porté par la Chine est en train de
s’estomper, après avoir atteint son apogée à la fin des années 2000. Ce constat d’une tendance lourde, qui va
marquer les prochaines décennies, a été émis par des spécialistes des échanges internationaux et des chercheurs
académiques peu soupçonnables de parti pris idéologique radical. Dans leur ouvrage collectif qui fait autorité, les
6
Prs Peter J. Buckley, Peter Enderwick et Adam Cross, auteurs de l’ouvrage de référence International Business ,
expliquent que le processus de mondialisation n’a plus de nouveaux grands marchés à intégrer, qu’après avoir été
portée par Pékin, qui l’a accélérée durant des décennies, après avoir intégré son marché et son industrialisation au
monde, la globalisation libérale à l’anglo-saxonne ne peut pas aller plus loin, d’autant que la Chine, devenue une
superpuissance, a comme priorité de développer un marché domestique et de s’autonomiser en cessant de n’être que
l’usine du monde des entreprises américaines et occidentales. Les auteurs estiment que ce mouvement de fond, qui
n’est qu’à ses débuts, va conduire inévitablement à un ralentissement de la mondialisation, tandis que les échanges,
qui ne vont pas s’arrêter, bien sûr, vont se développer sur un autre modèle, celui des économies régionalisées ou des
grandes régions économiques mondiales (Union européenne ; marché du Sud-Est asiatique, Union eurasiatique et
o
CEI russophones ex-soviétiques, marché nord-américain, voir cartes n 3 et 4). Cette régionalisation marchande ou
postmondialisation correspond en grande partie au paradigme des zones civilisationnelles de Samuel Huntington et
elle annonce la consolidation de pan-regions fondée sur des intérêts économiques, des sphères d’influences
géographiques communes qui vont de pair avec une multipolarisation géopolitique. Le monde va donc se décliner en
o
zones géocivilisationnelles (voir cartes n 2, 3 et 4) qui privilégient les échanges intrazones, sans supprimer les
échanges intercontinentaux les plus incontournables. Ce constat est également émis par Chetan Sehgal et Michael
Lai, analystes de la Franklin Templeton Emerging Markets Equity, qui prennent acte du fait que le coronavirus a
accentué la fracture entre la Chine et le reste du monde, notamment occidental, puis intensifié un processus
préexistant de démondialisation. Constatant que la crise a nettement aggravé la défiance entre la Chine et l’Occident,
observée avant même l’apparition de la Covid-19, ils expliquent, chiffres à l’appui, que l’objectif du pouvoir chinois
consiste à axer de plus en plus massivement la consommation sur son marché intérieur, passant ainsi du statut
« d’usine du monde » à la production de biens technologiques de pointe (puces informatiques, etc.) et à une
croissance à venir de plus en plus fondée sur le développement du marché domestique et la désexternalisation. Par
ailleurs, la crise sanitaire a mis en lumière l’extrême fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui a
provoqué une prise de conscience des élites nationales des autres grands pays décidés eux aussi à atténuer la trop
grande dépendance envers la Chine. La conclusion des auteurs est que le phénomène de mondialisation connu ces
vingt-cinq dernières années, qui a largement été fondé sur l’intégration de la Chine dans l’économie capitaliste
mondiale, s’estompe.
En fait, si tous les facteurs lourds qui ont promu la Chine comme usine du monde sont loin d’avoir disparu,
sachant que l’Europe et le monde ne pourront pas se passer d’elle du jour au lendemain et relocaliser des
gigantesques usines et industries implantées ou utilisées par les firmes occidentales et multinationales depuis des
décennies, Pékin est tout de même en train de perdre une part de son intérêt. Premièrement, les coûts de production
et de main-d’œuvre sont moins compétitifs que jadis. Deuxièmement, les prix de revient en Chine vont continuer à
augmenter progressivement en raison des pressions sur le respect des règles de travail exercées par l’OMT, en
particulier, et par les entreprises occidentales clientes, en général, de plus en plus contraintes par les normes ESG
(gouvernance et environnement) et par la prise en compte des externalités négatives (pollution, déchets…). Or ces
externalités négatives, qui incluent notamment la valeur carbone, en pleine croissance, sont calculées sur l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement, dont le transport, ce qui surenchérit les coûts. Cette tendance lourde va être
déterminante dans les choix des entreprises clientes de la Chine, notamment dans les pays occidentaux à la pointe
sur toutes ces normes. À cela s’ajoutent également les logiques de taxe carbone aux frontières, qui sont en train
d’émerger un peu partout, notamment en Europe, ainsi que les tensions sino-américaines, loin d’être résolues malgré
l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, qui semble avoir repris à son compte la guerre économique déclarée par Donald
Trump à la Chine, certes sans le dire aussi brutalement.
De la troisième vague de mondialisation à la démondialisation
Revenons maintenant sur le processus par lequel, après avoir connu son apogée dans les années 2000, la
mondialisation marchande à l’anglo-saxonne, nommée par les académiques « troisième vague » de mondialisation, a
7
commencé à être remise en cause et à décliner . Cette troisième vague, qui date des années 1990 dans un contexte de
chute de l’Empire soviétique, a été caractérisée par l’entrée de l’immense marché chinois et de l’usine du monde
chinoise dans la mondialisation depuis les années 1980, puis par l’intensification de trois processus, aujourd’hui
ralentis ou ayant connu leur apogée :
des échanges commerciaux (marchandises et services : « mondialisation marchande ») et des flux de
capitaux (transferts monétaires et investissements directs et indirects : « mondialisation financière ») ;
des flux humains (immigration, tourisme, voyages d’affaires : « mondialisation des personnes ») ;
et des flux d’informations (« mondialisation digitale »).
L’erreur fondamentale a consisté, durant des années, à surestimer ces trois intensifications et à y avoir une
fatalité qui aurait conduit à un processus inéluctable de désouverainisation et de dépossession des États de leurs
prérogatives régaliennes, financières et économiques. En réalité, entre 1980 et 2020, l’intensification des échanges
commerciaux n’a pas été aussi spectaculaire qu’on le dit, et la mondialisation a concerné avant tout celle des flux de
capitaux, des flux humains et surtout des flux d’informations, mais n’a pas détruit les souverainetés des États
puissants. Ces derniers l’ont au contraire instrumentalisée pour asseoir leur puissance et parfois même leur
hégémonie.
Essayons ici de faire justice de quelques idées reçues et confusions qui font croire que les adeptes de la
démondialisation seraient hostiles aux échanges économiques et voudraient « revenir en arrière ». Avant 1980,
l’abaissement des barrières douanières s’était réalisé de manière extrêmement progressive dans le cadre des
négociations internationales du Gatt (actuel OMC) avec une seule exception régionale : l’Europe qui, à partir de
1957, abolissait ses barrières douanières au sein d’un marché intérieur de 6 pays, puis 9, puis 12, puis 19, puis les
28 pays qui composaient l’Union européenne jusqu’au Brexit. Cependant, à partir des années 1990, les accords de
Marrakech et la création de l’OMC, qui ont regroupé 159 pays auxquels se sont jointes la Chine et la Russie, ont
abouti à un abaissement généralisé des barrières douanières dans le monde et à la mise en place d’un tribunal des
entraves au libre-échange, de sorte que, vu de l’Union européenne, hormis le contrôle du respect des normes et
quelques taxes symboliques, il n’y avait plus de différence entre les importations venues d’Europe et celles venues
de Chine. Or si l’on retire les échanges intra-européens des calculs du taux de pénétration des pays européens à
l’extérieur, en réalité, nous sommes toujours restés bien moins dépendants de l’extérieur qu’on le dit, car près de
80 % des échanges globaux ont toujours été effectués en « intrazone ». Certes, en valeur, les marchandises qui
traversent les océans grâce au recours massif aux containers sont au niveau mondial aujourd’hui le double de celui
de 1980. Cette augmentation en valeur varie selon les zones géographiques : vue d’Asie, la valeur des marchandises
exportées a été multipliée par quatre sur cette période, tandis que vue d’Europe, des États-Unis et d’Afrique, elle n’a
crû que de 50 % dans l’intervalle. Ainsi, hormis l’Asie du Sud-Est, cette progression se situe en réalité dans la lignée
de la croissance du commerce extérieur observée depuis 1950. Il y a eu donc surtout continuité plutôt qu’explosion
du commerce extérieur.
Doublement du commerce extérieur en valeur, mais augmentation
très modérée du taux d’importation
Les États ont en réalité toujours continué à échanger essentiellement les richesses à l’intérieur de leurs
frontières ou d’une même zone régionale. Le taux de pénétration des économies (part des importations) a certes
augmenté partout, mais pas du tout dans les proportions qu’on imagine. Pour information, un pays qui importe peu a
un taux d’importation inférieur à 20 %, comme les États-Unis et la Chine, et un pays qui importe beaucoup, 50 %, ce
qui est le cas des petits pays d’Europe comme le Benelux ou l’Autriche. Or entre 1980 et 2019, aucun pays n’a
changé de catégorie, même si tous ont vu la part de leurs importations augmenter. Ainsi, en France, les importations
8
sont passées de 25 % en 1980 à 32,8 % du PIB en 2019 , ce qui est peu. À l’échelle européenne, les importations de
9
l’UE vis-à-vis du reste du monde sont passées de 15 à 20,3 % , ce qui est finalement peu, d’autant qu’elles résultent
essentiellement des importations de l’Allemagne. Aux États-Unis, les importations sont passées, entre 1980 et 2019,
de 10 à 14,6 % du PIB, ce qui est encore plus faible. Quant à la Chine, soi-disant hypermondialisée, elle n’importait
10
que 17,3 % de son PIB en 2019 . Certes, nous avons déjà vu plus haut que Pékin utilise la mondialisation
marchande comme un vecteur d’accroissement et de projection de puissance, son objectif étant de remplacer les
entreprises occidentales par des sociétés chinoises et de préparer l’éviction des États-Unis de la mer de Chine, de
Taiwan, et du leadership mondial. La Chine a donc une lecture de la mondialisation totalement opposée à celle,
« mondialiste », de l’Occident, et c’est dans ce contexte que les firmes digitales et multinationales chinoises BATX
ont bloqué en Chine les Gafam américains. Ceci dit, après la crise sanitaire, la Chine devrait voir la part de ses
importations diminuer de façon significative, notamment celles en provenance d’Europe, et donc se démondialiser.
Par ailleurs, on assiste en Europe à des relocalisations permises par la robotisation, tandis que la Covid a permis de
réfléchir sur les secteurs stratégiques. Toutefois, répondent les adeptes de la mondialisation marchande, l’Europe
présente aujourd’hui un taux d’importation vis-à-vis de la Chine bien trop important pour permettre à ses industriels
de s’en passer à court terme. Il est vrai que les mesures préconisées par Arnaud Montebourg, François Lenglet ou
Jacques Sapir, fondées sur le protectionnisme raisonnable et la réindustrialisation, ne peuvent pas produire des effets
immédiats. On peut, certes, répondre que, si elles ne sont pas adoptées par les responsables politiques et
économiques des pays de l’UE, ce n’est pas en raison de leur impossibilité mais parce que ces élites occidentales,
surtout européennes, sont inhibées par un mondialisme de principe et sont pieds et poings liés aux États-Unis, aux
institutions à prétention supranationale, et aux multinationales qui n’y ont aucun intérêt. Or ceci n’est pas immuable.
Par ailleurs, la globalisation est loin de se résumer aux échanges commerciaux et on peut même imaginer une
postglobalisation avec bien moins d’échanges commerciaux transcontinentaux et constituée essentiellement de
mouvements de capitaux, de personnes, de flux d’informations, de relocalisation et régionalisation des échanges.
Des échanges de services demeurés localisés
On distingue souvent les échanges de services des échanges commerciaux. En pratique, la catégorie des
services est un fourre-tout, dans lequel on intègre aussi bien les prestataires de services financiers et de services
d’information que les distributeurs de produits commerciaux. Or les distributeurs de produits commerciaux ne sont
que le bras commercial d’échanges de produits, tels les magasins et les restaurants. Même avec Amazon et le
11
commerce en ligne, il n’y a rien de plus local que les services de distribution . Et dans l’avenir, de plus en plus de
firmes modestes on-line vont agir comme Uber et les Gafam, mais à un niveau plus local, plus territorialisé, et plus
contrôlable par les États. On peut mentionner les exemples d’applications locales concurrentes d’Uber dans des pays
européens, comme Free Now, présente dans 100 villes en Europe ; Taxi EU, qui dessert 160 villes européennes,
surtout allemandes ; Gett, actif dans 100 villes d’Europe occidentale et orientale ; G7, 100 % française, qui dessert
Paris, d’autres métropoles françaises et 120 villes européennes ; LeCab, utilisable à Paris et environs ; Cabify,
application espagnole de taxi desservant Barcelone, Alicante, Madrid, Valence, notamment. Maints exemples
existent dans d’autres secteurs : l’appli de coiffure à domicile française Popmyday, le réseau immobilier Idealista
(Espagne, Italie), ou encore, dans le domaine de l’alimentation, OptiMiam, l’application française antigaspillage qui
met en relation restaurateurs et consommateurs.
Le retour du bilatéralisme, reflux des investisseurs internationaux
et reréglementation financière
À l’échelle planétaire, et si l’on sort de l’occidentalo-centrisme déformant, véritable biais cognitif, on constate
que les échanges commerciaux ne se réalisent plus dans un contexte multilatéral sous le regard du tribunal de
l’OMC, mais essentiellement dans le cadre d’accords bilatéraux entre États souverains, souvent méfiants vis-à-vis
des accords internationaux contraignants. Ainsi, le projet de traité commercial transatlantique avait été une première
12
tentative de bilatéralisme entre l’Europe et les États-Unis . Le but n’était pas de baisser les droits de douane –
désormais quasi inexistants – mais de diminuer les obstacles normatifs aux échanges. L’échec de ce traité a été
contourné avec l’accord Canada-Europe qui permet aux États-Unis – eux-mêmes liés au Canada au travers de
l’Alena – de mettre un pied en Europe. C’est donc plus ici du bilatéral que du multilatéral, une logique de blocs bien
o
plus qu’une logique universelle à la Fukuyama (voir cartes n 2, 3 et 4). Bref, des échanges économiques entre
nations souveraines et blocs géocivilisationnels et des accords régionalisés entre États souverains jaloux de leurs
intérêts. Plusieurs exemples montrent que les logiques nationales priment et que seuls les dindons de la farce
prennent encore les accords internationaux de libre-échange pour des textes sacrés que personne n’oserait
contourner ou trahir : si l’accord sur le Brexit de décembre 2020 a donné l’idée aux États-Unis de l’ex-président
Trump de conclure un accord bilatéral avec le Royaume-Uni afin de poursuivre leur implantation en Europe, celui
entre l’Union européenne et la Chine sur les investissements, adopté lui aussi en décembre 2020, a essentiellement
permis à la Chine de contourner d’importants obstacles normatifs au commerce et aux investissements en Europe, à
son seul avantage… Le passage du multilatéralisme de l’OMC au bilatéralisme avec les États-Unis, le Canada, le
Royaume-Uni ou la Chine ne signifie pas nécessairement que l’Europe gagnera à ce changement de régime, mais
cela démontre par la négative que Lenglet, Montebourg et Sapir, et avec eux ceux que l’on classe dans la catégorie
de souverainistes, n’ont pas tort de dire qu’un patriotisme économique pourrait mieux préserver la santé des
e
économies européennes. Tout se passe donc comme si l’Europe du
XXI
, tiraillée par des intérêts nationaux
e
différents, subissait le même sort que la Chine au XIX avec les traités inégaux. À l’inverse, les États-Unis de Donald
Trump se sont lancés dans un conflit commercial avec la Chine que Joe Biden n’a pas l’air de contredire dans les
faits, intérêt national oblige… Il est vrai que l’économie américaine a un taux d’importation moins élevé que
l’Europe. L’administration Biden ne peut que poursuivre cette politique, car les États-Unis sont une vraie puissance
souveraine, et Joe Biden ne semble pas se laisser dicter sa conduite économique par les groupes de pression
californiens de la Silicon Valley ou les Gafam, récemment recadrés et visés par des politiques de réajustement de
taxes à la hausse.
L’intensification des mouvements de capitaux a été le phénomène le plus marquant de la mondialisation,
résultat de politiques publiques des années 1980. Cette mondialisation financière, accompagnée d’une extrême
financiarisation de l’économie et de dérégulations, a donné lieu à des phénomènes incontrôlables comme les
subprimes, à l’origine de la crise financière de 2008, fruit de l’irresponsabilité des gouvernements, des banques et
des agences de notation. Derrière l’internationalisation de la dette publique, on trouvait alors une volonté délibérée
des États d’élargir le nombre de leurs créanciers et d’attirer des capitaux étrangers, ceci dans le cadre d’un vaste
mouvement de dérégulation de la finance internationale, de privatisation de facto des banques centrales et des dettes
qui ont rendu les États tributaires d’intérêts financiers privés au détriment de leur souveraineté. Ce processus a
connu un ralentissement en 2008. Depuis lors, tirant les leçons de la crise financière, les États et leurs banques
centrales se sont appliqués à défaire les mesures de dérégulation qu’ils avaient encouragées entre 1985 et 2008. Ce
mouvement de reprise en main et de rerégulation de la finance mondiale par les États a été également porté par les
mécontentements des peuples scandalisés par le fait que les mêmes dirigeants qui leur ont imposé une austérité
insoutenable ont sauvé des banques qui avaient précipité la crise des subprimes.
Jusqu’à 2008, les géants américains des agences de notation de crédit ont fait la pluie et le beau temps, dans un
contexte de dérégulation et de soumission des États aux agences et institutions de crédit privées, phénomène
aujourd’hui critiqué et remis en cause. Connues pour avoir contribué à cautionner des endettements massifs d’États
insolvables et coupables d’avoir falsifié leurs comptes publics, comme la Grèce, on peut citer principalement les
trois grandes agences de notation Fitch Ratings, Moody’s et Standard & Poor’s (S&P), qui ont un véritable
13
monopole dans la notation des États en matière d’endettement . Ces agences détiennent à elles seules 90 % des
parts de marché en Europe, selon l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). La dépendance est
unanimement considérée problématique, car les notes qu’elles attribuent aux titres des dettes déterminent leurs
achats sur les marchés par la Banque centrale européenne. Or ces agences, fort liées aux pouvoirs et aux intérêts
anglo-saxons, ont maintes fois brillé par leur manque de déontologie, notamment lors de la crise de 2008 qu’elles
ont contribué à faire éclater, puisqu’elles ont accordé des notations favorables aux fonds de titrisation (subprimes),
ces créances douteuses qui ont affaibli les banques et fait trébucher l’économie financière mondiale. Derrière les
« Big Three », trente petites agences de notation spécialisées européennes existent, mais elles ne comptent que pour
très peu et les Européens peinent à rééquilibrer cette situation léonine qui rend l’Europe vulnérable aux intérêts
américains et de la mondialisation anglo-saxonne. Malgré tout, le fait que l’UE et d’autres États aient décidé de
réglementer ces agences de notation est une tendance lourde depuis 2010, date à laquelle une nouvelle
réglementation a été adoptée à l’échelle européenne, l’AEMF s’occupant de la surveillance des agences opérant en
Europe. Celles-ci doivent désormais rendre leurs modèles et analyses publics et les obligations imposées sont
désormais juridiquement plus contraignantes. De plus, un investisseur ne peut plus détenir plus de 5 % du capital de
deux agences de notation différentes, et une agence ne peut plus noter une entité dont elle possède plus de 10 % du
capital. Dans l’avenir, les États n’auront pas d’autres alternatives que de renforcer cette tendance et les Big Three
anglo-saxonnes finiront tôt ou tard par voir leur règne disparaître.
La déréglementation financière, remise en cause depuis 2018, avait consisté en une série de textes adoptés dans
les années 1980 tendant à assimiler le monde des marchés (les titres échangés en Bourse) et le monde du crédit (la
monnaie prêtée) qui étaient jusque-là séparés. Elle avait eu pour effet de rendre les titres presque aussi fongibles que
la monnaie, grâce à leur dématérialisation (plus de titres papier) et leur valorisation permanente (principe de la fair
value). Initiée au début dans un cadre national, elle s’était propagée grâce à la levée du contrôle des changes, la
suppression des restrictions à la création d’entreprises par des étrangers (investissements directs) et à l’entrée
d’étrangers dans le capital de sociétés existantes (investissements indirects), puis par l’autorisation, en 1985, des
banques à effectuer des opérations de marché (appelé en France et en Grande-Bretagne le « big bang »). Les
investissements indirects s’étaient multipliés avec l’essor des Bourses dans les années 1980. En France, la veille de
la crise de 2008, la part des actionnaires étrangers frôlait les 50 % des entreprises du CAC 40, en partie issue de
privatisations, et elle est tombée ensuite à 35 % après la crise. Ce ne sont toutefois pas les privatisations qui sont à
l’origine de la prise de contrôle de nos entreprises par des étrangers, mais une déconnexion des marchés financiers
de la sphère réelle. Ainsi, l’attrait des investisseurs internationaux pour les produits financiers des autres pays résulte
du développement de « clones » de titres au travers de la pratique des produits dits « dérivés », de la « titrisation » et
14
de la « collatéralisation », trois pratiques qui permettent aux investisseurs internationaux de mettre un pied sur un
marché étranger tout en pouvant le fuir rapidement en cas de crise et qui mêlent étroitement banques et marchés,
dans ce que l’on appelle officiellement depuis la crise de 2008 la « finance de l’ombre » (shadow banking). Ces trois
pratiques sont aujourd’hui remises en question et bien plus encadrées par les États que jadis, voire parfois prohibées.
Reréglementation financière, effets du Brexit et renationalisations
tous azimuts
La tendance à la démondialisation a en fait commencé dès la crise de 2008 avec une vague de réglementation
aux États-Unis (Dodd-Frank Act de 2012, grande loi financière d’Obama qui régulait la finance et fit réduire d’un
tiers les dérivés dans le monde), puis en Europe, avec le paquet réglementaire de Michel Barnier qui a entraîné une
décrue sensible, dès 2014, du volume des dérivés. La crise des subprimes a terni l’image de la titrisation qui a
également décru. Quant à la collatéralisation, elle a perdu beaucoup de sens depuis que les banques centrales
15
acceptent comme « collatéraux » des titres privés moins cotés que les titres publics. Un début de séparation des
banques de détail et des banques d’affaires (Volcker Rule aux EU, rapport Vickers au Royaume-Uni, lois de
séparation des activités de marché françaises et allemandes) a ainsi été mis en place afin de réduire la contagion des
activités de marché vers les activités de crédit. Cette séparation efface en partie les effets du big bang de 1985 et
abîme la gradation continue des taux entre les crédits bancaires et les financements de marché sur laquelle se fondait
l’efficacité des politiques monétaristes depuis les années 1980 jusqu’à la crise de 2008.
Le Brexit a quant à lui scellé la perte d’influence de la City sur la réglementation financière européenne. En
réalité, cette perte d’influence avait commencé dès 2010 avec l’arrivée de Michel Barnier au poste de commissaire
au marché intérieur en remplacement du très libéral Charlie McCreevy. Une législation européenne très favorable
aux contrôles a été alors mise en place sous son mandat. Paradoxalement, les Anglais se sont mis à jouer sur le
même terrain et, à la suite du rapport Vickers, ont séparé notamment beaucoup plus fortement que la France et
l’Allemagne les activités bancaires pour les particuliers et les PME des activités de marché. C’est comme si la
suppression de la mise en concurrence de Londres, Paris et Francfort avait eu pour effet de favoriser la
reréglementation dans chacun de ces pays. Le désintérêt pour la City s’est exprimé notamment dans les positions en
faveur d’un hard Brexit de Boris Johnson. L’accord final négocié en décembre 2020, s’il maintient l’Angleterre dans
l’Union douanière, empêche toutefois la City d’offrir ses services sur le continent. Certes, cela n’empêchera pas les
capitaux du continent de traverser la Manche pour bénéficier de services financiers sur mesure, mais même sur ce
terrain, on pourrait s’attendre à un retour du contrôle des changes.
Sur le plan des rachats d’entreprises, la démondialisation s’exprime également par des décisions visant à
protéger un marché domestique vis-à-vis de tentatives de prise de contrôle par des puissances étrangères. En France,
par exemple, le rachat par le groupe canadien Couche-Tard de Carrefour, premier employeur français, a été
empêché au motif de la défense de l’intérêt national. De la même manière, celui du fleuron français de la vision
nocturne, Photonis, fournisseur de l’armée française, par l’américain Teledyne, a été interdit par Bercy. Les
récurrents veto de l’État français sur des rachats de sociétés françaises par l’étranger ont été favorisés notamment par
le décret de 2014, à l’initiative d’Arnaud Montebourg, qui soumet les achats de grandes entreprises françaises liées
aux secteurs stratégiques (transports, aérospatial, high-tech, etc.) à l’autorisation de Bercy. Sur le plan européen, des
voix politiques de plus en plus fortes réclament un « Buy European Act » sur le modèle du Buy American Act des
États-Unis pour réserver aux entreprises européennes une part substantielle des marchés publics, systématiquement
ouverts aux entreprises d’États étrangers parfois hostiles et souvent concurrents.
Monétisation et nationalisation de la dette publique
Un autre effet du quantitative easing des banques centrales a été de réduire l’internationalisation de la dette
publique. En effet, dans le cadre des politiques monétaires, les banques centrales reçoivent traditionnellement des
titres de dette publique en échange des injections de liquidité, ce que l’on appelle la collatéralisation. Or
l’augmentation considérable de ces injections des banques centrales les a amenés à récupérer d’énormes quantités de
dette publique. Aux États-Unis, la Fed a ainsi souscrit, en 2020, 65 % des nouvelles émissions de dette publique et
ceci s’est poursuivi en 2021. Ce phénomène s’observe même au sein de la zone euro, où la BCE demande à la
Banque de France de recevoir en collatéral les bons du Trésor et les OAT français, et à la Bundesbank de prendre
exclusivement du Bund allemand. En zone euro, l’année 2021 devrait voir franchir le taux de 50 % de la dette
publique détenue par leurs banques centrales respectives. Cette situation engendre de nombreux débats sur
l’opportunité ou non d’annuler cette part de dette publique qui est en quelque sorte autodétenue. Il est probable que
cette annulation se fera, sous des formes plus ou moins masquées. Par exemple, même sans éteindre la dette
publique, il suffit de présenter dans les comptes nationaux les banques centrales dans la rubrique « administration
publique » pour que la dette détenue par elles disparaisse des statistiques. Bien entendu, ce genre d’entourloupe
risque d’entraîner l’illusion d’un refinancement indéfini de l’État à partir de la planche à billets et donc – à terme –
de l’inflation, avec également des risques de variation de changes forts, ce qui va détourner les investisseurs
étrangers à la recherche de placements sûrs. Cela signifie-t-il que souverainistes et marxistes étatistes et antiaustérité
ont raison de dire que l’on pourra ne pas payer les dettes ? Oui ! répondent certains économistes. Mais à condition
de dire clairement que ce sera la seule et dernière fois pour les cinquante ans à venir, afin de ne pas relancer les
anticipations d’inflation, et tous en même temps : UE, États-Unis, Suisse, Royaume-Uni, Japon, afin de ne pas
entraîner de fuites de capitaux.
Flottement des changes et retour au contrôle des changes
La suppression du contrôle des changes dans les années 1980 a été un puissant facteur de mondialisation.
Depuis quelques années, le retour du contrôle des changes résulte en premier lieu de la lutte contre le blanchiment et
le terrorisme harmonisée au niveau mondial par le Gafi à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il se double
d’une coopération fiscale renforcée, mise en place de manière multilatérale entre les États européens et surtout de
16
manière unilatérale, voire particulièrement intrusive, par les États-Unis avec la loi Fatca .
Par ailleurs, depuis décembre 2020, le Congrès américain a adopté une loi imposant aux propriétaires de
sociétés-écrans de divulguer leur nom au fisc. Ces sociétés-écrans, basées aussi bien au Delaware que dans les
Caraïbes, sont les coffres-forts des investisseurs en private equity. Ce contrôle des différentes formes de blanchiment
et d’évasion fiscale freine les investissements étrangers privés. Seuls les investissements à l’étranger passant via des
entités « régulées » comme les banques ou les grands fonds d’investissement (ces derniers sont encore peu régulés,
mais devraient l’être prochainement dans le cadre de la lutte contre le shadow banking) pourront continuer, et à
condition de ne plus permettre d’évasion fiscale.
La suppression de la convertibilité des dollars en or en 1972 avait entraîné à partir de 1976 une brève période de
flottement qui a été stoppée en 1986 par les accords du Plaza. À compter de cette date, un système de change plus ou
moins fixe a été mis en place avec la constitution de zones de change fixe (rattachement des monnaies émergentes
au dollar) ou à monnaie unique (création de l’euro). Cela avait, malgré les nombreuses crises de change, donné
confiance aux investisseurs étrangers qui ne craignaient plus de voir leurs investissements se déprécier à la suite
d’un effondrement du cours de la monnaie du pays dans lequel ils avaient investi. Cependant, ce système de change
fixe a eu un coût social très élevé, notamment dans les pays émergents (crise argentine de 2001). La crise de 2009 a
définitivement découragé les pays émergents à se raccrocher à une zone monétaire forte. La Chine a toujours refusé
d’arrimer sa monnaie à une autre, ce qui lui a permis de pratiquer une sous-évaluation systématique de sa monnaie et
donc de vendre ses produits moins cher. Les pays d’Europe de l’Est continuent pour le moment d’indexer leur
monnaie sur l’euro car, en échange, ils bénéficient des délocalisations des groupes allemands et français. Mais cette
délocalisation commence à refluer et les tensions peuvent remettre en cause le lien de change fixe (currency peg)
avec l’euro. En 2020, les États francophones d’Afrique centrale et occidentale ont décidé d’abandonner le couplage
du franc CFA à l’euro et ont créé une nouvelle monnaie commune, l’eco, qui sera à terme gérée en change flottant
tant par rapport à l’euro que par rapport au dollar. La généralisation de change flottant implique une augmentation
du risque de change pour les investisseurs étrangers qui retirent leurs billes, mais en même temps, une plus grande
autonomie pour l’industrie locale qui peut se développer à moindres frais. Ceci participe également du processus de
démondialisation car les investisseurs étrangers ont horreur du change flottant qui présente le risque de déprécier
leurs actifs.
L’arrêt durable des voyages d’affaires et du tourisme de masse
Les voyages d’affaires et le tourisme de masse ont été stoppés net par les différents confinements. Dans les
aéroports français, la fréquentation est tombée à 5 % pendant les périodes de restriction et n’est remontée qu’à 19 %
pendant les périodes de déconfinement. Le recours aux téléconférences a offert aux grandes entreprises le prétexte
idéal pour réduire drastiquement les frais de représentation (environ 30 % de la masse salariale des cadres). La
nécessité d’adapter les aéronefs aux normes sanitaires va renchérir au moins pour plusieurs années le coût des
voyages aériens. Dès mai 2020, Boeing a démantelé une grande partie de ses avions en construction et installé leurs
carcasses en Arizona en attendant l’édification de nouveaux types d’avions garantissant la non-contamination. Quant
à Airbus, il n’a pu tenir que grâce à ses commandes passées. Combiné avec les restrictions aux frontières (certificats
de vaccination), il pourrait en résulter une diminution de long terme du tourisme transfrontalier ou tout au moins du
tourisme nécessitant un transport aérien, lequel redeviendrait, comme dans les années 1970, le privilège des classes
aisées et ne serait plus accessible aux classes moyennes tant d’Occident que d’Orient. La démondialisation est ici
également pleinement en œuvre.
1. 1723-1790, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre 2, 1776.
2. Francisco Vergara, Les Fondements philosophiques du libéralisme, La Découverte, 14 février 2002.
3. Arnaud Montebourg, Votez pour la démondialisation, préface d’Emmanuel Todd, 2011.
4. François Lenglet, La Fin de la mondialisation, Paris, Fayard, 2013.
5. Paris, Seuil, 2012.
6. Oxford University Press, 2018, p. 652-665.
7. La première mondialisation remonte aux routes de la soie et à l’empire de Gengis Khan (1165-1227) puis à ses successeurs mongols au
e
XIII
siècle. Elle s’est intensifiée avec les découvertes du Portugal et son projet d’expansion globale. La deuxième vague a commencé avec la mise
en service du canal de Suez en 1869, point stratégique d’ouverture d’une nouvelle route vers les Indes. Ceci a coïncidé avec l’âge d’or de
l’impérialisme européen fondé sur l’exploitation et le commerce des ressources naturelles. La troisième vague a été favorisée par l’abandon de
l’étalon or par Nixon en 1971, la chute de l’ex-URSS et l’ouverture de la Chine et des pays d’Europe orientale au commerce mondial et au
capitalisme.
8. Insee, comptes nationaux 2020.
9. Parlement européen : PIB de 14 000 milliards d’euros et 2 842 milliards d’importations de biens et services.
10. Banque mondiale, voir https://donnees.banquemondiale.org.
11. Amazon et Uber sont globalisées, mais la logistique est assurée de manière locale par des entrepôts et des VPC locaux.
12. Contourné par le traité avec le Canada et sans doute via le RU grâce à l’accord sur le Brexit.
13. Les dettes publiques des États développés sont cotées par les agences de notation entre AAA (Allemagne) et BBB – (Grèce). Les particuliers
ont une espérance de vie de 80 ans et leur dette est moins bien cotée (par les banques prêteuses), entre simple A et B+, rarement C (en cas de
surendettement) et jamais D. Les dettes des entreprises sont cotées A+ C, ou D.
14. Un dérivé consiste à créer un actif qui représente le droit d’en acheter un autre (« sous-jacent »). La titrisation consiste à créer un actif
regroupant plusieurs sous-jacents. La collatéralisation (« rehypothécation ») vise à remettre temporairement en garantie un actif à un tiers qui le
remettra à un autre tout en l’inscrivant à son actif.
15. Les collatéraux sont des titres d’État donnés aux banques entre elles ou à la banque centrale pour obtenir de l’argent.
16. La loi Fatca, adoptée en 2010 sous l’administration Obama, obligera certains expatriés américains à abandonner leur nationalité américaine afin
de ne pas subir des peines de prison ou d’amendes disproportionnées.
Conclusion
Gouverner c’est prévoir, le désordre actuel était prévisible…
Le 31 juillet 2019, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de terre (Cemat), déclarait : « Il
faut être prêt à s’engager pour un conflit de survie […]. Le rapport de force redevient le mode de règlement des
différends entre nations […], nous devons résolument nous y préparer en gardant à l’esprit que le combat de haute
intensité devient une option très probable… » Rien de très rassurant… Mais un homme – ou une nation – averti en
vaut deux, d’autant que notre général précise à juste titre que « préparer la guerre ne peut souffrir aucune
approximation »… Les guerres peuvent être, certes, évitées. Cependant, on a plus de chance d’y parvenir en s’y
préparant – si vis pacem, para bellum – qu’en assénant des lieux communs pacifistes et multiculturalistes assortis de
« nous sommes tous des citoyens du monde » ou « les frontières sont meurtrières », ce qui est d’ailleurs souvent tout
le contraire car les prédateurs géopolitiques (impérialistes, totalitaires nazis ou communistes, islamistes, etc.) se
nourrissent de leur absence ou de leur porosité… Cette nécessité de la préparation a été rappelée de façon tragique
par la crise sanitaire, que certains ont assimilée à une guerre. Nous l’avons vu tout au cours de cet ouvrage : si la
politique consiste à préserver le bien commun, donc la communauté nationale, la pérennité de la nation, de ses
valeurs, de son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens (les trois grandes composantes de toute entité
géopolitique : territoires, population et valeurs fondamentales défendues par les institutions gouvernementales),
alors la politique, comme la géopolitique, ne consiste pas seulement à gérer, comme on l’entend trop souvent
(« gestion de la Cité »). Cette vision réduite, dépolitisée et, en fin de compte, bureaucratique de la politique, est loin
d’être complète. Car la Politique avec un grand P consiste avant tout à prévoir, à anticiper les risques et menaces, et
donc à concevoir des stratégies de long terme pour défendre la cité au sens de patrie ou de nation, et pas seulement
au sens de vie politicienne ou de géographie électoraliste. Nous avons vu plus haut que dans ce domaine, les
démocraties occidentales, paralysées par le court-termisme de leur vie politique très polarisée – de plus en plus
soumise à la tyrannie des médias et réseaux sociaux sans contre-pouvoirs puis des lobbys ou institutions
extraterritoriales –, ont le plus grand mal à défendre les intérêts de leurs citoyens. Les crises économique et
financière de 2007-2008, sanitaire et économique de 2020-2021, comme les risques migratoires, les nouvelles
menaces terroristes, séparatistes, fondamentalistes islamistes, sans oublier les risques environnementaux, « cyber »
et autres, ont démontré depuis des années que lorsque des dirigeants ne jugent pas primordial de prévoir, c’est
l’ensemble de la communauté qui finit par subir.
Le même manque de prévision et d’éthique de responsabilité, pour paraphraser Max Weber, a été confirmé ces
dernières décennies au niveau des institutions internationales elles-mêmes, trop souvent pavées de toutes les vertus
aux yeux des multilatéralistes qui oublient qu’elles ne sont que le fruit et l’expression de la volonté « originaire »
des États souverains. Ces institutions (ONU, FMI, OMS, etc.) sont instrumentalisées tantôt par les puissances
souverainistes les plus proactives et les plus soucieuses de leurs intérêts nationaux, tantôt par des intérêts
économiques privés et des puissances transnationalistes. Le projet de gouvernance mondiale, utopie dangereuse
portée par les États-Unis, l’Union européenne et les adeptes du Village mondial, ne peut qu’accentuer la nouvelle
ligne de fracture qui oppose multipolaristes et occidentalistes. Les institutions multilatéralistes ne sont pas inutiles si
elles demeurent des instances de dialogue, mais elles ne remplaceront jamais les pouvoirs nationaux qui représentent
les volontés et les identités des peuples souverains et qui sont la source même de leur pouvoir aucunement
inamovible. Car aucun État n’est obligé de demeurer membre ad vitam aeternam d’une institution internationale,
surtout si celle-ci est pilotée par des élites qui ambitionnent de réduire la souveraineté pourtant première d’un État.
Même la question de l’énergie et de l’environnement en est une illustration, comme nous l’avons vu plus haut : si la
Chine est devenue le leader mondial des énergies renouvelables et a mis en œuvre une stratégie de décarbonation et
d’économie verte pour 2060, ce n’est pas sous pression des organisations internationales, dont elle bafoue le plus
souvent ou détourne les dispositions et règles, mais par intérêt national afin d’atteindre l’autosuffisance énergétique,
de ne pas succomber à la pollution de masse et de dominer l’économie mondiale de demain dont la décarbonation
sera une source de croissance et d’innovations nouvelles majeures.
Les dirigeants des États occidentaux n’ont pas su s’adapter à la nouvelle réalité du monde polycentrique. Ils
n’ont pas anticipé la crise sanitaire alors que des rapports des services secrets français, de la CIA ou des fondations
comme celle de Bill Gates avaient tiré la sonnette d’alarme depuis le milieu des années 2000. Et concernant
l’islamisme radical, qui gangrène les sociétés occidentales ouvertes à tous les vents, ou l’immigration de masse hors
contrôle, avec ses conséquences en termes de chocs culturels, de sécurité et de difficulté d’intégration, ces dirigeants
prisonniers de leur utopie multiculturaliste et de leur court-termisme politique n’ont rien su ou voulu prévoir non
plus, faute d’éthique de responsabilité et de dévotion au bien commun national.
1
Sur le plan géopolitique mondial , le même esprit de non-responsabilité et de court-termisme a contribué au
désordre mondial actuel qui participe de plus en plus d’une anarchie internationale : les zones de conflit ne cessent
de s’élargir, avec des arcs de crises de milliers de kilomètres, de l’Afghanistan à l’Éthiopie, du Mali à la Libye, de la
Syrie à l’Ukraine, peut-être bientôt à l’Estonie (tensions accrues entre l’Otan et la Russie, voir chapitre III), de la
Corée du Nord aux îles Senkaku-Diaoyu et Paracels (Chine-Japon-États-Unis et pays d’Asie du Sud-Est alliés, voir
chapitres II et XI), de la République centre africaine à la Turquie, sans oublier, bien sûr, l’hyperterrorisme, fruit d’un
islamisme radical longtemps encouragé par les pays occidentaux pour lutter contre l’URSS sous la guerre froide et
ensuite pour endiguer la Russie et ses alliés dans les Balkans et dans le monde arabe. Les Occidentaux demeurent
d’ailleurs plus que jamais les obligés des mêmes puissances islamistes économiquement alliées (Turquie, pays du
Golfe, Pakistan, etc.) mais civilisationnellement ennemies…
La crainte d’une escalade conduisant à un conflit généralisé est de ce fait désormais plausible. Heureusement,
« le pire n’est jamais certain », et des contre-feux existent, mais l’homme et les nations agissent-ils toujours de façon
rationnelle ? En dépit des indispensables précautions que tout géopolitologue doit prendre pour tenter de se projeter
dans l’avenir, trois constats nous semblent donc peu discutables :
le monde occidental lato sensu et l’Europe en particulier nous semblent promis, à court et moyen terme, à
un indéniable déclin ;
du fait de la gigantesque course technologique qui constitue un élément incontournable de la toile de fond
du nouveau désordre international, les fondements séculaires de la géopolitique, de la géoéconomie et de
la géostratégie mondiales sont aujourd’hui profondément perturbés ;
mais le dieu Janus, en revanche, face aux grands défis décrits dans cet ouvrage et auxquels est confronté le
monde contemporain, est plus que jamais présent. En d’autres termes, l’avenir à moyen terme de la
planète semble s’orienter, pour de nombreux exégètes, soit vers une exacerbation des tensions qui pourrait
aboutir à un troisième conflit mondial, soit, hypothèse certes plus séduisante évoquée par les disciples
d’Emmanuel Kant, emprunter, sous l’égide des organisations internationales, les voies de la paix
universelle.
La première option, inhérente à la spécificité de l’arme nucléaire et au processus de prolifération, ne pourrait
aboutir qu’à l’Apocalypse. L’autre, eu égard aux piètres résultats obtenus par les organisations internationales en
général et l’ONU en particulier, nous paraît baigner au cœur de l’utopie. Alors, une troisième voie ? On peut aussi
parier en changeant d’échelle, sur la réapparition au premier rang des relations internationales, des États-nations qui
jouent simultanément les cartes de la Realpolitik et du soft power. Ou voir se concrétiser la prophétie (naguère
e
vivement critiquée par maints de ses contemporains) d’un André Malraux qui déclarait que « le XXI siècle sera
spirituel ou ne sera pas ». À ce propos, le désenchantement du monde opéré en Europe depuis deux siècles et mué
depuis des décennies en une déspiritualisation généralisée qui a conduit, parallèlement à l’action nihiliste de
McWorld, à une anomie et donc à un vide de sens et d’identité risque de laisser la place à l’islamisme conquérant.
Cette situation ne peut à son tour que favoriser l’ascension de forces radicales nationalistes identitaires qui le
combattent. Ce vide moral ou cette anomie de l’Occident libéral-libertaire est probablement le pire des défis pour les
sociétés européennes, dont les terres et populations, assignées à la désidentarisation et moralement affaiblies par
McWorld, sont plus que jamais convoitées par les Empires turco-islamistes, chinois et américains. En fin de compte,
le plus dangereux ennemi de l’Europe ne sont pas les prédateurs extérieurs chinois ou islamistes, les
narcopuissances, ou l’Empire étatsunien, mais sa « volonté d’impuissance ». L’Europe, « homme malade du
monde », civilisation fatiguée, lasse, complexée et désabusée, préfère-t-elle risquer de disparaître de l’Histoire plutôt
que de continuer à se battre pour survivre ? Le Vieux Continent sortira-t-il de sa léthargie et conjurera-t-il le déclin
prophétisé par Spengler ? Tout dépendra de la décision ou du refus des dirigeants européens de renouer avec une
politique de civilisation et de souveraineté. McWorld versus Europa.
o
1. Aldo Giannuli, « Elogio del disordine mondiale », Limes, n 2, 2017.
Cartes géopolitiques
1/ Le « Heartland » de Halford Mackinder et le « Rimland » de
Nicholas Spykman
o
Source : Hérodote, n 146.
e
2/ Les grands blocs géoéconomiques du XXI siècle et sous-ensembles
du « Bloc euro-occidental »
Source : Alexandre Del Valle, Guerres contre l’Europe, Paris, Les Syrtes, 2000.
3/ Les grands blocs géopolitiques, et organisations
stratégiques/géocivilisationnelles
4/ Les grandes organisations d’intégration régionale et alliances
régionales
5/ Les civilisations selon Samuel Huntington
Source : Samuel Huntington, Le Choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 1997.
6/ Tensions entre Pékin et ses voisins autour de la mer de Chine et
de ses ressources
7/ Tensions géoénergétiques entre la Turquie et ses voisins en
Méditerranée orientale
8/ Le projet califal de Daech (État islamique)
9/ Sultanat et califat turco-Ottomans
Source : Alexandre Del Valle, La Turquie dans l’Europe. Un cheval de Troie islamiste ?, Paris, Les Syrtes, 2003.
10/ Accords du 10 novembre 2020 relatifs au conflit du HautKarabagh
11/ Nations turcophones d’Asie centrale et du Caucase après la
disparition de l’ex-URSS
12/ Statut du nord de l’île de Chypre : territoire de l’UE et de la
république de Chypre occupé par la Turquie
Source : Alexandre Del Valle, Le Dilemme turc, op. cit., carte conçue par Viatcheslav Avioutskii.
13/ Rivalités géopolitiques autour des gazoducs européens et
méditerranéens
14/ L’Ukraine déchirée et la place stratégique de la mer Noire et de
la Crimée
15/ Pays les plus touchés par le virus de la COVID 19
Bibliographie des ouvrages cités
Agnew, John, Geopolitics. Re-Visioning World Politics, Londres/New York, Routledge, 2003.
Allison, Graham, Vers la guerre. L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ?, Paris, Odile Jacob, 2020.
Baker, Peter, Days of Fire. Bush and Cheney in the White House, Washington, Anchor, 2013.
Barber, Benjamin R., Djihad versus McWorld, Paris, Desclée de Brouwer, 1996.
Bazin, Xavier, Big Pharma démasqué, de la chloroquine aux vaccins, la crise du coronavirus révèle la face noire
de notre système de santé, Paris, Trédaniel, 2021.
Bello, Walden, Deglobalization. Ideas for a New World Economy, New York, Zed Books, 2002.
Bouthoul, Gaston et Carrère, René, Le Défi de la guerre. 1740-1974 : deux siècles de guerre et de révolution, Paris,
PUF, 1976.
Bouthoul, Gaston, Traité de polémologie. Sociologie des guerres, Paris, Payot, 1970.
Braillard, Philippe, Théories des relations internationales, Paris, PUF, 1977.
Brzezinski, Zbigniew, Le Grand Échiquier. L’Amérique et le reste du monde, Paris, Bayard, 1997.
Buckley, Peter J., Enderwick, Peter et Cross, Adam R., International Business, Oxford University Press, 2018.
Caillet, Romain et Puchot, Pierre, Le combat vous a été prescrit, Paris, Stock, 2017.
Chevalier, Jean-Marie Geoffron, Patrice, Les Nouveaux Défis de l’énergie, Paris, Economica, 2011.
Del Valle, Alexandre, Le Totalitarisme islamiste, Paris, Les Syrtes, 2002.
Del Valle, Alexandre, La Turquie dans l’Europe. Un cheval de Troie islamiste ?, Paris, Les Syrtes, 2003.
Del Valle, Alexandre, Le Complexe occidental. Petit traité de déculpabilisation, Paris, Toucan, 2014.
Del Valle, Alexandre, Les Vrais Ennemis de l’Occident. Du rejet de la Russie à l’islamisation des sociétés ouvertes,
Paris, L’Artilleur, 2016.
Del Valle, Alexandre, La Stratégie de l’intimidation. Du terrorisme jihadiste à l’islamiquement correct, Paris,
L’Artilleur, 2018.
Del Valle, Alexandre et Razavi, Emmanuel, Le Projet. Stratégie de conquête et d’infiltration des Frères musulmans
en France et dans le monde, Paris, L’Artilleur, 2019.
Diaz, Xavier, « Le tsunami de la dette atteint un nouveau record mondial », L’Agefi, 18 novembre 2011.
Djalili, Mohammad-Reza, Diplomatie islamique, Paris, PUF, 1989.
Éthier, Diane, Introduction aux relations internationales, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 2010.
Étienne, Bruno, L’Islamisme radical, Paris, Hachette, 1987.
Fukuyama, Francis, La Fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 2009.
Gallois, Pierre Marie, Stratégie de l’âge nucléaire, Paris, Calmann-Lévy, 1960.
Gallois, Pierre Marie, Géopolitique. Les voies de la puissance, Paris, Plon, 1990.
Gallois, Pierre Marie, Le soleil d’Allah aveugle l’Occident, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1995.
Gallois, Pierre Marie, Géopolitique. Les voies de la puissance, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1998.
Gallois, Pierre Marie, La France sort-elle de l’histoire ?, Paris, L’Âge d’Homme, 1999.
Gallois, Pierre Marie, Le Sang du pétrole. Les guerres d’Irak, 1990-2003, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2002.
Gallois, Pierre Marie, L’Heure fatale de l’Occident, Lausanne/Paris, L’Âge d’Homme, 2004.
Geoffroy, Michel, La Nouvelle Guerre des mondes, Paris, Via Romana, 2020.
o
Giannuli, Aldo, « Elogio del disordine mondiale », Limes, n 2, 2017.
Giblin, Béatrice (avec entre autres Avioutskii, Viatcheslav), Les Conflits dans le monde, Paris, Armand Colin, 2016.
Hagège, Claude, Contre la pensée unique, Paris, Odile Jacob, 2012.
Harbulot, Christian et Pichot-Duclos, Jean, La France doit dire non, Paris, Plon, 1999.
e
Hughes, Barry B., Continuity and Change in World Politics. Competing Perspectives, 3 éd., Upper Saddle River,
NJ, Prentice Hall, 1997.
Huntington, Samuel, Le Choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 1997.
Kaplan, Robert D., La Revanche de la géographie. Ce que les cartes nous disent des conflits à venir, Paris, Toucan,
2014.
Karmon, Ely et Barak, Michael, « Erdogan’s Turkey and the Palestinian Issue », Perspectives on Terrorism, vol. 12,
o
n 2, avril 2018.
Kassis, Randa et Del Valle, Alexandre, Comprendre le chaos syrien, Paris, L’Artilleur, 2016.
Kateb, Alexandre, Les Nouvelles Puissances mondiales. Pourquoi les BRIC changent le monde, Paris, Ellipses,
2011.
Kepel, Gilles, Le Prophète et Pharaon. Aux sources des mouvements islamistes, Paris, Gallimard, coll. « Folio
histoire », 2012.
König, Claire, « L’eau, futur or bleu ? La mer d’Aral et son évolution en Asie centrale », Futura-Sciences, 3 juin
2016.
Kraemer, Johann-Ewald, L’Euro. Dans les coulisses de la monnaie unique, Paris, Les Syrtes, 2001.
Kupchan, Charles, The End of the American Era. US Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-First
Century, New York, Knopf, 2002.
Lacoste, Yves, Dictionnaire de géopolitique, Paris, Flammarion, 2002.
Lacoste, Yves, Géopolitique. La longue histoire d’aujourd’hui, Paris, Larousse, 2006.
Lenglet, François, La Fin de la mondialisation, Paris, Fayard, 2013.
o
Mackinder, Halford John, « Le pivot géographique de l’Histoire », The Geographical Journal, vol. 23, n 4,
avril 1904, p. 421-437.
McLuhan, Marshall, The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man, Toronto, Canada, University of
Toronto Press, 1962.
Merry, Robert W., Sands of Empire. Missionary Zeal, American Foreign Policy, and the Hazards of Global
Ambition, New York, Simon & Schuster, 2005.
Milanovic, Branko, Inégalités mondiales. Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l’égalité des chances,
Paris, La Découverte, 2019.
Minc, Alain, La Mondialisation heureuse, Paris, Pocket, 1999.
Montebourg, Arnaud, Votez pour la démondialisation, Paris, Flammarion, 2011.
Nikonov, Viatcheslav, Comprendre la Russie, Paris, Apopsix, 2018.
Pitron, Guillaume, La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Paris,
Les Liens qui libèrent, 2018.
Pourtier, Roland, Afriques noires, Paris, Hachette, 2001.
Quatrepoint, Jean-Michel, Le Choc des empires. États-Unis, Chine, Allemagne : qui dominera l’économie-monde ?,
Paris, Gallimard, 2014.
Ross, Michael L., The Oil Curse. How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, New York,
Paperback, 2012.
Sapir, Jacques, La Démondialisation, Paris, Seuil, 2012.
Schooyans, Michel, Le Crash démographique, Paris, Le Sarment-Fayard, 1999.
Soppelsa, Jacques, Des tensions et des armes, Paris, PUF, 1984.
Soppelsa, Jacques, Lexique de géopolitique (en coll.), Paris, Dalloz, 1997.
Soppelsa, Jacques, Les Dates-clefs du dialogue régional en Amérique latine, Paris, Ellipses, 2002.
Soppelsa, Jacques, Les États-Unis. Une histoire revisitée, Paris, La Martinière-Seuil, 2004, 413 p.
Soppelsa, Jacques, Géopolitique du monde contemporain, Paris, Nathan, 2008.
Soppelsa, Jacques, Les Sept Défis capitaux du nouvel ordre mondial, Paris, A2C Médias, 2009.
Thual, François, La Crise du Haut-Karabakh. Une citadelle assiégée ?, Paris, PUF, 2002.
Touati, Marc, Un monde de bulles, Paris, Bookelis, 2018.
Vernier, Éric, Technique de blanchiment et moyens de lutte, Paris, Dunod, 2017.
Wallerstein, Immanuel, « Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the
o
World System », International Sociology, vol. 15, n 2, 2000, p. 251-267.
Yégavian, Tigrane, Les Diasporas turque et azerbaïdjanaise de France : instruments au service du panturquisme,
o
rapport n 27 du CF2R.
Zeller, Louis-Marie et Alidra, Wassim, « Terres rares : des enjeux de la transition énergétique aux enjeux
géopolitiques ? », Les Jeunes IHEDN, octobre 2019.
Ziegler, Jean, La Haine de l’Occident, Paris, Albin Michel, 2008.
Index des noms propres
Abdallah al-ash-Sheikh, Suleiman (ibn) 162
‘Abd al-Wahhāb, Muhammad (ibn) 162, 201
Aboud Rogo, Mohammed 201
Ahmadinejad, Mahmoud 213
al-Adnani, Abou Mohammed 173
al-Assad, Bachar 70, 83, 96, 109, 171-172, 197
al-Baghdadi, Abou Bakr (calife) 174
al-Banna, Hassan 158-159, 408
Allison, Graham 42, 46, 48-49, 55, 114, 497
al-Maqdissi, Abou Muhammed 192, 201
al-Masri, Abou Mohammed 177
al-Qardaoui, Youssef 196, 408
al-Qarni, Ayid 407
al-Salbi al-Mawla, Amir Mohammed Saïd 174
al-Shugairi, Ahmad 408
al-Souri, Abou Moussab 167, 191
al-Turkmani, Abou Omar 174-175
al-Zawahiri, Ayman 177
Atran, Scott 173, 201
Avioutskii, Viatcheslav 78, 493, 498
Ban Ki-Moon 198
Barber, Benjamin 18, 27, 42, 52-55, 155, 388, 497
Barnier, Michel 474
Bello, Walden 456, 497
Ben Laden, Hamza 175-176
Ben Laden, Oussama 176, 178, 188
Benyettou, Farid 162, 201
Bertrand, Badie 20, 375
Biden, Joe 53, 77-78, 80-81, 97, 215-216, 229, 243, 294-296, 300, 308, 316, 337, 389, 417-418, 421, 435-436, 438, 455-456,
464, 470
Bourguiba, Habib 146
Bouteflika, Abdelaziz 194
Bouthoul, Gaston 61, 73, 94, 341, 360-361, 364, 374, 497
Branko, Milanovic 499
Brzezinski, Zbigniew 21, 30-31, 37, 42, 46-48, 55, 81, 110-111, 117, 497
Burkhard, Thierry 1, 56, 481
Bush, George H. 41-42, 228
Bush, George W. 42, 45, 90, 102-104, 228, 235, 289
Cabirol, Michel 235
Carrère, René 61, 94, 497
Carter, Ashton 108
Carter, Jimmy 35, 227
Castro, Fidel 191
Charlie, McCreevy 474
Chávez, Hugo 406
Chevalier, Jean-Marie 497
Churchill, Winston 35, 41
Clinton, Bill 35, 42, 44
Cody, Wilson 279
de Gaulle, Charles 35, 309, 373
Del Valle, Alexandre 37, 55, 94, 112, 138, 201, 285, 337, 488, 492-493, 497-498
de Maillard, Jean 237, 285
Denécé, Éric 57, 94, 281, 285
Dicko, Mahmoud 185
Disraeli, Benjamin 56
Dunford, Joseph 107
Duroselle, Jean-Baptiste 42, 114
El Chapo (Joaquim Guzmán) 252, 254, 285
El Karoui Hakim 168
El Mencho (Nemesio Oseguera Cervantes) 255
Eltsine, Boris 67, 95, 101, 125, 228, 256
Erdoğan, Recep Tayyip 15, 24, 57, 59, 63, 70, 73, 78, 94, 158-159, 175, 197, 199-201, 269, 272, 285, 327, 332-333, 402,
404-405, 498
Étienne, Bruno 159, 498
Freeman, Morgan 337
Frezat, César 235
Friedman, Thomas 19, 26, 112, 155
Fukuyama, Francis 19, 37, 41, 43-44, 46, 48, 55, 125, 469, 498
Galacteros, Caroline 113, 126, 138
Gallois, Pierre Marie 24, 32, 36-37, 61, 91, 122, 130, 138, 202, 206-207, 226, 235, 498
Gates, Bill 423-424, 428, 452, 483
Gazzane, Hayat 285
Gengis, Khan 479
Georgieva, Kristalina 412, 419
Gomart, Thomas 420
Gorbatchev, Mikhaïl 220, 228
Grézaud, Pierre-Xavier 285
Haftar, Khalifa 83, 175
Hagège, Claude 139, 151, 498
Harpon, Mickaël 167
Haski, Pierre 285
Hassan II 373-374
Hitler, Adolf 168
Hughes, Barry 156, 161, 200-201, 498
Huntington, Samuel 21, 28, 42, 48-52, 55, 74, 87, 94, 114, 125, 356, 462, 489, 498
Hussein, Saddam 91, 201
Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) 85, 185
James, Deborah 108
Jong-un, Kim 89, 91, 205
Kadhafi, Mu’ammar 83, 91, 182
Kaplan, Robert D. 21, 37, 498
Kassis, Randa 498
Kennan, George 48, 111-112
Kennedy, Paul 41-42, 55, 114
Kerchove, Gilles (de) 163, 403
Khamenei, Ali (guide) 406
Khomeiny, Rouhollah (ayatollah) 194
Kissinger, Henry 129, 222, 375, 419
Koufa, Hamadoun 187
Kozyrev, Andrei 101
Kupchan, Charles 116, 138, 499
Lacoste, Yves 32, 37, 499
Lagarde, Christine 285
Laqueur, Walter 189-190, 201
Live Matters Blacks 115
Luttwak, Edward 116
Macron, Emmanuel 78, 97, 161, 197, 199, 405-406
Maduro, Nicolás 395-396, 406
Mahathir, bin Mohamad 402, 405
Ma, Jack 54-55, 416
Malraux, André 51, 146, 485
Mao, Zedong 191, 204
Mawdoudi, Abou Ala (al) 158-159
McFaul, Michael 103
Meng, Wanzhou 413
Merkel, Angela 197, 272, 308, 442
Merry, Robert W. 125, 138, 499
Michari, Rachid al-Alafassi 408
Monnet, Bertrand 285
Montaigne, Institut 168, 374, 407, 419
Naji, Abou Bakr 167, 170, 184, 201
Nataf, David 394
Nogueroles, Jean-Michel 360, 374
Nye, Joseph 41
Obama, Barak 42, 44-45, 53, 78, 99-100, 214, 228, 294-295, 305, 458, 474, 479
Paty, Samuel 193, 200, 405-406
Pécresse, Valérie 372
Pérez, Juan Martín 266
Pitron, Guillaume 337, 499
Pons, Noël 236
Poutine, Vladimir 16, 48, 69, 72-73, 76, 78-79, 81, 95, 97, 100-105, 107, 109, 112, 121, 228, 234, 348, 431
Qutb, Sayyid 158-159, 201
Ramadan, Hani 408
Ramadan, Tariq 408
Reagan, Ronald 55, 220
Reza Djalili, Mohammad 156-157, 201, 498
Rhoda, Weeks-Brown 239, 285
Rice, Condoleezza 105, 112, 137
Ross, Michael 93-94, 499
Salih al-‘Uthaymin, Muhammad (ibn) 162
Sanders, Bernie 453
Santo, Vincenzo 272-273
Sauvy, Alfred 341, 372
Schooyans, Michel 346, 374, 499
Sékou, Amadou Barryi 201
Senghor, Léopold Sédar 146
Sihanouk, Norodom 146
Smith, Adam 453
Soppelsa, Jacques 37, 55, 94, 235, 374, 499
Stefanini, Patrick 368, 374
Stoian, Karadeli Andreea 430
Tamim, Al Thani 406
Tedros, Adhanom Ghebreyesus 427
Touati, Marc 440, 442-443, 452, 500
Tribalat, Michèle 364, 366-367, 374
Trump, Donald 37, 42, 53, 89, 91, 97, 100, 114-115, 135, 214-216, 232, 243, 293-297, 306, 308, 316, 402, 404-405, 407,
411-413, 417-418, 426, 436, 453, 456-457, 464, 470
Vernier, Éric 236-237, 253, 264-266, 281-283, 285, 500
Wallerstein, Immanuel 500
Warren, Christopher 44
Waszczykowski, Witold 108
Weber, Max 482
Work, Robert 109
Xi Jinping 16, 48, 80, 124, 137, 297-299, 316, 425-427
Zarqaoui, Abou Moussa al- 174, 192, 201
Zelensky, Volodymyr 78, 97-98
Zhihao Zhang 452
Ziegler, Jean 130-131, 138, 500
Remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de cet
ouvrage : l’entrepreneur M. Y. Maestroni ; Patricia Mamet, membre honoraire du CESE ; les professeurs
Viatcheslav Avioutskii – géopolitologue disciple d’Yves Lacoste, spécialiste de l’espace ex-soviétique –, Éric
Vernier – directeur de l’école de commerce Iscid-Co, spécialiste des questions de blanchiment –, Drissa Kananbayé
– chercheur à l’ULB, expert du Sahel et du djihadisme –, Turab Gurbanov ; Simon Petermann ; puis Éric Dénecé,
président du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) ; Jean-Ewald Kramer, haut fonctionnaire
international ancien de la BCE ; Vincent Sinacola, ingénieur-chercheur ; Tigrane Yégavian, géopolitologue du
Caucase et contributeur de la revue Conflits ; Edoardo Secchi, économiste et président d’Italy-France Group ; et
Guglielmo Janello. Leurs conseils, apports, aides à la relecture et suggestions ont été précieux.